
LES ENFANTS RUSSES, AUX GROSSES JOUES PÂLES, DEVANT L'ISBA (page 182).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Title: Le Tour du Monde; La Russie, race colonisatrice
Author: Various
Editor: Édouard Charton
Release date: September 7, 2009 [eBook #29922]
Language: French
Credits: Produced by Carlo Traverso, Christine P. Travers and the
Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
(This file was produced from images generously made
available by the Bibliothèque nationale de France
(BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
Note au lecteur de ce fichier digital:
Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.
Ce fichier est un extrait du recueil du journal "Le Tour du monde: Journal des voyages et des voyageurs" (2ème semestre 1905).
Les articles ont été regroupés dans des fichiers correspondant aux différentes zones géographiques, ce fichier contient les articles sur la Russie.
Chaque fichier contient l'index complet du recueil dont ces articles sont originaires.
La liste des illustrations étant très longue, elle a été déplacée et placée en fin de fichier.
PARIS
IMPRIMERIE FERNAND SCHMIDT
20, rue du Dragon, 20
NOUVELLE SÉRIE—11e ANNÉE 2e SEMESTRE
Le Tour du Monde
a été fondé par Édouard Charton
en 1860
PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie
79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79
LONDRES, 18, KING WILLIAM STREET, STRAND
1905
Droits de traduction et de reproduction réservés.
L'ÉTÉ AU KACHMIR
Par Mme F. MICHEL
I. De Paris à Srinagar. — Un guide pratique. — De Bombay à Lahore. — Premiers préparatifs. — En tonga de Rawal-Pindi à Srinagar. — Les Kachmiris et les maîtres du Kachmir. — Retour à la vie nomade. 1
II. La «Vallée heureuse» en dounga. — Bateliers et batelières. — De Baramoula à Srinagar. — La capitale du Kachmir. — Un peu d'économie politique. — En amont de Srinagar. 13
III. Sous la tente. — Les petites vallées du Sud-Est. — Histoires de voleurs et contes de fées. — Les ruines de Martand. — De Brahmanes en Moullas. 25
IV. Le pèlerinage d'Amarnath. — La vallée du Lidar. — Les pèlerins de l'Inde. — Vers les cimes. — La grotte sacrée. — En dholi. — Les Goudjars, pasteurs de buffles. 37
V. Le pèlerinage de l'Haramouk. — Alpinisme funèbre et hydrothérapie religieuse. — Les temples de Vangâth. — Frissons d'automne. — Les adieux à Srinagar. 49
SOUVENIRS DE LA COTE D'IVOIRE
Par le docteur LAMY
Médecin-major des troupes coloniales.
I. Voyage dans la brousse. — En file indienne. — Motéso. — La route dans un ruisseau. — Denguéra. — Kodioso. — Villes et villages abandonnés. — Où est donc Bettié? — Arrivée à Dioubasso. 61
II. Dans le territoire de Mopé. — Coutumes du pays. — La mort d'un prince héritier. — L'épreuve du poison. — De Mopé à Bettié. — Bénie, roi de Bettié, et sa capitale. — Retour à Petit-Alépé. 73
III. Rapports et résultats de la mission. — Valeur économique de la côte d'Ivoire. — Richesse de la flore. — Supériorité de la faune. 85
IV. La fièvre jaune à Grand-Bassam. — Deuils nombreux. — Retour en France. 90
L'ÎLE D'ELBE
Par M. PAUL GRUYER
I. L'île d'Elbe et le «canal» de Piombino. — Deux mots d'histoire. — Débarquement à Porto-Ferraio. — Une ville d'opéra. — La «teste di Napoleone» et le Palais impérial. — La bannière de l'ancien roi de l'île d'Elbe. — Offre à Napoléon III, après Sedan. — La bibliothèque de l'Empereur. — Souvenir de Victor Hugo. Le premier mot du poète. — Un enterrement aux flambeaux. Cagoules noires et cagoules blanches. Dans la paix des limbes. — Les différentes routes de l'île. 97
II. Le golfe de Procchio et la montagne de Jupiter. — Soir tempétueux et morne tristesse. — L'ascension du Monte Giove. — Un village dans les nuées. — L'Ermitage de la Madone et la «Sedia di Napoleone». — Le vieux gardien de l'infini. «Bastia, Signor!». Vision sublime. — La côte orientale de l'île. Capoliveri et Porto-Longone. — La gorge de Monserrat. — Rio 1 Marina et le monde du fer. 109
III. Napoléon, roi de l'île d'Elbe. — Installation aux Mulini. — L'Empereur à la gorge de Monserrat. — San Martino Saint-Cloud. La salle des Pyramides et le plafond aux deux colombes. Le lit de Bertrand. La salle de bain et le miroir de la Vérité. — L'Empereur transporte ses pénates sur le Monte Giove. — Elbe perdue pour la France. — L'ancien Musée de San Martino. Essai de reconstitution par le propriétaire actuel. Le lit de Madame Mère. — Où il faut chercher à Elbe les vraies reliques impériales. «Apollon gardant ses troupeaux.» Éventail et bijoux de la princesse Pauline. Les clefs de Porto-Ferraio. Autographes. La robe de la signorina Squarci. — L'église de l'archiconfrérie du Très-Saint-Sacrement. La «Pieta» de l'Empereur. Les broderies de soie des Mulini. — Le vieil aveugle de Porto-Ferraio. 121
D'ALEXANDRETTE
AU COUDE DE L'EUPHRATE
Par M. VICTOR CHAPOT
membre de l'École française d'Athènes.
I. — Alexandrette et la montée de Beïlan. — Antioche et l'Oronte; excursions à Daphné et à Soueidieh. — La route d'Alep par le Kasr-el-Benat et Dana. — Premier aperçu d'Alep. 133
II. — Ma caravane. — Village d'Yazides. — Nisib. — Première rencontre avec l'Euphrate. — Biredjik. — Souvenirs des Hétéens. — Excursion à Resapha. — Comment atteindre Ras-el-Aïn? Comment le quitter? — Enfin à Orfa! 145
III. — Séjour à Orfa. — Samosate. — Vallée accidentée de l'Euphrate. — Roum-Kaleh et Aïntab. — Court repos à Alep. — Saint-Syméon et l'Alma-Dagh. — Huit jours trappiste! — Conclusion pessimiste. 157
LA FRANCE AUX NOUVELLES-HÉBRIDES
Par M. RAYMOND BEL
À qui les Nouvelles-Hébrides: France, Angleterre ou Australie? Le condominium anglo-français de 1887. — L'œuvre de M. Higginson. — Situation actuelle des îles. — L'influence anglo-australienne. — Les ressources des Nouvelles-Hébrides. — Leur avenir. 169
(p. xiv) LA RUSSIE, RACE COLONISATRICE
Par M. ALBERT THOMAS
I. — Moscou. — Une déception. — Le Kreml, acropole sacrée. — Les églises, les palais: deux époques. 182
II. — Moscou, la ville et les faubourgs. — La bourgeoisie moscovite. — Changement de paysage; Nijni-Novgorod: le Kreml et la ville. 193
III. — La foire de Nijni: marchandises et marchands. — L'œuvre du commerce. — Sur la Volga. — À bord du Sviatoslav. — Une visite à Kazan. — La «sainte mère Volga». 205
IV. — De Samara à Tomsk. — La vie du train. — Les passagers et l'équipage: les soirées. — Dans le steppe: l'effort des hommes. — Les émigrants. 217
V. — Tomsk. — La mêlée des races. — Anciens et nouveaux fonctionnaires. — L'Université de Tomsk. — Le rôle de l'État dans l'œuvre de colonisation. 229
VI. — Heures de retour. — Dans l'Oural. — La Grande-Russie. — Conclusion. 241
LUGANO, LA VILLE DES FRESQUES
Par M. GERSPACH
La petite ville de Lugano; ses charmes; son lac. — Un peu d'histoire et de géographie. — La cathédrale de Saint-Laurent. — L'église Sainte-Marie-des-Anges. — Lugano, la ville des fresques. — L'œuvre du Luini. — Procédés employés pour le transfert des fresques. 253
SHANGHAÏ, LA MÉTROPOLE CHINOISE
Par M. ÉMILE DESCHAMPS
I. — Woo-Sung. — Au débarcadère. — La Concession française. — La Cité chinoise. — Retour à notre concession. — La police municipale et la prison. — La cangue et le bambou. — Les exécutions. — Le corps de volontaires. — Émeutes. — Les conseils municipaux. 265
II. — L'établissement des jésuites de Zi-ka-oueï. — Pharmacie chinoise. — Le camp de Kou-ka-za. — La fumerie d'opium. — Le charnier des enfants trouvés. — Le fournisseur des ombres. — La concession internationale. — Jardin chinois. — Le Bund. — La pagode de Long-hoa. — Fou-tchéou-road. — Statistique. 277
L'ÉDUCATION DES NÈGRES
AUX ÉTATS-UNIS
Par M. BARGY
Le problème de la civilisation des nègres. — L'Institut Hampton, en Virginie. — La vie de Booker T. Washington. — L'école professionnelle de Tuskegee, en Alabama. — Conciliateurs et agitateurs. — Le vote des nègres et la casuistique de la Constitution. 289
À TRAVERS LA PERSE ORIENTALE
Par le Major PERCY MOLESWORTH SYKES
Consul général de S. M. Britannique au Khorassan.
I. — Arrivée à Astrabad. — Ancienne importance de la ville. — Le pays des Turkomans: à travers le steppe et les Collines Noires. — Le Khorassan. — Mechhed: sa mosquée; son commerce. — Le désert de Lout. — Sur la route de Kirman. 301
II. — La province de Kirman. — Géographie: la flore, la faune; l'administration, l'armée. — Histoire: invasions et dévastations. — La ville de Kirman, capitale de la province. — Une saison sur le plateau de Sardou. 313
III. — En Baloutchistan. — Le Makran: la côte du golfe Arabique. — Histoire et géographie du Makran. — Le Sarhad. 325
IV. — Délimitation à la frontière perso-baloutche. — De Kirman à la ville-frontière de Kouak. — La Commission de délimitation. — Question de préséance. — L'œuvre de la Commission. — De Kouak à Kélat. 337
V. — Le Seistan: son histoire. — Le delta du Helmand. — Comparaison du Seistan et de l'Égypte. — Excursions dans le Helmand. — Retour par Yezd à Kirman. 349
AUX RUINES D'ANGKOR
Par M. le Vicomte DE MIRAMON-FARGUES
De Saïgon à Pnôm-penh et à Compong-Chuang. — À la rame sur le Grand-Lac. — Les charrettes cambodgiennes. — Siem-Réap. — Le temple d'Angkor. — Angkor-Tom — Décadence de la civilisation khmer. — Rencontre du second roi du Cambodge. — Oudong-la-Superbe, capitale du père de Norodom. — Le palais de Norodom à Pnôm-penh. — Pourquoi la France ne devrait pas abandonner au Siam le territoire d'Angkor. 361
EN ROUMANIE
Par M. Th. HEBBELYNCK
I. — De Budapest à Petrozeny. — Un mot d'histoire. — La vallée du Jiul. — Les Boyards et les Tziganes. — Le marché de Targu Jiul. — Le monastère de Tismana. 373
II. — Le monastère d'Horezu. — Excursion à Bistritza. — Romnicu et le défilé de la Tour-Rouge. — De Curtea de Arges à Campolung. — Défilé de Dimboviciora. 385
III. — Bucarest, aspect de la ville. — Les mines de sel de Slanic. — Les sources de pétrole de Doftana. — Sinaïa, promenade dans la forêt. — Busteni et le domaine de la Couronne. 397
CROQUIS HOLLANDAIS
Par M. Lud. GEORGES HAMÖN
Photographies de l'auteur.
I. — Une ville hollandaise. — Middelburg. — Les nuages. — Les boerin. — La maison. — L'éclusier. — Le marché. — Le village hollandais. — Zoutelande. — Les bons aubergistes. — Une soirée locale. — Les sabots des petits enfants. — La kermesse. — La piété du Hollandais. 410
II. — Rencontre sur la route. — Le beau cavalier. — Un déjeuner décevant. — Le père Kick. 421
III. — La terre hollandaise. — L'eau. — Les moulins. — La culture. — Les polders. — Les digues. — Origine de la Hollande. — Une nuit à Veere. — Wemeldingen. — Les cinq jeunes filles. — Flirt muet. — Le pochard. — La vie sur l'eau. 423
IV. — Le pêcheur hollandais. — Volendam. — La lessive. — Les marmots. — Les canards. — La pêche au hareng. — Le fils du pêcheur. — Une île singulière: Marken. — Au milieu des eaux. — Les maisons. — Les mœurs. — Les jeunes filles. — Perspective. — La tourbe et les tourbières. — Produit national. — Les (p. xv) tourbières hautes et basses. — Houille locale. 433
ABYDOS
dans les temps anciens et dans les temps modernes
Par M. E. AMELINEAU
Légende d'Osiris. — Histoire d'Abydos à travers les dynasties, à l'époque chrétienne. — Ses monuments et leur spoliation. — Ses habitants actuels et leurs mœurs. 445
VOYAGE DU PRINCE SCIPION BORGHÈSE
AUX MONTS CÉLESTES
Par M. JULES BROCHEREL
I. — De Tachkent à Prjevalsk. — La ville de Tachkent. — En tarentass. — Tchimkent. — Aoulié-Ata. — Tokmak. — Les gorges de Bouam. — Le lac Issik-Koul. — Prjevalsk. — Un chef kirghize. 457
II. — La vallée de Tomghent. — Un aoul kirghize. — La traversée du col de Tomghent. — Chevaux alpinistes. — Une vallée déserte. — Le Kizil-tao. — Le Saridjass. — Troupeaux de chevaux. — La vallée de Kachkateur. — En vue du Khan-Tengri. 469
III. — Sur le col de Tuz. — Rencontre d'antilopes. — La vallée d'Inghiltchik. — Le «tchiou mouz». — Un chef kirghize. — Les gorges d'Attiaïlo. — L'aoul d'Oustchiar. — Arrêtés par les rochers. 481
IV. — Vers l'aiguille d'Oustchiar. — L'aoul de Kaënde. — En vue du Khan-Tengri. — Le glacier de Kaënde. — Bloqués par la neige. — Nous songeons au retour. — Dans la vallée de l'Irtach. — Chez le kaltchè. — Cuisine de Kirghize. — Fin des travaux topographiques. — Un enterrement kirghize. 493
V. — L'heure du retour. — La vallée d'Irtach. — Nous retrouvons la douane. — Arrivée à Prjevalsk. — La dispersion. 505
VI. — Les Khirghizes. — L'origine de la race. — Kazaks et Khirghizes. — Le classement des Bourouts. — Le costume khirghize. — La yourte. — Mœurs et coutumes khirghizes. — Mariages khirghizes. — Conclusion. 507
L'ARCHIPEL DES FEROÉ
Par Mlle ANNA SEE
Première escale: Trangisvaag. — Thorshavn, capitale de l'Archipel; le port, la ville. — Un peu d'histoire. — La vie végétative des Feroïens. — La pêche aux dauphins. — La pêche aux baleines. — Excursions diverses à travers l'Archipel. 517
PONDICHÉRY
chef-lieu de l'Inde française
Par M. G. VERSCHUUR
Accès difficile de Pondichéry par mer. — Ville blanche et ville indienne. — Le palais du Gouvernement. — Les hôtels de nos colonies. — Enclaves anglaises. — La population; les enfants. — Architecture et religion. — Commerce. — L'avenir de Pondichéry. — Le marché. — Les écoles. — La fièvre de la politique. 529
UNE PEUPLADE MALGACHE
LES TANALA DE L'IKONGO
Par M. le Lieutenant ARDANT DU PICQ
I. — Géographie et histoire de l'Ikongo. — Les Tanala. — Organisation sociale. Tribu, clan, famille. — Les lois. 541
II. — Religion et superstitions. — Culte des morts. — Devins et sorciers. — Le Sikidy. — La science. — Astrologie. — L'écriture. — L'art. — Le vêtement et la parure. — L'habitation. — La danse. — La musique. — La poésie. 553
LA RÉGION DU BOU HEDMA
(sud tunisien)
Par M. Ch. MAUMENÉ
Le chemin de fer Sfax-Gafsa. — Maharess. — Lella Mazouna. — La forêt de gommiers. — La source des Trois Palmiers. — Le Bou Hedma. — Un groupe mégalithique. — Renseignements indigènes. — L'oued Hadedj et ses sources chaudes. — La plaine des Ouled bou Saad et Sidi haoua el oued. — Bir Saad. — Manoubia. — Khrangat Touninn. — Sakket. — Sened. — Ogla Zagoufta. — La plaine et le village de Mech. — Sidi Abd el-Aziz. 565
DE TOLÈDE À GRENADE
Par Mme JANE DIEULAFOY
I. — L'aspect de la Castille. — Les troupeaux en transhumance. — La Mesta. — Le Tage et ses poètes. — La Cuesta del Carmel. — Le Cristo de la Luz. — La machine hydraulique de Jualino Turriano. — Le Zocodover. — Vieux palais et anciennes synagogues. — Les Juifs de Tolède. — Un souvenir de l'inondation du Tage. 577
II. — Le Taller del Moro et le Salon de la Casa de Mesa. — Les pupilles de l'évêque Siliceo. — Santo Tomé et l'œuvre du Greco. — La mosquée de Tolède et la reine Constance. — Juan Guaz, premier architecte de la Cathédrale. — Ses transformations et adjonctions. — Souvenirs de las Navas. — Le tombeau du cardinal de Mendoza. Isabelle la Catholique est son exécutrice testamentaire. — Ximénès. — Le rite mozarabe. — Alvaro de Luda. — Le porte-bannière d'Isabelle à la bataille de Toro. 589
III. — Entrée d'Isabelle et de Ferdinand, d'après les chroniques. — San Juan de los Reyes. — L'hôpital de Santa Cruz. — Les Sœurs de Saint-Vincent de Paul. — Les portraits fameux de l'Université. — L'ange et la peste. — Sainte-Léocadie. — El Cristo de la Vega. — Le soleil couchant sur les pinacles de San Juan de los Reyes. 601
IV. — Les «cigarrales». — Le pont San Martino et son architecte. — Dévouement conjugal. — L'inscription de l'Hôtel de Ville. — Cordoue, l'Athènes de l'Occident. — Sa mosquée. — Ses fils les plus illustres. — Gonzalve de Cordoue. — Les comptes du Gran Capitan. — Juan de Mena. — Doña Maria de Parèdes. — L'industrie des cuirs repoussés et dorés. 613
(p. 181) TOME XI, NOUVELLE SÉRIE.—16e LIV. No 16.—22 Avril 1905.

LES ENFANTS RUSSES, AUX GROSSES JOUES PÂLES, DEVANT L'ISBA (page 182).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

LA REINE DES CLOCHES «TSAR KOLOKOL» (page 190).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Les impressions qu'on va lire portent maintenant leur date. Depuis qu'elles furent éprouvées et écrites, de graves événements se sont produits: la Russie s'est engagée dans une guerre qui a bouleversé sa vie économique.
Que sortira-t-il de la lutte sanglante qui se livre en Extrême-Orient? L'œuvre de la colonisation russe se trouvera-t-elle compromise? Pourra-t-elle reprendre encore, après la terrible interruption qu'elle subit? C'est un problème qu'il serait prématuré de résoudre; et, en tous cas, c'est par une enquête autrement approfondie, avec des documents plus nombreux et plus étudiés, qu'il faudrait l'aborder.
Mais, si nous n'avons pas renoncé à publier ces impressions, si nous avons estimé utile de dire encore ce que nous avions cru discerner de la vie russe, c'est que l'on peut trouver dans les faits que nous avons observés, dans les manifestations que nous avons notées, et dans les souvenirs mêmes que nous avons rappelés, quelques éléments du jugement à porter sur les choses présentes.
Un mot seulement sur les raisons de cette grande excursion. Nous la dûmes à un prix de voyage, donné naguère par la Compagnie des Wagons-Lits. Nous fûmes trois à en profiter: Pierre Bourdon, Marius Dujardin et moi. Le père de Bourdon et un de ses amis, Charles Thiébeaux, s'étaient joints à nous. Tous ont une part de ces souvenirs; souvent, pendant les longues et douces journées que nous avons passées en descendant la Volga, ou dans les wagons du Transsibérien, nous nous sommes communiqué nos impressions, nos réflexions. Et l'on retrouvera sans doute dans ces pages quelque écho de la pensée de tous. Mais je dois remercier Thiébeaux de les avoir illustrées de ses belles photographies.
Et maintenant, comme disent nos vieux auteurs, «ici on parle, on conte, on raconte.»
(p. 182) I. — Moscou. — Une déception. — Le Kreml, acropole sacrée. — Les églises, les palais: deux époques.
Jusqu'à Varsovie, l'on se sent en Allemagne encore, autant qu'en Russie: les wagons sont prussiens; c'est en parlant allemand que l'on se fait comprendre. Mais, passé la Vistule, voici que les locomotives portent, à l'extrémité de leur cheminée, un capuchon tout noirci: des piles de bois, sapin ou bouleau, s'élèvent, régulières, sur le tender; la nuit, parfois, un essaim d'étincelles voltige autour du train.—Dans les wagons, larges et commodes, le samovar bout et les verres de thé circulent. Tout prend un nouveau caractère.
On est maintenant en Russie. Les gares, coquettes, avec leurs découpures, leurs boiseries, leurs toits verts, semblent toutes construites sur un même modèle. Chacun y entre, va, vient librement sur les quais: des enfants, des moujiks, sont venus voir passer le train; des femmes, aux jupes de couleur vive, aux grands châles jaunes ou bleus, attendent, accroupies devant leurs paniers, et offrent aux voyageurs des poires, des framboises, de larges champignons sauvages,—parfois aussi de petits objets de bois, faits au tour, ou taillés au couteau durant les longues veillées d'hiver. Tous ces paysans, aux yeux bleus, clairs et sans profondeurs, aux traits lourds et comme endormis, ces enfants aux grosses joues pâles, à la tignasse rousse, ont un air résigné et doux; ils jouissent naïvement de la vie, de l'agitation des voyageurs, de la locomotive qui manœuvre, de ce bel uniforme de gendarme que tous admirent. Le train parti, après les derniers trémolos de la cloche dont un employé fait trembler le battant, ils restent là encore, rêveurs.
Le train roule. La plaine environnante n'envoie aucun bruit. Elle s'étend, immense des deux côtés de la voie. Des céréales, des pâturages, des bouquets d'arbres, en varient parfois l'aspect. Les chemises rouges des moujiks, les jupes des femmes qui moissonnent, ça et là de grands troupeaux de bœufs, quelques cigognes, arrêtent heureusement les yeux dans cette immensité. La plaine invite au voyage: elle attire, elle prend, comme la mer prend les gamins des pêcheurs; et les paysans s'en vont, comme ils disent, «du côté où regardent les yeux». Entre l'isba, qui s'abrite sous les arbres, et les feux de campement, qui rougissent dans la nuit les visages des émigrants en marche, il n'y a point de différence: demain, la foudre brûlera le village, donnera l'ordre de partir, ou les moujiks, d'eux-mêmes, l'abandonneront, comme ils laissent au matin les cendres de leur feu. Et l'on comprend alors, dans cet infini de la plaine, avec quelle passion les paysans voyageurs désirent Moscou, la cité sainte, avec son Kreml superbe et ses cathédrales dorées, qui doivent surgir, là-bas, derrière l'horizon. C'est presque l'impatience du passager qui attend à la fin des longues traversées l'apparition de la côte. Et cette impatience nous saisit aussi.

LES CHARIOTS DE TRANSPORT QUE L'ON RENCONTRE EN LONGUES FILES DANS LES RUES DE MOSCOU (page 183).
Lorsqu'on a atteint Viasma, cette monotonie cesse: sur les pentes des collines vertes, que longent de petites rivières, des troupeaux de bœufs font de grandes taches mobiles. Les bois sont plus épais, plus fréquents; au long de la voie, les bruyères agitent leurs clochettes roses. Des villages forment au lointain de grandes masses noires; et au centre, toujours l'église les domine de ses clochetons bleus ou verts, au-dessus de ses murs blancs.
Enfin, voici Moscou!
C'est une déception. Moscou, c'était pour nous, pour notre imagination, la ville fabuleuse et lointaine, la ville orientale, splendide comme une cité des Mille et une Nuits, où la Grande Armée n'avait pénétré qu'avec une sorte de religieuse terreur. Et voici que nous ne trouvions qu'un fouillis de maisons basses, de cheminées d'usine, fumant parmi des dômes sans hauteur, de chantiers et d'ateliers.
Tandis que les drojkis nous menaient grand train vers le «Bazar slave», le caractère moderne de ce quartier de la ville nous choquait encore davantage. Après un arc de triomphe d'allure berlinoise, nous (p. 183) suivions une large rue mal pavée. Comme les maisons étaient basses, à peine un ou deux étages, toute la vie semblait écrasée, sans élan. Au milieu de ces voies, les piliers des lampes électriques avaient le grand air ridicule des peupliers isolés dans une plaine. Sur les trottoirs, les chapeaux de paille et les vestons courts, à l'européenne, étaient plus nombreux que les blouses rouges. Des tramways forçaient nos drojkis à se ranger! Seules, les icônes devant lesquelles nos cochers se signaient trois fois, les chapelles des rues où la foule des moujiks se pressait entre deux rangs de religieuses noires, où ces paysans que l'on apercevait çà et là près des longues files de chariots, nous permettaient d'espérer encore retrouver cette métropole historique que nous avions imaginée.
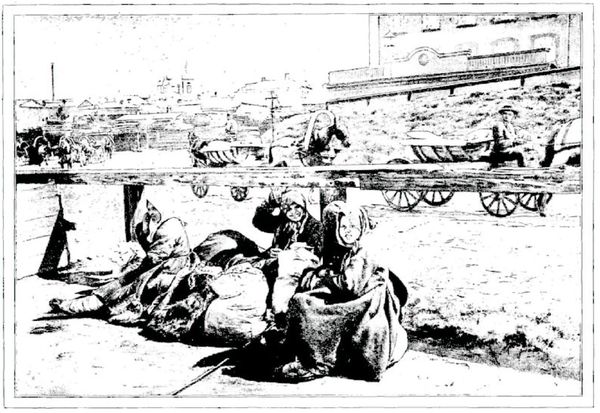
LES PAYSANNES EN PÈLERINAGE ARRIVÉES ENFIN À MOSCOU, LA CITÉ SAINTE (page 182).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Sur le soir, les cloches sonnèrent pour annoncer le dimanche: les battants frappaient avec régularité, les sons tombaient des tours, descendaient dans la ville, se mêlaient dans ses rues et remontaient en larges ondes comme les notes d'un unique et vaste carillon, qui aurait surgi de la terre même. Ce n'était point la gaieté bruyante des cloches en branle; mais il y avait dans ce bruit, je ne sais quoi de solennel, qui saisissait.
Plus tard, aux derniers moments du crépuscule, nous avons contourné le Kreml. Le mur d'enceinte, avec ses créneaux, ses portes à étages, aux toits aigus, aux images éclairées par une petite lampe, se profilait au-dessus de nous; et la masse des palais qu'il contenait nous pesait lourdement, tandis que nous allions, le long des murs, dans les anciens fossés élargis et transformés en jardins.
Peu à peu, la nuit tombait. Les tourelles, les clochetons aux arêtes vives, les dômes dorés eux-mêmes, tout s'effaçait. Seules, des murailles d'un blanc cru s'étalaient au milieu des masses rouge sombre, et le disparate de ces monuments nous choquait. Machinalement, naïvement, nous répétions le nom de Moscou, comme s'il devait évoquer enfin la cité sainte que nous voulions....
Ce fut le lendemain seulement qu'elle nous apparut: ce n'était pas dans les brumes flottantes du soir qu'il fallait chercher le Kreml et sa ville, mais sous le soleil vigoureux du matin. Le ciel avait la teinte grise des jours d'été brillants. À l'extrémité de la place Rouge, le fouillis polychrome de Saint-Basile, la fantastique église d'Ivan le Terrible, papillottait. Dans le Kreml, les dômes dorés, les clochers d'azur, les croix grecques, étincelaient. Les murailles, en briques à nu ou badigeonnées de blanc, resplendissaient d'un éclat égal; le rouge sombre des tours de l'enceinte, les tours blanches des cathédrales, la façade jaunâtre du palais Neuf, tout se perdait alors dans le même rayonnement.
Dans cette mer de lumière, l'unité vraie de cette ville sainte, la ville d'une race plutôt encore que la (p. 184) ville d'une nation, se révélait. On dit qu'elle est belle encore, sous la neige et toute constellée de glaces. Sa puissance n'éclate que sous les ciels extrêmes.
Ainsi les habitants: ils vont de la résignation absolue, du fatalisme passif, aux révoltes suprêmes et au terrorisme.
Napoléon est entré dans le Kreml; il y a couché; on a dit longtemps qu'il l'avait incendié; il a voulu le faire sauter. L'épopée gigantesque qui vint s'arrêter là, se perdre parmi les tourbillons de l'incendie, a laissé dans ces lieux quelque chose de légendaire. L'échec napoléonien a grandi le Kreml: il apparaît, comme un de ces châteaux dont les portes se ferment d'elles-mêmes, dont les murs oppriment, dont les pierres agissent; comme le peuple russe, comme l'hiver et le sol, contre le génie de Napoléon et le dernier élan révolutionnaire, le Kreml a lui aussi lutté.
C'est, comme tous les autres Kremls, l'acropole de la ville russe: des églises et des couvents, des palais et des casernes sont rassemblés dans son enceinte. Que la ville habitée brûle, que des ennemis l'occupent, elle continue de vivre dans son Kreml: le cœur bat toujours.
Le Kreml n'est donc pas la demeure d'un maître invisible, d'un sultan, comme les imaginations occidentales le reconstituent parfois; il est au peuple, il lui appartient. Et c'est ainsi qu'il est de tous les temps: la haute tour de l'Ivan Véliki continue de le signaler au loin, et les bourgeois de Moscou y ont doré naguère encore les toitures du monument d'Alexandre II.
C'est dans une boucle de la Moskowa, qu'il se dresse. De l'autre côté, la place Rouge le précède, fermée au fond par sa muraille crénelée. À l'extrémité de cette place, l'église de Saint-Basile, Vassili Blagennoï, dresse la forêt de ses clochers. Ainsi placée près de la citadelle, elle est le satellite de cet astre éclatant; et quand les Russes, au loin, se prosternent devant la ville, qui surgit de la plaine, ils joignent dans leur adoration Saint-Basile et le Kreml.

UNE CHAPELLE OÙ LES PASSANTS ENTRENT ADORER LES ICÔNES (page 183).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Saint-Basile, en effet, par son architecture, annonce toute une partie de la cité, qui s'est formée là. Tous ces monuments, assemblés au hasard des temps, no frappent point l'esprit, chacun isolément. Dans le chant de gloire de la race russe, deux grands motifs sans cesse reparaissent, celui d'Ivan le Terrible et celui de Napoléon, deux voix plus précises qui montent frémissantes à travers le concert de toutes, deux époques décisives dans cette histoire. Que les monuments du Kreml datent exactement de ces années, ou non, il n'importe: les efforts artistiques d'un peuple sont dès longtemps préparés, et les cœurs tentent leur force; les esprits aussi ne s'apaisent point d'un coup, et leurs vibrations longtemps se prolongent.
Au temps des deux Ivans, la Russie s'était décélée. Après de longues luttes, la terre russe était «rassemblée»: la horde d'Or reculait; la capitale tatare était prise.... Tandis que les Slaves d'Occident, déjà, défaillaient, la principauté de Moscou devenait la sainte Russie. La race, façonnée par les invasions, par la servitude avilissante, par la religion et les usages de Byzance, douce, résignée, patiente, se pliait à l'obéissance des grands princes, remettait ses terres à l'Église. À ce moment, tous les éléments d'origine diverse, slave, tatare ou byzantine, semblèrent se fondre en une civilisation une.
En Russie, comme dans toute l'Europe, le XVIe siècle manifestait sa force jeune et sa vigueur. Ivan, rusé et patient, par l'intrigue, par la corruption, par le meurtre, achevait l'État, fondait l'autocratie. Il terminait la lutte sourde contre les boïars, empoisonnait, égorgeait, puis fondait des messes pour les morts. C'était un esprit inquiet, tourmenté: défenseur de l'orthodoxie, il était tolérant; roi occidental par sa conception de l'État, ses institutions, sa diplomatie, il restait empereur (p. 185) byzantin par ses études théologiques, sa piété, son goût pour les arts. Il était l'héritier génial de ces grands princes moscovites qui s'élevaient par les païens, construisaient des cathédrales et mouraient tonsurés.

LA PORTE DU SAUVEUR QUE NUL NE PEUT FRANCHIR SANS SE DÉCOUVRIR (page 185).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Moscou avait grandi; elle avait remplacé Kief dans la vénération du peuple. «Dieu te bénira, disait à Ivan Kalita le métropolite Pierre, il t'élèvera au-dessus de tous les autres princes, et agrandira cette ville au-dessus de toutes les autres villes. Ta race régnera sur ce lieu pendant de longs siècles, tes mains dompteront tous ses ennemis; les saints feront ici leur demeure et mes os y reposeront.» Saint Serge à Troïtza commençait de bâtir cette auréole de couvents qui devait nimber la cité sainte; les dômes d'azur et d'or enchâssaient déjà la colline du Kreml, comme l'orfèvrerie qui recouvre les images, et la muraille aux pierres solides courait maintenant tout autour, sur les pentes.
L'enceinte crénelée du Kreml est ornée de dix-huit tours, percée de cinq portes. La plus célèbre est celle du Sauveur, SPASSKOÏ, la Porte sainte. Elle passe dans une grosse tour carrée, à trois étages en retrait; un clocher la termine. Elle porte, sur ses flancs, des horloges indiquant l'heure à tous les horizons. Nul, même étranger, même hérétique, ne peut la franchir sans se découvrir: les récalcitrants, aux siècles passés, devaient s'agenouiller cinquante fois devant l'image du Sauveur; aujourd'hui, sans doute, on les arrête. Cette dévotion obligatoire de l'entrée, c'est comme une purification de l'âme: au jour du couronnement, le nouveau tzar entre par là. C'est dans le Kreml, en effet, dans l'atmosphère pieuse des églises et des couvents, que se développait la vie des anciens princes. À l'Assomption, ils étaient couronnés; à l'Annonciation, mariés; aux Saints-Archanges, ensevelis.
L'Assomption est la plus ancienne cathédrale du Kreml; elle est la seule qui vive encore. Les autres ne sont plus que de vastes reliquaires, où les souvenirs étonnent les voyageurs; mais l'Assomption n'est point désertée. Aux jours de couronnement, aux grandes fêtes, les tapis rouges recouvrent l'escalier du palais, et parmi le bruit des cloches et le grondement des canons, les nouveaux tzars, suivis de toute leur cour, descendent; l'église s'ouvre, la vie pénètre et murmure parmi l'immobilité hiératique des icônes.
Le monument actuel n'est pas l'église de Jean à l'aumônière, le prince charitable et âpre au gain. Il date du règne d'Ivan III. L'ambassadeur de ce tzar à Venise avait embauché pour son maître un Florentin, Fioraventi, qui avait travaillé pour des Occidentaux, pour Cosme de Médicis, pour François Ier et Mathias Corvin. Ce devait être un de ces aventuriers d'art qui erraient alors par toute l'Europe, un autre Benvenuto Cellini, en quête d'aventures, de sensations et de moyens nouveaux, un génie souple qui savait faire œuvre belle, dans tous les styles. Comme Léonard de Vinci, c'était un inventeur, un savant presque universel; il imagina un bélier pour ruiner les constructions déjà faites, fondit des canons, construisit un pont de bateaux, apporta en Russie une nouvelle manière de cuire la brique. Les Russes l'appelaient Aristote.
Sa cathédrale, d'allure toute byzantine, semble plutôt l'œuvre d'architectes venus de Constantinople. Il se peut que cet artiste, ami de la lumière joyeuse, comme ceux de la Renaissance, ait travaillé sur des plans faits avant lui; peut-être aussi fut-il, dès cette époque, un tenant des primitifs! Il n'importe: Fioraventi dut bâtir avec joie, car son œuvre est belle.
(p. 186) L'église est carrée, soutenue par quatre énormes piliers; ils sont si forts, si massifs, que, du dedans, les murs extérieurs semblent ne pas supporter l'édifice, être là seulement pour en isoler l'espace. Le toit est plat, à l'orientale, et l'élan de l'église ne se rassemble pas comme dans nos flèches gothiques: c'est l'édifice tout entier, régulier et géométrique, qui monte droit au ciel, comme pour y marquer sa place, ainsi que dans le rite antique. Une grande coupole le surmonte, flanquée de quatre plus petites.
À l'intérieur, au fond de l'abside et du côté de l'orient, il y a l'autel, un seul autel, car il n'y a qu'un Dieu. Entre l'autel et la nef, formant un sanctuaire nouveau, l'iconostase, haute muraille de vermeil, historiée de figures, se dresse: c'est le voile de ces «temples». Ses portes sont fermées durant la consécration, et nul ne les peut franchir, sauf le tzar et les prêtres.
À gauche de l'autel, les reliques les plus précieuses sont montrées au peuple; on les voit, dans de grandes vitrines, semblables à celles de nos musées, et les fidèles viennent baiser les carreaux qui les protègent. Ici, les princes de Moscou, qui butinaient les reliques, comme les Italiens recueillaient les manuscrits anciens ou les os de Tite-Live, ont rapporté la tunique du Sauveur, un morceau de la robe de la Vierge, un clou de la Sainte Croix. Sur l'iconostase, parmi les figures des moines au froc sombre, parmi les chevaliers et tous les saints grecs qui s'étagent sur trois rangs, plus chargées de pierreries, plus étouffées sous l'or, les vierges miraculeuses de Vladimir et d'Iaroslaf sont suspendues. Tandis que le sacristain approche son cierge et fait étinceler les diamants, le visage noir de la Vierge peinte par saint Luc (dit la tradition) se distingue mal; peu à peu, cependant, on découvre la lueur des yeux, puis la demi-blancheur des pommettes; on suit les contours de l'or, et, comme sortant lentement de l'ombre, la figure apparaît.
Jusqu'au plafond, jusqu'à la coupole, où l'œil de Dieu seul voit les efforts de l'artiste, des peintures montent; elles se courbent et se redressent suivant les hasards de l'architecture; à la lumière des cierges, tout ce peuple de saints, malgré ses attitudes convenues, semble remuer doucement. Tout éclate dans ces compositions byzantines, sur fond or. Tout impressionne les sens, mais ne les excite pas. Comme le veut l'Église grecque, c'est un art tout spiritualiste, sans attrait charnel. C'est pour cela que les statues ont été si longtemps proscrites (car on peut les croire vivantes); c'est pour cela que la peinture reproduit sans cesse les types imaginés au Ve siècle par les moines du mont Athos.

UNE PORTE DU KREML (page 185).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Les mesures, enfin, que l'artiste a prises contre le jour, ajoutent encore à l'impression religieuse que produit l'édifice; c'est seulement par des meurtrières, par des fentes grillées que la lumière pénètre. Tantôt elle se développe tout au long sur la saillie d'un mur; tantôt les rayons, lancés, traversent l'ombre, viennent frapper l'or bruni des piliers, mais ils glissent sur cette surface lisse. Puis les lueurs reflétées se répandent faiblement, à travers l'espace obscur, jusqu'à l'iconostase, où les diamants, les saphirs, les turquoises, les émeraudes, les améthystes, les accrochent, les multiplient, et leur scintillement intense constelle la paroi d'or.
À l'opposé de l'autel, les tombeaux de saint Pierre et des autres métropolites de Moscou s'allongent, le long des murailles latérales, dans l'ombre calme. Seul, un jeune paysan endimanché les contemplait pieusement. Au milieu de l'église, entre les quatre piliers, une estrade s'étendait où se tient le tzar, au jour du couronnement. C'est là, en effet, qu'il devient le chef de l'orthodoxie; couronné, il franchit la porte de l'iconostase, et, seul devant son Dieu, communie de sa propre main. Alors des milliers de cierges illuminent l'église, et les peintures de la voûte sont révélées aux hommes.
Tout près de l'Assomption, et pour compléter l'évocation de l'ancien tzarisme, ses deux sœurs se dressent, les Saints-Archanges et l'Annonciation. La première est bâtie dans le même système: des piliers massifs, de grands murs blancs, que le soleil chauffe à outrance, des coupoles dorées; à l'intérieur, les images carapacées d'orfèvrerie et le fourmillement des saints. Ici, pourtant, les souvenirs humains abondent. (p. 188) Les portraits des anciens tzars alternent avec les figures convenues des saints; comme des reliques, leurs vêtements sont conservés, et dans l'isolement d'une salle, leurs cadavres reposent. Ils sont là, dans les cercueils de sapin, recouverts de velours rouge à croix d'or, le Terrible et ses fils, et parmi eux, Ivan, celui qu'il tua, et dont le meurtre tourmenta ses derniers jours, ruina son œuvre. On voit souvent reproduite en Russie cette scène farouche: le vieux tzar, à genoux, ravagé par la douleur, étreignant dans ses bras le cadavre de son enfant et s'efforçant de lui rendre la vie par ses baisers exaspérés; la salle est vide, et les murs lui renvoient sa plainte.

LES MOINES DU COUVENT DE SAINT-SERGE, UN DES COUVENTS QUI ENTOURENT LA CITÉ SAINTE (page 185).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
À l'Annonciation, l'antique église au pavé d'agate, les anciens tzars étaient mariés, les tzarines ensevelies.
Ces trois cathédrales annoncent la Moscovie de la Renaissance; elles recueillent pour la Russie, pour l'art des âges suivants, le pur héritage de Byzance. Mais lorsque, par la servitude tatare, la Russie eut repris contact avec l'Orient sauvage, puis redevenue libre, rivalisa avec lui, l'art se modifia. Il y eut dans les esprits un moment étrange: ils étaient tourmentés, tiraillés entre l'imitation de Byzance et la façon orientale, originelle. De cette inquiétude chercheuse des Ivans et de leurs contemporains, le Vieux Palais et Saint-Basile naquirent, expression de la Russie sainte que les vieux Russes devaient défendre contre les tentatives des tzars modernisants.

DEUX VILLES DANS LE KREML: CELLE DU XVe SIÈCLE, CELLE D'IVAN, ET LA VILLE MODERNE, QUE SYMBOLISE ICI LE PETIT PALAIS (page 190).
Parmi les monuments d'allure moderne, qui étalent sur le Kreml leurs façades régulières, ce qui reste des anciens palais, resserré et comprimé, se terre sauvagement dans son originalité. Le palais à facettes, avec l'escalier rouge, du haut duquel le tzar couronné montre au peuple «la lumière de ses yeux», le petit palais d'or, le Térem, ce gynécée de l'ancienne Russie, sont toujours disposés et meublés pour la vie étroite d'un Moyen Âge septentrional. Ce sont de petites salles basses et voûtées, dont les habitants devaient mener une existence accroupie, des chambres d'une ornementation bizarre et fantasque, où les filets d'or éclatent parmi des teintes sombres. Sur les murs, les images familières, protectrices des tzars, sont plus immobiles encore et plus tristes dans le fouillis miroitant des décorations orientales. La salle à manger, la chambre à coucher, l'oratoire, donnent l'impression d'un Cluny russe encore habité. À l'extrémité du palais, dans un édifice aux clochetons de forme bulbeuse, la chambre dorée; une voûte la surmonte, retombant sur un épais pilier central, et d'épaisses barres dorées, jetées d'un arc à l'autre, empêchent l'écartement des arcatures. Partout reluit l'or des légendes en lettres slavonnes. C'était là, dit-on, que l'on discutait des intérêts religieux de la Russie. Tout autour, il y avait des sièges, creusés dans le mur, où s'asseyaient sans doute les princes de l'orthodoxie. Incertitude de la condition, incertitude de la vie, ces deux terreurs du Moyen Âge, on les éprouvait sous les voûtes basses: l'homme restreignait sa vie, pour qu'elle offrît moins de prises. C'était tout bas, avec une sorte de peur religieuse, que notre guide murmurait le nom d'Ivan le Terrible. Contre des crimes de raison d'État, le peuple russe ne se rebelle point. Il les regarde presque comme une nécessité; et dans sa conscience peu lucide, il s'est bien souvent résigné.
Ce sont les mêmes impressions, les mêmes souvenirs à Saint-Basile, le monument par excellence d'Ivan IV. Ce fut lui qui le fit construire pour remercier le Ciel de la prise de Kazan, lui qui jugea l'œuvre, une fois terminée,—et il la jugea belle et surprenante,—car il fit tuer l'architecte pour qu'il n'en bâtit plus d'autres. Mais Saint-Basile est aussi l'église de la Russie naissante: comme c'était par la religion que la (p. 189) Russie nouvelle avait dû s'affirmer d'abord, la religion se fit nationale; et les saints que les Tatars avaient martyrisés furent unis désormais, dans la mémoire des peuples et sur les murs des églises, aux premiers martyrs et aux Pères.
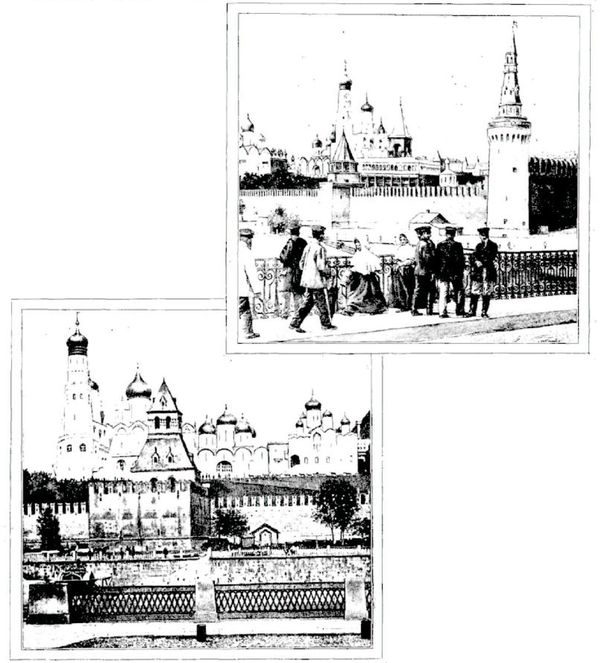
LE MUR D'ENCEINTE DU KREML, AVEC SES CRÉNEAUX, SES TOURS AUX TOITS AIGUS (page 183).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
TOUT PRÈS DE L'ASSOMPTION, LES DEUX ÉGLISES SOEURS SE DRESSENT: LES SAINTS-ARCHANGES ET L'ANNONCIATION (page 186).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Saint-Basile est bâtie sur une espèce de plate-forme, entourée de terrains en contre-bas. Ses huit ou dix coupoles, toutes de dimensions, de formes diverses, ses clochetons, tantôt taillés à facettes, tantôt côtelés de nervures, témoignent dès l'abord du composite étonnant de l'édifice. Gothique et Renaissance, tatar et byzantin, tous les styles se rencontrent là, comme les tendances opposées dans l'esprit d'Ivan. Ce n'est pas une église régulièrement disposée, avec des nefs, des coupoles, des effets de lumière prévus, mais un faisceau de chapelles, collées les unes contre les autres. Il semble qu'un plan ait été impossible, que la construction se soit accomplie au hasard. Sous les clochers d'or à croix grecques, les murs resplendissent dans une polychromie violente: ce ne sont pas de larges couches symétriques, qui reposent la vue, mais tout un miroitement de lueurs vagues, qui scintille au soleil comme les écailles d'un poisson jeté sur la plage. À l'intérieur, chacun des dômes et des clochers recouvre une chapelle: Saint-Basile semble une église «d'intentions particulières». Tantôt on passe d'un sanctuaire à l'autre directement, tantôt par de longs détours dans des couloirs percés dans la muraille, et où il faut baisser la tête. Dans la coupole, tout en haut, on aperçoit des figures hiératiques, celles du Sauveur, de la Vierge, d'un saint, dont le regard emplit l'édifice. Toutes ces peintures ont un aspect sombre, barbare, dans l'enchâssement de leur or. Au sortir de la place Rouge, gaie comme une grève, aux midis d'été, entre les dorures du Kreml et la façade blanche du Gostinoï Dvor, cette tristesse intérieure étonne.
Sous l'église, une sorte de crypte était illuminée de cierges. Des pierreries, de l'or partout: le trésor souterrain d'un château de légende. Des popes officiaient avec l'animation accoutumée; trois ou quatre malheureux baisaient la terre avec ferveur. À la sortie, une demi-douzaine de mendiants se précipitèrent sur nous: une marchande nous proposa des bibelots de religion.
Ainsi, de l'Assomption à Saint-Basile, c'était toute une ville qui se précisait et s'isolait peu à peu dans (p. 190) notre imagination: la Moscou du XVIe siècle. Comme les anciennes communes ou les villes royales, elle avait ses cathédrales, ses palais, son beffroi enfin dominant tout le Kreml, l'Ivan Véliki. C'est un énorme donjon, octogone, à trois étages en retrait, dont le dernier est surmonté par une coupole d'or. Trente-quatre cloches forment son carillon: l'une, dit-on, est la cloche communale de Novgorod la grande, d'autres plus petites, en argent, furent données par Catherine II. Au bas, la reine des cloches (tsarkolokol), un bourdon monstrueux, datant du règne d'Alexis Mikhaïlovitch.
Du haut de cette tour, la ville immense se découvre. Tout au pied, c'est d'abord l'entassement fantastique du Kreml. De toutes parts, les clochetons aux reflets métalliques, les flèches à six ou huit pans, s'aiguisent vers le ciel; les coupoles d'azur, constellées d'or, s'arrondissent parmi les tours gothiques de l'enceinte; et les dômes dorés, les calottes en plaques de cuivre battu, resplendissent; aux points saillants, et comme pour un jaillissement plus intense, la lumière se concentre et brasille. On dirait que tout ce tumulte s'anime, que toutes ces tours et ces clochers se déplacent, se croisent, montent vers le ciel et redescendent. Plus loin, derrière la boucle de la Moskowa, à l'abri de sa citadelle, Moscou se prolonge à l'infini. Au premier plan, sur les bords du fleuve, des façades blanches et d'aspect moderne lui font une limite précise. Mais immédiatement l'œil ne distingue plus qu'une immense étendue verte, du vert clair d'un étang qui dort. Ça et là, des clochers dorés ou argentés émergent comme des nénuphars. Sous ses toits peints, la grande cité vit. On n'aperçoit pas, de l'Ivan Véliki, ces cheminées d'usine où la vue se heurtait à l'arrivée: c'est, tout entière et seule, la cité sainte et marchande du XVIe siècle. Telle qu'un vaste couvent, où ceux qui passent essaient vainement de rien transformer, où la maison elle-même suit sa tradition, vit de sa vie indépendante et façonne celle de ses habitants, malgré l'Occident et par ces restaurations, dont un peuple naïf l'accable sans cesse, la ville d'Ivan demeure, dans le tumulte des civilisations. Mais ce n'est pas un souvenir mort: avec elle c'est toute sa vie qui persiste.
Et pourtant, tout près de l'Assomption, importune et lassante au premier abord, la façade rougeâtre du palais Neuf s'étale: plus loin, près de la place Rouge, c'est l'Arsenal, le palais de Justice, des casernes qui cachent le mur à créneaux.

À L'EXTRÉMITÉ DE LA PLACE ROUGE, SAINT-BASILE DRESSE LE FOUILLIS DE SES CLOCHERS (page 184).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
À l'opposé de la porte Spasskoï, du côté de l'occident, une large avenue monte au Kreml, par la porte de la Trinité. La Grande Armée est entrée par là. Sur cette voie triomphale, on croit voir monter encore la bande tumultueuse des soldats occidentaux, fiers et pourtant inquiets. On croit entendre les tambours, les commandements, le claquement des essieux et, par intervalles, les notes de la Marseillaise qui s'élancent du Kitaï-Gorod: tout un bruit guerrier, qui se répand le long du fleuve, fouette les murailles, et dont l'écume brisée ruisselle sur les dômes.
À ce moment, le peuple russe se ressaisit: contre l'ennemi, ce fut lui qui se dressa. Le moujik brûla son isba, fit le désert devant l'armée; la guerre le passionnait; avec les kosaks, il pendait, égorgeait les traînards ou les maraudeurs. Le vieux Kutuzow, le général aimé du peuple et fataliste comme lui, dédaigneux de la tactique occidentale, répétait que c'était au soldat russe qu'il devait la victoire.—À l'entrée du Kreml, au long des murs de l'Arsenal, les pièces françaises prises en 1812 sont alignées. On lit, au-dessous, en russe et en français: «Canons pris sur les ennemis par la victorieuse armée et par la fidèle et dévouée nation russe.» Officiellement, l'action du peuple est reconnue et glorifiée.

DU HAUT DE L'IVAN VÉLIKI, LA VILLE IMMENSE SE DÉCOUVRE (page 190).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Ce fut alors un demi-avènement de la nation. Le tzar l'avait retrouvée; la vieille alliance entre le père (p. 191) et les enfants avait été refaite. Mais qu'il était devenu étrange ce père! Comme il semblait gêné au milieu de la ville sainte! Depuis longtemps, les Occidentaux l'avaient séduit, suborné dans son Pétersbourg, par des charmes magiques, loin de ses fils! Sans doute, les longs efforts de ses prédécesseurs l'avaient conduit à la gloire de 1807, à cette alliance par laquelle il dominait l'Europe et gagnerait peut-être Constantinople, enfin! Mais l'étranger avait souillé la sainte Moscou!
Or, en 1812, le peuple russe accepta ce que ses tzars avaient fait, adopta comme siens les monuments d'allure occidentale qui déjà avaient envahi le Kreml; il ne voulut rien laisser de ce qu'on avait fait russe. Napoléon, sans le vouloir, avait accompli l'œuvre où Pierre le Grand avait échoué.
De ces années, donc, date l'évolution d'une Russie contemporaine. Tout le Kreml moderne, inachevé encore, complété jour à jour, suivant les besoins, en devint le signe matériel.
Non loin de l'Arsenal, des casernes, du palais de Justice, le palais Neuf s'étend régulier et ferme, classique comme Versailles, devant le chaos du Kreml ancien.
Nous avons visité le Trésor des tzars. Par un escalier solennel, on arrive à une grille monumentale, en fer poli. Elle donne accès dans une vaste salle, à coupole. À côté des soldats modernes, des fonctionnaires indolents, quatre grands mannequins équestres, revêtus d'armures slavonnes, montent leur garde séculaire. De cette rotonde, deux galeries partent, en forme de demi-cercle: les souvenirs de toute une histoire y sont rassemblés, attendant pour revivre l'imagination alerte d'un visiteur. Il y a là des richesses inestimables, des milliers de pierres précieuses, des tonnes d'or. Ces merveilles retiendraient peu, si leur prix seul avait invité les tzars à en faire montre.
Mais le travail délicat de l'orfèvrerie, les souvenirs évoqués et le fantastique même d'un tel amoncellement forcent les regards. Les sceptres anciens où les diamants pétillent, les couronnes où s'étagent les rampes de rubis, de saphirs, de turquoises, celles d'Astrakan et de Kazan, celle de Sibérie, celle de Vladimir Monomaque, les robes de couronnement, comme d'immenses vagues d'or qu'on aurait figées là, symbolisent pour la multitude naïve la grandeur de la monarchie, comme l'orfèvrerie des icônes lui fait deviner les splendeurs célestes. Plus loin, ce sont les cadeaux, ceux des sultans, ceux des khans de Circassie, ceux des Lithuaniens et de Napoléon, hommages du monde entier au tzar, les selles, les étoffes magnifiquement tissées, les coupes ouvragées ou les vases de Sèvres, puis des drapeaux, loques effilochées, pendues là, ceux de Pojarski, avec les figures hiératiques des saints, ceux des légions polonaises, des haillons tricolores, aux inscriptions révolutionnaires, des armures de tous les temps, de toutes les guerres, prises sur les ennemis ou offertes par les princes étrangers, les carrosses des anciens tzars, le gigantesque traîneau d'Élisabeth, le mobilier de Pierre le Grand. Surtout, les souvenirs de 1807 à 1815 emplissent ces lieux; mais ce n'est pas seulement la défroque de l'ennemi vaincu, le chapeau de Napoléon que l'on montre, comme à Berlin. L'empereur ici reste glorieux et respecté. C'est qu'il rappelle le moment où, pour la première fois, la nation russe compta dans l'Europe, c'est qu'il fut, volontairement ou non, son initiateur à la vie moderne, c'est enfin qu'il toucha Moscou. La grandeur de l'épopée révolutionnaire émane de ces salles.
(p. 192) À l'extrémité de la galerie, une statue de marbre blanc domine le musée tout entier; en tenue d'apothéose, comme un César romain, Napoléon médite sur l'organisation de la conquête. Lui aussi, les Russes l'ont adopté. Près de ces souvenirs, et continuant cette histoire dont ils indiquent les étapes, le tzar habite. Nous avons parcouru les appartements, les salons somptueusement meublés, la chambre à coucher, la salle du trône aux riches tentures. Dans ces salles immenses, l'ornementation est sobre, et l'éclat des dorures ne les encombre pas. Les salles capitulaires de Saint-Georges, de Saint-André, que le blason des ordres a servi seul à orner, et aux murs couverts d'inscriptions, sont de toute beauté, vastes et simples.
Ainsi deux villes dans le Kreml: une du XVe et du XVIe siècle, immobile; l'autre occidentale, envahissante. Il a pourtant son unité, unité vraie que des artistes, comme Théophile Gautier, peuvent ne pas découvrir, mais que le peuple sent.
Or cette unité ne naît pas de ce sentiment de solidarité dans le temps, qu'on appelle la tradition; il n'y a point de place pour ce sentiment dans la conscience russe. Les monuments ne marquent pas là, degré par degré, le progrès lent d'une civilisation: entre la ville d'Ivan et la ville moderne, il y a solution de continuité. Et pourtant, le peuple ne distingue pas.
C'est que les Russes ne sont pas une nation: ils sont une race, et une race n'a pas de traditions. Elle ne sent pas ce qu'a laissé le travail des générations successives; le passé a disparu. Cela, en Russie, a frappé tous les étrangers: «Chez vous, rien n'est respecté parce que rien n'est ancien, écrit de Maistre à un Russe.» Michelet rappelle ce mot: «Nul passé, nul avenir, le présent seul est tout.» Herzen, enfin, le révolutionnaire: «Nous sommes libres du passé, parce que notre passé est vide, pauvre, étroit.» La nation est une personne; la tradition la constitue, elle a besoin d'institutions; la Russie n'a pas su en acclimater d'étrangères, ni en créer de nationales. Les membres d'une nation se classent par leurs idées, par la manière dont ils entendent l'œuvre de leur groupe dans le monde. Les Russes examinent la figure du voisin, disent: «Celui-ci est vrai Russe; il a les yeux bleus, les pommettes saillantes.» Plus vraiment, mais de même, les Grands-Russiens sont les vrais Russes, parce qu'ils colonisent mieux, parce que leurs facultés naturelles les rendent plus propres à résister, à assimiler ou détruire par contact les races vigoureuses. C'est encore une fois que le peuple russe agit comme une race, physiquement.
Ainsi son Kreml ne doit-il pas lui apparaître comme le gardien d'une tradition séculaire; il ne le voudrait pas couvert de cette teinte grise, dont nous aimons voir nos monuments revêtus. L'antiquité d'une nation est sa force; la race a besoin de se sentir jeune. Le Kreml, donc, doit être éternellement neuf, comme la ville; aussi, comme ils repeignent les peintures byzantines, pour que leur sainteté soit plus évidente, les Moscovites rebadigeonnent le Kreml, pour que la grandeur russe ne soit pas mise en doute. Le resplendissement du neuf, voilà ce qui fait l'unité extérieure du Kreml, ce qui assure la race de sa force constante.
Le Kreml brille comme le ciel, et le moujik assimile au ciel éternellement resplendissant sa cité sainte. Un mot religieux de Moscou le dit: «Au-dessus de Moscou, le Kreml; au-dessus du Kreml, le ciel.»
(À suivre.) Albert Thomas.

UN DES ISVOTCHIKS QUI NOUS MÈNENT GRAND TRAIN À TRAVERS LES RUES DU MOSCOU (page 182).
Droits de traduction et de reproduction réservés.
TOME XI, NOUVELLE SÉRIE.—17e LIV. No 17.—29 Avril 1905.

IL FAIT BON ERRER PARMI LA FOULE PITTORESQUE DES MARCHÉS MOSCOVITES, ENTRE LES PETITS MARCHANDS, ARTISANS OU PAYSANS QUI APPORTENT LÀ LEURS PRODUITS (page 195).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
II. — Moscou, la ville et les faubourgs. — La bourgeoisie moscovite. — Changement de paysage; Nijni-Novgorod: le Kreml et la ville.

L'ISVOTCHI A REVÊTU SON LONG MANTEAU BLEU (page 194).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Moscou.—Plus que ses cathédrales, plus que son Kreml et ses palais, nous avons aimé Moscou, Moscou elle-même, la cité vivante et bourdonnante.
Comme ville industrielle d'abord, comme centre de commerce, comme point de réunion des lignes de chemins de fer, Moscou s'étend et se transforme, grandit, en face de Pétersbourg; la foule de ses marchands s'agite; dans le travail universel, Moscou à son tour fait effort.
Mais c'est une personne que cette ville; une personne vivante et presque humaine, qui dissuade ou qui conseille,—qu'il faut aimer ou haïr,—qui façonne les cœurs. C'est ainsi que le peuple la vénère. Pour lui elle est, au sens précis, littéral, «la sainte mère», celle à qui il demande assistance et refuge aux heures de danger. Lorsque Kutuzow l'abandonna, la sacrifia pour sauver la Russie, il sentait bien que «ce n'était pas une ville comme une autre». Il ne voulut pas y entrer, et, pleurant, passa par les faubourgs.
Ainsi tout le peuple s'abandonne à elle, subit son ascendant; il la sait douce, hospitalière. Au sortir du steppe dont l'infini tue les bruits, cette activité resserrée, ce fourmillement de rues, ces bruits sonores rassurent. Et la foule s'y agite heureuse, se sentant là chez elle, dans sa ville.
Sans doute des étrangers sont venus d'Occident, qui ont essayé de transformer Moscou. Voyez un peu la nouvelle parure dont ils l'ont revêtue: des tramways, des piliers de lampes électriques, interrompent les larges rues; des façades de pierre (p. 194) se sont introduites, par force, entre les maisons de bois, et sur la ville, en un réseau serré et enveloppant, les fils téléphoniques se croisent, innombrables; parmi les enseignes en lettres russes, des inscriptions françaises se sont glissées; dans les étalages, bien ordonnés, les produits parisiens déploient leur coquetterie.
Oui, mais Moscou reste sainte; que les machines ronflent dans les usines, que les sifflets des locomotives percent l'air à l'entour d'elle, Moscou accepte la civilisation, elle agrée tout ce que l'Europe lui apporte; comme son peuple, elle est souple; elle s'assimile avec facilité les connaissances occidentales, elle se plie aux habitudes nouvelles. Mais ne croyez pas l'avoir changée! Pétersbourg a pu se transformer au contact des Allemands ou des Français, mais non Moscou. Dans toutes ces rues, la civilisation occidentale reste isolée; elle ne pénètre pas la vie russe, elle ne lui donne pas une forme nouvelle. Le soir, quand les lampes électriques épandent leurs lueurs bleuâtres, les boutiques basses, à peine éclairées, ne répondent pas à leur appel joyeux. Les races orientales circulent, sans se mêler, parmi la ville immense, et la civilisation occidentale s'agite comme une autre race qui passe.
Dans sa capitale intacte, le peuple se sent bien chez lui. Sur les routes, une multitude vient vers Moscou: ce sont des pèlerins, pieds nus, qui viennent quêter pour une église; avec leur bâton et leur sébile, ils se tiendront, des journées durant, à la porte des cathédrales. Ce sont des paysans, toute une famille, des enfants aux tuniques roses, des femmes aux jupons rouges, un mouchoir autour de la tête, tous entassés sur la paille, dans une téléga, et qui arrivent pour travailler.
Beaucoup viennent pour une saison. Aux jours d'été, tandis que les riches marchands et les bourgeois partent pour la campagne, à plusieurs verstes de la ville, le peuple en devient le maître; les plaisirs européens encombrent moins la rue. Dans des maisons basses, dans des sortes de caves, isvotchis ou charretiers, tous ceux qui sont venus des champs logent pêle-mêle.
Au jour, ils se répandent par les rues, foule pittoresque et bariolée. Les isvotchis recouvrent de leur long manteau bleu la saleté du dessous; ils attendent, sous le soleil brûlant de midi, résignés et patients, comme leur cheval même, qu'un M. Orloff (c'était le nom de notre guide) avec ses étrangers, les appelle ou les siffle; aussitôt, un escadron s'élance, et, dans une sorte de fantasia, tourbillonne le long du trottoir. Les commissionnaires aux portes des hôtels, aux coins des rues, font leur faction. Ils causent, rient, se bousculent. Cette foule est gaie, enfantine; ils badaudent joyeusement, mais sans insistance: tandis qu'un de nos compagnons photographiait le Kreml, ils passaient près de nous; nous observaient, mais sans s'arrêter, sans former de groupes.
Sur la chaussée, parmi les drojkis rapides, des files interminables de charrettes avancent lentement; l'entreprise de charroi paraît être une industrie moscovite prospère. Chaque cheval a le nez dans la voiture qui le précède: le plus souvent, il y est attaché, et toute la troupe avance, d'un seul mouvement.
Parfois, un cortège empêche d'aller. Tantôt des prisonniers que des soldats emmènent, un convoi, peut-être, pour la Sibérie: il y a là des hommes, des adolescents de figure nerveuse, des femmes aussi, portant un léger paquet de hardes, et cette troupe avance avec lenteur. Plus loin, c'est un enterrement qui monte le long du Kreml depuis le pont de la Moskowa; le cercueil, couvert d'un drap rouge sombre, était porté sur les épaules; en avant, un sacristain tenait l'icône, avec sa robe blanche et dorée, semblable à l'extrémité d'une étole.
Une autre fois, le convoi sortait d'un hospice, tout près d'un marché: c'était un enfant sans doute que l'on enterrait. Le char, blanc et doré, était traîné par quatre chevaux habillés de noir; un homme à longue robe tenait chaque cheval. Tout cela luisait sous le soleil, et l'on sentait, imminente, une gaieté recueillie.

À CÔTÉ D'UNE ÉPICERIE, UNE DES PETITES BOUTIQUES OÙ L'ON VEND LE KVASS, LE CIDRE RUSSE (page 195).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Le marché étincelait dans son fouillis. On aurait cru se promener dans un grand bazar oriental; dans des baraques en bois ou sur le sol, il y avait des amoncellements de ferraille. De grands coffres, de couleur argentée, ornés comme des cercueils, étaient empilés les uns sur les autres; les petits tonneaux neufs, tout blancs, attiraient par leur élégance. Les marchands de vaisselle étaient les plus ardents, insistaient pour nous vendre un moutardier ou une cafetière; mais beaucoup de ces objets venaient d'Occident. D'autres vendaient des fruits; des marchandes offraient du kvass, sorte de cidre russe, de couleur rouge, qu'elles tenaient dans de grandes carafes en verre. Et des Tatars offraient des étoffes étalées sur leurs bras.
Il faisait bon errer ainsi, entre ces auvents; on sentait là le travail isolé, celui du paysan, dans son isba, de l'ouvrier des villes, dans sa boutique basse, tout seul, aidé de ses outils primitifs; tout un travail patriarcal, humble et pénible.
Mais, déjà, la grande industrie a pénétré. Un soir, comme nous étions dans le Kreml, à l'heure du crépuscule, et que les bruits plus rares montaient s'éteindre là, nous avons vu les ouvriers modernes: ils avaient la face pâlie; ils ne regardaient plus avec la curiosité enfantine du reste du peuple; ils parlaient plus haut; ils respectaient moins la sainteté du Kreml. Ils s'en allaient deux par deux, les jeunes surtout, serrés l'un contre l'autre, comme s'ils avaient senti plus fort le besoin d'être unis.
Ainsi allions-nous, au travers de la ville, nous laissant pénétrer par la rumeur active qui nous enveloppait.
Un dimanche, après midi, nous sommes allés aux Moineaux. Les Moineaux sont une ondulation faible de la plaine russe et du haut de laquelle on découvre Moscou. Un souvenir historique, aussi, appelle là: c'est du haut de cette colline que Napoléon vit le Kreml.
Après avoir franchi la Moskowa, on traverse l'ancienne ville tatare. Elle est peuplée aujourd'hui de petites maisons, coquettes, au milieu de jardins, et qui témoignent de l'aisance des habitants. Les moujiks enrichis, des commerçants heureux, habitent là, dans ce quartier tranquille, entre des hospices, des monuments publics ou des églises.
Peu à peu, à mesure que nous montions, nous apercevions, au détour de la route, les clochers dorés de Moscou et, par endroits, la masse des maisons. Au bout d'une demi-heure, nous étions aux Moineaux.
Il était deux heures, à peu près, le moment même où la Grande Armée put enfin contempler Moscou étincelante, au 14 septembre 1812. Rappelez-vous comment Ségur raconte cette arrivée. Les éclaireurs ont découvert la ville: «À ce spectacle, frappés d'étonnement, ils s'arrêtent, ils crient: «Moscou! Moscou!» Chacun alors presse sa marche, on accourt on désordre, et l'armée entière, battant des mains, répète avec transport: «Moscou! Moscou!» comme les marins crient: «Terre! Terre!» après une longue navigation. Puis c'est Napoléon lui-même, qui accourt, heureux, confiant, recueillant de nouveau les hommages de ses maréchaux, s'arrêtant transporté, et s'exclamant: «La voilà donc enfin, cette ville fameuse!»
Du restaurant des Moineaux, le spectacle est merveilleux: ce n'est plus, comme du haut de l'Ivan Véliki, l'immensité enveloppante de la ville qui retient l'esprit; ici elle apparaît vraiment comme la halte au milieu de la plaine sans limites, comme la tiare de pierreries que porte l'empire russe. Au pied de la pente (p. 196) boisée des Moineaux, c'est la Moskowa, qui se déroule en une immense boucle. Une plaine où, ça et là, des couvents, des cabanes, dressaient leurs clochers et montraient leurs toits, s'étendait, toute verte, avec ses routes blanches. Au fond, Moscou brillait. On l'apercevait tout entière: l'église du Sauveur d'abord aux cinq dômes fulgurants; puis, derrière, les clochers bulbeux du Kreml, la tour de l'Ivan Véliki, la façade du Palais Neuf. Tout autour, dans la teinte uniforme des autres toits, des clochers plus petits faisaient effort vers le Kreml. Et, par derrière, la ville semblait se prolonger à l'infini, se répandre vers l'Orient inculte et qu'il faut coloniser.
Nous regardions, stupéfaits, saisis d'admiration. Sur la terrasse, des hommes, des femmes, buvaient le thé ou collationnaient: c'étaient «des richards», comme disait notre guide, qui s'asseyaient là tout un après-midi, buvant, mangeant, raillant les passants; de grands industriels ou des rentiers de Moscou. À l'extrémité d'une table, une petite fille, d'un an à peine, la tête perdue dans une grande capote, était portée par une bonne, négligée par sa mère, une de ces grandes dames, sans doute, qui riaient et plaisantaient, sans songer à la ville qui s'étalait là-bas. Seule, l'enfant, naïve et curieuse, semblait comprendre, comme le peuple, la beauté du spectacle; et ses yeux noirs, ses deux grands yeux, seuls actifs, seuls vivants, dans son visage pâle de petite maladive, restaient fixés obstinément sur les coupoles d'or.
Au dehors, de pauvres gens, venus là sans doute comme nos ouvriers vont à Meudon le dimanche, étaient montés par les sentiers, au travers du bois. Ils avaient vu Moscou surgir lentement, à mesure qu'ils montaient, et maintenant ils s'extasiaient devant son resplendissement.
De l'autre côté, une route redescendait vers la ville; nous l'avons prise. Il faisait, à cette heure, une chaleur d'étuve, l'air était sans vent; dans un ciel absolument pur, seul, un nuage blanc s'étirait. Une poussière épaisse demeurait suspendue au-dessus de la plaine et, par son immobilité fluide, donnait à tout le paysage une légèreté infinie.
Dans le village, tout voisin du restaurant, les isbas paraissaient endormis et déserts. On n'entendait aucun bruit; seuls, des enfants se baignaient dans une mare sale, près de la route, et clapotaient avec les canards. Par les fenêtres des isbas, le samovar apparaissait, brillant.

ET DES TATARS OFFRAIENT DES ÉTOFFES ÉTALÉES SUR LEURS BRAS (page 195).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Au pied de la colline, tout auprès de la Moskowa, un village annonce les faubourgs industriels. À la porte d'un tractir (cabaret), des hommes jasaient, observaient naïvement les passants, avant d'entrer boire un verre de vodka.
Puis ce fut la campagne suburbaine accoutumée, les marais, la culture des légumes, les potagers. Sur l'autre rive, un couvent au mur crénelé, avec ses clochetons et ses dômes dorés, reposait. Ici, on n'entendait aucun bruit; un chant de coq partit soudain dans ce silence et emplit l'air.
Enfin, nous revînmes à Moscou; nous arrivâmes par les faubourgs ouvriers. On apercevait des bâtisses régulières, des magasins et des usines. Dans les environs, des familles logeaient, s'entassaient à tous les étages autour de grandes cours où le linge séchait sur des piquets de bois et où des icônes, parfois, étaient suspendues, protectrices. Le dimanche, elles étaient dehors; quelques-uns, en habit de fête, sortaient du Jardin zoologique; d'autres, plus nombreux, étaient restés aux alentours des tractirs. Les cris, les plaisanteries, ne faisaient pas défaut; une vieille femme, passant par là, fut poursuivie par quelques-uns; elle leur tenait tête bravement, répondait avec verve, sans doute; car elle les faisait rire et les désarmait. La rude gaieté populaire éclatait.
Au soir, nous sommes allés à Petrovsky Park, le Bois de Boulogne de Moscou. Il s'étend entre la ville, dont les dernières villas se sont cachées là sous les arbres, et le palais construit par Catherine II. Devant le palais, une vaste surface plane s'étend, lieu des réjouissances populaires.
(p. 197) Çà et là, dans le bois, des restaurants, des cafés-concerts. Il fallait, dit-on, dîner à Mavretagn, au restaurant mauresque, connaître la haute société moscovite. Nous y fûmes menés. C'était un Français, le maître d'hôtel, qui nous reçut; il fallut visiter tous les pavillons, un à un, celui-ci dont les glaces avaient coûté tant, celui-là dont l'ornementation avait failli ruiner le propriétaire, tous ces cabinets où de riches marchands dépensaient en une nuit plusieurs milliers de roubles, avec un gros tapage de gens blasés.

PATIENTS, RÉSIGNÉS, LES COCHERS ATTENDENT SOUS LE SOLEIL DE MIDI (page 194).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Pendant le dîner, deux orchestres jouaient tour à tour, l'un civil, l'autre militaire, le meilleur. Des airs français, naturellement, comme le Chant du Départ, ou des morceaux d'opéra, comme l'ouverture de Guillaume Tell, nous furent offerts. Tandis que l'orchestre continuait de jouer, comme en sourdine, tandis que les lampes électriques filtraient leurs rayons au travers du feuillage vert, nous nous laissions aller à rêver un peu, dans une grande détente de l'attention.
Pendant ce temps, le maître d'hôtel contait l'accident de Petrovsky-Park, arrivé là tout près, lors de la fête du couronnement de Nicolas II. C'était la foule énorme se pressant pour la distribution des vivres, se bousculant pour arriver à temps, pour recevoir, puis les planches qui se brisent, au-dessus du ravin, les malheureux qui s'enfoncent là, s'entassent, s'étouffent, et la multitude des autres, alors, qui poussent toujours, qui passent sur le fossé comblé de morts, sur ce nouveau parquet qui ne s'enfoncera pas..., enfin les cadavres qu'on emporte toute la nuit, accumulés sur les chariots, et les noms, pendant quinze jours, emplissant les colonnes des journaux.
Nous songions ace peuple naïf et gai de Moscou, que nous avions vu tout au long du jour, et ce malheur qui l'avait frappé, nous paraissait d'autant plus triste et plus insupportable.
Il était tard déjà quand nos voitures nous ramenèrent à l'hôtel, par l'arc de triomphe d'Alexandre Ier, tout le long de la Vertskaïa. Le ciel avait quelque chose d'éthéré et d'immatériel, avec ses étoiles pâles et la lueur diaphane de son couchant. Les petites chapelles étaient closes; le peuple, ouvriers et moujiks, avait disparu; la Moscou russe dormait. Mais les lampes électriques semblaient triompher. À fond de train, des troïkas et des drojkis revenaient de Petrovsky; aux lueurs de l'électricité, ou apercevait parfois un officier et une femme, serrés l'un contre l'autre dans l'étroite voiture; sur les trottoirs, des filles passaient.
Entre Paris et Tomsk, à Varsovie, à Nijni, vous trouverez le marchand de Moscou. Depuis qu'il a quitté le caftan de ses pères, depuis qu'il fait peiner des milliers d'ouvriers, il va par toute l'Europe, l'Asie, pour vendre et pour acheter, pour jouir. J'eus le bonheur d'en voir un à Moscou même, chez lui, parmi son luxe, M. K... Il habite à Marosseïka une maison à deux étages, un petit hôtel d'allure occidentale. À l'intérieur, on trouve le confortable, le luxe moderne et cosmopolite.
En bas, c'est la bibliothèque, le cabinet de travail, la chambre du précepteur, celle de ses domestiques, celle de la gouvernante. À l'entrée, devant le grand escalier de pierre, un valet prend vos chapeaux, vos manteaux, et vous les rend à la sortie, sans jamais faire erreur. Au premier, habitent les maîtres; après (p. 198) deux salons, ornés de quelques Falguière «qui coûtent cher», on arrive à la salle à manger, aux buffets où s'alignent les services dorés, puis à la serre, au jardin d'hiver, où les plantes vertes «entretiennent la tradition de la verdure». Au-dessus, habitent les enfants et leurs domestiques. Un hôtel parisien ne serait pas disposé d'une autre façon.
Mais les chambres à coucher sont peu développées: le lit et les tentures ne préoccupent point les Moscovites comme les Français; on campe en Russie plutôt qu'on ne couche. Les couchettes sont petites et étroites, les draps peu larges; le plaisir du lit, «bien rollé», comme disent nos paysans, est inconnu ici. C'est que la maison tout entière protège du froid, nul souffle de l'atmosphère glacée du dehors n'y peut pénétrer, la vie s'isole et s'alourdit parmi les salles aux doubles fenêtres, où monte la chaleur des poêles.
Nous avions déjà parcouru l'hôtel, quand le «patron» vint nous rejoindre. C'était un homme de trente ans environ, bien bâti, d'allure nerveuse. Il était brun, portait de longs cheveux noirs, luisants; dans le visage de teint bronzé, les yeux noirs, légèrement bridés, brillaient derrière les lunettes d'or. Il avait le front haut, l'arcade sourcilière très développée. Il parlait le français très rapidement, avec de brusques arrêts, quand un mot lui manquait, sur ce ton chantant et avec ce zézaiement de beaucoup de Russes, quand ils parlent notre langue. Il se tenait tout près de son interlocuteur, et le fixait obstinément.
Dans sa vie de travail et de plaisirs, ce sont les qualités du moujik que vous retrouvez. Comme le paysan se résigne à émigrer, à reconstruire l'isba plus loin, dans la plaine; comme le soldat marche pendant 1 000 kilomètres en disant: «Nitchévo: ce n'est rien!» ainsi pendant des nuits, pour augmenter sa fortune et pour la manifester, M. K... dîne, boit du champagne, cause avec des marchands et rit avec des femmes.
«Voilà trois nuits que je ne dors pas, nous dit-il. Tous mes amis sont éreintés. Moi, je suis debout». Nitchévo, ce n'est rien.

UNE COUR DU QUARTIER OUVRIER, AVEC L'ICÔNE PROTECTRICE (page 196).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Sans doute, il ne boit plus de vodka. Mais une belle cave, voilà la marque d'une grande fortune! Les vieux vins de Bordeaux ou de Bourgogne, les marques de Champagne, les cognacs à 100 roubles la bouteille, voilà ce qu'il faut montrer au visiteur.
Comme nous paraissions peu sensibles à tout cet étalage, on nous montra l'écurie; son écurie est l'autre orgueil de M. K.... Il fait courir parfois, et il a remporté quelques prix à Moscou.
Dans une cour intérieure, assez sale, où la poussière s'accumulait entre les petits pavés inégaux, des brins de paille traînaient, des tas d'ordures. Dans les maisons particulières, comme dans les hôtels, ces cours intérieures sont toujours malpropres. Les écuries s'ouvraient là.
Un à un, sur la demande du maître, tous les chevaux nous furent amenés. C'étaient d'abord plusieurs paires de magnifiques Orloffs: au repos, ils payaient peu de mine, mais dès qu'on les faisait courir un peu autour de la cour, ces animaux nerveux se redressaient, le corps tout entier tendu. Ils ont la tête très fine, le poitrail très développé; c'est uniquement par le collier qu'ils entraînent la voiture. Ce sont surtout des chevaux de vitesse, ceux avec lesquels le patron, pendant les après-midi d'hiver, laisse derrière lui les autres traîneaux, à travers Petrovsky Park. Le cocher part à fond de train, puis s'arrête, va au pas. Qu'une troïka essaie de le passer, vite, il repart; et c'est avec ces alternatives, au milieu de la joie orgueilleuse du maître, que se fait la promenade. Des chevaux suédois à longue crinière, plus petits, plus trapus et moins nerveux, servent aux longs voyages; ils trottent souvent pendant 60 kilomètres sans manger ni boire, et arrivent frais.
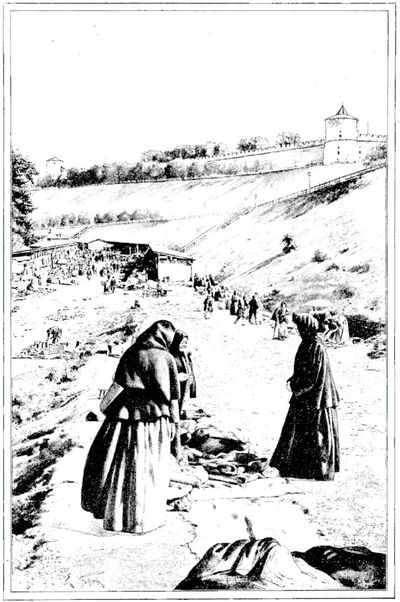
SUR LE FLANC DE LA COLLINE DE NIJNI, AU PIED DE LA ROUTE QUI RELIE LA VIEILLE VILLE À LA NOUVELLE, LA CITADELLE AU MARCHÉ (page 204).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Tandis que leur maître causait, caressait ses chevaux, une foule de domestiques s'empressaient autour de lui. Quand nous étions arrivés dans la cour, ils s'étaient tous précipités, en courant, avaient demandé ses ordres. Maintenant, le long des murs, ils attendaient. Le maître tira une cigarette de son étui; en courant, (p. 200) l'un s'approcha, alluma la cigarette. Trois fois, il revint pour le même office. Le maître eut soif, un autre apporta de la bière. Un tout petit chat, sorti de l'écurie, vint se frotter contre ses jambes; un troisième serviteur s'approcha respectueusement et l'emporta. Je m'étonnai de cet esclavage domestique, de cet empressement à deviner et à satisfaire tous les caprices, et je dis mon étonnement.
«Oh! à Paris, me répondit-il, il y a aussi de bons domestiques! Mais nous ne sommes pas mal servis.»
Je songeai, en même temps, à ses ouvriers, ses autres esclaves, qu'il ne connaissait pas, qui ne pouvaient se signaler par un tel service. J'aurais voulu savoir s'il s'intéressait à leur vie, s'il avait souci de leur condition.
«Avez-vous, lui dis-je, beaucoup d'ouvriers?
—17 000, répondit-il, dans mes filatures....»
Et immédiatement, comme il voyait ma surprise:
«Que voulez-vous? Ici, avec 100 000 francs de revenu par an, on n'est pas riche. Il faut au moins 300 000 francs.»
Ainsi, qu'il organise dans ses filatures un économat, car les ouvriers mêmes ne seraient pas capables de former «l'artel»; qu'il établisse, comme veut la loi, des hôpitaux et des écoles, qu'il paie un médecin pour ses travailleurs, il n'en reste pas moins qu'il faut les exploiter pour mener à Moscou la grande vie occidentale. Nombre d'ouvriers sont payés, là-bas, 4 roubles par semaine, des apprentis 30 kopecks. Et le patron fait cela avec naïveté; il ne s'étonne pas de leur patience, de leur résignation; l'ouvrier n'est-il pas content, avec un petit verre de vodka?
Le moujik vole et ment innocemment; le grand marchand du XIXe siècle, méprisant les vieilles coutumes, vêtu à la mode et rasé, est resté vraiment «moujik de commerce», comme disait Ivan le Terrible; il exploite innocemment. Le sens moral n'est pas très développé dans toutes les âmes russes, depuis le prince Dolgoroukow jusqu'aux plus humbles paysans.
Mais le riche Moscovite n'a pas gardé les traditions pieuses et les saints usages; il n'aime plus en Moscou la ville religieuse, il ne se laisse pas pénétrer par son activité dévote. Il a les yeux fixés sur l'étranger, pour l'imiter ou pour le combattre, et n'a plus d'amour pour la sainte Mère.
Cependant cette classe est forte. Au milieu d'un peuple indolent, qui n'a d'énergie que pour supporter, la bourgeoisie moscovite a de l'initiative.

LE MARCHÉ ÉTINCELAIT DANS SON FOUILLIS (page 195).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Comme les figures de ses saints, la physionomie russe apparaissait hiératique et figée; mais voici que déjà quelques traits s'animent. Tous les sentiments semblaient endormis; voici que déjà quelques-uns excitent à l'action. Et peu à peu, tandis que le caractère de la race devient plus complexe et plus vivant, des caractères individuels s'affirment et se précisent, par des efforts divers pour grandir Moscou et la Russie dans le monde.
M. K... ne songe qu'au commerce, au luxe occidental et pétersbourgeois qui transformera l'ancienne capitale: que les étrangers viennent en foule, et la ville sera puissante. Quand ses fils seront grands, quand ils connaîtront le français, ils partiront pour l'étranger, ils perfectionneront les manufactures, et ils répandront les dernières modes européennes.

DÉJÀ LA GRANDE INDUSTRIE PÉNÈTRE: ON RENCONTRE À MOSCOU DES OUVRIERS MODERNES (page 195).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
M. C..., un autre marchand, au contraire, est préoccupé d'art, de littérature. Nous l'avions rencontré en chemin de fer, il se rendait, pour son commerce, à la foire de Nijni. M. Orloff nous l'avait signalé comme un grand amateur de tableaux. Si M. C... est connaisseur, nous ne savons; mais il aime les arts. Il lit assidûment les articles du Figaro, parle de Michelet, qu'il a lu, dit-il, et de Sorel et de Monod, comme un Français. Mais c'est de nos expositions surtout qu'il aime à parler, de leurs clous, de leurs plus étranges exhibitions, et l'on se demande, parfois, au cours de la conversation, si ce sont nos arts ou ces grands étalages qui l'intéressent le plus vivement.
À la gare de Varsovie, encore au retour, nous avons rencontré un autre Moscovite. C'était un grand vieillard, à longue barbe blanche, de figure ouverte et souriante. Il avait beaucoup voyagé en France, connaissait bien Paris et ses environs. Pour cette raison, peut-être, la vie politique, les questions sociales le préoccupaient. Il aimait son Moscou, mais dans Moscou surtout, tout le rassemblement d'hommes actifs, intelligents, qui pourraient un jour, sans doute, contribuer au Gouvernement. Aussi était-ce avec piété qu'il parlait d'Alexandre II, des réformes de 1861; et il était fier de l'initiative des bourgeois de Moscou, qui, par leurs souscriptions, avaient élevé au tzar réformateur le nouveau monument du Kreml. Il avait 5 000 ouvriers, mais ses ouvriers étaient heureux, incontestablement! «Quelques jours avant son départ, n'avaient-ils pas pourtant voulu faire grève? Il avait informé le gouverneur de Moscou. 130 cosaques étalent venus, mais ils ne suffisaient pas; alors il en avait fait venir 130 autres, et tous avaient poussé les grévistes devant son comptoir. Ceux qui avaient cédé reprenaient le travail; les autres avaient été chassés, condamnés.» Et le bonhomme racontait cela simplement, comme chose juste et toute naturelle; pourquoi demander un salaire plus fort? il vous dit, lui, qu'ils sont heureux. Le partage de l'autocratie entre le tzar et la bourgeoisie, tel semblait pour ce libéral l'idéal du Gouvernement.
Lorsque l'on part un soir de Moscou pour Nijni, c'est une tout autre Russie que l'on découvre à son réveil. Ce n'est plus dans une plaine sans limites, entrecoupée seulement de ruisseaux et de villages que le train court, mais des collines légèrement bleutées ferment l'horizon, les isbas noirs s'espacent presque sur une seule ligne, laissant deviner un fleuve tout proche. Ça et là, sur des chantiers, de grandes barques, encore inachevées, attendent; des filets étendus sèchent au soleil.
Le train passa parmi des bois; puis, sur une vaste place, des pavillons coquets parurent alignés. Nous (p. 202) arrivions à Nijni. Au travers de la foire,—par le grand pont de bois,—c'est à la ville même qu'il faut aller d'abord, comme il faut saluer une mère respectée. Elle s'élève sur une éminence, que la monotonie infinie de la plaine fait paraître encore plus abrupte et plus haute. Elle domine le confluent de l'Oka et de la Volga, et se présente à la Russie lointaine, qui se prolonge vers l'Oural, comme une nouvelle Moscou. N'est-ce pas là, sur cette colline que notre voiture gravit avec lenteur, que la race russe s'est retrouvée, une première fois?
Après les Ivans, la Russie nouvelle s'élevait toute droite, comme une tige vivace et forte; au-dessus des boïars brisés, des bourgeois soumis et des principautés rassemblées, son tzar dominateur, et qui l'avait faite une, gardait parmi les peuples la tradition de l'Empire. Elle surgissait, Byzance nouvelle qui recommencerait contre les païens la lutte du Christ; les ambassadeurs venus d'Occident se pressaient vers elle, et les espoirs s'exaltaient. Mais voici que des malheurs sans nombre l'avaient accablée: la dynastie, farouche et laborieuse, qui l'avait fait grandir s'était éteinte, les tzars nouveaux s'étaient laissé prendre; le métropolite était prisonnier, et, dans Moscou découronnée, les Polonais tenaient le Kreml. Les boïars étaient révoltés et trahissaient; des bords du Don et de ceux du Dnieper, des bandes de Kosaks s'étaient élancées pour piller; et les églises étaient souillées. Le peuple semblait mort; la famine et la peste l'avaient ravagé; et les appels fervents des moines de Troïtza ne faisaient plus sursauter les cœurs.
Un jour pourtant ces appels furent entendus. C'était à Nijni, sur cette esplanade du Kreml, peut-être, où les rayons du soleil s'abattaient avec violence; et devant le peuple assemblé, le protopope lisait la lettre venue du monastère inviolé. Tous, sans doute, étaient émus; mais de la multitude aucun bruit ne montait. Alors Kouzma Minine, le marchand boucher, fut éloquent; il dit ce que tous ressentaient: «Si nous voulons sauver l'empire de Moscovie, il ne faut épargner ni nos terres, ni nos biens; vendons nos maisons, engageons nos femmes et nos enfants; cherchons un homme qui veuille combattre pour la foi orthodoxe et marcher à notre tête.» Pojarski consentit, et le bourgeois Minine avec le noble Pojarski sauvèrent la Moscovie en 1612.

SUR L'OKA, UN LARGE PONT DE BOIS BARRAIT LES EAUX (page 204).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Nous avons visité le Kreml, dont les murailles blanches, au-dessus du brouhaha cosmopolite de la foire, gardent jalousement ce souvenir. Près du palais du gouverneur, l'Église de la Transfiguration dresse son dôme et ses clochetons. Sous l'étendard de Pojarski, Minine y repose, avec la protection des saints et des vierges miraculeuses; en bas, dans la crypte humide, les cercueils des anciens princes de Nijni sont alignés, tous uniformément recouverts d'un drap noir à petite croix d'argent. Nous fûmes frappés par le ton étrange du malheureux qui nous montrait ces souvenirs: dans sa figure pâle, les yeux brillaient avec intensité; par instants, il avait un air inspiré. Il ne débitait pas son récit accoutumé avec l'air de lassitude de tous les gardiens; il parlait, avec vivacité, avec feu, en dévot de ces grandes choses. En face de lui, notre guide semblait embarrassé. «Voilà, reprenait-il en traduisant, il vous dit que....» Et il résumait,—semblant mettre les choses au point.
Derrière le Kreml, toute la ville s'étend; elle semble un grand village. Quelques voies cependant, plus larges et plus droites, suivies par les tramways, sont bordées de boutiques à l'européenne; malgré la hauteur, malgré l'abrupt de ces pentes, les coutumes occidentales sont montées là, et elles ont pénétré l'antique cité russe.
Mais plus loin, tout au bout de la route poussiéreuse qui s'allonge sur le plateau, le monastère de Petchersky demeure dans son isolement. La colline se prolonge en un plateau dénudé et grisâtre, où la ville a peine à se limiter, et où des cabanes isolées une à une s'étendent. Sur les seuils, des femmes regardent; (p. 203) des moujiks nous croisent, portant des seaux pleins d'eau aux extrémités du bâton recourbé qui leur coupe l'épaule. Au bord de la route, une vieille femme à demi voilée, comme les musulmanes, appuyée contre une balustrade, est immobile, protégeant de son ombre une enfant en haillons qui dort, étendue sur le sable chaud.

DANS LE QUARTIER OUVRIER, LES FAMILLES S'ENTASSENT, À TOUS LES ÉTAGES, AUTOUR DE GRANDES COURS (page 196).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Après avoir longé les isbas d'un village, la route descend dans une espèce de petit cirque qui a jour vers la Volga: c'est là que dort le monastère. À droite, sur la pente du fond, devant des bouleaux aux troncs élancés, une maisonnette rit sous le soleil. Tout ce paysage est calme, et la lumière qui filtre au travers des feuillages ne brûle point là, comme dans la plaine. De la Volga, aucune voix, aucun murmure de l'eau ne monte.
Nous avons passé sous la voûte d'une porte: à gauche, des bâtiments alignés avaient tracé le chemin; à droite, parmi les derniers arbres descendus des pontes, un cimetière avait couché ses pierres blanches. C'est là, dit-on, que furent ensevelis les boïars, victimes du Terrible; et leurs cadavres se sont mêlés à ceux des anciens moines.
Par une autre porte, dont la voûte humide faisait pressentir la poussée prochaine des lierres et des orties, nous sommes entrés dans le couvent. Il semblait d'abord qu'il n'y eût personne. La grande cour paraissait immobilisée par le soleil lourd des midis d'été. Deux ou trois figures parurent aux fenêtres; un domestique, puis un diacre vinrent à nous.
Le diacre nous montra l'église: elle était obscure, basse, et pourtant ne manquait pas de coquetterie; les ors et les pierreries n'y éblouissaient pas, mais tiraient les regards sans violence; la demi-lumière tombée des feuillages venait s'y perdre en larges flaques, sur les dalles. Les images nous furent désignées, toutes les richesses accoutumées. Puis, d'une sacristie aux coffres vermoulus, que les toiles d'araignée semblaient seules retenir au mur et sur lesquels traînaient pêle-mêle des livres poussiéreux, le diacre nous apporta le livre des messes que le Terrible avait fondées pour les âmes de ses boïars, puis de vieux manuels de liturgie où les lettres slavonnes éclataient en couleurs vives sur le papier jauni; enfin, avec plus de dévotion encore, le livre de comptes du couvent. Ce qu'avait apporté chacun était noté scrupuleusement, et le diacre tournait les pages pieusement, comme s'il avait senti que la vie des anciens continuait en lui, entre les (p. 204) mêmes murailles, sous le regard des mêmes images, éclatantes toujours, comme autrefois.... Et c'étaient bien les mêmes rêves qui l'environnaient; c'était bien aux mêmes contemplations qu'il s'abandonnait, entre la Volga toute brune, où les regards glissaient, et la verdure clapotante du grand bois.
Ce diacre était beau, avec sa longue barbe, ses yeux gris qui brillaient, ses traits réguliers et forts. Un des nôtres voulut le photographier; il alla revêtir une robe neuve, prit son bonnet au long voile noir, piqua sur sa poitrine le ruban rouge de sa croix, et debout, la poitrine cambrée, majestueux comme s'il officiait, il posa. Ça et là des fenêtres s'entr'ouvraient, d'autres moines paraissaient, s'amusaient de ce spectacle. Il posait sans orgueil, sachant bien qu'il devait être beau pour plaire au peuple et l'attirer à Dieu. Il nous séduisait par son air de force tranquille, par son regard et par sa complaisance à nos caprices de voyageurs. Nous lui avons serré la main, et nous sommes partis.
Le long de la côte, un petit cheval échevelé tirait furieusement son chariot. Une femme a passé avec sa fillette joufflue, qui souriait à nous voir.
Nous avons regagné la ville; nous avons franchi le ravin profond qui la coupe en deux, et de l'extrémité de la colline abrupte, nous avons regardé la plaine. De la terrasse du bazar oriental où nous logions, ou du belvédère du Kreml, ce sont deux panoramas prodigieux qui se déroulent sans limites.
Au Kreml, ce sont des prairies, bossuées à peine de pentes et de montées qui reculent indéfiniment l'horizon. Toutes vertes encore, au premier plan, l'éloignement bientôt les fait paraître bleues ou les revêt d'une brume légère, de la couleur grise et mauve d'un ciel d'automne. Des haies, des bouquets d'arbres l'interrompent, et de toutes parts, une infinité de tas de foin, jaunes comme de petites meules de paille, surgissent parmi la nappe verte. Dans cette immensité, la Volga déploie ses eaux, tantôt miroitant au soleil tout au long de vastes plages, tantôt plus sombres et plus bleues, dans des méandres lointains. Au pied de la colline, sur des bancs de sable, des piles de bois formaient des masses noires régulières; et des chalands aux mâts élancés, serrés les uns contre les autres, semblaient interrompre le fleuve. Un souffle passait, léger, continu, comme lassé par la vastitude des plaines.
Du bazar, au contraire, c'était la foire, le confluent de l'Oka et de la Volga qu'on dominait: l'Oka toute proche, contre la colline, la Volga plus lointaine et plus mystérieuse, quand elle surgissait de la demi-incertitude de l'horizon. Au fond, bordant l'Oka ou se répandant entre les deux fleuves, des forêts faisaient une bande bleue. Un de ces incendies, si fréquents en Russie, poussait tout haut, dans l'air sans souffle, une masse blanche de fumée, qui se confondait avec les nuages. À la lisière des bois, des cheminées d'usine limitaient la foire, c'est-à-dire la ville immense étendue là, dont elles préparaient le trafic. Puis la nappe enveloppante des deux fleuves contenait la multitude des toits verts qui abritaient le grand marché; au-dessus, l'église et la maison centrale se dressaient. Sur l'Oka, parmi le fourmillement des barques, des remorqueurs et des chalands, un large pont de bois barrait les eaux. De longues files de chariots, aux dougas bariolés, les blouses rouges des hommes du peuple, les tramways électriques, faisaient, tout au travers, des lignes parallèles. Sur le flanc de la colline, coupé par la raie jaune d'une allée bien sablée et garnie de bancs, des wagons funiculaires montaient et descendaient, de la ville nouvelle à l'ancienne, du marché à la citadelle.
(À suivre.) Albert Thomas.

LE CHAR FUNÈBRE ÉTAIT BLANC ET DORÉ (page 194).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Droits de traduction et de reproduction réservés.
(p. 205) TOME XI, NOUVELLE SÉRIE.—18e LIV. No 18.—6 Mai 1905.
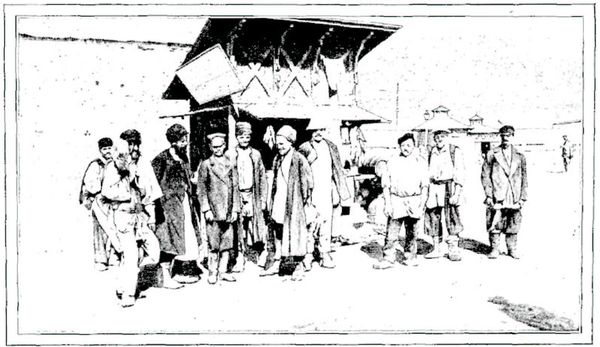
À NIJNI, TOUTES LES RACES SE RENCONTRENT, GRANDS-RUSSIENS, TATARS, TCHERKESSES (page 208).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
III. — La foire de Nijni: marchandises et marchands. — L'œuvre du commerce. — Sur la Volga. — À bord du Sviatoslav. Une visite à Kazan. — La «sainte mère Volga».

UNE FEMME TATARE DE KAZAN DANS L'ENVELOPPEMENT DE SON GRAND CHÂLE (page 214).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
À la foire de Nijni, l'œuvre difficile et féconde du commerce éclate aux yeux tout entière. Dans notre vie sociale d'Occident, si complexe, si continue, nous ne sentons plus, pour ainsi dire, sa difficulté ni sa grandeur. Les denrées arrivent trop facilement, les trains partent trop fréquents et trop rapides. Ici, à Nijni, les marchands sont venus souvent encore en longues caravanes, par les routes poussiéreuses des plaines, ou par le glissement indolent des fleuves, et la bourse cachée, qui marquait leur chair, leur rappelait sans cesse l'impérieuse nécessité des voyages et des trafics. De l'Oural et du Caucase, de Vladivostok ou de Kiatkha, ils ont apporté aux marchands d'Occident les produits innombrables de travailleurs isolés et ils ont senti, dès longtemps, les liens qui unissaient les peuples.
C'est un mot inexact que l'Orient et l'Occident se donnent rendez-vous à Nijni. À vrai dire, c'est un Orient russe et un Occident russe qui se mêlent là. De la civilisation occidentale, ce sont les lampes électriques, les tramways, l'organisation moderne d'une autre Moscou. De l'Orient, ce sont les produits qui s'étalaient déjà au Gostinoï-Dvor de Moscou que l'on rencontre, mais aussi ceux qui les portèrent: des Tcherkesses et des Sibériens, des Finnois et des Tatars, tous les peuples courbés sous le knout.
Nous avons traversé le grand pont par lequel la foule silencieuse allait vers la foire, et nous y avons pénétré avec elle.
Il ne faut pas croire trouver là quelqu'une de ces grandes réunions paysannes qui ne durent qu'un jour, (p. 206) avec de vastes étalages en plein air, des tentes grises et des baraques. Le marché dure six semaines, et il faut des abris aux milliers d'hommes qui le visitent. La foire est donc une ville, toute une ville moderne qu'on a voulue commode et propre.
Toutes les maisons y sont bien russes, faites de bois et recouvertes de toits verts; mais elles s'alignent rigoureusement, à la manière d'Occident, au long des rues larges et régulières. Elles se composent d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surplomb, soutenu par de minces piliers; et l'on se promène ainsi, sous une galerie ininterrompue, où les marchands laissent leurs richesses, lorsque les boutiques sont combles.—Partout, au coin des rues, sur le bord des trottoirs, des fontaines versent de l'eau; et des équipes d'arroseurs, poussant la haute roue où les tuyaux s'enroulent, apaisent la poussière trop souvent remuée. De la gare à la ville, les tramways passent et repassent. Au soir, la clarté des lampes électriques protège la vie des voyageurs. Au croisement des rues, des tourelles blanchies à la chaux laissent voir, par leurs portes, des escaliers qui s'enfoncent sous terre. Ce sont les cabinets d'aisances. D'immenses couloirs dallés, tout bordés de cellules ouvertes, s'étendent ainsi sous la ville: la nuit, une vanne se lève, et les eaux du fleuve pénétrant avec force, purifient ces lieux. C'est un ingénieur français, M. de Béthencourt, qui assura ainsi la salubrité de Nijni.
On nous a conduits à la Maison centrale, un de ces grands halls aux toits de vitres, qu'on appelle «palais» dans les expositions. Ici, c'était avec plus de pompe et de coquetterie que les produits de l'Orient étaient étalés: dans de petites boutiques, le fouillis des bazars s'était ordonné, sur les planches, dans les casiers, dans les vitrines. La fée des légendes était passée là, divisant tout et classant tout, de sa baguette. En haut, dans une galerie transversale, un orchestre jouait. C'étaient des airs simples et populaires, qui tombaient lentement parmi la multitude silencieuse. Des hommes, des femmes du peuple, assis sur des bancs, s'abandonnaient au charme de cette musique et semblaient heureux, comme ils sont à l'office.
Puis, sortis de la Maison centrale, de nouveau, au hasard des rues, nous avons marché.

NOUS AVONS TRAVERSÉ LE GRAND PONT QUI MÈNE À LA FOIRE (page 205).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Nous avons longé les boutiques, regardé, touché les objets, parfois marchandé et acheté. Dans une rue, c'étaient des coffres de toutes dimensions, peints de couleurs vives, ornementés de vernis d'or et d'argent, aux serrures compliquées, et qui servent de commode à la fin des voyages. Dans une autre voie, les charrons avaient accumulé leurs roues. Plus loin, une jeune fille offrait ces châles blancs d'Orenbourg, immenses et si légers, qu'ils peuvent tout entiers passer dans une bague. Un tout petit nous présentait des coffrets vernis qui tentaient par leur simplicité et par les nervures de leur bois. Dans une boutique, des brodequins et des chaussons attiraient les yeux par leurs nœuds roses ou bleus. Des bibelots incrustés d'or, d'argent ou de nacre, des étuis à cigarettes, des portefeuilles, rappelaient, sous les vitrines, le travail délicat des ouvriers d'Orient. Dans un magasin plus vaste, plus lumineux que les autres, des fourrures étaient entassées. Des peaux de martres et de zibelines, des peaux de castors et de renards bleus nous furent montrées; quelques-unes pendaient au mur, noires, moirées de bleu, ou toutes blanches avec des poils bruns qui dépassaient; une odeur fauve émanait de ces dépouilles que la main sentait si douces, et la voix se faisait plus basse, comme étouffée par leur épaisseur lourde. Plus loin encore, sous un abri, des balances gigantesques étaient pendues.
Puis la marche continua. Une idée nous tourmentait: qui donc amassait là ces richesses? quels étaient-ils, les travailleurs anonymes et forts qui les accumulaient en ce lieu? Et tandis que nous passions sans cesse dans des rues nouvelles, comme en des pays nouveaux, nous examinions avec plus d'attention et de sympathie (p. 207) tous ces hommes de races diverses, qui nous heurtaient du coude. Le désir nous prenait de leur demander, comme aux héros d'Homère: «Qui donc es-tu? ô étranger; de quel pays et de quel nom? Es-tu un homme ou bien un Dieu? un marchand ou bien un pirate?»

AU DEHORS, LA VIE DE CHAQUE JOUR S'ÉTALAIT, PÊLE-MÊLE, À L'ORIENTALE (page 207).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
C'étaient d'abord des Tatars aux pommettes saillantes, aux yeux plus nettement bridés que ceux des Russes, aux lèvres grosses, au teint jaunâtre; ils portaient sur le sommet de la tête de petites calottes d'une étoffe sombre, égayée de fleurs, d'aspect sale. Puis des Tcherkesses, au teint bronzé, aux traits plus fins, à la moustache noire et frisée, couverts de longs vêtements gris, à parements noirs, une calotte d'astrakan sur la tête; un enfant suivait parfois, habillé, lui aussi, du costume national, et les jambes tenues dans des bottes minuscules. Des musulmanes, la figure voilée, tout enveloppées dans leur grand châle bleu et blanc, semblaient indifférentes aux regards des passants. Dans le quartier chinois, aux toits recourbés, aux inscriptions voyantes et bizarres, nous n'avons pas vu de Chinois; mais le thé arrivait en longues caravanes, de la frontière sibérienne, dans d'énormes ballots de peaux de bœuf, que les expéditeurs avaient marquées au couteau de signes cabalistiques. Surtout, des tablettes, vert sombre, comme des plaques de bronze, attiraient les yeux. Ce sont des briques de thé: elles sont fort dures, contiennent un nombre infini de feuilles comprimées et coûtent peu. L'homme du peuple les gratte, enlève quelques copeaux verts dont il fait son thé. Le quartier persan était désert; ses habitants arrivent tard.
Au dehors, parmi les rues, comme s'il avait fallu ne rien prélever sur la place trop étroite, réservée aux trafics immenses, la vie de chaque jour s'étalait, pêle-mêle, à l'orientale. Les petits marchands étaient innombrables; des marchands d'œufs tenaient leurs deux paniers aux extrémités d'un bâton recourbé qui leur fléchissait la taille. Au coin des rues, des marchandes de kvass, un pied sur le trottoir, soutenaient du genou la carafe de verre où le soleil jouait, dans la liqueur rouge. Puis c'étaient des gâteaux, des fruits qu'une fillette proposait aux passants.
Des galeries et des rues, un murmure de vie, perceptible à peine, s'élevait; ni tapage, ni tumulte, pas même le brouhaha des activités indécises. Des hommes traversaient la chaussée, leur théière en main, couraient chercher de l'eau, et, dans la pénombre des boutiques, on les apercevait, derrière les comptoirs, qui buvaient leur thé dans la soucoupe, un bout de sucre entre les dents. D'autres, des pauvres, assis sur les bords des trottoirs, déjeunaient d'un fruit, d'une pastèque, d'un poisson séché au soleil.
(p. 208) À l'extrémité des larges voies qui s'ouvrent vers la plaine, des campements sont disposés. Près des chariots, près des chevaux dételés, attachés à un arbre ou à leur voiture même, les hommes reposent sur un bout d'étoffe ou enveloppés seulement dans leur touloupe.
Un prince a eu souci de cette misère: il a bâti deux vastes bâtiments semblables aux grands marchés de nos villes, l'un où les pauvres mangent, l'autre où ils s'abritent pour dormir. Dans le premier, les moujiks assis, les coudes sur la table et le regard vague, dévoraient leurs poissons séchés, leurs fruits et les débris d'une viande vieille et déjà puante qu'un marchand vendait à l'entrée. Le samovar, heureusement, sifflait, et beaucoup, le sucre entre les dents, se réjouissaient du thé.
À l'asile de nuit, la foule commençait d'arriver: chacun prenait une place en silence sur deux étages de planches, dont les rangées traversaient la salle en toute sa longueur. Ils plaçaient sous la tête leur paquet de hardes, s'étendaient et dormaient. Ils entraient, sortaient librement. Quelques-uns, à la porte, attendaient à plus tard et parlaient entre eux.
Près de l'asile, enfin, nous sommes allés au marché des cloches; elles étaient toutes suspendues sur des bâtis de bois, grandes et petites, à la voix puissante ou au son cristallin, attendant de verser aux misérables moujiks les consolations toujours attendues. La lumière affaiblie glissait sur le métal luisant de leurs parois et se répandait sur la foule des pauvres qui les venait voir.

LES GALERIES COUVERTES, DEVANT LES BOUTIQUES DE NIJNI (page 206).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
C'était l'heure où, malgré la vigueur encore intacte du soleil, on pressent le crépuscule prochain, l'heure des énergies déployées et du travail plus intense, dont le résultat va se décider. Par les rues, la foule bariolée coulait toujours; des familles repartaient sur leurs chariots, le père, le grand-père souvent, la femme et les enfants, étendus sur la paille,—et le petit cheval à la longue crinière flottante, à l'œil intelligent, tirait avec furie. Parmi les courses hardies des charretiers, aux blouses bouffantes, qui se réjouissaient des galops sourds sur le pont de bois et des sauts de leur voiture vide, les tramways allaient de leur vitesse assurée, unie. Les cosaks, immobiles au croisement des voies, réglaient ce flot de la rue. Et, dans cette heure dernière de l'activité, la multitude oubliait, semblait-il, les gains égoïstes, comme saisie tout entière par la puissance dominatrice du travail unique qui s'accomplissait là.
C'est alors que l'unité vraie de la ville devenait sensible. Elles importaient peu les jouissances opposées, dont le désir avait rassemblé tous ces hommes étrangers; mais par le contact, par la fusion de ces multitudes, les efforts s'unissaient dans une même œuvre, et la ville entière y participait. L'importance de la foire de Nijni dans la vie russe éclatait. L'empire des tzars est avant tout une grande mêlée des races; pour qu'elles s'usent mieux entre elles, pour qu'elles fusent plus complètement les unes dans les autres, ou pour que les forces de leur originalité disparue augmentent et renouvellent la vigueur des Grands-Russiens, n'est-il pas nécessaire, en effet, qu'elles prennent contact, qu'elles s'éprouvent mutuellement en de grandes occasions? Vassili Ivanovitch l'avait bien compris lorsque, pour faire échec à la foire de Kazan, il fondait celle de Makarieff, qui devint plus tard celle de Nijni, sur les bords mêmes de cette Volga, où toutes les races, tatares, finnoises et slaves avaient indiqué par leurs migrations le chemin du rendez-vous. Aujourd'hui encore, c'est sous la protection et sous l'autorité du gouverneur russe que le grand marché s'ordonne.

DANS LES RUES, LES PETITS MARCHANDS ÉTAIENT INNOMBRABLES (page 207).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Nous sommes allés chez le gouverneur. On nous fit pénétrer dans une vaste salle, aux murs dénudés, tout blancs, à filets d'or. Autour d'une petite table, où des papiers traînaient parmi des cendriers, des boîtes d'allumettes, des cigarettes et des verres de thé, plusieurs secrétaires travaillaient, sans grande hâte, peu attentifs à leur ouvrage, fumant, buvant, causant, en bons fonctionnaires russes. Le chef de la police, un colonel, plusieurs fonctionnaires attendant d'être introduits, formaient un petit groupe au milieu de la salle. Au long des murs, des femmes, des enfants, des hommes pâles, faibles et las, avaient (p. 209) peine à supporter l'attente; la misère de deux femmes en noir éclatait violemment sur la paroi blanche. Des Tcherkesses exposaient avec une lenteur fière leurs demandes; de temps à autre, un moujik poussait la porte doucement et entrait timide. Une mère nous présentait son enfant, les larmes aux yeux, et, sans mots, sans tendre la main, du regard seulement, implorait quelques kopecks; une autre parlait d'un ton plaintif, et l'on sentait sa crainte de n'être pas écoutée: c'étaient l'aspect et les attitudes des salles d'attente dans nos cliniques. Près de la fenêtre, devant un rideau blanc que traversaient les rayons du soleil, une vieille femme, aux joues creuses, aux rides profondes, aux yeux brillants, toute vêtue de rouge sombre, était accroupie, les coudes sur ses genoux, le menton dans les mains. Elle regardait fixement, comme la sorcière haineuse et sarcastique des vieux contes.
Comme le crépuscule commençait, entre les deux talus verts où la route s'insinue, nos voitures remontaient au bazar oriental. Cet hôtel est un lieu de plaisir, une maison de thé, le Mavretagn de Nijni. Dans un grand pavillon, dont le balcon aux boiseries découpées domine la vallée, un restaurant et une salle de café-concert sont disposés. Tout autour, dans un jardin, des chalets en bois à un étage, perdus dans la verdure, abritent les étrangers paisibles ou cachent les débauches des riches marchands.
Nous avons dîné à l'heure de France, tandis qu'au ciel se déployait la splendeur du soir.
Sur la scène, pendant le dîner, des chœurs parurent; c'étaient des hommes, car les femmes, nous expliqua Orloff, avaient causé du scandale. Ils portaient le costume national, aux couleurs voyantes, les larges bottes; ils chantaient des airs populaires et dansaient la «cosaque». Ils nous chantèrent la Marseillaise, en russe, sans élan, sur un ton presque résigné. Entre temps, un orchestre jouait. Peu à peu des drojkis arrivaient; la salle s'emplissait de bruit et de fumée.
Elle était comble quand un nègre, fort médiocre acteur et mauvais acrobate, débita quelques monologues et chansonnettes comiques, exécuta quelques tours. Alors ce fut un trépignement d'enthousiasme dans ce public qui restait insensible, un instant auparavant, aux chants sereins et presque religieux des chœurs populaires. Les femmes levaient leur verre en l'honneur de ce pitre, et leurs joues s'empourpraient sous la poudre de riz; un officier applaudissait à tout rompre, et son battement de mains se prolongeait après tous les autres.
Tous ces gens-là, nous ne les avions pas vus par les rues: le jour, ils étaient dans les maisons de thé, avec les Orientaux, les marchands aux caftans bruns, sur les quais des fleuves, brassant les affaires, achetant pour des millions de roubles des marchandises non débarquées et qui continuaient vers un autre point. Le soir, ils montent ici pour la fête obligatoire; ils sont riches, il faut qu'ils ripaillent, comme le moujik boit s'il a vingt kopecks.
Très tard, accoudés à la balustrade, tandis que derrière nous, dans la salle illuminée, leur foule se laissait griser par la fumée, la lumière, les applaudissements et les rires, nous regardions la ville endormie et sereine, dont le labeur silencieux et frémissant s'était apaisé. À l'horizon, une lueur encore demeurait et se reflétait plus faible, dans une dérivation de la Volga, là-bas, près de l'endroit où les campements populaires (p. 210) étaient dressés. Dans l'eau sombre des deux rivières, les lueurs tremblotantes des lampes faisaient de longues traînées tout autour des bateaux qui semblaient plus noirs. Le grand pont de l'Oka, baigné par la lumière douce de l'électricité, formait une large raie blanche, et l'on voyait encore des hommes qui passaient. Parfois un sifflet de remorqueur déchirait la nuit, et sa violence dominait le vain tumulte de la fête.
Nous rêvions alors aux transformations énormes que ces marchands accomplissaient inconsciemment. C'était pour eux, c'était à cause de leurs trafics et pour leurs plus grandes richesses que les chemins de fer poussaient leurs voies toutes droites au travers des steppes, et que les remorqueurs remplaçaient maintenant les manèges grinçants des vieux chalands. Elle est de moins en moins nombreuse la foule qui vient à Nijni. Bien des boutiques sont désertes, des marchands paraissent, traitent une affaire, repartent; et bientôt les fers de l'Oural, qui s'y accumulent et encombrent ses quais, s'en iront désormais, d'un cours réglé, par chemin de fer, vers les plaines du Don et la Russie du Sud.
Bientôt, peut-être, la grande assemblée de Nijni n'aura plus lieu, et si les riches marchands traversent plus fréquemment l'Asie, si les courtiers européens arrivent jusqu'au centre des peuples tcherkesses ou tatars, les grandes caravanes ne se rencontreront plus à l'antique foire. Les chemins de fer auront eu ce premier effet d'isoler les peuples, de supprimer le contact des foules. Mais par eux la vie économique des diverses régions sera bientôt intensifiée; les divers marchés entreront dans la dépendance les uns des autres, et ce sera une solidarité plus profonde et plus durable qui unira les peuples de l'immense empire.
Nous nous souviendrons longtemps des heures délicieuses passées sur la Volga, de Nijni-Novgorod jusqu'à Samara. Ce n'était plus, en tumulte, des spectacles divers et heurtés qui surgissaient devant nous, mais, pendant trois jours, le même grand paysage se développant à l'infini, monotone et pourtant varié!
Ce fut sur le Sviatoslav, un des beaux paquebots à aubes de la Compagnie Caucase et Mercure que nous fîmes cette traversée. Tout en bas, les marchandises y étaient accumulées: des ballots d'étoffes, des produits de l'industrie moscovite qui descendaient vers Astrakhan. En haut, les passagers logeaient. Des toiles blanches abritant le pont, claquaient au vent. Au-dessus enfin, la dunette. Entre les deux tambours, la cabine du pilote dominait le fleuve; ils étaient là quatre ou cinq hommes, attentifs, les mains sur les poignées qui commandaient le gouvernail.

DANS UNE RUE, C ÉTAIENT DES COFFRES DU TOUTES DIMENSIONS, PEINTS DE COULEURS VIVES (page 206).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
En Russie, où les voyages durent parfois une semaine, où il faut parcourir de longs espaces pour découvrir enfin un horizon nouveau, des relations familières se nouent vite entre voyageurs. Des enfants jouaient, couraient sur le pont, et les cris joyeux des petites filles «attrapées» riaient dans les couloirs comme des chants d'oiseaux. D'autres, plus hardis, plus mondains déjà, s'en venaient vers nous, comme leurs parents, et voulaient être photographiés. Un petit d'Orenbourg, surtout, aux yeux gris bleu, au front haut et étroit, un bambin de dix ans qui souriait toujours, venait causer avec nous, en allemand; il prononçait à la russe, sur un ton chantant, d'une petite voix nette et précise. Lorsque nous lui dîmes que nous allions à Tomsk, il eut un rire de surprise, un «io, io, io» adorable, à nous rendre orgueilleux d'aller en Sibérie. C'étaient les femmes, ensuite, ni bien jolies, ni bien élégantes sous leurs fichus légers de Kazan; mais des convenances gênantes n'entravaient point leur gaieté. Plusieurs, fort ennuyées de ne point connaître le français, nous proposaient de résoudre la «question du jour», de ces anneaux emmêlés qu'il faut dégager, sans forcer, et que nos camelots vendent sur les boulevards; l'une d'elles entr'ouvrait la porte du salon, regardait nos efforts inutiles, et nous les entendions alors qui riaient (p. 212) toutes sur le pont. Le soir, à l'avant, un petit cercle se formait: le capitaine et son second, un médecin qui retournait à Kazan; des tchinovniks et des marchands s'entretenaient avec nous. Orloff, notre guide, attentif, traduisait, résumait: et c'était plaisir de voir cet empressement hospitalier de tous, du capitaine surtout, dont la voix très douce chantait plus souvent, plus respectueusement écoutée.

PRÈS DE L'ASILE, NOUS SOMMES ALLÉS AU MARCHÉ AUX CLOCHES (page 208).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
À l'arrière, dans un grand dortoir, avec deux étages de planches, le peuple était entassé pêle-mêle parmi ses paquets et ses provisions. Au chaud soleil, dans les rues actives, le moujik isolé nous avait semblé moins misérable, mais dans cette vaste salle, on ne voyait plus qu'un amoncellement de savons malpropres, de touloupes graisseuses, de jupes déchirées et maculées. Parfois un bras s'étirait; une jambe, entourée d'un lacis de cordelettes, changeait de position. Des familles s'étaient groupées, femmes et enfants; ils s'asseyaient en cercle sur leurs bagages et savouraient le thé; sur le pont, une grande bouilloire, à toute heure, leur donnait de l'eau chaude. Il y avait là des émigrants, des marchands au caftan brun, dont quelques-uns, dit-on, étaient fort riches, des Asiatiques qui revenaient de Nijni. Tous, résignés, supportaient sans se plaindre la fatigue du voyage et le contact lourd des autres. Aux escales, ils s'animaient, descendaient et couraient, achetaient des provisions; puis tout rentrait dans le demi-silence de leur résignation.

PLUS LOIN, SOUS UN ABRI, DES BALANCES GIGANTESQUES ÉTAIENT PENDUES (page 206).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
D'une allure régulière, le Sviatoslav glissait sur le fleuve; il allait prudemment pourtant, le jour, entre les bouées qui signalaient les bancs de sable; la nuit, entre leurs lueurs pâlottes, dont le reflet tremblait sur l'eau, et les feux rouges du rivage, au long des passes. Souvent des sondeurs, armés de perches graduées, se rendaient à la proue. Ils jetaient leur bâton, puis, par de grands cris monotones, transmis de bouche en bouche, ils annonçaient la profondeur. La nuit, lorsque le tressautement du navire, aux coups réguliers de la bielle, s'entendait plus distinct, lorsqu'on ne voyait plus dans le lointain que les falots, rouge et vert, d'un autre bateau, ces sons monotones, qui réglaient, parmi le sommeil du fleuve et de ses rives, cette activité isolée, semblaient étranges, inquiétants. Parfois le Sviatoslav touchait, frottait contre le banc de sable, et l'on entendait des planches qui craquaient sourdement.... Mais les aubes battaient plus vite; le navire s'enlevait, passait.
Pendant des heures, accoudés au bordage d'avant, nous regardions le paysage, indéfiniment renouvelé dans sa monotonie même. C'était, sur la rive droite, la ligne continue des falaises, sans grande élévation, qui dominent le fleuve. Elles étaient dénudées souvent ou recouvertes d'une herbe maigre, jaunie au soleil; un bois de sapins parfois s'y accrochait, ou c'étaient tout en haut les troncs blancs des bouleaux qui luisaient. Parfois aussi, la falaise s'évasait, formait un large amphithéâtre qui s'ouvrait sur la Volga, et les villages, à l'abri de leur église blanche, aux coupoles vertes, y disposaient à l'aise leurs isbas en rondins. Ils étaient si haut perchés, si bien protégés contre les crues qu'ils semblaient tout à fait séparés du fleuve. Des routes, cependant, y conduisaient, qu'on découvrait parfois toutes blanches sur le talus jaune.
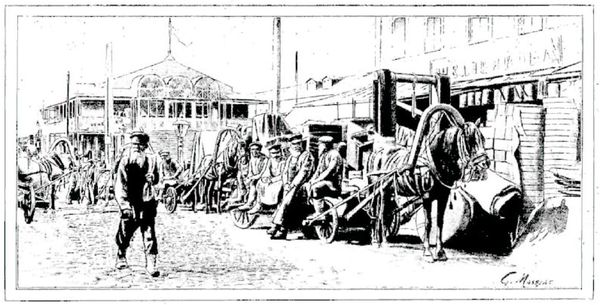
DANS UNE AUTRE RUE, LES CHARHONS AVAIENT ACCUMULÉ LEURS ROUES (page 206).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
À gauche, c'était la plaine unie, à l'infini. Dans le fleuve même, elle se prolongeait par de vastes plages sablonneuses, par des bancs de sable, comme si les collines de la rive droite seules l'arrêtaient. Et, de fait, entre le fleuve large et la plaine qu'il anime, il y a comme une amitié naturelle. Pendant l'hiver, il l'étend lui-même par la surface lisse de ses glaces; plus tard, à la débâcle, c'est lui qui va vers elle, s'enfle, sort de (p. 213) son lit et répand au loin, sur 20 verstes, ses eaux fécondantes. C'est pour cela que les villages se réfugient là-bas à l'abri des ondulations boisées qu'on aperçoit à l'horizon, enveloppées de brume bleue.
Entre ces rives, la Volga déroule largement ses eaux. Point de courants, point de rapides; mais vraiment «le chemin qui marche», la belle route qui glisse loin tout entière, et dont les eaux puissantes et calmes unissent les peuples.

PAYSANNES RUSSES, DE CELLES QU'ON RENCONTRE AUX PETITS MARCHÉS DES DÉBARCADÈRES OU DES STATIONS (page 215).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
De Nijni jusqu'à Samara, la navigation est fort animée.
C'étaient d'abord les grands paquebots qui nous croisaient, au milieu d'appels joyeux et de saluts réciproques. Puis c'étaient des chalands, dont le passage lourd restait longtemps marqué sur la surface de l'eau. De Moscou, de Nijni, vers le Caucase et vers l'Asie, ils transportaient les produits d'Occident, les indiennes, les rouenneries, les bibelots des civilisés. En sens inverse, les matières brutes de l'Orient remontaient le courant comme une masse énorme de travail en puissance: du blé, du coton, du pétrole enfin que les puits avaient déversé dans les grands réservoirs flottants. Mais les chevaux de halage, que l'on attelait autrefois en foule, et les mariniers, courbés sur la perche, avaient disparu. À peine voyait-on çà et là quelques voiles immenses, qui ramassaient le vent. Partout, la vapeur, l'essoufflement des remorqueurs, leur hâte. Dans le calme infini de ces lieux, l'effort haletant de la navigation moderne semblait se perdre, et les yeux suivaient avec plus de joie les grands trains de bois qui s'abandonnaient avec confiance à la grande force du fleuve.
Autour des villages, une agitation joyeuse régnait. Des bateaux de pêcheurs, des bacs, ponctuaient la nappe des eaux. Dès que le sifflet du Sviatoslav se répercutait au long de la falaise, pénétrait sous les bois et dans les cirques des villages, des canots partaient de la rive, approchaient, malgré le remous des aubes, et les riverains adroits lançaient les paquets de lettres ou recevaient les autres au vol.
Un matin, nous accostâmes au débarcadère de Kazan. C'était un ponton carré, couvert d'un vaste baraquement. L'activité était là, plus dense, et dans la foule des marchands, on sentait la fièvre d une ville. Des fillettes offraient dans des corbeilles des gâteaux ou des pommes; des femmes tenaient un seau de kvass, tendaient un verre; d'autres étaient assises tout au long du pont par où les voyageurs gagnaient la rive; elles avaient devant elles des tas de pastèques ou des ogourtsis (concombres).
Plus haut, sur la route bordée de petits auvents, des marchands, debout, proposaient du pain, de la (p. 214) viande, des poissons séchés. Parmi la foule des moujiks qui couraient aux provisions, des débardeurs, en longue file, transportaient des sacs de blé, des marchands tatars, allant de l'un à l'autre, étalaient sur leurs bras tout un choix bariolé de ces mouchoirs de cou, si légers et si transparents, qu'on fabrique à Kazan. Des bambins se haussaient pour nous offrir du lait, dans des bouteilles de toutes formes. Point d'annonces bruyantes, point de cris discordants, mais de la foule environnante qui vous pressait, qui semblait vous barrer le chemin, un murmure de sollicitation montait, irrésistible.
Nous avons loué des drojkis pour pousser jusqu'à la ville, qui s'étend à 7 verstes de là. Nous avons suivi d'abord une large rue, bordée de maisons de bois à grandes boutiques, et qui prolonge, pour ainsi dire, le débarcadère; il n'y a guère en cet endroit que des boutiques de comestibles et des bureaux.
Le port est relié à Kazan par une chaussée en remblai qui coupe la plaine. Un mince filet d'eau y coulait encore à cette époque de l'année; au moment des inondations, la Volga la couvre toute. On apercevait, d'un côté, un remblai nouveau, celui du chemin de fer, qui se déployait en une longue courbe; de l'autre, parmi l'herbe maigre et desséchée, sur les bords de grandes flaques d'eau, des piles de bois étaient dressées; on travaillait dans des chantiers. À l'extrémité de la route, les tours blanches du Kreml et leurs clochetons dorés faisaient une barrière.
Notre visite fut rapide. Par les rues droites et régulières, nos drojkis ont parcouru la ville haute et le Kreml; c'est là qu'habitent les fonctionnaires et les Russes. Mais dans la plaine basse, de l'autre côté, habitent les Tatars. Vers les portes, dans les faubourgs qui ceignent toutes les villes de vie populaire et de travail, nous en avons vu quelques-uns, quelques types de cette population singulièrement forte, intacte, non russifiée. Ces musulmans sont comme les juifs en Occident; ces femmes voilées, à la marche lente, dans l'enveloppement de leur grand châle, ces hommes d'allure vigoureuse, de force ramassée, accomplissent avec application l'œuvre de chaque jour. Les marchands de chiffons et de vieux habits sont nombreux à Kazan, les petits métiers fleurissent. Parfois les hommes partent, vont dans les grandes villes, domestiques ou garçons de restaurant, probes et économes toujours; mais ils restent musulmans.
Par ces qualités du Tatar, l'industrie devait grandir et transformer Kazan; des usines se sont établies et prospèrent. Vers midi, des ouvriers sortaient, des hommes et des apprentis, couverts de vêtements sombres, bleus ou noirs. Ils ne se répandaient pas par la rue, mais se suivaient en petits groupes, au long des trottoirs. Nulle hâte, nul cri: ils ne sentaient pas, comme nos ouvriers nerveux et délicats, le besoin des mouvements libres, déréglés. Simplement, ils avaient ajusté leur effort à cette tâche nouvelle, et ils la faisaient, comme les travaux anciens, avec la même application tenace.

LE KREML DE KAZAN. C'EST LÀ QUE SONT LES ÉGLISES ET LES ADMINISTRATIONS (page 214).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Dans la plaine sablonneuse, vers le port, le commerce fourmillait. Des chevaux passaient, chargés de paquets; des charrettes se suivaient en longues files; des drojkis filaient, enveloppés de poussière, défiant les poursuites. C'était, sous le soleil aveuglant, une hâte fiévreuse. Plus proche de l'Asie et restée comme nomade, malgré la fermeté de son Kreml, dont les hautes tours la rassemblent, Kazan demeure encore aujourd'hui, sur les bords de la Volga, la ville orientale où l'Asie, qui la créa, concentre toujours ses produits.
Mais la foule se pressait vers le ponton, plus bruyante un peu, car l'heure du départ approchait; la cloche sonna trois fois, et le Sviatoslav repartit, du mouvement régulier de ses palettes.
Au soir du même jour, après le confluent de la Kama, au moment où les rives du fleuve devenaient moins nettes et que ses eaux abondantes semblaient vouloir envahir la plaine, le bateau parut incertain de sa route, il tourna sur lui-même, accosta près d'un bateau noir, en fer, surmonté seulement d'une pompe à bras, où des moujiks attendaient. C'était le réservoir de pétrole.
Un passeur nous a conduits sur la rive, et nous l'avons suivie quelque temps pendant l'arrêt.
La berge était plus haute que de coutume sur la rive gauche; elle montait doucement, par une pente couverte de buissons, d'arbustes et de fleurs. Un isba était là, tout proche; nous avons voulu le visiter.

SUR LA BERGE, DES TARANTASS ÉTAIENT RANGÉES (page 216).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHE DE M. THIÉBEAUX.
Un vieux moujik se tenait à la porte, vendant des fruits, du pain et du poisson. Orloff entra sans lui demander la permission.
Il y avait deux salles, de plafond peu élevé, séparées par une cloison de bois; mais, perçant la cloison, des deux côtés le poêle s'étendait. C'est sur ce poêle que la famille russe couche pendant l'hiver. Dans la première salle, il y avait des tonneaux, des écuelles, des pots, de grands coffres en bois, les ustensiles de la vie quotidienne, jetés là pêle-mêle dans un coin. L'autre était la chambre; point de lit, point d'autres vêtements: le moujik a sur lui toute sa garde-robe. Tout autour de la salle, des bancs étaient fixés, assez larges, où l'on couche pendant l'été; il y avait aussi des tables, quelques verres, et sous les lueurs du soleil couchant, deux samovars étincelaient. Une vieille femme alignait des pains noirs sortant du four; elle nous reconduisit, vint avec nous sur le seuil de la porte. Entre le plafond et le toit de l'isba, dans un grenier ouvert à tous les vents, on apercevait les tonneaux et les pots de grès qui servent à fabriquer le kvass ou à préparer le chtchi, le fameux potage aux choux aigres.
À la porte, sous un auvent, le vieux vendait toujours. Orloff nous présenta comme des «Français de Paris», ce qui fit sourire le moujik, sans qu'il parût comprendre; puis le guide plaisanta, tapota sur les bras nus de la bonne femme, la fit «tournevirer», lança quelques mots qui firent rire des soldats, et après force poignées de main, force salutations du vieux, nous redescendîmes vers le bateau.
C'était, tout autour du débarcadère, la même animation qu'à Kazan: tous les marchands de pommes, de pastèques, de kvass, les paysannes offrant leur lait, des débardeurs transportant des sacs de blé. Mais toute cette foule était bruyante, plus secouée d'une rude gaieté populaire; des soldats, dont on voyait partout les uniformes blancs parmi les jupes bariolées et les blouses rouges, s'embarquaient pour des manœuvres, et, dans un autre paquebot, entre le Sviatoslav et le ponton, les canons avaient été tirés. Notre public de troisième classe se pressait autour d'un petit cabaret de bois; chacun prenait un verre et se servait; le patron, souriant, se contentait de surveiller. Au coup de cloche, tous se dispersèrent, coururent au bateau.
Et le Sviatoslav une fois encore reprit le courant; le crépuscule défaillait déjà, mais ses lueurs affaiblies prolongèrent le soir indéfiniment. Tandis que la nuit avait avancé du fond de la plaine et que la lune, à l'horizon, se levait, incertaine et rougeâtre à l'ouest, le brouillard qui surgissait du fleuve semblait tenir en suspension des teintes rouges, sans éclat, sous le bleu sombre des flots. La nuit, le brouillard, les couleurs, s'élançaient de tous côtés, s'inséraient dans le paysage. La Volga elle-même n'avait plus son allure calme et douce, elle avait peine, semblait-il, à retenir ses eaux; ses berges semblaient moins certaines; la rive droite, moins haute, moins régulière, était entaillée par de larges golfes. Et tandis que les palettes brassaient l'eau plus nerveusement, et que le vent froid de la nuit cinglait déjà la figure, une inquiétude irraisonnée nous saisissait.
Puis, lentement, tout s'apaisa; la lune était maintenant haut dans le ciel; ses rayons se reflétaient en un long cierge tremblotant, dont les lueurs indécises venaient se perdre à l'entour du bateau. Des nuages (p. 216) passaient, mais si légers et transparents qu'ils n'interrompaient point les rayons des étoiles. Dans l'ombre, les rives redevenaient plus proches, plus secourables, et le moujik pouvait reprendre confiance en la grande rivière protectrice, en «la sainte mère Volga». Parfois des chants venaient à travers le silence: tantôt la mélopée lente des hommes de peine qui tiraient un bateau ou le déchargeaient, tantôt, sur une péniche, des mariniers qui se plaisaient à faire sonner leur voix dans le silence, sur les eaux. Ou apercevait les fanaux vert et rouge des bateaux qui remontaient; le travail des hommes ne s'arrêtait pas.
Et nous songions, dans la nuit, au tumulte des peuples qui s'étaient rencontrés là, au heurt des races et des hommes dont les souvenirs persistaient. Les races de l'Orient s'étaient avancées jusqu'à ces bords paisibles, puis elles s'étaient établies. Des Finnois d'abord, les Moraves, les Tchouvaches, les Tchérémisses et les Votiaks; des peuples primitifs et doux, vivant de la chasse et de la pêche, et dont de petits groupes isolés perpétuent aujourd'hui le nom et les coutumes. Puis c'étaient les hordes conquérantes, les Khajars, les Bulgares et les Mongols, dont les chevaux, arrêtés soudain sur la rive, avaient fait dérouler du sable dans les eaux calmes. Itil, Bolgary, Saraï, toutes les capitales ruinées, dormaient à l'entour de Kazan, héritière de leur grandeur, déchue aussi, mais vivante. Et maintenant la sainte rivière était russe tout entière; de Rybinsk à Astrakhan, elle ne reflétait plus que les armes impériales à la proue des bateaux, ou les lettres slavonnes de leurs noms. Mais le fourmillement des hommes était devenu plus grand, et les races qu'elle supportait, plus nombreuses. Elle avait enseigné le chemin à la race voyageuse des Grands-Russiens; vers l'Asie, elle avait entraîné leurs bandes nombreuses, comme autrefois le Dnieper emportait vers Byzance leurs blanches flottilles. Et tous partaient avec confiance, car la sainte Volga ne pouvait être trompeuse. Aujourd'hui, toujours, d'autres partaient pour peupler les pays nouveaux que le cours du fleuve avait faits leurs. Et d'autres races remontaient vers Kazan, Nijni ou Moscou, dont les désirs âpres et la curiosité avaient été éveillés par la venue de ces hommes blonds. C'était toujours «la route unie», la voie naturelle de ces pays, et elle coulait désormais, comme les antiques voies romaines, entre deux lignes de tombeaux.
Au matin, le bateau est entré dans la boucle de Samara. C'était une matinée toute blanche, où, devant le soleil, les brumes de la terre montaient purifiées. À droite, les monts élevés, couverts de bois sombres, paraissaient tout bleus dans l'air du matin; et le sifflet du Sviatoslav s'y répercutait longuement.
À Stavropol, ce fut le dernier arrêt avant Samara. Comme toujours, la ville était loin dans les terres; une route poussiéreuse, à larges ornières, y conduisait. Sur la berge, dont le sable fin brûlait, des tarantass étaient rangées; les petits chevaux piaffaient, secouaient la tête; et les sonnettes pendues à la douga faisaient entendre un carillon nerveux et impatient.
Puis les dernières heures s'écoulèrent avant l'arrivée; le soleil était haut déjà dans le ciel, et ses rayons dardés se répandaient sur l'eau, en flaques miroitantes. À la gaieté du matin, au fleuve qui manifestait sa puissance, l'imagination plus alerte répondait; elle évoquait une dernière fois les paysages accoutumés des derniers jours, la suite ininterrompue des hautes falaises, avec leurs bois et leurs villages, la plaine immense et ses plages sablonneuses, et cette large coulée de flots qui avait aidé si longtemps le labeur des hommes.
(À suivre.) Albert Thomas.
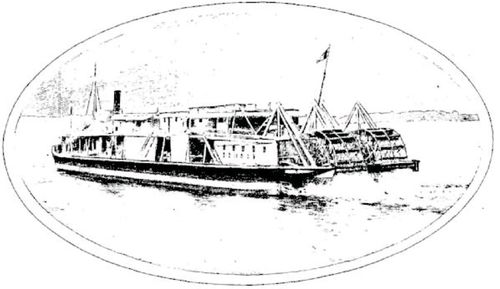
PARTOUT SUR LA VOLGA D'IMMENSES PAQUEBOTS ET DES REMORQUEURS (page 213).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Droits de traduction et de reproduction réservés.
(p. 217) TOME XI, NOUVELLE SÉRIE.—19e LIV. No 19—13 Mai 1905.

À PRESQUE TOUTES LES GARES IL SE FORME SPONTANÉMENT UN PETIT MARCHÉ (page 222).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
IV. — De Samara à Tomsk. — La vie du train. — Les passagers et l'équipage: les soirées. — Dans le steppe: l'effort des hommes. — Les émigrants.

DANS LA PLAINE (page 221).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Par un gris matin d'août, nous sommes montés sur le «Transsibérien», et nous avons retrouvé le plaisir paresseux des trains russes. De Samara jusqu'à Oufa, nous avons traversé, pendant tout un jour, la plaine qui précédé l'Oural. C'était à l'infini l'étendue grise des champs fauchés. Près de la voie, les villages étaient rares, mais plus populeux, plus vastes; et ils se ressemblaient tous avec leur église, leur cimetière sous un bois de bouleaux, leurs isbas noires et pitoyables, et leurs petits enclos, où verdissaient quelques légumes, où des tournesols agitaient, au bout des tiges, leurs «soleils» jaunes. On les trouvait, de préférence, au bord des cours d'eau, petites rivières lentes qui avaient creusé dans le sol friable des vallées minuscules et abruptes.—Et plus loin, en voici un qui avait brûlé: ce n'étaient plus que des débris noirs, des tas de cendres à la place des meules, des planches noircies et brisées aux lieux où étaient les isbas. Pas un homme: sur l'ordre du feu, ils s'en étaient allés plus loin, vers cette Sibérie peut-être, dont les trains vagabonds avaient fait naître en eux le désir. Et l'on se répétait dans les wagons que deux cents maisons de Kazan avaient brûlé deux jours avant.
Dans les champs, les blouses rouges des faucheurs souriaient au soleil, et sur les routes, dont le ruban s'amincissait au loin, parfois un tarantass allait grand train, dans un nuage de poussière. Nous le suivions longtemps du regard, avec un sourire de penser à Michel Strogoff. Un bouquet de bouleaux, des chevaux dans un champ, deux ou trois isbas autour d'une gare, une petite mare, avec des herbes aquatiques, un bœuf blanc et des oies, c'étaient les plaisirs des yeux dans ces plaines grises.
(p. 218) Après midi, un grand vent a soufflé: de tous côtés, la poussière s'est élevée, ici plus fine au-dessus des champs, là plus obscure, plus épaisse sur les routes ou près des villages. La plaine se soulevait de partout. De petits arbres pliaient. Des chevaux effarés galopaient au hasard, et les bandes de corbeaux tourbillonnaient sur les villages. Le ciel était noir, et des gouttes de pluie, lourdes, tombaient déjà, faisant des taches claires sur les vitres poussiéreuses du train. Dans les champs, les moissonneurs rentraient sans hâte, sans effroi. Sur la route, une vieille femme ramenait un cheval. Des enfants continuaient de jouer au bord d'une mare. Mais l'orage s'est dissipé, a disparu; et plus loin, sous le ciel éclairci, le travail continuait. À l'horizon, quelques collines se sont profilées, premières hauteurs de l'Oural, et les nuages lourds, de teintes cuivrées, se sont arrêtés au-dessus, quand commençait le crépuscule. À Oufa, la nuit était tombée, et dans le Transsibérien, comme dans un grand hôtel roulant, la vie des longues soirées s'organisait.
Nous avons visité notre maison roulante. Après la locomotive et le fourgon à bagages, dont une partie était occupée par une machine électrique, le train se composait de quatre wagons, de ces wagons russes, hauts et larges, un peu lourds d'aspect, mais si commodes! La voiture verte, la première, était le wagon-restaurant; elle contenait les cabines des employés, de l'équipage, comme nous disions; puis la salle de bains, avec sa grande baignoire de marbre, ses robinets de douches et ses appareils de gymnastique; enfin, après un petit passage resserré où était l'office, la grande salle à manger. L'ameublement était simple, avec un bel air d'aisance: des chaises et un grand canapé de cuir sombre, un guéridon et de petites tables, une bibliothèque, un piano, des portraits du tzar et de la tzarine, et dans un coin de la salle, l'icône minuscule. Pas de cuisine: les buffets sont le charme de ces longs voyages. Aux gares, tous se pressent autour de leur comptoir, choisissent les portions et s'assoient à la table commune; souvent aussi, les garçons du restaurant emportent les plats dans le wagon, et le repas, moins pressé, augmenté de quelques hors-d'œuvre, se prolonge parfois longtemps, dans le bercement du voyage. C'est de Moscou, dans les coffres à provisions, entre les roues, que l'on a emporté les saucissons et les jambons, les œufs, le caviar, les harengs, les zakouskis indispensables. Aux gares, les marchés en plein air permettent de les renouveler.

UN PETIT FUMOIR, VITRÉ DE TOUS CÔTÉS, TERMINE LE TRAIN (page 218).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Puis vient un wagon de seconde, un large wagon à couloir, aux compartiments fermés tantôt par des portes pleines, tantôt par de simples portières.—Au milieu du wagon de première, tout un grand salon a été réservé, dont les canapés et les fauteuils sont recouverts de housses rayées rouge et blanc. Par les portes entr'ouvertes, on aperçoit les tables surchargées de livres, de tasses de thé ou de gâteaux, l'abat-jour vert de la petite lampe électrique, et de tous côtés, dans les filets, sur les banquettes, l'amas des valises et des oreillers. Enfin l'autre wagon de seconde termine le train par une sorte de fumoir, vitré de tous côtés, d'où l'on découvre en tous sens le pays parcouru.
Dans les couloirs, des tableaux annoncent la gare prochaine et les buffets; dans le salon des premières, de grandes cartes sont pendues, qui permettent de suivre la route; et l'on trouve dans la bibliothèque des livres de renseignements sur la Sibérie.
Cet hôtel roulant a son personnel: l'électricien, un petit bonhomme noir et toujours sautillant; le médecin, masseur et dentiste à la fois; les petits garçons de restaurant, le brun et le blond, toujours souriants, amusés de tout au long de la route, courant à chaque gare réunir les plats du buffet ou marchander les provisions; le maître d'hôtel et cuisinier, qui règle nos repas, prépare les œufs et le thé, et fait la note: il montre parfois sa large figure et sa barbe brune à la porte de l'office. Chaque soir, les garçons des wagons retirent, de dessous le toit, les oreillers, les matelas, et dressent les couchettes. Enfin deux ingénieurs (c'est ainsi qu'ils se désignent) surveillent la marche du train et font la joie des voyageurs. C'est à qui des deux en fera le moins pour conduire le train, pour examiner l'état de la (p. 219) voie, pour télégraphier notre arrivée; mais tous deux rivalisent de bons offices auprès des étrangers, de paroles aimables auprès des voyageuses. L'un, K....., barbe brune et beaux yeux noirs, était un joli garçon et qui le savait; notre guide l'appelait tsertsaïed, voleur de cœurs. L'autre, Sergui Serguievitch, grand maigre, à la barbiche blonde, aux yeux ternes, plus intelligent peut-être, mais à la figure usée déjà par les longues nuits de ripaille.

LES ÉMIGRANTS ÉTAIENT LÀ, PÊLE-MÊLE, PARMI LEURS MISÉRABLES BAGAGES (page 226).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.
Dans le train, c'est un va-et-vient continuel: du restaurant au fumoir, des compartiments au salon, les passagers goûtent, vingt fois par jour, le plaisir de ces petits voyages. Ils vont lentement, par le long couloir, devant les compartiments ouverts d'où s'échappent, avec la fumée des papirosses, des parfums de thé et des bribes de conversations bruyantes. Comme notre hôtel n'est pas grand et que le couloir est étroit, les rencontres sont fréquentes. Bientôt un sourire les égaie, et comme beaucoup le désirent, la conversation s'engage. Ils chantonnent tous un français pur et facile, et devant la carte du salon, dans l'isolement du petit fumoir, les entretiens se prolongent longtemps, sérieux et familiers, sur la Sibérie, sur la France, sur le mir russe, sur les études classiques ou sur Zola. De la part de tous, c'est la même amabilité, le même empressement curieux, avec tantôt plus de discrétion, tantôt plus de simplicité et de candeur.
Pendant le jour, le fumoir de l'arrière était toujours très occupé: on y trouvait habituellement une jeune femme et sa sœur, demoiselle blonde en robe rouge, avec une ceinture dorée, qui s'occupait avec patience de ses deux neveux, deux bambins turbulents et pleurnicheurs. À côté d'elles, un vieux Monsieur, tout enveloppé d'une houppelande grise, se perdait dans une vague contemplation du pays parcouru; c'était un personnage assez bizarre, composant toujours la simplicité de ses allures, et dont les paroles donnaient une impression de fausseté; quelques-uns d'entre nous l'appelaient le «pasteur protestant» et d'autres «le banquier en fuite». On ne l'aurait pas rencontré sans sa femme, une vieille à bonnet noir, toujours dans une attitude de déférence et d'approbation aux paroles et aux gestes de son mari; pour un peu, elle nous aurait appelés, afin de nous le montrer tandis qu'il distribuait du pain aux émigrants ou qu'il s'essayait déplorablement à jouer la Marseillaise sur le piano du wagon-restaurant.—D'un bout à l'autre du train, on se heurtait partout à un Américain, grand vieillard maigre et remuant, presque âgé de soixante-dix ans, et qui entreprenait un voyage d'agrément autour du monde: il levait très haut sa tête fine, encadrée de cheveux blancs bouclés, et faute de pouvoir parler français, distribuait quelques sourires. Son guide ne le quittait point, un gros homme blond, d'allure et d'accent tudesques. Il vantait fort «son Monsieur» et l'aidait naïvement à (p. 220) faire montre de sa richesse; à Tomsk, ils firent atteler une voiture «à trois chevals le premier jour, à cinq chevals le lendemain», comme il disait; mais un officier de police coupa les clochettes du pompeux équipage: les pompiers seuls ont le droit de se servir de clochettes pour annoncer l'incendie.
Pour nous, c'était dans l'intimité du petit salon que nous restions de préférence; quelques-uns agitaient déjà des projets de voyage au Baïkal, ou nous causions tous ensemble avec le commandant N... et Monsieur M.... C'étaient nos hôtes préférés, ceux dont l'hospitalité semblait la plus franche, la plus sérieuse. Et c'était chose importante que ce choix, dans un pays de mensonges comme la Russie!
Le commandant s'en allait à Vladivostok rejoindre son navire. Grand et vigoureux, de figure calme et sympathique, il parlait fort bien français, mais ses phrases devenaient alors comme plus timides et plus sourdes. Les enfants l'aimaient; lorsque nous descendions aux gares, il y en avait toujours un ou deux qui couraient vers lui; il les tenait par la main, et tout heureux et souriant, il se promenait avec eux le long des quais; «ils allaient voir ensemble la locomotive» et revenaient parfois avec une petite canne ou des fleurs. Lorsque le commandant parlait de la marine ou du Transsibérien, une lueur animait la douceur de ses yeux; ses paroles devenaient plus vives et communiquaient à tous un peu du respect et de l'admiration qu'il avait pour le tzar. Les récentes constructions de vaisseaux, les millions de roubles dont Nicolas II venait de décider la dépense pour l'augmentation de la flotte, la défense rapide et sûre de l'Asie contre l'Anglais (on ne redoutait pas encore le Japonais), tout cela l'enthousiasmait.
Avec lui, notre interlocuteur habituel était M. M..., riche entrepreneur, qui s'en allait plus loin que Tomsk, du côté de Krasnoïarsk, pour surveiller l'exploitation de ses mines. Grand et fort, comme tant de Russes, M. M... était un homme de trente-cinq à quarante ans; dans sa figure au teint mat, aux traits un peu lourds, ses yeux vifs brillaient encore avec plus d'intelligence, et de malice. D'esprit souple et riche, comme un Slave, il avait pourtant dans la discussion quelque chose de la logique et de la certitude mesurée de l'esprit occidental. Il aimait à faire la preuve de ses connaissances, citait Virgile, le récitait, et discutait sur nos auteurs; d'ailleurs, nul pédantisme. Hardi, entreprenant, il témoignait une sorte de dédain aristocratique pour ceux qui restent à la maison. Il aurait dit volontiers, avec le moujik, que le foyer rend bête et le voyage instruit: Pitchka prolchit, doroga outchit. Surtout il se montrait à tout propos convaincu de la grandeur de l'Empire, de la supériorité de sa race et de l'avenir du slavisme.

LES PETITS GARÇONS DU WAGON-RESTAURANT S'APPROVISIONNENT (page 218).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Le soir, lorsque l'électricité illuminait le train, la gaieté devenait plus bruyante. C'était l'heure où tous se trouvaient; dans la journée, les spectacles qu'offrait le pays distrayaient bien des esprits, mais personne ne résistait plus à la gaieté d'être ensemble. C'était dans le wagon-restaurant que la société se réunissait. Après le repas, lorsque la fumée des cigarettes emplissait la salle et que les verres de thé circulaient, les conversations devenaient plus vives, les voix s'élevaient peu à peu, et les rires. Le gros guide de l'Américain pressentait un plaisir, courait chercher son «Monsieur». Une demoiselle allemande se mettait au piano, attaquait une fois encore le début du Pas de quatre.—Le «pasteur-banquier» s'essayait à jouer la Marseillaise, et le gros homme se mettait à chanter.—Les enfants couchés, la demoiselle en rouge et sa sœur venaient prendre le thé; les autres voyageurs peu à peu envahissaient la salle, et par la porte entrebâillée de l'office, on voyait le maître d'hôtel et les employés du train, qui se bousculaient pour voir, ou qui se jetaient en arrière pour rire à l'aise.
Toute la nuit, le train avait suivi les longs méandres des rails dans l'Oural, et nous avons pu voir encore, dans les brouillards du matin qui s'allégeaient, les rivières aux lits encombrés de pierres, les forêts sombres (p. 221) et les hautes parois déchiquetées de la montagne; puis les dernières collines ont bleui à l'horizon, et nous sommes entrés dans la plaine. Trois jours de lent voyage jusqu'à Tomsk, trois jours de dorlotement doux et continu dans la grande maison roulante.

ÉMIGRANTS PRENANT LEUR MAIGRE REPAS PENDANT L'ARRÊT DE LEUR TRAIN (page 228).—PHOTOGRAPHIE DE M. A. N. DE KOULOMZINE.
Avant Tchéliabinsk, nous nous plaisions à retrouver un peu de la précision et de la fraîcheur des paysages ouraliens. À droite de la voie, de grands lacs riaient à la lumière, et tout à l'entour de leur resplendissement, sur les pentes qui les bordaient, les isbas étaient rassemblées en de grands villages, comme dans la montagne, le long des rivières. C'étaient là, de loin en loin, comme de petites nations, des mondes isolés. La barrière de l'Oural, sous la ligne claire du soleil, fermait un côté de l'horizon; de l'autre, des brumes blanchâtres s'amassaient, et l'on aurait cru que leurs gazes et leurs mousselines montaient d'une vallée lointaine.
Plus loin, c'était le steppe. De chaque côté du remblai, il déroulait son étendue jusqu'à l'horizon. Partout l'herbe avait poussé, dans sa variété riche, dans sa puissance non contrariée. On dit qu'elle est superbe, lorsqu'au printemps, hors de la boue des neiges fondues, elle fait jaillir du sol ses floraisons éclatantes. Mais elle était belle alors encore, après que juillet avait commencé de la dessécher, avec ses fleurs rouges ou bleues, demi-fanées, avec ses tiges jaunies que le poids des baies avait courbées, et pourtant si hautes encore qu'elles atteignaient le poitrail des chevaux, et que les hommes y baignaient jusqu'à la ceinture. Quand le vent s'élevait, il gonflait ses vagues mouvantes, et leur houle grisâtre venait battre le chemin droit qui la coupait comme une digue. Parfois, des bois de bouleaux émergeaient, comme des îlots dans la mer, des grandes herbes, et nous aimions leurs jeunes taillis, avec leurs troncs blancs, leurs petites branches tordues et grêles, leur feuillage grisâtre et frémissant. Parfois aussi, c'étaient des lacs, d'un bleu sombre, ou qui reflétaient les volumineuses lueurs du crépuscule. Mais bientôt recommençait la plaine.
C'était aux heures de midi surtout qu'elle faisait éclater sa puissance. À travers l'air immobile, des niasses lourdes de chaleur s'affaissaient sur elle, et l'on aurait dit qu'elle frémissait toute, et s'offrait plus entière aux flamboiements du soleil. Les taillis de bouleaux semblaient plus petits et plus humbles, une touffe d'herbes un peu plus haute: tout se perdait dans l'unité de cette étendue. Et tout entière elle crépitait de vie. On entendait un murmure vague et formidable, qui sortait du remuement des hautes herbes: froissements de tiges et chocs de fleurs, bruissement des sauterelles, et grésillement de milliards d'insectes, qui luisaient sous le soleil comme des molécules de lumières.
Puis le crépuscule venait; la lumière d'or se diffusant d'abord dans tout l'horizon, le flamboiement des nuages, les dégradations infinies des teintes, dans l'enveloppement d'une buée rougeâtre, et tout enfin, quand les dernières lueurs s'étaient éteintes dans le ciel vaporeux et diaphane, cette lumière vert pâle qui persistait jusqu'au jour.
Dans la molle tiédeur de la nuit, la vie s'apaisait; mais le frissonnement de toutes ces petites existences montait encore de chaque touffe dans l'immensité sans écho. Tranquilles d'âme, dans le bercement indolent du wagon, nous avons passé là des heures délicieuses de rêverie: ce n'était plus le voyage haletant à travers (p. 222) les villes, les monuments qu'il fallait voir, les souvenirs qui se réveillaient: nous nous abandonnions tout entiers à l'influence douce de la puissance de la plaine.
À d'autres heures, son immensité effrayait; sa fécondité nous semblait mauvaise, dévoratrice d'efforts, useuse d'hommes, et toute notre tendresse se reportait sur les villes, sur les gares, sur tout ce qu'il y avait d'humanité tenace, groupée là contre le rail.
Rien n'est plus beau, en effet, que la concentration des efforts autour de ce chemin de fer que les ingénieurs ont étendu tout droit à travers le steppe. Autrefois, les marchands s'en allaient en longues caravanes vers Kazan, vers Nijni, porter jusqu'en Europe le thé et les fourrures, les produits de Chine et de Sibérie. Maintenant, c'est vers la grande ligne, vers les quelques villes qui la jalonnent que tous portent leurs pas; les trains, perpétuelles et régulières caravanes, recueillent aujourd'hui les denrées de l'Asie, et nous avons vu les interminables files de chariots, ou les chameaux qui les apportaient vers les gares. Il se peut qu'une raison politique et militaire ait décidé la construction de la nouvelle ligne, mais aujourd'hui le commerce s'en empare, et c'est avant tout l'œuvre de colonisation qui s'accomplira par elle.
Aux gares, nous rencontrions, de temps en temps, les trains habituels qui attendaient que le nôtre fût passé. C'étaient, à côté des tchinovniks et des autres riches passagers, la même foule que sur le pont du Sviatoslav: les marchands d'Orient, au teint bronzé, aux yeux bridés, aux cheveux crépus, toujours enveloppés de leurs longs manteaux, avec un bonnet d'astrakan, ou sur le sommet de la tête une riche calotte de velours,—des Kirghizes, indigènes, aux yeux vifs, au visage profondément ridé, à la barbe frisée, et que l'on voyait aussi le long de la voie sur leurs petits chevaux nerveux, ou devant leurs huttes; enfin, la foule des travailleurs russes, paysans émigrés, marchands, ouvriers de la voie.

L'AMEUBLEMENT DU WAGON-RESTAURANT ÉTAIT SIMPLE, AVEC UN BEL AIR D'AISANCE (page 218). PHOTOGRAPHIE DE M. A. N. DE KOULOMZINE.
Les gares remplaçaient les caravansérails; beaucoup y logeaient, attendant le train qui devait les emmener; tous y arrêtaient pour les repas. De deux heures en deux heures, elles apparaissaient longtemps à l'avance, à l'horizon du chemin droit et blanc. Elles se ressemblaient toutes. Derrière de longs quais de bois, au milieu d'un petit jardin dont les fleurs voyantes tiraient les yeux, une maisonnette, aux boiseries découpées, dressait son toit rouge ou vert. Elle était presque tout entière occupée par le buffet, salle commune de ces nouveaux relais, où les voyageurs mangeaient et dormaient. Sur les murs, un tronc surmonté d'une image dorée représentait l'église à construire et mendiait une aumône aux voyageurs. Devant la gare ou sous un abri spécial, un tonneau contenait de l'eau potable, et un énorme samovar versait l'eau bouillante dans les théières. Près de la station, quelques isbas, la plupart en construction; les villages sont toujours loin dans les terres et il s'en construit là de nouveaux.
À presque toutes les gares, il se forme spontanément un petit marché. Sur une table de bois ou sur la terre, devant elles, les paysannes disposent des gâteaux de miel, du pain blanc ou noir, des melons d'eau et des pastèques, des poissons sèches ou des saucissons, des pommes de «kèdre» et des graines de tournesol, que les Sibériens ou les Russes grignotent toute la journée, des fruits sauvages, semblables à des groseilles; parfois il y avait des œufs, de petits œufs comme ceux des poulettes anglaises, des œufs frais! qui ne voyageaient pas dans les coffres d'un wagon depuis six jours. Sur une assiette, un jour, une marchande nous offrit exactement une trentaine de petits pois écossés. C'étaient des femmes du pays, grandes et fortes, aux traits vagues comme ceux des Russes, au visage marqué (p. 224) de taches de rousseur, aux yeux bleus, clairs et sans profondeur: la fatigue précoce des femmes qui travaillent les avait enlaidies, toutes jeunes encore. Elles portaient par-dessus leur chemisette une simple jupe voyante, qui les serrait à la taille, et s'enveloppaient tout le haut du corps d'un grand châle, d'éclatante couleur. Des enfants, des bambins, venus peut-être d'un village éloigné, offraient une bouteille d'un lait épais, crémeux, ou de petits pains noirs qu'ils vendaient 1 kopeck; dans leur visage bouffi par la misère, le sourire immuable de la race restait marqué.

LES GENDARMES QUI ASSURENT LA POLICE DES GARES DU TRANSSIBÉRIEN—PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Plus près du train, plus attentif au voyage de la caravane nouvelle, tout un peuple d'ouvriers ou d'employés formait sur le quai des groupes bariolés et actifs; sur les piles de bois alignées, pendant près d'un kilomètre, avant ou après la gare, et sur le tender de la locomotive, on voyait une chaîne de moujiks et des bûches qui volaient, de blouse rouge en blouse rouge, jusque sur la machine. Au matin, toute une équipe faisait la toilette du train: les uns montaient sur les wagons, et à l'aide d'un seau accroché à une longue corde, emplissaient les réservoirs; d'autres manœuvraient une pompe à bras pour recharger la locomotive; d'autres encore inspectaient les graisseurs et faisaient sonner les cercles des roues. Toute une bande de femmes, armée de seaux, de chiffons et de balais, envahissaient les wagons et lavaient les couloirs.—Le chef de gare, en casquette rouge, surveillait ce travail, tout en causant avec le chef de train, en tunique noire à lisérés violets, avec les ingénieurs ou avec quelque voyageur. Immobiles et droits en arrière, deux ou trois «gendarmes du train», des hommes superbement bâtis, en uniformes bleus à brandebourgs rouges, et surmontés d'une toque rouge à haute bordure d'astrakan et à plumet.
Toute cette activité, ce fourmillement des hommes et des couleurs, nous paraissait plus minuscule et plus cher dans l'immensité du steppe. Longtemps, lorsque de nouveau, sur la voie toute droite, l'horizon attirait le train, nos yeux restaient attachés à ce petit point rouge ou vert, qui désignait encore le toit aigu de la station.
Et sur le blanc remblai qui avait coupé la plaine, le convoi roulait de nouveau. On sentait alors l'importance de la route nouvelle qui pénétrait la terre de fécondité, et nous songions que peut-être, un jour, dans les esprits innocents des peuplades d'Asie, le chemin de fer aurait sa légende, comme «la sainte mère Volga».

L'ÉGLISE, PRÈS DE LA GARE DE TCHÉLIABINSK, NE DIFFÈRE DES ISBAS NEUVES QUE PAR SON CLOCHETON (page 225).—PHOTOGRAPHIE EXTRAITE DU «GUIDE DU TRANSSIBÉRIEN».
Point de villes, point de villages: toujours le steppe, où les poteaux des verstes se succèdent monotones. À peine, dans tout ce long voyage, deux ou trois grandes gares, et quelques heures d'arrêt. Les villes sont loin, toujours, parfois à 4 kilomètres de la gare qui porte leur nom, et il en résulte qu'un faubourg se forme là pour le commerce, pour le repos des voyageurs, pour l'abri des ouvriers, villages d'auberges et de campements qui supplanteront un jour les villes anciennes.
À Tchéliabinsk, nous avons erré au milieu des isbas nouvelles, groupées à leur aise dans la plaine unie et sablonneuse qui semble aboutir là. C'est comme la première étape de la civilisation; c'est «le point d'émigration» où tous les paysans attendent que les fonctionnaires aient réglé leur sort. C'est là aussi, sous ces hangars que longe la voie, que toutes les marchandises attendent parfois pendant plusieurs semaines d'être dirigées vers l'Europe. Au bord (p. 225) de la grande route, que suivent les longues files des télègues, on a l'unique impression d'un arrêt, d'un bivouac où chacun sait qu'il faut aller plus avant.—Ici comme à Omsk, comme à Taïga, comme dans tous les groupes d'isbas que la grande ligne a fait jaillir de terre, une église de bois a été ajustée; avec ses poutres équarries, elle diffère peu des isbas neuves, mais elle est surmontée de clochetons bulbeux et de croix grecques. Nous sommes entrés: on sentait l'odeur d'un office récent, et les rayons clairs, qui entraient par la fenêtre, illuminaient une atmosphère encore alourdie d'encens. De ce petit sanctuaire, il transpirait un air d'humilité, mais d'une humilité coquette, rieuse, orthodoxe. Le sacristain a pris plaisir à nous montrer les ornements en perles, les fleurs en papier et, sous une vitrine, le cercueil de Pâques que l'on expose au Vendredi-Saint. Tout cet attirail du culte, nous le connaissions pour l'avoir vu chez nous, dans les greniers des presbytères villageois, mais il était ici plus respecté.

UN TRAIN DE CONSTRUCTEURS ÉTAIT REMISÉ LÀ, AVEC SON WAGON-CHAPELLE (page 225).—PHOTOGRAPHIE DE M. A. N. DE KOULOMZINE.
Le lendemain, c'était à Omsk que nous passions; le train a franchi l'Irtych sur un long pont de fer de 800 mètres de long, et nous avons aperçu la ville au loin, sur la rive droite. Ici, c'était encore une grande gare, caravansérail et entrepôt. Entre le fleuve et la station, un campement d'ouvriers blottissait contre la voie ses huttes recouvertes de terre. Un train de constructeurs était remisé là, avec ses dortoirs, avec son wagon-chapelle. Cette gare, ces hangars, cette grande roulotte, et tout là-bas ces bâtiments blancs, dont les façades dominaient les toits de la ville, tout marquait un nouveau point d'appui pour les colonisateurs. Devant la gare, le faubourg s'étendait; dans des cabanes, des paysans vendaient des poissons séchés, du lait et des fruits; une église était en construction, et nous sommes montés sur les poutres pour mieux découvrir la ville.
Comme on devait les aimer, ces villes dans l'immensité de la plaine! Elles n'étaient pas encore comme en Occident des agglomérations productrices, mais déjà des lieux de réunion, des marchés, des foires continuelles, où les hommes se retrouvaient, où, par le contact de tous, les marchandises devenaient des valeurs. Dans les hangars de Tchéliabinsk, les marchandises attendaient pour passer l'Oural; à Petropavlosk, une caravane de chameaux venait lentement vers la gare. Dans des stations, souvent modestes, nous avons vu de grands amoncellements de sacs blancs et de forme plate; les trains de marchandises en étaient chargés, et les télègues, sur les routes, douze, quinze, vingt ou trente en file, pliaient sous leur poids. C'était le blé, un petit blé, au grain dur, comme le blé irka de la Crimée. Et cependant nous n'avions aperçu, du train, que des champs peu nombreux, de petits rectangles plus gris dans l'immensité du steppe. Qu'adviendra-t-il quand tout sera mis en culture, quand des millions d'émigrants russes auront retourné la terre, quand les chemins seront devenus plus commodes, quand au lieu de passer par Moscou, il s'écoulera par les lignes nouvelles de (p. 226) Samara à la mer Noire, on quelques jours? Qu'adviendra-t-il de nos marchés, et comme les mesures de protection auront peu d'efficacité contre la pauvreté surproductrice du peuple jeune!
Et lorsque ces pensées nous envahissaient l'esprit, nous nous prenions à aimer davantage toute l'activité de la route paisible qui créait des nations et révolutionnait le monde. Ces gares et le grouillement de leur foule bigarrée, cette voie et le travail qu'elle suscitait, les ponts, ponts de bois à fleur d'eau et dont toutes les poutres craquaient sous la lourdeur du train, ponts de fer monumentaux sur le Tobol, sur l'Irtych et sur l'Ob, tout cela nous devenait plus précieux.
C'était surtout une joie vive que la rencontre de ces larges fleuves qui pénétraient le continent, et qui venaient nouer leur œuvre de commerce à celle de la grande ligne. Le dernier soir, nous avons traversé l'Ob; longtemps à l'avance, une teinte bleue légère, qui coupait le ciel avant l'horizon, nous avait désigné sa vallée. Puis, après une station, le train s'est engagé lentement sur le pont, et nous avons dominé le fleuve. Il était large de près de 1 200 mètres, divisé en deux bras, par une île de sable, où se dressaient de noirs sapins. Sous le soleil chaud de cette soirée, entre les deux gares qui bordaient son pont, il nous apparaissait plus puissant encore, plus dispensateur de civilisation et de fécondité.
À la gare de Samara, comme nous attendions le Transsibérien, nous avions remarqué des hommes, des femmes, des enfants, couchés dans une salle, à l'entour de la vaste bouilloire en cuivre rouge qui était le samovar de la station. Ils étaient là, pêle-mêle, parmi leurs misérables bagages, comme des paquets de haillons; leurs vêtements étaient crasseux, et les vives couleurs avaient passé; les touloupes qu'ils emportaient luisaient de graisse. Des millions de mouches assiégeaient cette misère, se posaient sur les hardes et sur les hommes, sur le visage des enfants, pauvres petits êtres chlorotiques qui ne prenaient plus la peine de les chasser. Quand on entrait, l'odeur violente de la misère russe et la fumée des cigarettes saisissaient à la gorge.
Sur le quai, on entourait un vieux moujik: de longs cheveux gris et bouclés encadraient son front ridé; dans son visage bronzé, les pommettes faisaient saillie et, profondément, les yeux bleus luisaient. Une barbe blanchissante coulait sur sa poitrine entre les deux côtés de la touloupe ouverte. Sous la touloupe, il portait la blouse rouge et le pantalon bouffant; des lacis de toile entouraient ses jambes. D'une voix douce et chantante, il racontait que dans le Gouvernement de Kazan toutes les récoltes avaient brûlé, qu'il était allé plus loin en voyage d'exploration pour voir des terres; et maintenant il revenait, il retournait chercher toute la famille qui allait partir s'installer là-bas.
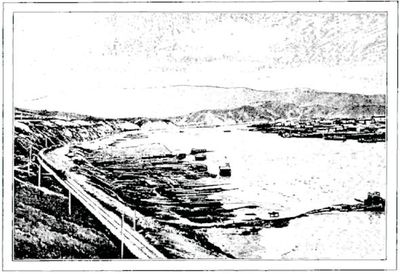
VUE DU STRETENSK: LA GARE EST SUR LA RIVE GAUCHE, LA VILLE SUR LA RIVE DROITE. PHOTOGRAPHIE DE M. A. N. DE KOULOMZINE.
Ils étaient 200 000, cette année-là, qui partirent pour la Sibérie, pendant les quatre mois de l'été, et que l'on rencontrait en troupes inégales, répandues sur tout le parcours. Depuis que Gregori Strogonoff s'était heurté, pour la première fois, aux peuplades asiatiques, et que le kosak Irmak Timoféévitch avait envoyé à Ivan le Terrible la couronne de Sibérie, le peuple russe tout entier se sentait attiré par l'horizon nouveau du steppe; les «monts de la Ceinture» ne l'arrêtaient point; il sentait, par delà, l'immensité qui était à lui. Malgré le servage, malgré les peines sévères qui frappaient les fuyards, des aventuriers, des paysans plus épris de liberté, partaient; ils savaient passer les monts, se cacher, se terrer dans la taïga, et des communautés russes furent retrouvées plus tard à la frontière de Chine. De hardis chasseurs cherchaient les fourrures; d'autres l'or et les métaux, et les kosaks établissaient leurs ostrogui. C'était comme un retour vers l'Asie qui commençait. Et toute la masse (p. 227) paysanne, rivée à la glèbe, secouait son frein, voulait partir, puisque la plaine amie l'invitait au voyage, puisque l'horizon la demandait. Il fallait des mesures terribles pour la tenir là.

UN POINT D'ÉMIGRATION (page 228).—PHOTOGRAPHIE DE M. A. N. DE KOULOMZINE.
Enfin, après des siècles, l'oukase parvint, l'oukase tant attendu, si souvent annoncé, qui déclarait les paysans libres; cette fois, il n'était point faux. Mais il leur fallait encore acheter cette liberté, payer des droits. Ils payèrent donc, et quand ils eurent payé, quand le chemin de fer qu'on n'avait point fait pour eux eut tracé une facile et large route au travers de l'Asie, la race se réveilla joyeuse; d'une irrésistible poussée, les forces naturelles, longtemps contenues, augmentées de tous les progrès modernes, exaltées par leur liberté, se précipitèrent.
Grande masse instinctive qui accomplit sans la connaître et sans la vouloir sa besogne prodigieuse! Ils n'émigrent point, comme les Allemands, pour créer des débouchés nouveaux au commerce de la métropole, répandre leur langue et partout le respect de leur nation! Ils vont plus loin, parce que la foudre a brûlé les isbas, parce que l'incendie a ravagé les moissons, parce qu'il n'y a plus assez de terres pour la population augmentée des mirs. Ils vont plus loin, parce qu'il y aura peut-être, là-bas, des terres où de grands propriétaires ne feront pas de procès aux petits moujiks imbéciles, où tout le sol, tout l'usufruit du sol appartiendra aux moujiks; ne dit-on pas dans les villages que le labeur est moins rude là-bas, que la terre est plus fertile avec moins de peine, et que toute la récolte appartient à qui la cultive? Et ils vont plus loin, comme les raskolniks et les stranniki, poussés, eux aussi, par leur rêve mystique, stimulés par leur désir de l'âge nouveau, cherchant de steppe en steppe la cité idéale, «le pays des justes», comme le héros de Gorki;—agissant d'instinct, surtout, sans souci jamais du lendemain, la conscience fermée, comme le torrent qui descend la montagne, comme le fleuve qui a crevé ses digues!
Que trouvera-t-il au bout de son espoir? La loi du 2 décembre 1896 l'a réglé: l'émigrant russe va d'abord gratuitement visiter les terres; puis il emmène sa famille. Parfois ce sont des mirs entiers qui s'arrachent au sol et vont établir ailleurs la nouvelle communauté. La terre concédée demeure la propriété de l'État; mais le paysan en a l'usufruit. Chaque émigrant masculin reçoit 16 hectares 5 ares de terre; on lui fait une avance de 30 roubles; on lui donne le bois pour construire l'isba.
Depuis ceux qui revenaient du voyage d'exploration ou qui attendaient le départ, dans le caravansérail de Samara, jusqu'aux paysans de Sibérie que nous avons vus au marché de Tomsk, nous en avons trouvé à chacun des moments de l'émigration.
Un soir, à la gare d'Oufa, il y en avait qui attendaient un autre train pour passer l'Oural; la pluie tombait, et les lampes du Transsibérien répandaient une lueur triste sur le bitume mouillé. Ils étaient tous, quinze ou vingt peut-être, entassés ensemble sur le quai; un monceau de femmes et d'enfants, enveloppés dans les touloupes, étendus là comme des cadavres. Une moiteur humaine s'exhalait cependant de ces paquets de haillons. La gare, trop petite, était pleine, et le train ne partait que le lendemain à cinq heures.
Tchéliabinsk est un point d'émigration: c'est là que l'administration russe règle le sort des communautés ou des individus; sous les hangars de la station ou dans les baraquements, la foule s'entasse en attendant que (p. 228) les passeports soient vérifiés, les terres assignées. On les recueille, nous dit-on, dans des constructions semblables à l'asile de Nijni; on les soigne, on les chauffe, on les nourrit, et c'est de là qu'on les dirige, par des voies diverses, vers les terres nouvelles. Comme nous nous promenions dans toute la gare, nous en avons vu qui allaient repartir, les formalités accomplies; ils souriaient tous, heureux de l'attente enfin terminée, heureux des champs qu'ils allaient ensemencer. Dans un autre coin, un moujik qui revenait d'exploration et qui avait peut-être un peu trop bu de la blanche vodka, délieuse des langues, plaisantait, nous raillait de payer beaucoup de roubles pour voyager, alors que lui, pauvre moujik, allait et venait gratuitement et, dans sa quatrième classe, arrivait tout comme nous.
Plus loin, dans une petite station, un groupe avait campé; avant de construire l'isba, ils avaient dressé près de la voie quelques abris de feuillage. Deux hommes sont venus d'abord, curieux de mieux voir le train et les voyageurs, puis des enfants qui couraient pieds nus, des femmes aux yeux clairs, aux traits plus réguliers et plus déliés que ceux des Grands-Russiens. Ceux-là venaient de Mohilef.
Plus loin encore, des isbas étaient en construction; des moujiks apportaient sur leurs épaules les troncs de sapin équarris, d'autres les ajustaient. Ici encore, ils ne récolteraient rien avant un an, et les femmes apportaient aux voyageurs des baies rouges et des pommes de hêtre, pour gagner quelques kopecks.
Et partout, au long de la ligne, on rencontrait leurs trains, les wagons rouges de quatrième classe, avec leurs petites fenêtres, et qui ressemblaient aux roulottes de nos bohémiens errants. Ils étaient entassés là, heureux pourtant, si, dans les gares, le samovar versait l'eau chaude en abondance, et s'ils pouvaient trouver des poissons séchés ou des fruits.
Ce qui nous frappait surtout, c'était la constante charité des voyageurs; à toutes les gares où nous trouvions des émigrants, ils nous avaient appris à distribuer aux femmes des morceaux de pain, des kopecks aux enfants. Jamais les émigrants ne demandaient; jamais les regards ne convoitaient; c'était en tous la même insouciante résignation. Cependant, la misère était grande, quand il avait fallu quitter le village incendié, les champs dévastés, ou que la famine, décimant les mirs, les avait boutés hors la province.
Mais si développée que soit la charité des hautes classes russes, la collaboration qu'elle crée entre tous n'est point suffisante; elle ne saurait empêcher bien des forces d'être perdues, dans leur libre expansion, sur la terre d'Asie. En poussant instinctivement de ce côté, dès l'instant où il a été dégagé de la terre, le moujik a déterminé de nouveau l'avenir de la race; il a traîné derrière lui le Gouvernement et les hautes classes, tous ceux qui détournaient trop souvent leurs regards vers l'Occident; il les a forcés de le suivre, d'aider son œuvre de leurs efforts et de leur science.
Celui qu'ils avaient négligé ou moqué, qu'ils avaient voulu plier à toutes leurs conceptions de politiciens occidentaux, les a dominés à son tour, parce qu'il est resté plus près de la nature, parce qu'il a obéi plus fidèlement à leur instinct de race! Tandis qu'ils étaient incertains du modèle, qu'ils forgeaient des plans de société, le moujik a agi, et tous se sont reconnus dans son action.... Mais qui sait si tout là-bas, à la limite de l'Asie, les combinaisons ambitieuses n'ont point, de nouveau, compromis l'avenir? Qui peut dire si l'œuvre pacifique de la race sortira intacte de la lutte présente?
(À suivre.) Albert Thomas.

ENFANTS D'ÉMIGRANTS (page 228).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Droits de traduction et de reproduction réservés.
(p. 229) TOME XI, NOUVELLE SÉRIE.—20e LIV. No 20.—20 Mai 1905.
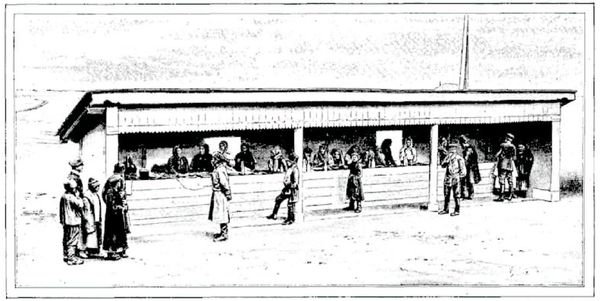
UN PETIT MARCHÉ DANS UNE GARE DU TRANSSIBÉRIEN.—PHOTOGRAPHIE DE M. LEGRAS.
V. — Tomsk. — La mêlée des races. — Anciens et nouveaux fonctionnaires. — L'Université de Tomsk. Le rôle de l'État dans l'œuvre de colonisation.

LA CLOCHE LUISAIT, IMMOBILE, SOUS UN PETIT TOIT ISOLÉ (page 236).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
À Tomsk, où notre voyage aboutissait, nous avons eu la sensation de ce que devrait être toute l'œuvre russe, si elle était bien conduite: le moujik colonisateur pénétrait les autres races; les hautes classes l'aidaient par leur hardiesse dans les entreprises, par leur dévouement dans les fonctions publiques; le Gouvernement dirigeait et réglait les efforts. Et c'était une œuvre de civilisation, où la race qui colonisait se découvrait elle-même, dans l'exaltation de ses forces, fixait son caractère et se grandissait par l'action. Cette Sibérie occidentale, cette plaine immense avec ses bouquets de bouleaux, ses fleuves analogues à ceux de la plaine européenne, qu'était-elle autre chose qu'une Russie exagérée, et où il fallait refaire en plus grand le travail qui avait fait la Russie?
C'est pour cela que la force du peuple s'y exerçait plus obstinément à coloniser et que l'intelligence y multipliait les œuvres.
Nous étions arrivés tard à la gare de Taïga, où M. M... et le commandant N... nous avaient quittés; ils devaient suivre plus loin la grande ligne. Puis, pendant toute la nuit, le train nous a cahotés lentement, sur les 65 kilomètres qui séparent Tomsk de Taïga. Au matin, on nous a réveillés: nous étions devant une station blanche. Nous nous sommes levés, nous avons rassemblé nos bagages, et M. Orloff a sifflé des isvotchiks; Tomsk, comme toute ville sibérienne qui se respecte, était cachée à quelques verstes de sa gare.
Un tronçon de route conduisait jusqu'à une plaine vague, à l'herbe rare et jaunie, où les conducteurs de voitures s'étaient fait un chemin à leur gré. Des deux côtés de la route primitive, que des prisonniers étaient occupés à remblayer, à transformer en chaussée solide et définie, les sinuosités des ornières marquaient dans la boue ou la poussière les chemins les plus usités; les frôles drojkis ou les télègues manquaient à tout instant de culbuter dans des fondrières.
(p. 230) À la moindre pluie, cette plaine n'est plus qu'un vaste marécage, où les roues disparaissent tout entières. Quelques maisons se sont établies là, pourtant; des isbas sales, groupées autour d'une mare, sur le bord de la route, des traktirs borgnes, des marchands de fruits ou des fabricants de cercueils, tout un quartier d'aspect peu sûr, comme toujours ces alentours de gares sibériennes, sans administration ni police, où l'assassinat est fréquent, où «la nuit, comme nous disait un Russe, les moujiks ont coutume de demander les papiers». Puis nous sommes passés près d'une église à clochetons verts, et dont la cloche luisait, immobile, sous un petit toit isolé. Enfin, par une pente rapide où les cochers ont lancé leurs chevaux, nous sommes descendus dans la ville.
Dans une vallée que les collines de la rive droite de la Tome élargissent en cet endroit, elle a groupé ses maisons grises et ses toits verts, tantôt arrêtés au pied des hauteurs, tantôt envahissant leurs montées jaunâtres quand elles se rapprochent du fleuve; des dômes d'or n'y flamboient pas, mais comme dans un village, les murailles plus blanches de quelques églises ou la vive verdure d'un jardin illuminent d'un peu de gaieté cette mélancolie.
Il y eut bientôt un coin de la ville que nous connûmes mieux, un coin délicieux que nous avons affectionné davantage, durant les quelques jours que nous y sommes demeurés. C'étaient les environs de notre hôtel, l'hôtel d'Europe.
Dans une sorte de fossé, de vallon minuscule, et qui faisait songer à une carrière abandonnée depuis longtemps, un ruisseau coulait, l'Ouchaïka, qui coupait la ville en deux. Il roulait encore en cette saison un peu d'une eau malpropre, où des blanchisseuses cependant lavaient leur linge. À droite, cette dépression du sol était bordée par une large rue, une place plutôt, limitée par toute une rangée de boutiques basses, d'où parfois la muraille nue d'une église ou la façade régulière d'une maison moderne s'élevait. D'un côté, cette rue menait au pied de la colline, tantôt grise, tantôt égayée par les teintes claires d'un jardin; une chapelle blanche y riait sous le ciel chaud. De l'autre, elle aboutissait dans une vaste place, devant la berge de la Tome. Là, une église allongeait son mur, dont les fenêtres, ornées de vitraux, laissaient venir jusqu'à la rue le bruit des offices. C'était une assez grande église, mais elle avait un air pauvre et délabré. Dans ce pays où les plus simples sanctuaires ont un aspect neuf, où l'on rebadigeonne sans cesse les cathédrales du Kreml et les vieilles peintures, on prenait plaisir à voir ces murs, dont les plâtres tombés avaient mis la brique à nu, ces ornements d'or pâlis et cette teinte bleue du dôme, ternie par le rude climat.
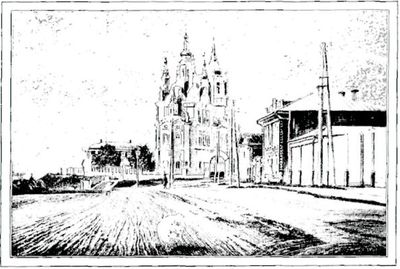
NOUS SOMMES PASSÉS PRÈS D'UNE ÉGLISE À CLOCHETONS VERTS (page 230).—PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
De l'autre côté de la rue, ou plutôt dans le milieu même de la chaussée, de petits arbres entouraient la chapelle d'une icône, étincelante de lumière. Elle était précédée d'un long abri, où de nombreux fidèles pouvaient se prosterner. Parfois, la voiture de l'icône stationnait là, une berline attelée de trois chevaux, où les moines la transportaient, quand des particuliers désiraient la recevoir, pour attirer sur leur demeure des bénédictions. Plus loin, c'était la place avec de petites halles, comme dans nos villes de province, avec un marché en plein air, très animé; tout autour, des maisons plus serrées, plus hautes et plus blanches: un nouveau quartier de commerce. Quelques pas encore, et l'on découvrait le cours de la Tome, une rivière bleue, plus large que notre Seine. Elle miroitait gaiement au soleil et se mêlait à la plaine, dans un horizon qui semblait tout proche. La ligne verte de l'autre rive, plus élevée, bornait le regard, et comme rien ne la dépassait, comme c'était partout au-dessus d'elle l'immensité vaste du ciel, l'imagination retrouvait la plaine qui recommençait.
À distance à peu près égale de la colline et de la Tome, une autre rue joignait la première au coin de (p. 231) l'hôtel d'Europe, et sur un pont de bois qui grondait sourdement au galop des troïkas, elle franchissait l'Ouchaïka. Elle venait, large et droite, depuis l'extrémité de la ville, depuis l'horizon clair qu'on apercevait là-bas, entre les deux rangées des maisons basses et leurs trottoirs de bois. Des files interminables de charrettes s'avançaient, par trente, par cinquante, comme de longues caravanes, au pas lent des petits chevaux, attachés souvent à la voiture qui les précédait, et les blouses rouges des conducteurs se dandinaient à côté. Comme à Tchéliabinsk, comme à Omsk, on avait sur cette route l'impression du plus loin, du plus avant, toujours; Tomsk n'était encore qu'un campement, une auberge sur la longue voie que suivait l'émigration. Par delà l'Ouchaïka, la route bordée d'une barrière contournait un instant la petite vallée creusée par le fleuve, puis montait toute droite vers la haute ville, où se groupaient, comme en un Kreml non fortifié, la cathédrale et le palais du gouverneur, l'Université et les bâtiments administratifs. C'était de là que descendaient les fils du télégraphe et du téléphone, et leur réseau enveloppait la ville. Quand venait le soir, les lampes électriques, suspendues à deux poteaux, répandaient en cercles leurs lueurs bleues.

TOMSK A GROUPÉ DANS LA VALLÉE SES MAISONS GRISES ET SES TOITS VERTS (page 230).—PHOTOGRAPHIE DE M. BROCHEREL.
Grandes routes ou petits chemins, les rues de Tomsk étaient toutes semblables: une simple bande de terrain que l'on n'empierre sans doute jamais, limitée par les maisons qui la bordent, et, pendant l'été, rarement praticable aux piétons, soit que la pluie en ait fait un marécage infect, soit que le soleil, séchant la boue, y amoncelle la poussière. Par bonheur, il y avait les trottoirs, des trottoirs en bois, élevés au-dessus de la chaussée, et où l'on monte par des escaliers de deux ou trois marches. C'est sur cette estacade improvisée au-dessus de la mer de boue qui envahit les rues, que nous pouvions faire quelques promenades à travers la ville. De distance en distance, aux carrefours, en particulier, un parquet de bois, que la boue couvrait parfois, réunissait les deux trottoirs et permettait de traverser la rue. Les maisons étaient basses, avec des boutiques en sous-sols et de grandes enluminures d'enseignes. Une odeur de fruits s'en exhalait, parfois l'odeur des petites pommes vertes qui se vendaient partout, sur les étals du marché, dans les gares du Transsibérien, aux débarcadères de la Volga.
Mais plus que la ville, le peuple, la rue nous charmait. Ce n'était plus le bonheur naïf et à demi mystique du moujik de Moscou, quand il se confondait dans la sainteté de la ville; le travail était là comme plus positif: chacun paraissait plus ardent à sa tâche, définie et limitée. Les porteurs d'eau descendaient vers la Tome, avec leur petit cheval et leur tonneau; ils entraient dans le fleuve, et debout sur le rebord de leur véhicule, à l'aide d'une large écope, ils remplissaient le tonneau; puis, dans la boue, tous les muscles tendus, (p. 232) les petits chevaux nerveux gravissaient la berge. Sur le bord de l'Ouchaïka, quatre ou cinq isvotchiks formaient toujours comme une station de fiacres; ou les entendait à toute heure échanger leurs plaisanteries, mais le moindre coup de sifflet les mettait en émoi, et, rivalisant de vitesse, ils galopaient comme des cochers antiques, caracolaient devant le client, qui choisissait. Le matin, ils descendaient eux aussi dans la Tome et lavaient leurs voitures. Dans les rues, les marchands de kvass sollicitaient un achat; d'autres offraient des graines de tournesol, des sortes de prunelles et des pommes de kèdre. Et sur les trottoirs, il y avait des groupes de gens assis, causant ou grignotant des graines: c'étaient des dvorniks et des commissionnaires, toujours prêts à courir pour quelques kopecks.
De nos promenades parmi cette foule mêlée, nous avons gardé une impression bizarre de méfiance et de curieuse amitié. C'est que cette ville abritait, en effet, des individus de toutes nations, de toutes classes, de toutes qualités. Au milieu des Russes, des Polonais, qui sont nombreux ici, dit-on, et que nous ne savions discerner, on rencontrait des indigènes asiatiques, des Kirghizes ou d'autres races amenées là, des hommes au teint bronzé, aux cheveux noirs, aux yeux vifs, vêtus de longs manteaux, coiffés de toques à fleurs et que nous appelions d'un seul nom: des Tatars. Ça et là, quelques Chinois, presque aussi rares qu'à Nijni, éveillaient l'attention. Ils vendent librement du thé et des peaux, et font clandestinement le commerce de l'or. On nous désignait aussi des Sibériens plus vigoureux, plus massifs que les Russes: ils avaient, en général, le teint basané, moins pâle; les femmes étaient lourdes et fortes, sans beauté, et notre ami K... en tchinovnik insolent, leur lançait au passage un «Sibirskaïa!» de mépris. Il faut convenir d'ailleurs avec Catherine II «que les beautés de Iaroslav sont bien autre chose que les femmes sibériennes».
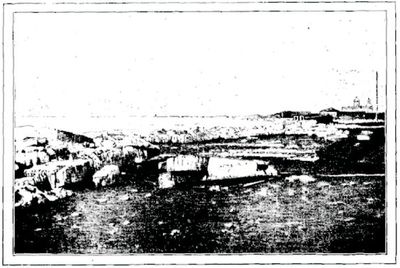
APRÈS LA DÉBÂCLE DE LA TOME, PRÈS DE TOMSK (page 230).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. LEGRAS.
Avec cette population confuse, Tomsk apparaît d'abord comme la ville orientale, le marché constant où les nomades, venus de loin, rencontreront les marchands. Mais en même temps que cette affluence, Tomsk a dû recevoir d'autres activités, qui ont augmenté l'âpreté des luttes; à coté des émigrants, des entrepreneurs, des tchinovniks, dont la foule s'est entassée là depuis cinquante ans, toutes les années lui ont amené des aventuriers et des condamnés. C'étaient des aventuriers déjà, ces brigands des rives du Don, que le kosak Irmak Timoféévitch avait entraînés avec lui à la conquête des régions nouvelles; et la Russie n'a cessé de produire de ces conquistadores, de ces hardis coureurs, moitié brigands, moitié chasseurs, qui allaient habiter dans les ostrogui des kosaks. Puis les «criminels» et les «politiques» ont été déportés là, pêle-mêle; on ne les distingue pas du reste de la foule; ils sont tenus seulement à la résidence, et se sont recréé bien souvent une «situation». Tel cocher est un ancien criminel; tel marchand a été condamné pour vol; tel prince célèbre, qui emploie ses loisirs forcés à faire des enquêtes sur la Sibérie, est un concussionnaire de marque, dont les exploits en ce genre ont le don de réjouir la haute société russe. Comment s'étonner que la police russe s'exagère encore ici, s'il est possible,—et que quelque haut fonctionnaire à l'uniforme imposant vienne, par exemple, nous interroger sur nos passeports, dont quelques traits le préoccupent! Pays neuf, où se ruent les appétits égoïstes dans une espérance de satisfactions plus amples; mêlée des races qui fait l'effort plus pénible et plus obstiné le travail; résidence de condamnés politiques à l'intelligence élevée, à la volonté ferme, et de criminels; ville au milieu d'un désert avec tous les raffinements des jouissances, où les passions seront plus âpres et les désirs plus véhéments! Fatalement ici, parmi la race vigoureuse, mais encore indécise, forte au bien comme au mal, le vice s'épanouira et il usera peut-être l'énergie du peuple!

LE CHEF DE POLICE DEMANDE QUELQUES EXPLICATIONS SUR LES PASSEPORTS (page 232).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Les hôtels sibériens donnaient bien cette impression; malgré leurs lampes électriques, malgré les belles (p. 233) salles de billard ou les salons de restaurant avec leurs orgues monumentaux et leurs pianos mécaniques, ils avaient une apparence d'auberge louche, où des domestiques hypocrites et crasseux devaient partager avec le patron les produits de leurs vols. À l'hôtel d'Europe où nous étions, c'était un spectacle curieux que le va-et-vient continuel des paysans qui venaient vendre aux voyageurs du pain, du beurre ou des fruits; en Sibérie, on ne demande souvent à l'hôtel qu'une chambre et un samovar; les Russes apportent toujours leurs oreillers et leurs draps et achètent leurs repas à ces marchands du dehors. Nous couchions tout en haut, à côté d'un ménage de domestiques, dont le sourire volontairement niais et l'empressement suspect nous tinrent toujours en méfiance.
À l'hôtel de Russie c'était autre chose; on n'y pouvait venir, à n'importe quelle heure du jour, sans y rencontrer quelques femmes, vêtues à l'avant-dernière mode de Paris, et qui étaient sans doute attachées à l'établissement. Là-haut, dans les salons particuliers, les conducteurs du train, les «beaux ingénieurs» et quelques tchinovniks de leurs amis célébraient avec elles leur séjour à Tomsk. Forts au plaisir comme ils pouvaient l'être au travail, ils passaient là les nuits et quelquefois la moitié du jour à chanter et à boire.
À une extrémité de la ville, quand on avait traversé les derniers faubourgs et qu'on atteignait la lisière des champs, un café-concert, un «jardin», comme on disait, était caché dans un assez joli bois. Le jour, il était désert; à peine un étranger y venait-il en promenade. Mais le soir, lorsque la nuit était tombée, les isvotchiks commençaient d'arriver; au-dessus de la porte d'entrée où l'on pouvait lire, en lettres de bois, le nom de l'établissement: Sad Rossia, deux quinquets répandaient une lueur faible. C'était une promenade délicieuse que de venir à cette heure-là, à la limite de la ville et de la plaine, au galop nerveux du petit cheval et parmi les cahots des ornières. Hors des maisons enténébrées, aucun rayon de lumière ne filtrait. Un souffle frais arrivait par-dessus la plaine, caressait le visage; dans le ciel illimité, les étoiles brillaient. Et il faisait bon encore dans les coins plus retirés, lorsque dans le feuillage où s'éteignaient les notes criardes, la fraîcheur du soir pénétrait et tombait lentement parmi les nappes de chaleur que le jour avait accumulées. Quant au concert, sous le baraquement où il était installé, on eût dit quelque concert de barrière; l'expérience (p. 234) de Nijni nous avait prouvé, d'ailleurs, qu'en cette matière, les Russes ne sont pas d'une grande exigence. Pour nous, bien qu'intéressés plutôt par la grosse sottise du public, nous sourîmes de pitié quand quelques malheureux chanteurs, hommes et femmes, en costume de marins français, vinrent nous chanter une chanson allemande sur l'air connu des Matelots. C'était là le plaisir des marchands, des petits fonctionnaires qui repartaient continuer leur noce dans les maisons de Tomsk. Quelquefois, dit-on, le moujik veut avoir aussi sa part de plaisir, et il détrousse le fêtard au bord du chemin.
Mais ce n'était point là tout Tomsk; les colonisateurs y poursuivaient leur labeur, et lui donnaient son caractère; les indigènes et les premiers colons qui avaient vécu sous la protection des kosaks, les Sibériens et les déportés, toutes les populations qui s'étaient formées là successivement, puis pêle-mêle, le flot d'hommes que le chemin de fer apportait pendant les mois des étés, tout se confondait là. À vrai dire ce n'était point, à ce qu'il nous parut, un peuple nouveau qui naissait, une race nouvelle qui se démêlait. Quels que soient, en effet, le caractère et l'avenir des autres Sibéries, ici, dans cette Russie nouvelle, identique de climat et de sol à l'ancienne, c'était l'œuvre primitive, l'œuvre instinctive et obstinée de la russification qui continuait de s'accomplir plus complexe encore et plus parfaite, puisqu'elle éprouvait plus de résistance.
Oui, c'était vraiment la Russie que l'on retrouvait dans sa primitive vigueur. D'abord, la masse anonyme des émigrants avait fécondé le sol nouveau. On les retrouvait sur la grande place, aux bords de la Tome, les jours de marché, vendant les fruits, les produits de la terre, devant leur télègue; puis ils repartaient au long des rues poussiéreuses, s'arrêtant parfois pour un achat, et sur la litière de foin, femme, enfants, toute la famille aux vêtements rouges, était entassée. Et c'étaient bien les mêmes paysans, plus bronzés seulement, moins pâles, et (peut-être était-ce une illusion!) de figure plus animée.

LA CATHÉDRALE DE LA TRINITÉ À TOMSK (page 238). PHOTOGRAPHIE EXTRAITE DU "GUIDE DU TRANSSIBÉRIEN".
C'étaient eux encore que nous avons vus défiler en une longue procession, un jour de fête, celui des Préobrajéniés, où l'orthodoxie consacre les fruits de la terre. La veille, toutes les cloches l'avaient annoncé; les notes sourdes des bourdons ou les battements plus secs, plus allègres des petites cloches étaient tombés en pluie pressée sur les toits plats, dans les rues larges, et s'étaient perdus dans le ciel et sur la plaine. Au matin, ils avaient de nouveau chanté leur appel joyeux, et les paysans étaient revenus une fois encore avec tout le grouillement de leurs vêtements rouges; et les femmes étaient endimanchées, plus élégantes dans l'enveloppement de leurs châles neufs. Puis, dans un nouveau carillon, les processions s'étaient mises en marche, les étendards d'or en avant, les popes majestueux et hâtifs, enfin la foule naïvement heureuse, qui les suivait sans recueillement. Bruit des chants et murmure de la religieuse cohue, grouillement des vêtements clairs, et par-dessus tout, l'averse ininterrompue des carillons.
Et c'étaient encore des Russes que nous rencontrions aux hôtels, sur les trottoirs de bois, dans les bureaux des administrations ou dans les salles de l'Université, tout un peuple de fonctionnaires, d'avocats, de médecins, de professeurs, venus de Pétersbourg ou de Moscou, des marchands, de grands entrepreneurs. Sans doute, ce ne sont que des portraits trop exacts que ceux faits si souvent de ces hautes classes, sottement pliées à des coutumes d'emprunt, raffinées et sceptiques, et recherchant uniquement, parmi les intrigues des salons et de la cour, des satisfactions personnelles, de ces marchands égoïstes, âpres au gain, usuriers et voleurs, de ces tchinovniks, à la fois insolents et plats, qui profitent de l'anarchie administrative pour exploiter le peuple et voler l'État. Mais, dans la jeune génération, des éléments nouveaux se sont révélés: princes, commerçants et industriels délaissant Pétersbourg pour venir extraire de la houille en Sibérie, ou tchinovniks consacrant leur vie à amoindrir la souffrance du paysan et à assurer son voyage.

TOMSK: EN REVENANT DE L'ÉGLISE (page 234).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
(p. 236) Après nos promenades dans la ville, ou lorsque nous étions las des plaisanteries d'un K..., il y avait un endroit solitaire où nous aimions nous réfugier: une chambre de l'hôtel de Russie, petite et claire, où il y avait du silence et du travail. Un fonctionnaire y logeait, un ingénieur agronome, chargé d'une répartition des terres. Nous l'avions rencontré sur le Transsibérien, et bien qu'il ne nous eût pas souvent adressé la parole, nous avions été heureux de le retrouver après le départ de nos camarades; sa modestie et sa douceur donnaient confiance. À toute heure du jour, lorsqu'il n'était point en voyage, nous étions assurés de le trouver devant sa table, entre des cartes et des mémoires, près du samovar qui chantait.
Nous aimions son isolement, son travail d'esprit net, énergique et lucide, qui réglait modestement la vie de populations entières, et c'était pour nous une vraie joie, lorsqu'il voulait bien distraire quelques minutes pour parler de son labeur, de ses fonctions, de toute la grande émigration. Nous aimions à deviner son dévouement qu'il ne disait pas, quand il nous parlait avec amour des campements, des nouveaux villages et de la qualité des terres.
Et nous resongions alors à la cohue des trains sibériens, du train de luxe surtout, à ces travailleurs qui venaient soutenir par la hardiesse de leurs entreprises, par leurs capitaux et leur intelligence, par leur dévouement de fonctionnaires, que la routine n'entravait point, l'instinctive poussée des paysans. Alors nous comprenions plus intimement le caractère et les paroles de M. M..., son mépris pour ces Français qui restent au foyer, qui ne savent point eux-mêmes exploiter leurs capitaux, qui préfèrent, dans la crainte des risques, les prêter à un État, et son admiration pour ceux qui savaient sacrifier les plaisirs aux vastes entreprises. Avocat et bien renté comme lui, un Français se serait fait dans les milieux intellectuels de la capitale une vie de dilettantisme oisif; lui, l'instinct colonisateur l'avait poussé, comme le moujik, et cette souplesse, cette jeunesse, d'un esprit qui voulait tout embrasser, aller au fond de tout, et que la science aurait enivré, il la sacrifiait à cette œuvre réaliste, ou plutôt il la consacrait comme une force nouvelle de civilisation. Puis nous nous rappelions la passion avec laquelle ils s'entretenaient tous du chemin de fer, des canaux, des terres à exploiter, des moyens de culture; nous nous rappelions ces histoires qu'on nous avait contées d'exilés politiques se donnant à la même œuvre, demeurant en Sibérie, même après leur peine terminée, pour coloniser encore. Et il nous semblait presque alors que nous avions part à leur activité, et que nous allions être entraînés avec eux dans l'immensité de leur œuvre.

TOMSK N'ÉTAIT ENCORE QU'UN CAMPEMENT, SUR LA ROUTE DE L'ÉMIGRATION (page 231).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
C'était cette joie qui les animait tous, qui les soulevait, qui les faisait déborder de force et d'espoir, et qui les entraînait sur les grands chemins. Enfin! ils avaient pris conscience de leurs destinées, de leur mission dans le monde; ils s'étaient déliés de tous leurs préjugés, de toutes leurs croyances d'Occidentaux que les circonstances politiques condamnaient à l'impuissance; ils avaient suivi le moujik, "l'humble camarade", qui obéissait naïvement à l'instinct de la race, et de cet instinct ils avaient pris une claire conscience. Autrefois, toutes les classes étaient isolées dans leur tâche, vivaient et travaillaient seulement dans l'intérêt de la couronne. Maintenant, toutes les forces étaient associées dans une œuvre commune, dans la besogne de la race, et les hautes classes devenaient ardentes à instruire le peuple par les écoles privées, par les sociétés d'instruction (p. 237) primaire, pour l'aire l'union plus féconde encore, et plus accompli le travail. Le caractère se fixait, se déterminait dans l'action par cette création d'une Sibérie, qui allait devenir comme le modèle de la Russie future.

UNE RUE DE TOMSK, DÉFINIE SEULEMENT PAR LES MAISONS QUI LA BORDENT (page 231).—PHOTOGRAPHIE DE M. BROCHEREL.
Quand nous sortions de chez l'agronome et que nous nous retrouvions dans les rues de Tomsk, après ces moments de conversation et de rêverie, la ville nous semblait tout inachevée, non point endormie à la manière de la Grande-Russie, dans une indétermination séculaire, mais comme un prodigieux chantier, où l'on hâtait la construction de la cité prochaine. On n'en pouvait douter à l'heure qui précède le crépuscule, lorsque des coulées d'or pâli glissaient à l'horizon; ça et là, c'étaient des places nues, baignées de clarté, des espaces non bâtis encore; une palissade de bois entourait encore la cathédrale inachevée; les rues boueuses semblaient des alentours de palais en construction, détrempées par les mortiers, défoncées par les lourds chariots; là-bas, les maisons grises n'étaient plus que des baraquements d'ouvriers, et les hauts poteaux du télégraphe, du téléphone, des lampes électriques, formaient l'échafaudage géant de la ville future. La Tomsk actuelle semblait plus frêle, plus au ras du sol, dans le triomphe de cette lumière vermeille qui la submergeait; mais on pressentait la ville définitive et solide qui devait naître.
Nous sommes allés à l'Université. Elle est isolée dans un bois de bouleaux, là-bas, à l'extrémité de la ville, passé la cathédrale et le palais du gouverneur. Son domaine s'étend au long d'une large route dont l'autre côté est semé de villas, prenant leurs aises dans des jardins boisés. Nous avons découvert les longs bâtiments blancs où elle s'abrite; les isvotchiks ont franchi la barrière du bois et nous ont menés par une allée solide, bien sablée, devant la grande porte.
Nous nous réjouissions à la pensée que nous allions trouver des étudiants russes, qui nous diraient leur travail, leurs projets, un recteur que les conditions mêmes de notre voyage intéresseraient et qui allait nous parler à la fois de nos Universités et de celle de Tomsk, des études qu'on y faisait, des programmes!... Nous espérions qu'il serait tout heureux de nous recevoir, de nous donner en abondance des renseignements, de nous faire connaître des "camarades" de Sibérie. Il y avait bien de la vanité, peut-être, dans ces imaginations; mais elle était si naturelle!
Nous fûmes déçus. Nous avions oublié pour ces camarades ce que nous n'oublions pas pour nous-mêmes, qu'ils avaient aussi des vacances en Sibérie! Chez le recteur, notre visite fut pénible; il y mit infiniment de bonne grâce; mais, chose qui nous étonna! malgré dix mois de séjour en France, il baragouinait à peine quelques mots de français. Devant un si haut personnage, Orloff semblait s'effacer. Nous aurions pu audacieusement risquer un discours latin; la conversation se fit en allemand, très laborieuse. Nous avons compris que l'Université ne se composait encore que d'une faculté de médecine,—car c'était de médecins que le besoin se faisait sentir tout d'abord en ces pays neufs; qu'une faculté de droit allait ouvrir à la rentrée prochaine, que les autres viendraient plus tard. Puis il nous apprit que les élèves étaient en vacances, qu'ils étaient externes, que quelques-uns cependant logeaient dans un pavillon particulier, qu'il nous désigna dans un coin du bois, primitive Sorbonne de l'Université qui naissait! Le recteur nous avait l'air d'un administrateur (p. 238) bienveillant et doux; il était gros, un peu crasseux, nonchalant, peu intéressé au fond, et nous cachait mal l'ennui que lui causait notre visite.
Le lendemain, le bibliothécaire devait être là; nous sommes revenus le trouver. C'était un homme encore jeune, un peu hirsute, qui cachait dans sa barbe un visage malicieux: on devinait derrière les lunettes la vivacité de ses yeux de myope, son regard limité et aigu. Il parlait un français agréable, et se servait assez drôlement des préjugés accoutumés contre nous. Il savait les noms des voyageurs qui étaient passés par Tomsk et racontait sans rire l'histoire de leurs méprises. Plein de prévenance et fort instruit, il connaissait admirablement les trésors confiés à sa garde, toute cette collection dont le fond principal est constitué par l'ancienne bibliothèque du comte Strogonoff. Il nous a montré des éditions rares de Boccace, de Lucien, de Daphnis et Chloé, de la Pucelle, la plupart ornées de fines gravures du XVIIIe siècle. Il cherchait les plus licencieuses, pensant peut-être que c'étaient celles-là auxquelles des Français devaient prendre le plus de plaisir; d'ailleurs il connaissait fort bien leur place.
Il nous fit remarquer encore une vieille bible allemande du XVIe siècle, une chronique depuis l'origine du monde, vieux livre en lettres gothiques, édité à Nuremberg en 1493, de pittoresques reproductions de Sainte-Sophie, toute une collection de vieilles estampes pour les œuvres de Shakespeare, enfin des livres de la bibliothèque du roi de France, reliés en rouge avec des fleurs de lys d'or, et il s'est donné la petite satisfaction du Moscovite qui montre au Kreml nos canons de 1812: «Vous ne les avez plus!», répétait-il. Plus loin, sur une édition de Lucrèce, il s'est fort amusé à nous faire lire, à haute voix, une page de latin. Enfin, il nous a salués cérémonieusement et est retourné à son travail.
Ça et là, dans les rayons, nous avions aperçu, non sans étonnement, les œuvres de Guizot, le XIXe siècle de Michelet, surtout d'assez nombreux traités d'économie politique, enfin des écrits de Pecqueur, de Proudhon et d'auteurs socialistes.
Avec les appartements de quelques fonctionnaires et la bibliothèque, l'Université contient encore des salles de clinique, de curieux musées de géologie et d'archéologie. Nous nous sommes promenés dans les couloirs, dans les salles où pénétrait librement la clarté du jour; lorsqu'on regardait par la fenêtre, les yeux se reposaient sur le feuillage vert tendre des bouleaux. Un calme profond, le silence d'un grand couvent. Le jeune homme blond qui nous conduisait marchait d'un pas lent et respectueux. Nous avons visité une sorte de parloir, de salle de réception, où le tzar s'est arrêté pendant son voyage de tzarévitch à travers l'Asie, et où il a laissé son portrait avec sa signature: le guide nous fit découvrir. Enfin, tout au bout de longs couloirs, et comme dominant tout le reste, la chapelle.
L'Université dépendait de l'État, de l'État religieux et autocratique, mais l'État, c'était ici la grande puissance qui colonisait.

LES CLINIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE TOMSK (page 238).—PHOTOGRAPHIE EXTRAITE DU «GUIDE DU TRANSSIBÉRIEN».
Lorsqu'on errait à travers les rues de la ville, dont les maisons basses semblaient toujours provisoires, la cathédrale de pierre, qui était presque achevée, le palais du gouverneur, les nombreuses administrations du chemin de fer, des voies fluviales et des routes, et même le bureau de poste, dans son haut pavillon de bois, nous apparaissaient au contraire comme les points solides où s'appuyait l'activité des colons. Lorsque nous voyagions de bureau en bureau pour avoir des renseignements, nous avions plaisir à passer dans ces antichambres un peu solennelles, avec leurs huissiers cérémonieux, avec leurs glaces et leurs grands escaliers de bois, à pénétrer dans le bourdonnement de ces salles où retentissaient plus haut la sonnette du téléphone et les petits coups secs des appareils télégraphiques, ou bien dans le silence de ces bureaux, dont les tables étaient surchargées de cartes, de mémoires, de rapports, (p. 239) imprimés ou manuscrits, et où travaillaient de hauts fonctionnaires toujours bienveillants. Quelle joie, encore, dans ce bureau tumultueux de la poste, où l'on apercevait, courbées sur les appareils, des jeunes filles, serrées dans leurs dolmans à boutons de métal, attentives, comme si elles avaient eu conscience de la valeur de leur tâche! Sans doute, nous connaissions les habitudes anarchiques de l'administration russe; à l'heure même, nous eûmes à en souffrir, mais nous ne pouvions nous empêcher d'imaginer le rôle de cette colonisation officielle qui, dans un État renouvelé, compléterait et grandirait l'autre. C'est qu'elle était gigantesque la besogne qui revenait à l'État, le Transsibérien d'abord, la grande ligne qui avait pénétré le pays; les commissaires d'émigration qui préparaient et réglaient le voyage des paysans; les ingénieurs qui hâtaient la construction des embranchements nouveaux, qui allaient faire des forages dans le steppe pour trouver l'eau nécessaire; les enquêteurs qui reconnaissaient la qualité des terres, les mœurs, le tempérament des habitants primitifs; les agronomes qui faisaient le partage du sol, tout ce peuple de fonctionnaires dépendait forcément du Gouvernement central.

LES LONGS BÂTIMENTS BLANCS OÙ S'ABRITE L'UNIVERSITÉ (page 237).—PHOTOGRAPHIE EXTRAITE DU «GUIDE DU TRANSSIBÉRIEN».
Paysans, hautes classes, État, trois forces associées dans la même œuvre. Mais de ce qu'il y a fatalement collaboration, il doit s'ensuivre une révolution profonde dans l'État russe.
Longtemps, bien longtemps, presque depuis le jour où Pierre le Grand avait rêvé de faire de la Russie la représentante de l'Europe en Orient et l'héritière de sa politique traditionnelle contre le Turc, une sorte de discordance profonde avait régné entre l'État et le peuple. Pour faire la Russie plus forte, pour dégager son corps entravé et massif, Pierre le Grand avait dû lutter contre les nations occidentales et avec leurs propres armes. Alors il avait créé cet État moderne, à l'européenne, création artificielle et voulue, qui avait soulevé tant de haines. Contre la Suède, contre la Pologne, contre la Prusse, contre l'Autriche, ses successeurs avaient poursuivi ses guerres et ils avaient perfectionné ses institutions européennes.
Mais le peuple ne suivait pas: sourdes, les oppositions persistaient; et dans la masse amorphe de l'immense nation, l'État centralisé n'avait point de racines. Parfois, il est vrai, lorsque la lutte contre le Polonais hérétique ou contre le Turc impie réveillaient les vieilles croyances, il semblait momentanément qu'il y eût accord entre la nation russe et cet État moderne; l'enthousiasme pieux et le calcul des princes semblaient tendre au même but. Parfois encore, à quelques moments terribles de son histoire, la Russie connaissait cette unanimité profonde entre le Gouvernement et la masse qui atteste l'existence d'un peuple; dans le péril de 1812, par exemple, lorsque l'ennemi souillait le Kreml, lorsque les savants d'Occident devaient abandonner la défense au vieux Kutusow, alors le peuple se sentait groupé autour du Gouvernement moderne, et le Gouvernement moderne se mettait au service du peuple. Mais cette unité n'était que passagère; la crise passée, les princes et les leurs continuaient d'intriguer, de lutter en Occident, tandis que la nation, sacrifiée et résignée, rêvait, dans la misère, du jour heureux où le tzarisme donnerait enfin aux moujiks et les terres et le bonheur.
Mais où les trouver ces terres? où le trouver ce bonheur? Au loin, dans la plaine, la race errante et (p. 240) vagabonde les cherchait, la race colonisatrice qui depuis Novgorod-la-Grande et Moscou avait peu à peu envahi, conquis, russifié l'immense pays. Le jour où le chemin eut été désigné, le jour où le voyage enfin fut possible, des masses partirent. Coûte que coûte, il fallut suivre; le Gouvernement, lui aussi, dut se retourner vers l'Asie; il dut aider le peuple dans son labeur sibérien.
De là vient l'originalité étrange de cette colonisation sibérienne: elle ne procède pas d'une tradition politique, comme celle qui s'accomplit dans le Brandebourg; elle n'est pas l'œuvre voulue, systématique d'un État qui dirige tout, qui conduit tout. Elle n'est point due, non plus, comme la colonisation du Far West à des initiatives individuelles et réfléchies; on ne les rencontre ici que dans les hautes classes et en nombre limité. Elle est seulement comme la continuation, le prolongement de l'œuvre instinctive de colonisation et d'assimilation qui caractérise la race russe.
Mais alors on conçoit le rôle propre qui doit être celui de l'État russe; Gouvernement paternel, par tradition, il a le devoir de protéger, d'aider les masses instinctives dans leur poussée vers l'Asie; c'est à l'œuvre pacifique de colonisation qu'il doit consacrer ses ressources nouvelles. Mais l'œuvre entreprise exige aussi qu'il soit un Gouvernement économique et industriel. Il répondrait ainsi à la conception politique de la haute classe. M. M... et tous ceux que nous avons rencontrés aimaient à nous répéter alors qu'il était oiseux de discuter de la forme du Gouvernement. L'essentiel était que le Gouvernement favorisât les entreprises, fît des enquêtes, établît des communications, répandît partout le bien-être et la prospérité. Et c'était avec enthousiasme qu'ils décrivaient l'œuvre de l'État, la construction des chemins de fer ou des canaux, les enquêtes, les règlements de l'émigration, et cette union économique que l'activité centralisatrice allait réaliser entre les pays divers de l'immense Empire.
C'était là le point de départ; mais, sans doute, en admettant même que les événements violents, qui troublent parfois les évolutions les plus sûres, ne bouleversent point cette œuvre, en admettant même que le tzarisme ne se laisse point tromper par sa puissance nouvelle et ne compromette point par de folles entreprises l'énergie sûre de la race, qui ne voit les conséquences infinies et certaines d'une telle transformation? Lorsqu'à l'usage, dans le pays désormais exploité, les problèmes économiques seront devenus plus complexes, les intérêts des individus et des entreprises plus enchevêtrés et plus mêlés, alors la bourgeoisie et le peuple, voudront connaître et discuter du Gouvernement. La nation s'est consacrée à la colonisation, au commerce; la colonisation et le commerce la ramèneront à la politique. Par ce caractère industriel et commerçant de l'État, les questions économiques deviennent fatalement des questions politiques; les appétits surexcités feront sortir le peuple russe de sa résignation séculaire. Les questions sociales surviennent; et l'on sait quelles racines vivaces elles ont dans les âmes russes: rêves mystiques du communisme paysan, exaltation de la jeunesse pensante, christianisme d'un Tolstoï, sans compter ici encore les souvenirs et les leçons de nos luttes occidentales, toutes ces aspirations soutenues par les désirs matériels voudront être satisfaites. Que de changements inouïs le travail instinctif du moujik aurait fait germer!... Mais qui sait si l'État comprendrait bien sa tâche! Qui sait si les traditions du passé ne compromettraient point l'œuvre nouvelle et grande qui s'offrait à lui!
(À suivre.) Albert Thomas.

LA VOITURE DE L'ICÔNE STATIONNAIT PARFOIS (page 230).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Droits de traduction et de reproduction réservées.
(p. 241) TOME XI, NOUVELLE SÉRIE.—21e LIV. No 21.—27 Mai 1905

FLÂNEURS À LA GARE DU PETROPAVLOSK (page 242).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. LEGRAS.
VI. — Heures de retour. — Dans l'Oural. — La Grande-Russie. — Conclusion.

DANS LES VALLÉES DE L'OURAL, HABITENT ENCORE DES BACHKIRS (page 245).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Dimanche 21/9 août.—Ce soir, nous avons retrouvé notre train; il était propre, remis à neuf, devant la gare blanche et coquette. Nous étions arrivés longtemps à l'avance, et nous nous sommes mêlés à la foule qui était venue pour voir le départ du grand train ou pour le visiter. Hors des petits groupes de toilettes claires et d'ombrelles blanches, des voix féminines s'élevaient; plus loin, parmi les blouses rouges des moujiks, ou n'entendait que le grignotement des pommes de kèdre, ou des graines de tournesol. Tout souriait: c'était la joie du crépuscule approchant, la joie du lent voyage et du retour. La cloche nous a semblé tinter avec plus de solennité; les adieux ont été plus tendres, plus prolongés que de coutume; un dernier tintement et, sur les rails, le glissement indolent a recommencé.
Autour de Tomsk, s'étendait une fraîche campagne toute bosselée de collines que les troncs blancs des bouleaux avaient parées: dans la prairie, ainsi limitée, une rivière coulait. La mélancolie d'un soir d'automne, déjà, transpirait de ce paysage. Les feuilles n'avaient pas encore pris leurs teintes d'or, mais elles étaient comme séchées, d'un vert sans éclat. Une lueur rose flottait dans un brouillard à l'horizon. Ça et là, dans le ciel, quelques nuages, gris bleu s'effilaient, et les troncs mauves des bouleaux semblaient refléter quelque chose de leurs teintes étranges. La nuit était tombée quand nous sommes arrivés à Taïga.
Lundi 22/10 août.—Nous avons retrouvé dans le train l'Américain et son guide, et la demoiselle en rouge qui revient à Pétersbourg, toute seule. Nous occupons, Dujardin et moi, un compartiment, et personne ne viendra nous déranger de tout le voyage. M. A..., un musicien, d'origine grecque, est notre voisin: visage (p. 242) brun, cheveux noirs, parler gras et vêtements clairs, grand causeur et qui trouve pourtant moyen d'être discret.
Ce matin, un accident est arrivé à la machine; deux heures environ, nous sommes restés entre deux gares, attendant une locomotive. C'était passé l'Ob, dans le steppe. Les voyageurs sont descendus. À droite, un taillis de bouleaux entourait une petite mare, et dans ce terrain marécageux, des plantes grasses avaient poussé; des essaims de moustiques empêchaient d'avancer. De l'autre côté du remblai, on était plongé dans les hautes herbes, fourmillantes de vie. Tandis que les garçons du restaurant cherchaient des baies sauvages, de petits fruits noirs ou rouges, dont ils étaient friands, tandis que le guide pétersbourgeois photographiait, et qu'Avierino s'essayait à marcher sur un rail, nous avons cueilli des fleurs, et nous avons eu plaisir à détailler l'infinie variété des herbes. Il y en avait de droites et d'élancées, dont la tige souple se terminait par des vrilles, et garnies d'un duvet que le moindre souffle faisait envoler. Il y avait aussi des quantités innombrables de fleurs rouges que la sécheresse avait plus ou moins assombries, et qui, vues de loin, en masses, teignaient la plaine d'un brun merveilleux. Hors des herbes grasses, la multitude des graminées élançait ses épis argentés et mouvants, qui luisaient comme un vol d'insectes dans un rayon de soleil. Au milieu d'elles, des ombelles épanouissaient leurs disques roses ou violets. D'autres agitaient des clochettes bleues; des immortelles faisaient des taches d'un grenat sombre, et des marguerites sauvages cerclaient de pétales de feu leur centre noir. Au travers de ces masses, parmi la forêt des tiges, les menthes humbles, dont on découvrait près de terre les fleurs violettes, exhalaient leur parfum. Et là aussi, sur le bord du remblai, les lychnis, les compagnons blancs, inclinaient leurs clochettes blanches, comme sur le bord de nos routes.
Mardi 23/11 août.—Toujours la monotonie du steppe: à droite, à gauche, les yeux avides d'émotions accueillent avec empressement tout spectacle inaccoutumé. Ici, la mélancolie d'une forêt brûlée, avec ses troncs de bouleaux noircis, ses feuilles recroquevillées et rousses qui pendent encore; là, au passage, un Kirghize, sur son petit cheval.....
..... Petropavlosk, toute une grande gare: des marchands, des émigrants, des flâneurs. Derrière une plaine sablonneuse, stérile, lentement ondulée, des façades blanches émergent, luisent au soleil: des bureaux, cela est sûr; des maisons d'administration, où parmi la paresse et le vol, l'œuvre des colonisateurs s'accomplit encore.
Plus loin, une petite gare dans un bouquet de verdure.
Nous causons; nous jouons aux dominos, nous regardons les gravures du voyage du tzarévitch en Sibérie ou dans l'Inde. Mon camarade prend des notes sur un livre de Dolgoroukov, établit nos comptes, écrit des lettres. À chaque gare, il court chercher des fleurs nouvelles. Ce soir, il en a rapporté de merveilleuses, toutes violettes, tige, feuilles et fleurs, comme si on les avait trempées dans un bain de couleur,—couvertes de duvet,—douces au toucher.

UN TAILLIS DE BOULEAUX ENTOURAIT UNE PETITE MARE.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
Mercredi 24/12 août.—À Omsk, à Petropavlosk, à Kourgane et à Tchéliabinsk, des voyageurs nouveaux sont montés: marchands, tchinovniks, ingénieurs, deux officiers.
Dans un compartiment, nos «ingénieurs», puis un nouveau venu, André Andrévitch, de figure plus fine, aux yeux plus brillants derrière le lorgnon, plus sérieux et plus réfléchi, sont assis toujours auprès d'une même voyageuse, et font d'interminables parties de cartes; la dame ne cesse de fumer des papirosses, dont les cartons jonchent le tapis. K... est bruyant; c'est lui qui marque: il marque à la craie, à même le tapis vert de la table, de grands chiffres blancs, qu'une petite brosse n'efface, qu'imparfaitement, après chaque partie. Au bout de plusieurs heures, lorsqu'ils sont las, ils viennent causer avec nous; ils aiment à parler des popes crasseux et répugnants, à railler leur famille nombreuse et misérable, et se moquent des prétentions de leur femme, la popadiana: ils n'en feront que plus de signes de croix aux offices.
(p. 243) Dans le fumoir, à l'arrière, la demoiselle en rouge, un haut fonctionnaire, deux officiers et le musicien. Ce dernier scande la marche du train, et on l'entend parfois qui, tout seul, bat la mesure: τουτο μἑν, τουτο δε; ou encore τουτον τον τρὁτον, quand les roues sautent d'un rail à l'autre.

LES RIVIÈRES ROULAIENT UNE EAU CLAIRE (page 244).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
Des deux militaires, l'un est un officier supérieur attaché au gouverneur d'Omsk: c'est un homme de taille moyenne, d'allure un peu lente, d'aspect modeste; un honnête visage russe, des yeux intelligents; une voix douce, un parler lent. Il nous raconta qu'il conduisit jadis, à travers le gouvernement d'Omsk, Henri d'Orléans et Bonvalot, et nous vante l'amabilité de «notre» prince. Il ne parle du tzar et de l'État qu'avec beaucoup de respect, infiniment d'affection.... Chose rare en Russie! il cause seulement de ce qu'il sait, de la campagne des Balkans à laquelle il a pris part, de l'organisation militaire russe; et à son tour, il nous demande des renseignements sur notre armée, sur nos écoles spéciales.
Par contre, son compagnon, jeune officier de l'Académie de guerre, est insupportable. Dans un visage plat, des traits durs, des yeux vifs, une moustache blonde peu fournie, sur une lèvre tombante et grossière; jambe fine et pantalon collant; le dolman pris à la taille; une voix aiguë et sifflante, insolent et fat de toute sa personne. Aux gares, il parlait fort pour attirer sur lui l'attention. Trois sujets de conversation: le jeu, les chevaux et les femmes;—posant au désillusionné, au misogyne, au pessimiste, et ne dédaignant pas de dire des grossièretés devant des jeunes filles.
Ce soir, tout un petit concert dans le wagon-restaurant: les artistes ont quêté pour l'orphelinat de Moscou.
Entre Miask et Oufa s'étend la région de l'Oural méridional, nettement définie par sa hauteur entre les deux plaines de Sibérie et de Grande-Russie.—La ligne se déroule dans la montagne, sur les pentes et les montées: elle suit la vallée des rivières, coupe comme une écharpe blanche le flanc des collines, s'abrite sous les roches à pic, ou dans de vastes circuits dont on aperçoit longtemps à l'avance l'autre extrémité, contourne les gorges plus profondes. La voie est peu solide, les pluies plus fréquentes; les gelées et les débâcles du printemps minent, chaque année, le remblai. Les ingénieurs sont attentifs; on entend tour à tour ahaner la locomotive et les freins grincer. Mais, dans cette lente promenade, les yeux jouissent davantage de la nouveauté, de la fraîcheur du paysage.
C'est comme un monde isolé et fermé, une forteresse de rochers, battus par la mer des plaines et qui les domine de la ligne bleuâtre de ses remparts. On dirait que les nappes lourdes de la chaleur, qui s'affaissaient uniment sur l'immensité du steppe et exaltaient partout la vie de l'herbe, n'ont pu pénétrer ces vallées et qu'elles sont demeurées au-dessus de leur atmosphère fraîche, impénétrable. Le matin, on avait froid. Le ciel était pâle, comme un ciel d'hiver, empli de brume, mais sans pluie. Dans une bande de lumière plus blanche, les arêtes des sommets se détachaient plus vigoureusement.
Ces montagnes, cependant, n'étaient point sauvages; à l'exception de quelques falaises abruptes qui menaçaient la voie et dont on apercevait contre les wagons les masses noires stratifiées, les vallées étaient douces, hospitalières. On se serait cru dans les environs de Tarbes ou d'Argelès, parmi les premières hauteurs (p. 244) des Pyrénées; les rivières roulaient des cailloux dans leur eau claire, écumaient contre de gros rochers; mais elles se répandaient plus librement que nos gaves, dans des vallées plus larges, à fond plat. C'était la fin de l'été; quelques torrents étaient à sec. Parfois les monts s'interrompaient, et le train traversait une sorte de cirque où la bigarrure d'une prairie brillait sous la lumière plus franche. Puis les hauteurs recommençaient; elles étaient presque toutes boisées, et dans le lointain aucun pic ne scintillait de neiges.
Dans l'isolement de cette région, des hommes s'étaient arrêtés; sans doute, l'instinct nomade des moujiks de la plaine ne les poussait plus, comme eux, en avant. Sur la voie, à l'exception de quelques terrassiers, on apercevait seulement les gardes-barrières, qui, le train passé, se plaçaient entre les deux rails, et, immobiles, continuaient d'observer sa marche, jusqu'à ce qu'ils l'eussent perdu de vue. Aux gares, les employés, quelques marchands d'objets en fer forgé, rarement un mendiant; les émigrants ne s'arrêtent point là, et les habitants ne savent pas regarder les trains, toute une journée, en rêvant de la fertilité des régions lointaines.
Dans les vallées, entre la rivière et la montagne, ou tout à l'entour d'un lac à l'eau sombre, les villages s'échelonnaient. De loin, à Zlatooust, les isbas on bois avaient un aspect misérable, comme des huttes; mais par-dessus leur amas noir, l'église faisait resplendir sa coupole verte et ses murs blancs; et devant la lisière des bois, des cultures incitaient au village une ceinture de teintes claires. À Vazovaïa, la forêt cernait la gare, un bâtiment dont le granit grisâtre éclatait sur un fond de sapins noirs, et qui plaisait par sa solidité. En arrière, les bois neufs d'une chapelle éclairaient les dessous du bois, et les clochetons d'argent luisaient parmi les feuilles. Sur la terre, les fleurs avaient déroulé comme un tapis rouge. Plus loin, dans une de ces vallées qui se ressemblaient toutes, avec leurs rivières incertaines et sans profondeur, avec leurs îles verdoyantes, leurs collines boisées ou leurs falaises noires, un autre village avait encore assemblé ses isbas, autour de l'église blanche et verte. Les maisons peu serrées laissaient entre elles de grands espaces, couverts d'un gazon jauni; elles étaient uniformes, toutes entourées d'un petit jardin. Au bord de la rivière, des forges s'abritaient sous des bâtiments et dressaient haut leurs cheminées. Là, tout remuait, tout était vivant; une activité, continue et tenace, des hommes et de la nature. Les routes étaient nombreuses, des routes grises que les ornières accoutumées avaient tracées; des troïkas y filaient allègrement, ou toute une file de chariots qui montait vers la gare. Les rivières, aussi, étaient vivantes, tantôt perdues sous l'amoncellement des pierres et cherchant à retrouver leur cours, tantôt plus profondes et rassemblant leurs eaux, pour mouvoir les roues des moulins ou des forges. Et voilà que la montagne elle-même s'animait. Comme dans ces forêts, les bouleaux avaient poussé leurs troncs d'argent entre les sapins, et que les bouquets, tantôt clairs, tantôt sombres de leur feuillage, distinguaient chaque arbre par l'inégalité de leurs teintes, on aurait dit que toute cette masse remuait. C'était comme une armée de géants verts qui gravissait la pente, qui allait à l'assaut de la montagne. Ça et là, l'or de quelques feuilles déjà sèches pointait dans ce revêtement sombre.

LA LIGNE SUIT LA VALLÉE DES RIVIÈRES (page 243).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
L'Oural est riche en minerai, et cette richesse a retenu le labour des habitants. L'industrie a crevé la montagne, elle a envahi ses vallées, elle a, accroché ses ateliers bruyants au-dessus des rivières. Mais les usines sont loin de la ligne, à 150 verstes, quelquefois, comme l'usine d'une compagnie française dont les Russes aimaient à nous vanter l'exemple. Il suit de là que l'organisation industrielle, dans ces régions, a une physionomie originale, et qui fait saillir quelques traits du nouveau mode de travail.
Dans le gouvernement d'Orenbourg, en effet, il y a peu de culture; l'été est court; on ne peut semer que de l'avoine, qui rend peu. Le pays est donc un pays d'ouvriers, et comme il est d'usage en Russie, ils sont plusieurs milliers dans une même usine. L'ouvrier reçoit de la terre, un petit jardin, des pâturages et du bois pour construire son isba; mais on lui retient tout cela sur son salaire. L'usine a ses magasins, vend les vivres. (p. 245) L'organisation en cité ouvrière, sous la direction du patron, est la forme la plus fréquente de la vie des travailleurs russes. Par ordre de l'État, chaque usine a son école, son hôpital, son médecin, et des inspecteurs passent, dit-on, souvent. Peut-être le moujik agriculteur a-t-il aujourd'hui plus d'indépendance! Peut-être a-t-il plus souvent à exercer son initiative! Mais n'est-il pas frappant de voir la servitude séculaire, devenue pour ainsi dire instinctive, reparaître au moment où le Russe doit s'assouplir à une nouvelle condition de vie?
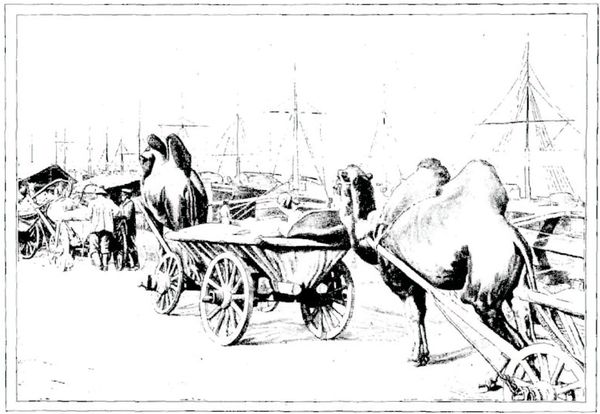
COMME TOUTE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE SEMBLE FRÊLE EN FACE DES EAUX PUISSANTES DE LA VOLGA (page 248).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. G. CAHEN.
Ce monde des cités ouvrières vit et produit, ainsi, dans l'isolement de sa vallée; il produit, toute une année, sans interruption, sans souci des acheteurs et de leurs besoins; dans les forêts, les bûcherons et les charbonniers préparent le combustible, et pendant des mois, sur les rives de la Bielaïa, les fers s'amoncellent. Mais au printemps, c'est un réveil subit: le fleuve s'enfle, les lourds bateaux peuvent se confier à ses eaux puissantes; on se rappelle ici qu'il y a d'autres hommes, là-bas, dans la plaine; et par la Bielaïa, par la Kama et par la Volga, jusqu'à Kazan, jusqu'aux quais de Nijni, les fers de l'Oural descendent. C'est tout le capital des entreprises, c'est tout le travail de l'année, toute la vie d'un peuple qui se confie aux eaux. Il est des années, dit-on, où la Bielaïa du printemps n'a pas assez d'eau, et c'est pendant deux ans que le travail s'amasse ainsi.
Étrange isolement des forces productrices! Comme on doit souhaiter là-bas, dans les inquiétudes du printemps, de pouvoir plus constamment mesurer son effort aux besoins des autres! comme on doit sentir parfois toute la puissance de solidarité en germe dans le travail moderne!
Autrefois, une population de race finnoise habitait ces vallées, les Bachkirs; mais, selon le phénomène ethnographique qui a créé la Moscovie, les Slaves ont russifié ces indigènes païens, et les derniers, sans doute, bientôt disparaîtront. On dit que ceux-ci sont devenus musulmans, et cette particularité explique le vouloir-vivre tenace de leur race. Le Gouvernement, tolérant, leur permet d'élever des mosquées, et le fanatisme religieux est inconnu chez ces peuples simples. Dans les villages, les deux races sont mêlées; ils sont excellents voisins, mais la race vigoureuse étouffera les derniers indigènes dans son envahissement pacifique.—À une station, nous avons vu un mendiant bachkir, un vieillard aveugle, attentivement conduit par un petit garçon. Le bonhomme était grand, droit malgré la vieillesse, mais il laissait retomber sa tête sur sa poitrine, et l'on avait peine à voir son visage maigre et ridé, bronzé par le soleil et par la vieillesse, où la (p. 246) place des yeux semblait plus vaste. Le petit, à la mine éveillée, guettait à droite et à gauche où recueillir les kopecks. Et le vieux avait de doux gestes, pleins d'affection, pour le remercier. Vivante et triste image de la race qui disparaît!
Mais qui sait si la race, triomphante à son tour, n'est point sur son déclin, minée, elle aussi, par l'industrie! Les peuples occidentaux, dont le caractère avait été précisé et affermi par des siècles d'histoire et qui avaient fait la machine, ont été eux-mêmes asservis par elle. Par la collaboration de tous, par l'instruction, par une aspiration plus véhémente à l'indépendance, ils ont commencé de s'affranchir. Mais qu'adviendra-t-il de la race douce, aux traits vagues et indolents, au caractère incertain, et qui accomplit encore, par instinct seulement, son œuvre de colonisation? Ne va-t-elle pas être broyée dans les engrenages de l'industrie? On dit que les mœurs sont horribles dans les campagnes russes où elle a pénétré, que la vodka y coule plus pernicieuse, et que les ouvriers se vendent mutuellement leurs femmes. Que le foyer de la chaudière n'anéantisse point la race en même temps que ses forêts!
La nuit est tombée. Par une dernière pente, le train descend vers Oufa. Le crépuscule vient de s'éteindre: mais une déchirure d'un rouge sombre cerne l'horizon et colore de violet les revers des nuages noirs. Nous descendons le long de la rivière Oufa, qui entre, elle aussi, dans la plaine, et sur l'eau, luisante des derniers reflets du ciel, des bateaux glissent, formes noires.
Nous avons éprouvé, en traversant la Grande-Russie, l'impression d'une reconnaissance; nous avons revu Samara et la Volga, des isbas de pêcheurs et des chalands, puis la campagne plate avec ses villages, Moscou enfin. Et des paysages nouveaux nous semblaient déjà vus. Autour de nous, les voyageurs parlaient, comme avec plus d'affection, des moujiks, du mir, des vieilles institutions, de cette primitive Russie, si séduisante, dans l'incertitude de sa force. Car c'était là la Moscovie, une Russie plus intimement russe, puisque des colons l'avaient faite dans un premier essai de colonisation orientale, et qu'à son tour, elle envoyait ses émigrants vers la Sibérie. De nos souvenirs et de nos impressions, une image se réveille en nous, douce et grisâtre, et qui pour nous est la Russie. Point de couleurs mêlées et éclatantes, point de vive lumière, mais une mélancolie effacée et pauvre, et tout au fond, le scintillement d'un dôme.
Russie marchande de la Volga, Russie industrielle de Toula et de Moscou, Russie agricole de la plaine, il y a là toutes les formes de l'activité russe, non point dispersées et heurtées, mais comme le travail d'une même race, soutenu par les mêmes forces et par les mêmes qualités; et c'est comme une première et incomplète ébauche de la Russie à faire.....

BACHKIRS SCULPTEURS.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. PAUL LABBÉ.
τουτο μἑν, τουτο δε, le musicien grec scande toujours la marche du train qui va maintenant plus allègre, au sortir de l'Oural. Voici de nouveau la plaine, non plus immense et traîtresse comme le steppe mouvant, mais lentement ondulée, coupée de ruisseaux, paisible; tantôt des pâturages, tantôt des carrés jaunâtres de champs moissonnés, à peine distincts. Point de variété: le moujik ne fait pas de différence entre son village et le village voisin, entre son champ et les autres champs. Toujours, si loin qu'il aille, il est assuré de revoir les troncs argentés des bouleaux et des trembles, la poussière blanche des chemins que soulève le galop des troïkas, les blouses rouges ou les jupes éclatantes des femmes pointillant la plaine, les troupeaux de bétail ou les chevaux gambadant en liberté, et tout en haut, dans le ciel clair, le vol noir des corbeaux. On ne peut pas ne pas les aimer. (p. 248) cette grisaille, ces villages, ces isbas en troncs de sapins, grises comme le sol, grises comme les meules où s'entasse la paille des années précédentes, et les cimetières! et les ruisseaux profondément entaillés, aux rives noires, d'aspect sauvage! et l'église dominant tout de la floraison dorée de ses bulbes! Dans tous ces lieux, la même activité si pauvre de moyens: une culture arriérée encore, les instruments et les méthodes du XVe siècle; pas d'engrais. Au loin, les moulins à vent hérissant les collines; près des villages, on voit des groupes de paysans, des blouses rouges qui s'agitent; on bat le blé. Cependant, tout près de la voie, vers laquelle s'en viennent toujours les longues files des télègues, aux gares, il y a parfois un élévateur où le blé s'amasse pour l'exportation. Et tout cela, terre et travail, tout est souriant dans sa pauvreté, heureux sous le ciel pur, dans l'air vif qui court sur les champs nus.

À LA GARE DE TCHÉLIABINSK, TOUJOURS DES ÉMIGRANTS (page 242).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. LEGRAS.
De loin en loin, c'est une ville, Samara, Toula, un plus grand village avec plus de dômes et de murs blancs, mais ni plus fier, ni plus dur à l'homme que la pauvre campagne. Nous avions revu Samara répandant ses toits verts sur une pente douce de colline, égrenant, pêle-mêle, insouciante et gracieuse, la parure de ses coupoles; c'était la ville de province que nous connaissions, mais plus naïve et plus jolie de loin que dans la civilisation crasseuse de ses rues. Le lendemain, c'était Toula, «la charmante Toula», comme disait le colonel qui venait d'Omsk, bâtie dans une vallée fraîche, au bord d'une maigre rivière. Comme le train la contournait, en passant d'une gare à l'autre, pour rejoindre la ligne de Moscou, nous avons pu goûter sa beauté légère et aussi plus occidentale, ses dômes moins obsédants, ses maisons modernes et sa verdure. Les cheminées des usines, groupées au fond de la vallée, ne la déparaient pas; elles fixaient seulement le paysage, le rendaient moins vague. Tout auprès s'étendait le faubourg ouvrier, un vrai village russe, des isbas isolées, chacune avec son enclos, et laissant toujours entre leurs rangées, non pas une rue, mais une large place couverte d'une herbe rare que paissaient des bestiaux. Le train a dépassé ces faubourgs; il a traversé un champ vaste, désolé, où des bandes de corbeaux croassaient, voletaient, s'abattaient sur le sol, et tournoyaient autour de quelques chevaux en liberté; puis nous sommes revenus, par l'autre ligne, jusqu'à la gare principale. Là, d'autres trains allaient partir, dans des directions diverses, pour des distances plus courtes; une foule plus nombreuse, une ardeur plus mêlée occupait la station. Les convois de marchandises témoignaient du travail de la côte. Des soldats embarquaient, après la manœuvre, le visage noir, les habits de toile blanche salis par la poussière et la graisse; ils avaient formé les faisceaux, et le long du train, dans les marmites de campement, préparaient le thé; ils avaient rompu les rangs, couraient en désordre, mais c'est à peine si l'on entendait un vague murmure. Dans la gare, il y avait un riche buffet, une belle icône; on y vendait des objets en fer de Toula, des anneaux pour clefs, des couteaux, des porte-monnaie.

UNE BONNE D'ENFANTS, AVEC SON COSTUME TRADITIONNEL (page 251).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. G. CAHEN.
Mais l'industrie qui les produisait n'élevait pas là son bourdonnement accoutumé; on aurait dit qu'elle ne pénétrait ni les mœurs ni la nature; c'étaient des moujiks que l'on voyait aux gares, et dans l'indolence résignée des caractères, dans l'immensité des horizons, il semblait que l'industrie usait vainement sa force. Ici, comme dans la plaine, le travail semblait pauvre et sans fixité.
Point d'œuvre humaine ici qui paraisse grande: si belle soit-elle, elle ne s'accommodera qu'avec peine à la majesté de la nature. Dans nos pays d'Occident, les grands travaux, les grandes usines, toutes les «merveilles de l'industrie» apparaissent à l'esprit, fortes et splendides; ici le pont du chemin de fer, jeté à travers la Volga, ce pont long de 1 200 mètres, avec ses douze piles blanches qui le jalonnent, avec ses entrées triomphales surmontées des armes de la Russie, avec son gigantesque tablier dont le fleuve reflète la large bande rouge, tout cela est mesquin; la Volga déroule au loin la puissance de ses eaux bleues, elle entraîne (p. 249) confusément les bancs de sable et les frêles bateaux. À la sortie du pont, une chapelle est bâtie, où l'icône resplendit de la lueur des cierges. Et le village de Syzrane qui a logé entre le fleuve et la voie ses isbas misérables, garnies de poissons séchés, ses jardinets où les filets sont étendus au soleil, et ses barques en construction, semble tout humble, lui aussi, dans son labeur.

JOIE NAÏVE DE VIVRE ET MÉLANCOLIE.—UN PETIT MARCHÉ DU SUD (page 250).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE M. G. CAHEN.
Partout la même pauvreté, partout la même misère. Dans la masse anonyme des moujiks, il n'y a point de variétés; qu'ils soient pêcheurs ou marchands, ouvriers ou agriculteurs, la même somnolence alourdit les traits, décolore les yeux; ils sont plus pâles peut-être dans les ateliers clos, plus bronzés à l'air vif de la plaine, mais ils demeurent identiques. C'est qu'il s'exerce sur tous, uniformément, des influences plus constantes que celle du métier: l'influence du climat et celle de la misère. Dans le froid extrême ou dans l'extrême chaleur, le corps n'apprend point à réagir; il se résigne ou il s'isole dans la maison surchauffée ou dans l'épaisseur malsaine de la touloupe. Point de nourriture fortifiante: du thé, du pain, des confitures; la vodka compense l'insuffisance de ces mets. Le tempérament russe s'est formé ainsi, comme les spectacles grandioses de la nature ont formé l'intelligence.
En traversant ces pays où tout semble imparfait, inachevé, nous avions sans cesse à l'esprit les belles pages de Michelet où il célèbre la France; où retraçant l'ensemble de son histoire, il montre l'homme se dégageant du sol, échappant au fatalisme, s'élevant de ce qui est matériel et local jusqu'à «l'idée plus libre du village natal, de la ville, de la province, d'une grande patrie par laquelle il compte lui-même dans les destinées du monde», et par un nouvel effort «jusqu'à l'idée de la patrie universelle, de la cité de la Providence».—Développement irréalisable ici peut-être! Pour qu'une nation se soit formée, pour qu'une patrie soit née, il a fallu la diversité locale. Le paysan russe aime la terre, la terre vague, partout semblable; mais il n'aime point son village; il n'aime pas son lopin. Comment ce peuple grandira-t-il? Comment sortira-t-il de cette résignation séculaire que le climat lui donne peut-être, et que l'ignorance entretient?
Hélas! il a déçu bien des dévouements; lorsque, pour la première fois, la Russie a frémi de sentir pénétrer en elle le travail moderne, beaucoup avaient fondé sur lui l'espoir grandiose d'une nation nouvelle, «brûlant les étapes», devançant même la civilisation occidentale. Mais il a fallu revenir de ce culte du (p. 250) moujik! Quel mystère que ce peuple, jeune par son caractère, par ses institutions, par sa vigueur de race, et vieux déjà de sa longue histoire! Et cependant on ne peut s'empêcher de l'aimer pour son charme indéfinissable, pour ce qu'il a, comme l'enfant, des "possibilités" de tout. Joie naïve de vivre et mélancolie, vol, mensonge, débauche et préoccupations morales, communisme du mir et mystique désir d'un communisme plus chrétien et plus abondant en jouissances, attente du millénium; amour du tzar et ignorance de la Russie comme nation, quelle puissance purifiera et déliera cet esprit confus! À tous les degrés de la société russe, dans les hautes classes si intelligentes et dans la masse anonyme du peuple, il y a une force qui manque, une force tout occidentale: la réflexion. L'esprit russe n'est point centré. Il n'est point délicat aux sensations légères de l'extérieur; il ne sent que les extrêmes; il ne sait pas classer ni limiter, distinguer le réel de l'idéal, de l'abstrait.
Et la même question, toujours, obsédait l'esprit: comment ce peuple instinctif prendra-t-il conscience de son effort?
Quelques-uns, logiquement rêvaient de "l'apparition de l'individualisme dans la conscience russe", d'une assimilation plus profonde des institutions occidentales. Le mir, disaient-ils, et tout l'organisme villageois étaient ébranlés; une classe moyenne se formait, une sorte de bourgeoisie à l'occidentale, mêmes qualités et même esprit; l'industrie bouleversait la masse tranquille des moujiks, un prolétariat urbain naissait, et la Russie allait devenir brusquement plus démocratique et plus organisée, avec toute une hiérarchie, toute une variété de classes.

UN RUSSE DANS SON VÊTEMENT D'HIVER (page 249).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. G. CAHEN.
—Erreur! erreur! répondaient les autres. Le mir n'est point en décadence, et malgré les difficultés, les paysans fondent toujours des communautés nouvelles. La force de révolution que vous prêtez à l'industrie s'éteint dans notre pays; le moujik ouvrier reste semblable à son frère des champs. La sainte Russie adoptera l'industrie; mais l'industrie ne bouleversera point les conditions de sa vie. Aujourd'hui comme autrefois, la parole de Samarine reste vraie: "Il n'y a chez nous que deux forces vivantes: l'autocratie on haut, le mir en bas."
Mais au lieu du communisme patriarcal, au lieu du partage des terres qui ralentissait la production, on verrait le communisme nouveau, fondé tout à la fois sur la division et sur l'unité du travail; l'agriculture industrielle pénétrerait la campagne russe, et le mir deviendrait la communauté organisée, régulatrice des efforts. Tandis que le tzarisme, en aidant, en dirigeant la colonisation, aurait clairement désigné à la Russie sa mission dans le monde, la race elle-même, poussée par son rêve de jouissances nouvelles et d'un monde meilleur, accommodant son ardeur et ses institutions aux nécessités modernes, se reconnaîtrait comme nation, fixerait son génie mobile.
Quelle était la vraie de ces deux thèses? Longuement, nous poursuivions ces pensées, tandis que nos yeux erraient sur la plaine. Peu à peu, il nous semblait qu'un changement s'était fait. C'était toujours l'étendue incertaine avec ses ondulations, ses minuscules collines. Mais de tous côtés, des embranchements quittaient la ligne, descendaient vers des usines aux briques noircies par la fumée, et surmontées de cheminées en tôle. Ces usines se mêlaient aux cabanes, elles se groupaient, comme les villages agricoles devenus plus nombreux, au pied des falaises grisâtres et sur le bord des rivières entaillées dans le sol. Et c'était là comme des mirs industriels, où le moujik apprendrait le communisme nouveau.
Nous avons traversé l'Oka; la ligne allait maintenant toute droite à travers les bois, sur un solide remblai de pierre, comme une belle et large route. Et c'était bien une route que les paysans suivaient au long des rails pour aller d'un village à l'autre. Nous entrions dans la banlieue de Moscou, une campagne plus (p. 251) riche, plus boisée, où l'on apercevait moins souvent la pauvreté des isbas, mais dans les bois frais, les datchas, les villas d'été où se réfugie, pendant les chaleurs, la population riche. De la campagne à la ville, c'est un va-et-vient continuel, un mélange des deux populations; l'hiver, les bourgeois rentrent, mais tous les ouvriers venus pour les charrois de l'été, pour les grands travaux, les maçons et les charretiers retournent à leur tour au village. Les gares avaient déjà l'aspect souriant et bon enfant de la grande ville. Elles étaient bordées de larges quais de bois qui servaient de promenade; sur les bancs, quelques bourgeois lisaient, où non loin, des enfants jouaient, gardés par leurs bonnes au costume pittoresque. Des vendeurs de fruits venaient offrir le plaisir d'un marchandage.

DANS TOUS LES VILLAGES RUSSES, UNE ACTIVITÉ HUMBLE, PAUVRE DE MOYENS.—MARCHANDS DE POTERIES (page 248).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. G. CAHEN.
Et nous sentions déjà toute la joie du retour, quand nous pensions, dans la lassitude causée par ces six jours de voyage, que nous allions revoir Moscou, la ville aimée et familière, qui déjà nous avait bercés une fois, et que nous souhaitions de revoir avec l'affection de l'émigrant ou du pèlerin.
Au loin, enfin, nous l'avons aperçue, lorsque nous commencions à peine de traverser les terrains vagues qui précèdent ses faubourgs. Il était tard déjà, et les rougeoiements du crépuscule s'éteignaient, mais dans tout l'horizon une buée de couleurs tendres persistait, bleu pâle, mauve, lilas et rose. Et dans cette atmosphère paisible et légère, notre Moscou réapparaissait, avec toutes ses églises; avec tous ses dômes. Mais ce n'était pas la beauté triomphante de midi, le flamboiement des coupoles d'or, la splendeur des murailles et l'éclat miroitant des fouillis polychromes. La grande ville était calme et douce dans le soir, dressant plus haut sa tour d'Ivan Véliki, et confondant ses dômes dans les nuées rougeâtres qui l'enveloppaient.
C'était ainsi sans doute que les moujiks l'aimaient. Et c'était sur cette image qu'ils devaient fixer les yeux, dans leur attente mystique du monde nouveau, lorsqu'ils rêvaient de ce temps «où la terre tout entière serait aux moujiks, où ce serait partout Moscou, une universelle Moscou, où ce qui vaut 60 kopecks n'en vaudrait plus qu'un, où le kvass coulerait en abondance sur les places publiques, et où la vodka aurait versé l'oubli, cette fois définitif, des misères passées».
Notre rêve fut-il une erreur? Nous sommes-nous trompés, lorsque, en traversant l'immense plaine, de Moscou à Tomsk, nous avions cru pressentir les destinées magnifiques de ce peuple russe, de cette race russe, dont les instincts colonisateurs semblaient devoir se déployer, avec tant de puissance, jusqu'à l'extrémité de l'Asie?
Nous ne voulons pas le croire; toutes les forces latentes qui commençaient d'agir, toutes les énergies populaires qui inauguraient, inconsciemment encore, une œuvre grande, ne peuvent être anéanties par la crise présente. Mais tandis qu'au jour le jour nous nous plaisions à noter les efforts nouveaux des différentes (p. 252) classes, l'ardeur colonisatrice du moujik enfin libéré du servage héréditaire, le travail conscient et réfléchi de ces ingénieurs, de ces agronomes, de ces techniciens de toutes sortes, heureux de mettre la science au service d'une grande œuvre collective,—puis le dévouement de ces fonctionnaires, si différents des vieux tchinovniks, paresseux et concussionnaires,—enfin çà et là quelques initiatives heureuses du Gouvernement impérial,—nous oubliions trop facilement que toutes les forces du passé, «toutes les puissances des ténèbres» entravaient encore l'essor superbe de ce peuple.
Brusquement, par le conflit d'Extrême-Orient, il a été rappelé à ceux qui l'oubliaient que les maux anciens subsistaient, qu'ils continuaient leur œuvre d'usure et de destruction des forces. Il a été révélé que le vieil esprit d'ambition et d'hégémonie régnait encore dans les conseils du Gouvernement impérial, et qu'il n'était point occupé de l'unique pensée de développer, pour le bonheur de tous, les ressources profondes de la nation. Il a été révélé encore, qu'à côté des fonctionnaires dévoués et conscients de leur tâche, les autres étaient nombreux encore qui se contentaient de vivre leur vie égoïste, dans la désorganisation de tout. Et il a été révélé surtout que ces initiatives conscientes, qui devenaient de plus en plus nécessaires pour la conduite de l'œuvre commune, ces efforts d'intelligence,—et par là même de liberté,—qui, depuis les étudiants jusqu'aux moujiks, sollicitaient peu à peu tout le peuple, épouvantaient une autorité traditionnelle, qui n'avait point su les gagner et qui ne songeait plus qu'à les entraver.
À l'heure où nous écrivons, tandis que les armées campent encore en Mandchourie, il serait bien osé de dire quelle sera l'issue de la lutte, quelles en seront les conséquences pour la Russie. Mais que l'armée russe sorte victorieuse ou vaincue des tristes batailles engagées là-bas, que l'autocratie tzarienne conserve son pouvoir intact ou qu'elle soit forcée à des concessions administratives ou politiques, les forces profondes du peuple seront peut-être moins atteintes que celles de tout autre par une lutte aussi terrible. Nous avons insisté sur cette idée: si la France est une nation, si la Prusse est un État, la Russie, elle, est encore une race. Et si les mots disent peu de chose, scientifiquement, ils rendent bien l'impression que nous éprouvions au milieu de cette activité collective, qu'une sorte d'instinct seul dirigeait, et à laquelle les forces intelligentes ne pouvaient que s'adapter. Le lien entre l'individu et l'État était lâche et les grandes répercussions de la vie collective se mouraient rapidement dans la plaine immense, aux environs des grandes villes. Mais, par cela même, les conseils du Gouvernement peuvent être hésitants et désemparés; l'œuvre instinctive continuera, préparatrice de destinées plus conscientes. Que le Gouvernement russe le comprenne donc une fois pleinement, qu'il se contente de mettre en œuvre, dans la liberté et dans la paix, toutes les forces de la nation, qu'il relève la condition des paysans, à la campagne, qu'il leur épargne la misère, plus horrible encore, que l'industrie introduit fatalement parmi eux, et, dans un bien-être nouveau, dans une liberté nouvelle, le moujik connaîtra enfin ce pays des justes, qu'il a si souvent désespéré de trouver.
Albert Thomas.
Novembre 1904.

LÀ, AU PASSAGE, UN KIRGHIZE SUR SON PETIT CHEVAL (page 242).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.
Droits de traduction et de reproduction réservés.
L'ÉTÉ AU KACHMIR
Par Mme F. MICHEL
En «rickshaw» sur la route du mont Abou. (D'après une photographie.) 1
L'éléphant du touriste à Djaïpour. 1
Petit sanctuaire latéral dans l'un des temples djaïns du mont Abou. (D'après une photographie.) 2
Pont de cordes sur le Djhilam, près de Garhi. (Dessin de Massias, d'après une photographie.) 3
Les «Karévas» ou plateaux alluviaux formés par les érosions du Djhilam. (D'après une photographie.) 4
«Ekkas» et «Tongas» sur la route du Kachmir: vue prise au relais de Rampour. (D'après une photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 5
Le vieux fort Sikh et les gorges du Djhilam à Ouri. (D'après une photographie.) 6
Shèr-Garhi ou la «Maison du Lion», palais du Maharadja à Srinagar. (Photographie Bourne et Sheperd, à Calcutta.) 7
L'entrée du Tchinar-Bagh, ou Bois des Platanes, au-dessus de Srinagar; au premier plan une «dounga», au fond le sommet du Takht-i-Souleiman. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 7
Ruines du temple de Brankoutri. (D'après une photographie.) 8
Types de Pandis ou Brahmanes Kachmirs. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 9
Le quai de la Résidence; au fond, le sommet du Takht-i-Souleiman. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 10
La porte du Kachmir et la sortie du Djhilam à Baramoula. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 11
Nos tentes à Lahore. (D'après une photographie.) 12
«Dounga» ou bateau de passagers au Kachmir. (Photographie Bourne et Shepherd, à Calcutta.) 13
Vichnou porté par Garouda, idole vénérée près du temple de Vidja-Broer (hauteur 1m 40.) 13
Enfants de bateliers jouant à cache-cache dans le creux d'un vieux platane. (D'après une photographie.) 14
Batelières du Kachmir décortiquant du riz, près d'une rangée de peupliers. (Photographie Bourne et Shepherd, à Calcutta.) 15
Campement près de Palhallan: tentes et doungas. (D'après une photographie.) 16
Troisième pont de Srinagar et mosquée de Shah Hamadan; au fond, le fort de Hari-Paryat. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 17
Le temple inondé de Pandrethan. (D'après une photographie.) 18
Femme musulmane du Kachmir. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 19
Pandit Narayan assis sur le seuil du temple de Narasthan. (D'après une photographie.) 20
Pont et bourg de Vidjabroer. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 21
Ziarat de Cheik Nasr-oud-Din, à Vidjabroer. (D'après une photographie.) 22
Le temple de Panyech: à gauche, un brahmane; à droite, un musulman. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 23
Temple hindou moderne à Vidjabroer. (D'après une photographie.) 24
Brahmanes en visite au Naga ou source sacrée de Valtongou. (D'après une photographie.) 25
Gargouille ancienne, de style hindou, dans le mur d'une mosquée, à Houtamourou, près de Bhavan. 25
Temple ruiné, à Khotair. (D'après une photographie.) 26
Naga ou source sacrée de Kothair. (D'après une photographie.) 27
Ver-Nag: le bungalow au-dessus de la source. (D'après une photographie.) 28
Temple rustique de Voutanar. (D'après une photographie.) 29
Autel du temple de Voutanar et accessoires du culte. (D'après une photographie.) 30
Noce musulmane, à Rozlou: les musiciens et le fiancé. (D'après une photographie.) 31
Sacrifice bhramanique, à Bhavan. (D'après une photographie.) 31
Intérieur de temple de Martand: le repos des coolies employés au déblaiement. (D'après une photographie.) 32
Ruines de Martand: façade postérieure et vue latérale du temple. (D'après des photographies.) 33
Place du campement sous les platanes, à Bhavan. (D'après une photographie.) 34
La Ziarat de Zaïn-oud-Din, à Eichmakam. (Photographie Bourne et Shepherd, à Calcutta.) 35
Naga ou source sacrée de Brar, entre Bhavan et Eichmakar. (D'après une photographie.) 36
Maisons de bois, à Palgam. (Photographie Bourne et Shepherd, à Calcutta.) 37
Palanquin et porteurs. 37
Ganech-Bal sur le Lidar: le village hindou et la roche miraculeuse. (D'après une photographie.) 38
Le massif du Kolahoi et la bifurcation de la vallée du Lidar au-dessus de Palgam, vue prise de Ganeth-Bal. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 39
Vallée d'Amarnath: vue prise de la grotte. (D'après une photographie.) 40
Pondjtarni et le camp des pèlerins: au fond, la passe du Mahagounas. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 41
Cascade sortant de dessous un pont de neige entre Tannin et Zodji-Pal. (D'après une photographie.) 42
Le Koh-i-Nour et les glaciers au-dessus du lac Çecra-Nag. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 43
Grotte d'Amarnath. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 43
Astan-Marg: la prairie et les bouleaux. (D'après une photographie.) 44
Campement de Goudjars à Astan-Marg. (D'après une photographie.) 45
Le bain des pèlerins à Amarnath. (D'après une photographie.) 46
Pèlerins d'Amarnath: le Sadhou de Patiala; par derrière, des brahmanes, et à droite, des musulmans du Kachmir. (D'après une photographie.) 47
Mosquée de village au Kachmir. (D'après une photographie.) 48
Brodeurs Kachmiris sur toile. (Photographie Bourne et Shepherd, à Calcutta.) 49
Mendiant musulman. (D'après une photographie.) 49
Le Brahma Sar et le camp des pèlerins au pied de l'Haramouk. (D'après une photographie.) 50
Lac Gangabal au pied du massif de l'Haramouk. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 51
(p. ii) Le Noun-Kol, au pied de l'Haramouk, et le bain des pèlerins. (D'après une photographie.) 52
Femmes musulmanes du Kachmir avec leurs «houkas» (pipes) et leur «hangri» (chaufferette). (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 53
Temples ruinés à Vangath. (D'après une photographie.) 54
«Mêla» ou foire religieuse à Hazarat-Bal. (En haut, photographie par l'auteur; en bas, photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 55
La villa de Cheik Safai-Bagh, au sud du lac de Srinagar. (D'après une photographie.) 56
Nishat-Bagh et le bord oriental du lac de Srinagar. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 57
Le canal de Mar à Sridagar. (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 58
La mosquée de Shah Hamadan à Srinagar (rive droite). (Photographie Jadu Kissen, à Delhi.) 59
Spécimens de l'art du Kachmir. (D'après une photographie.) 60
SOUVENIRS DE LA COTE D'IVOIRE
Par le docteur LAMY
Médecin-major des troupes coloniales.
La barre de Grand-Bassam nécessite un grand déploiement de force pour la mise à l'eau d'une pirogue. (D'après une photographie.) 61
Le féminisme à Adokoï: un médecin concurrent de l'auteur. (D'après une photographie.) 61
«Travail et Maternité» ou «Comment vivent les femmes de Petit-Alépé». (D'après une photographie.) 62
À Motéso: soins maternels. (D'après une photographie.) 63
Installation de notre campement dans une clairière débroussaillée. (D'après une photographie.) 64
Environs de Grand-Alépé: des hangars dans une palmeraie, et une douzaine de grands mortiers destinés à la préparation de l'huile de palme. (D'après une photographie.) 65
Dans le sentier étroit, montant, il faut marcher en file indienne. (D'après une photographie.) 66
Nous utilisons le fût renversé d'un arbre pour traverser la Mé. (D'après une photographie.) 67
La popote dans un admirable champ de bananiers. (D'après une photographie.) 68
Indigènes coupant un acajou. (D'après une photographie.) 69
La côte d'Ivoire. — Le pays Attié. 70
Ce fut un sauve-qui-peut général quand je braquai sur les indigènes mon appareil photographique. (Dessin de J. Lavée, d'après une photographie.) 71
La rue principale de Grand-Alépé. (D'après une photographie.) 72
Les Trois Graces de Mopé (pays Attié). (D'après une photographie.) 73
Femme du pays Attié portant son enfant en groupe. (D'après une photographie.) 73
Une clairière près de Mopé. (D'après une photographie.) 74
La garnison de Mopé se porte à notre rencontre. (D'après une photographie.) 75
Femme de Mopé fabriquant son savon à base d'huile de palme et de cendres de peaux de bananes. (D'après une photographie.) 76
Danse exécutée aux funérailles du prince héritier de Mopé. (D'après une photographie.) 77
Toilette et embaumement du défunt. (D'après une photographie.) 78
Jeune femme et jeune fille de Mopé. (D'après une photographie.) 79
Route, dans la forêt tropicale, de Malamalasso à Daboissué. (D'après une photographie.) 80
Benié Coamé, roi de Bettié et autres lieux, entouré de ses femmes et de ses hauts dignitaires. (D'après une photographie.) 81
Chute du Mala-Mala, affluent du Comoé, à Malamalasso. (D'après une photographie.) 82
La vallée du Comoé à Malamalasso. (D'après une photographie.) 83
Tam-tam de guerre à Mopé. (D'après une photographie.) 84
Piroguiers de la côte d'Ivoire pagayant. (D'après une photographie.) 85
Allou, le boy du docteur Lamy. (D'après une photographie.) 85
La forêt tropicale à la côte d'Ivoire. (D'après une photographie.) 86
Le débitage des arbres. (D'après une photographie.) 87
Les lianes sur la rive du Comoé. (D'après une photographie.) 88
Les occupations les plus fréquentes au village: discussions et farniente Attié. (D'après une photographie.) 89
Un incendie à Grand-Bassam. (D'après une photographie.) 90
La danse indigène est caractérisée par des poses et des gestes qui rappellent une pantomime. (D'après une photographie.) 91
Une inondation à Grand-Bassam. (D'après une photographie.) 92
Un campement sanitaire à Abidjean. (D'après une photographie.) 93
Une rue de Jackville, sur le golfe de Guinée. (D'après une photographie.) 94
Grand-Bassam: cases détruites après une épidémie de fièvre jaune. (D'après une photographie.) 95
Grand-Bassam: le boulevard Treich-Laplène. (D'après une photographie.) 96
L'ÎLE D'ELBE
Par M. PAUL GRUYER
L'île d'Elbe se découpe sur l'horizon, abrupte, montagneuse et violâtre. 97
Une jeune fille elboise, au regard énergique, à la peau d'une blancheur de lait et aux beaux cheveux noirs. 97
Les rues de Porto-Ferraio sont toutes un escalier (page 100). 98
Porto-Ferraio: à l'entrée du port, une vieille tour génoise, trapue, bizarre de forme, se mire dans les flots. 99
Porto-Ferraio: la porte de terre, par laquelle sortait Napoléon pour se rendre à sa maison de campagne de San Martino. 100
Porto-Ferraio: la porte de mer, où aborda Napoléon. 101
La «teste» de Napoléon (page 100). 102
Porto-Ferraio s'échelonne avec ses toits plats et ses façades scintillantes de clarté (page 99). 103
Porto-Ferraio: les remparts découpent sur le ciel d'un bleu sombre leur profil anguleux (page 99). 103
La façade extérieure du «Palais» des Mulini où habitait Napoléon à Porto-Ferraio (page 101). 104
Le jardin impérial et la terrasse de la maison des Mulini (page 102). 105
La Via Napoleone, qui monte au «Palais» des Mulini. 106
La salle du conseil à Porto-Ferraio, avec le portrait de la dernière grande-duchesse de Toscane et celui de Napoléon, d'après le tableau de Gérard. 107
La grande salle des Mulini aujourd'hui abandonnée, avec ses volets clos et les peintures décoratives qu'y fit faire l'empereur (page 101). 107
Une paysanne elboise avec son vaste chapeau qui la protège du soleil. 108
Les mille mètres du Monte Capanna et de son voisin, le Monte Giove, dévalent dans les flots de toute leur hauteur. 109
Un enfant elbois. 109
Marciana Alta et ses ruelles étroites. 110
Marciana Marina avec ses maisons rangées autour du rivage et ses embarcations tirées sur la grève. 111
Les châtaigniers dans le brouillard, sur le faite du Monte Giove. 112
... Et voici au-dessus de moi Marciana Alta surgir des nuées (page 111). 113
La «Seda di Napoleone» sur le Monte Giove où l'empereur s'asseyait pour découvrir la Corse. 114
La blanche chapelle de Monserrat au centre d'un amphithéâtre de rochers est entourée de sveltes cyprès (page 117). 115
Voici Rio Montagne dont les maisons régulières et cubiques ont l'air de dominos empilés... (page 118). 115
(p. iii) J'aperçois Poggio, un autre village perdu aussi dans les nuées. 116
Une des trois chambres de l'ermitage. 117
L'ermitage du Marciana où l'empereur reçut la visite de la comtesse Walewska, le 3 Septembre 1814. 117
Le petit port de Porto-Longone dominé par la vieille citadelle espagnole (page 117). 118
La maison de Madame Mère à Marciana Alta. — «Bastia, signor!» — La chapelle de la Madone sur le Monte Giove. 119
Le coucher du soleil sur le Monte Giove. 120
Porto-Ferraio et son golfe vus des jardins de San Martino. 121
L'arrivée de Napoléon à l'île d'Elbe. (D'après une caricature du temps.) 121
Le drapeau de Napoléon roi de l'île d'Elbe: fond blanc, bande orangé-rouge et trois abeilles jadis dorées. 122
La salle de bains de San Martino a conservé sa baignoire de pierre. 123
La chambre de Napoléon à San Martino. 123
La cour de Napoléon à l'île d'Elbe. (D'après une caricature du temps.) 124
Une femme du village de Marciana Alta. 125
Le plafond de San Martino et les deux colombes symboliques représentant Napoléon et Marie-Louise. 126
San Martino rappelle par son aspect une de ces maisonnettes à la Jean-Jacques Rousseau, agrestes et paisibles (page 123). 126
Rideau du théâtre de Porto-Ferraio représentant Napoléon sous la figure d'Apollon gardant ses troupeaux chez Admète. 127
La salle égyptienne de San Martino est demeurée intacte avec ses peintures murales et son bassin à sec. 127
Broderies de soie du couvre-lit et du baldaquin du lit de Napoléon aux Mulini, dont on a fait le trône épiscopal de l'évêque d'Ajaccio. 128
La signorina Squarci dans la robe de satin blanc que son aïeule portait à la cour des Mulini. 129
Éventail de Pauline Borghèse, en ivoire sculpté, envoyé en souvenir d'elle à la signora Traditi, femme du maire de Porto-Ferraio. 130
Le lit de Madame Mère, qu'elle s'était fait envoyer de Paris à l'île d'Elbe. 130
Le vieil aveugle Soldani, fils d'un soldat de Waterloo, chauffait, à un petit brasero de terre jaune, ses mains osseuses. 131
L'entrée du goulet de Porto-Ferraio par où sortit la flottille impériale, le 26 février 1815. 132
D'ALEXANDRETTE
AU COUDE DE L'EUPHRATE
Par M. VICTOR CHAPOT
membre de l'École française d'Athènes.
Dans une sorte de cirque se dressent les pans de muraille du Ksar-el-Benat (page 142). (D'après une photographie.) 133
Le canal de Séleucie est, par endroits, un tunnel (page 140). 133
Vers le coude de l'Euphrate: la pensée de relever les traces de vie antique a dicté l'itinéraire. 134
L'Antioche moderne: de l'ancienne Antioche il ne reste que l'enceinte, aux flancs du Silpios (page 137). 135
Les rues d'Antioche sont étroites et tortueuses; parfois, au milieu, se creuse en fossé. (D'après une photographie.) 136
Le tout-Antioche inonde les promenades. (D'après une photographie.) 137
Les crêtes des collines sont couronnées de chapelles ruinées (page 142). 138
Alep est une ville militaire. (D'après une photographie.) 139
La citadelle d'Alep se détache des quartiers qui l'avoisinent (page 143). (D'après une photographie.) 139
Les parois du canal de Séleucie s'élèvent jusqu'à 40 mètres. (D'après une photographie.) 140
Les tombeaux de Séleucie s'étageaient sur le Kasios. (D'après une photographie.) 141
À Alep une seule mosquée peut presque passer pour une œuvre d'art. (D'après une photographie.) 142
Tout alentour d'Alep la campagne est déserte. (D'après une photographie.) 143
Le Kasr-el-Benat, ancien couvent fortifié. 144
Balkis éveille, de loin et de haut, l'idée d'une taupinière (page 147). (D'après une photographie.) 145
Stèle Hittite. L'artiste n'a exécuté qu'un premier ravalement (page 148). 145
Église arménienne de Nisib; le plan en est masqué au dehors. (D'après une photographie.) 146
Tell-Erfat est peuplé d'Yazides; on le reconnaît à la forme des habitations. (D'après une photographie.) 147
La rive droite de l'Euphrate était couverte de stations romaines et byzantines. (D'après une photographie.) 148
Biredjik vu de la citadelle: la plaine s'allonge indéfiniment (page 148). (D'après une photographie.) 149
Sérésat: village mixte d'Yazides et de Bédouins (page 146). (D'après une photographie.) 150
Les Tcherkesses diffèrent des autres musulmans; sur leur personne, pas de haillons (page 152). (D'après une photographie.) 151
Ras-el-Aïn. Deux jours se passent, mélancoliques, en négociations (page 155). (D'après une photographie.) 152
J'ai laissé ma tente hors les murs devant Orfa. (D'après une photographie.) 153
Environs d'Orfa: les vignes, basses, courent sur le sol. (D'après une photographie.) 154
Vue générale d'Orfa. (D'après une photographie.) 155
Porte arabe à Rakka (page 152). (D'après une photographie.) 156
Passage de l'Euphrate: les chevaux apeurés sont portés dans le bac à force de bras (page 159). (D'après une photographie.) 157
Bédouin. (D'après une photographie.) 157
Citadelle d'Orfa: deux puissantes colonnes sont restées debout. (D'après une photographie.) 158
Orfa: mosquée Ibrahim-Djami; les promeneurs flânent dans la cour et devant la piscine (page 157). (D'après une photographie.) 159
Pont byzantin et arabe (page 159). (D'après une photographie.) 160
Mausolée d'Alif, orné d'une frise de têtes sculptées (page 160). (D'après une photographie.) 161
Mausolée de Théodoret, selon la légende, près de Cyrrhus. (D'après une photographie.) 162
Kara-Moughara: au sommet se voit une grotte taillée (page 165). (D'après une photographie.) 163
L'Euphrate en amont de Roum-Kaleh; sur la falaise campait un petit corps de légionnaires romains (page 160). (D'après une photographie.) 163
Trappe de Checkhlé: un grand édifice en pierres a remplacé les premières habitations (page 166). 164
Trappe de Checkhlé: la chapelle (page 166). (D'après une photographie.) 165
Père Maronite (page 168). (D'après une photographie.) 166
Acbès est situé au fond d'un grand cirque montagneux (page 166). (D'après une photographie.) 167
Trappe de Checkhlé: premières habitations des trappistes (page 166). (D'après une photographie.) 168
LA FRANCE AUX NOUVELLES-HÉBRIDES
Par M. RAYMOND BEL
Indigènes hébridais de l'île de Spiritu-Santo. (D'après une photographie.) 169
Le petit personnel d'un colon de Malli-Colo. (D'après une photographie.) 169
Le quai de Franceville ou Port-Vila, dans l'île Vaté. (D'après une photographie.) 170
Une case de l'île de Spiritu-Santo et ses habitants. (D'après une photographie.) 171
Le port de Franceville ou Port-Vila, dans l'île Vaté, présente une rade magnifique. (D'après une photographie.) 172
(p. iv) C'est à Port-Vila ou Franceville, dans l'île Vaté, que la France a un résident. (D'après une photographie.) 173
Dieux indigènes ou Tabous. (D'après une photographie.) 174
Les indigènes hébridais de l'île Mallicolo ont un costume et une physionomie moins sauvages que ceux de l'île Pentecôte. (D'après des photographies.) 175
Pirogues de l'île Vao. (D'après une photographie.) 176
Indigènes employés au service d'un bateau. (D'après une photographie.) 177
Un sous-bois dans l'île de Spiritu-Santo. (D'après une photographie.) 178
Un banquet de Français à Port-Vila (Franceville). (D'après une photographie.) 179
La colonie française de Port-Vila (Franceville). (D'après une photographie.) 179
La rivière de Luganville. (D'après une photographie.) 180
LA RUSSIE, RACE COLONISATRICE
Par M. ALBERT THOMAS
Les enfants russes, aux grosses joues pales, devant l'isba (page 182). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 181
La reine des cloches «Tsar Kolokol» (page 190). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 181
Les chariots de transport que l'on rencontre en longues files dans les rues de Moscou (page 183). 182
Les paysannes en pèlerinage arrivées enfin à Moscou, la cité sainte (page 182). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 183
Une chapelle où les passants entrent adorer les icônes (page 183). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 184
La porte du Sauveur que nul ne peut franchir sans se découvrir (page 185). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 185
Une porte du Kreml (page 185). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 186
Les moines du couvent de Saint-Serge, un des couvents qui entourent la cité sainte (page 185). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 187
Deux villes dans le Kreml: celle du xve siècle, celle d'Ivan, et la ville moderne, que symbolise ici le petit palais (page 190). 188
Le mur d'enceinte du Kreml, avec ses créneaux, ses tours aux toits aigus (page 183). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 189
Tout près de l'Assomption, les deux églises-sœurs se dressent: les Saints-Archanges et l'Annonciation (page 186). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 189
À l'extrémité de la place Rouge, Saint-Basile dresse le fouillis de ses clochers (page 184). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 190
Du haut de l'Ivan Véliki, la ville immense se découvre (page 190). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 191
Un des isvotchiks qui nous mènent grand train à travers les rues de Moscou (page 182). 192
Il fait bon errer parmi la foule pittoresque des marchés moscovites, entre les petits marchands, artisans ou paysans qui apportent là leurs produits (page 195). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 193
L'isvotchik a revêtu son long manteau bleu (page 194). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 193
Itinéraire de Moscou à Tomsk. 194
À côté d'une épicerie, une des petites boutiques où l'on vend le kvass, le cidre russe (page 195). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 195
Et des Tatars offraient des étoffes étalées sur leurs bras (page 195). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 196
Patients, résignés, les cochers attendent sous le soleil de midi (page 194). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 197
Une cour du quartier ouvrier, avec l'icône protectrice (page 196). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 198
Sur le flanc de la colline de Nijni, au pied de la route qui relie la vieille ville à la nouvelle, la citadelle au marché (page 204). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 199
Le marché étincelait dans son fouillis (page 195). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 200
Déjà la grande industrie pénètre: on rencontre à Moscou des ouvriers modernes (page 195). (D'après une photographie.) 201
Sur l'Oka, un large pont de bois barrait les eaux (page 204). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 202
Dans le quartier ouvrier, les familles s'entassent, à tous les étages, autour de grandes cours (page 196). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 203
Le char funèbre était blanc et doré (page 194). (D'après une photographie.) 204
À Nijni, toutes les races se rencontrent, Grands-Russiens, Tatars, Tcherkesses (page 208). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 205
Une femme tatare de Kazan dans l'enveloppement de son grand châle (page 214). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 205
Nous avons traversé le grand pont qui mène à la foire (page 205). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 206
Au dehors, la vie de chaque jour s'étalait, pêle-mêle, à l'orientale (page 207). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 207
Les galeries couvertes, devant les boutiques de Nijni (page 206). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 208
Dans les rues, les petits marchands étaient innombrables (page 207). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 209
Dans une rue, c'étaient des coffres de toutes dimensions, peints de couleurs vives (page 206). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 210
Près de l'asile, nous sommes allés au marché aux cloches (page 208). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 211
Plus loin, sous un abri, des balances gigantesques étaient pendues (page 206). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 211
Dans une autre rue, les charrons avaient accumulé leurs roues (page 206). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 212
Paysannes russes, de celles qu'on rencontre aux petits marchés des débarcadères ou des stations (page 215). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 213
Le Kreml de Kazan. C'est là que sont les églises et les administrations (page 214). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 214
Sur la berge, des tarantass étaient rangées (page 216). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 215
Partout sur la Volga d'immenses paquebots et des remorqueurs (page 213). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 216
À presque toutes les gares il se forme spontanément un petit marché (page 222). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 217
Dans la plaine (page 221). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 217
Un petit fumoir, vitré de tous côtés, termine le train (page 218). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 218
Les émigrants étaient là, pêle-mêle, parmi leurs misérables bagages (page 226). (D'après une photographie de M. J. Cahen.) 219
Les petits garçons du wagon-restaurant s'approvisionnent (page 218). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 220
Émigrants prenant leur maigre repas pendant l'arrêt de leur train (page 228). (Photographie de M. A. N. de Koulomzine) 221
L'ameublement du wagon-restaurant était simple, avec un bel air d'aisance (page 218). (Photographie de M. A. N. de Koulomzine) 222
Les gendarmes qui assurent la police des gares du Transsibérien. (Photographie de M. Thiébeaux.) 223
L'église, près de la gare de Tchéliabinsk, ne diffère des isbas neuves que par son clocheton (page 225). (Photographie extraite du «Guide du Transsibérien».) 224
Un train de constructeurs était remisé là, avec son wagon-chapelle (page 225). (Photographie de M. A. N. de Koulomzine.) 225
Vue De Stretensk: la gare est sur la rive gauche, la ville sur la rive droite. (Photographie de M. A. N. de Koulomzine.) 226
(p. v) Un point d'émigration (page 228). (Photographie de M. A. N. de Koulomzine.) 227
Enfants d'émigrants (page 228). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 228
Un petit marché dans une gare du Transsibérien. (Photographie de M. Legras.) 229
La cloche luisait, immobile, sous un petit toit isolé (page 230). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 229
Nous sommes passés près d'une église à clochetons verts (page 230). (Photographie de M. Thiébeaux.) 230
Tomsk a groupé dans la vallée ses maisons grises et ses toits verts (page 230). (Photographie de M. Brocherel.) 231
Après la débâcle de la Tome, près de Tomsk (page 230). (D'après une photographie de M. Legras.) 232
Le chef de police demande quelques explications sur les passeports (page 232). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 233
La cathédrale de la Trinité à Tomsk (page 238). (Photographie extraite du «Guide du Transsibérien».) 234
Tomsk: en revenant de l'église (page 234). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 235
Tomsk n'était encore qu'un campement, sur la route de l'émigration (page 231). (D'après une photographie.) 236
Une rue de Tomsk, définie seulement par les maisons qui la bordent (page 231). (Photographie de M. Brocherel.) 237
Les cliniques de l'Université de Tomsk (page 238). (Photographie extraite du «Guide du Transsibérien».) 238
Les longs bâtiments blancs où s'abrite l'Université (page 237). (Photographie extraite du «Guide du Transsibérien».) 239
La voiture de l'icône stationnait parfois (page 230). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 240
Flâneurs à la gare de Petropavlosk (page 242). (D'après une photographie de M. Legras.) 241
Dans les vallées de l'Oural, habitent encore des Bachkirs (page 245). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 241
Un taillis de bouleaux entourait une petite mare. (D'après une photographie.) 242
Les rivières roulaient une eau claire (page 244). (D'après une photographie.) 243
La ligne suit la vallée des rivières (page 243). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 244
Comme toute l'activité commerciale semble frêle en face des eaux puissantes de la Volga! (page 248.) (D'après une photographie de M. G. Cahen.) 245
Bachkirs sculpteurs. (D'après une photographie de M. Paul Labbé.) 246
À la gare de Tchéliabinsk, toujours des émigrants (page 242). (D'après une photographie de M. J. Legras.) 247
Une bonne d'enfants, avec son costume traditionnel (page 251). (D'après une photographie de M. G. Cahen.) 248
Joie naïve de vivre, et mélancolie. — un petit marché du sud (page 250). (D'après une photographie de M. G. Cahen.) 249
Un russe dans son vêtement d'hiver (page 249). (D'après une photographie de M. G. Cahen.) 250
Dans tous les villages russes, une activité humble, pauvre de moyens. — Marchands de poteries (page 248). (D'après une photographie de M. G. Cahen.) 251
Là, au passage, un Kirghize sur son petit cheval (page 242). (D'après une photographie de M. Thiébeaux.) 252
LUGANO, LA VILLE DES FRESQUES
Par M. GERSPACH
Lugano: les quais offrent aux touristes une merveilleuse promenade. (Photographie Alinari.) 253
Porte de la cathédrale Saint-Laurent de Lugano (page 256). (Photographie Alinari.) 253
Le lac de Lugano dont les deux bras enserrent le promontoire de San Salvatore. (D'après une photographie.) 254
La ville de Lugano descend en amphithéâtre jusqu'aux rives de son lac. (Photographie Alinari.) 255
Lugano: faubourg de Castagnola. (D'après une photographie.) 256
La cathédrale de Saint-Laurent: sa façade est décorée de figures de prophètes et de médaillons d'apôtres (page 256). (Photographie Alinari.) 257
Saint-Roch: détail de la fresque de Luini à Sainte-Marie-des-Anges (Photographie Alinari.) 258
La passion: fresque de Luini à l'église Sainte-Marie-des-Anges (page 260). (Photographie Alinari) 259
Saint Sébastien: détail de la grande fresque de Luini à Sainte-Marie-des-Anges. (Photographie Alinari.) 260
La madone, l'enfant Jésus et Saint Jean, par Luini, église Sainte-Marie-des-Anges (page 260). (Photographie Alinari.) 261
La Scène: fresque de Luini à l'église Sainte-Marie-des-Anges (page 260). 262
Lugano: le quai et le faubourg Paradiso. (Photographie Alinari.) 263
lac de Lugano: viaduc du chemin de fer du Saint-Gothard. (D'après une photographie.) 264
SHANGHAÏ, LA MÉTROPOLE CHINOISE
Par M. ÉMILE DESCHAMPS
Les quais sont animés par la population grouillante des Chinois (page 266). (D'après une photographie.) 265
Acteurs du théâtre chinois. (D'après une photographie.) 265
Plan de Shanghaï. 266
Shanghaï est sillonnée de canaux qui, à marée basse, montrent une boue noire et mal odorante. (Photographie de Mlle Hélène de Harven.) 267
Panorama de Shanghaï. (D'après une photographie.) 268
Dans la ville chinoise, les «camelots» sont nombreux, qui débitent en plein vent des marchandises ou des légendes extraordinaires. (D'après une photographie.) 269
Le poste de l'Ouest, un des quatre postes où s'abrite la milice de la Concession française (page 272). (D'après une photographie.) 270
La population ordinaire qui grouille dans les rues de la ville chinoise de Shanghaï (page 268). 271
Les coolies conducteurs de brouettes attendent nonchalamment l'arrivée du client (page 266). (Photographies de Mlle H. de Harven.) 271
Une maison de thé dans la cité chinoise. (D'après une photographie.) 272
Les brouettes, qui transportent marchandises ou indigènes, ne peuvent circuler que dans les larges avenues des concessions (page 270). (D'après une photographie.) 273
La prison de Shanghaï se présente sous l'aspect d'une grande cage, à forts barreaux de fer. (D'après une photographie.) 274
Le parvis des temples dans la cité est toujours un lieu de réunion très fréquenté. (D'après une photographie.) 275
Les murs de la cité chinoise, du côté de la Concession française. (D'après une photographie.) 276
La navigation des sampans sur le Ouang-Pô. (D'après une photographie.) 277
Aiguille de la pagode de Long-Hoa. (D'après une photographie.) 277
Rickshaws et brouettes sillonnent les ponts du Yang King-Pang. (D'après une photographie.) 278
Dans Broadway, les boutiques alternent avec des magasins de belle apparence (page 282). 279
Les jeunes Chinois flânent au soleil dans leur Cité. (Photographies de Mlle H. de Harven.) 279
Sur les quais du Yang-King-Pang s'élèvent des bâtiments, banques ou clubs, qui n'ont rien de chinois. (D'après une photographie.) 280
Le quai de la Concession française présente, à toute heure du jour, la plus grande animation. (D'après une photographie.) 281
Hong-Hoa: pavillon qui surmonte l'entrée de la pagode. (D'après une photographie.) 282
«L'omnibus du pauvre» (wheel-barrow ou brouette) fait du deux à l'heure et coûte quelques centimes seulement. (D'après une photographie.) 283
Une station de brouettes sur le Yang-King-Pang. (D'après une photographie.) 284
Les barques s'entre-croisent et se choquent devant le quai chinois de Tou-Ka-Dou. (D'après une photographie.) 285
(p. vi) Chinoises de Shanghaï. (D'après une photographie.) 286
Village chinois aux environs de Shanghaï. (D'après une photographie.) 287
Le charnier des enfants trouvés (page 280). (D'après une photographie.) 288
L'ÉDUCATION DES NÈGRES
AUX ÉTATS-UNIS
Par M. BARGY
L'école maternelle de Hampton accueille et occupe les négrillons des deux sexes. (D'après une photographie.) 289
Institut Hampton: cours de travail manuel. (D'après une photographie.) 289
Booker T. Washington, le leader de l'éducation des nègres aux États-Unis, fondateur de l'école de Tuskegee, en costume universitaire. (D'après une photographie.) 290
Institut Hampton: le cours de maçonnerie. (D'après une photographie.) 291
Institut Hampton: le cours de laiterie. (D'après une photographie.) 292
Institut Hampton: le cours d'électricité. (D'après une photographie.) 293
Institut Hampton: le cours de menuiserie. (D'après une photographie.) 294
Le salut au drapeau exécuté par les négrillons de l'Institut Hampton. (D'après une photographie.) 295
Institut Hampton: le cours de chimie. (D'après une photographie.) 296
Le basket ball dans les jardins de l'Institut Hampton. (D'après une photographie.) 297
Institut Hampton: le cours de cosmographie. (D'après une photographie.) 298
Institut Hampton: le cours de botanique. (D'après une photographie.) 299
Institut Hampton: le cours de mécanique. (D'après une photographie.) 300
À TRAVERS LA PERSE ORIENTALE
Par le Major PERCY MOLESWORTH SYKES
Consul général de S. M. Britannique au Khorassan.
Une foule curieuse nous attendait sur les places de Mechhed. (D'après une photographie.) 301
Un poney persan et sa charge ordinaire. (D'après une photographie.) 301
Le plateau de l'Iran. Carte pour suivre le voyage de l'auteur, d'Astrabad à Kirman. 302
Les femmes persanes s'enveloppent la tête et le corps d'amples étoffes. (D'après une photographie.) 303
Paysage du Khorassan: un sol rocailleux et ravagé, une rivière presque à sec; au fond, des constructions à l'aspect de fortins. (D'après une photographie.) 304
Le sanctuaire de Mechhed est parmi les plus riches et les plus visités de l'Asie. (D'après une photographie.) 305
La cour principale du sanctuaire de Mechhed. (D'après une photographie.) 306
Enfants nomades de la Perse orientale. (D'après une photographie.) 307
Jeunes filles kurdes des bords de la mer Caspienne. (D'après une photographie.) 308
Les préparatifs d'un campement dans le désert de Lout. (D'après une photographie.) 309
Le désert de Lout n'est surpassé, en aridité, par aucun autre de l'Asie. (D'après une photographie.) 310
Avant d'arriver à Kirman, nous avions à traverser la chaîne de Kouhpaia. (D'après une photographie.) 311
Rien n'égale la désolation du désert de Lout. (D'après une photographie.) 312
La communauté Zoroastrienne de Kirman vint, en chemin, nous souhaiter la bienvenue. (D'après une photographie.) 313
Un marchand de Kirman. (D'après une photographie.) 313
Le «dôme de Djabalia», ruine des environs de Kirman, ancien sanctuaire ou ancien tombeau. (D'après une photographie.) 314
À Kirman: le jardin qui est loué par le Consulat, se trouve à un mille au delà des remparts. (D'après une photographie.) 315
Une avenue dans la partie ouest de Kirman. (D'après une photographie.) 316
Les gardes indigènes du Consulat anglais de Kirman. (D'après une photographie.) 317
La plus ancienne mosquée de Kirman est celle dite Masdjid-i-Malik. (D'après une photographie.) 318
Membres des cheikhis, secte qui en compte 7 000 dans la province de Kirman. (D'après une photographie.) 319
La Masdjid Djami, construite en 1349, une des quatre-vingt-dix mosquées de Kirman. (D'après une photographie.) 320
Dans la partie ouest de Kirman se trouve le Bagh-i-Zirisf, terrain de plaisance occupé par des jardins. (D'après une photographie.) 321
Les environs de Kirman comptent quelques maisons de thé. (D'après une photographie.) 322
Une «tour de la mort», où les Zoroastriens exposent les cadavres. (D'après une photographie.) 323
Le fort dit Kala-i-Dukhtar ou fort de la Vierge, aux portes de Kirman. (D'après une photographie.) 324
Le «Farma Farma». (D'après une photographie.) 325
Indigènes du bourg d'Aptar, Baloutchistan. (D'après une photographie.) 325
Carte du Makran. 326
Baloutches de Pip, village de deux cents maisons groupées autour d'un fort. (D'après une photographie.) 327
Des forts abandonnés rappellent l'ancienne puissance du Baloutchistan. (D'après une photographie.) 328
Chameliers brahmanes du Baloutchistan. (D'après une photographie.) 329
La passe de Fanoch, faisant communiquer la vallée du même nom et la vallée de Lachar. (D'après une photographie.) 330
Musiciens ambulants du Baloutchistan. (D'après une photographie.) 331
Une halte dans les montagnes du Makran. (D'après une photographie.) 332
Baloutches du district de Sarhad. (D'après une photographie.) 333
Un fortin sur les frontières du Baloutchistan. (D'après une photographie.) 334
Dans les montagnes du Makran: À des collines d'argile succèdent de rugueuses chaînes calcaires. (D'après une photographie.) 335
Bureau du télégraphe sur la côte du Makran. (D'après une photographie.) 336
L'oasis de Djalsk, qui s'étend sur 10 kilomètres carrés, est remplie de palmiers-dattiers, et compte huit villages. (D'après une photographie.) 337
Femme Parsi du Baloutchistan. (D'après une photographie.) 337
Carte pour suivre les délimitations de la frontière perso-baloutche. 338
Nous campâmes à Fahradj, sur la route de Kouak, dans une palmeraie. (D'après une photographie.) 339
C'est à Kouak que les commissaires anglais et persans s'étaient donné rendez-vous. (D'après une photographie.) 340
Le sanctuaire de Mahoun, notre première étape sur la route de Kouak. (D'après une photographie.) 341
Cour intérieure du sanctuaire de Mahoun. (D'après une photographie.) 342
Le khan de Kélat et sa cour. (D'après une photographie.) 343
Jardins du sanctuaire de Mahoun. (D'après une photographie.) 344
Dans la vallée de Kalagan, près de l'oasis de Djalsk. (D'après une photographie.) 345
Oasis de Djalsk: Des édifices en briques abritent les tombes d'une race de chefs disparue. (D'après une photographie.) 346
Indigènes de l'oasis de Pandjgour, à l'est de Kouak. (D'après une photographie.) 347
Camp de la commission de délimitation sur la frontière perso-baloutche. (D'après une photographie.) 348
Campement de la commission des frontières perso-baloutches. (D'après une photographie.) 349
Parsi de Yezd. (D'après une photographie.) 349
Une séance d'arpentage dans le Seistan. (D'après une photographie.) 350
(p. vii) Les commissaires persans de la délimitation des frontières perso-baloutches. (D'après une photographie.) 351
Le delta du Helmand. 352
Sculptures sassanides de Persépolis. (D'après une photographie.) 352
Un gouverneur persan et son état-major. (D'après une photographie.) 353
La passe de Buzi. (D'après une photographie.) 354
Le Gypsies du sud-est persan. 355
Sur la lagune du Helmand. (D'après une photographie.) 356
Couple baloutche. (D'après une photographie.) 357
Vue de Yezd, par où nous passâmes pour rentrer à Kirman. (D'après une photographie.) 358
La colonne de Nadir s'élève comme un phare dans le désert. (D'après une photographie.) 359
Mosquée de Yezd. (D'après une photographie.) 360
AUX RUINES D'ANGKOR
Par M. le Vicomte De MIRAMON-FARGUES
Entre le sanctuaire et la seconde enceinte qui abrite sous ses voûtes un peuple de divinités de pierre.... (D'après une photographie.) 361
Emblème décoratif (art khmer). (D'après une photographie.) 361
Porte d'entrée de la cité royale d'Angkor-Tom, dans la forêt. (D'après une photographie.) 362
Ce grand village, c'est Siem-Réap, capitale de la province. (D'après une photographie) 363
Une chaussée de pierre s'avance au milieu des étangs. (D'après une photographie.) 364
Par des escaliers invraisemblablement raides, on gravit la montagne sacrée. (D'après une photographie.) 365
Colonnades et galeries couvertes de bas-reliefs. (D'après une photographie.) 366
La plus grande des deux enceintes mesure 2 kilomètres de tour; c'est un long cloître. (D'après une photographie.) 367
Trois dômes hérissent superbement la masse formidable du temple d'Angkor-Wat. (D'après une photographie.) 367
Bas-relief du temple d'Angkor. (D'après une photographie.) 368
La forêt a envahi le second étage d'un palais khmer. (D'après une photographie.) 369
Le gouverneur réquisitionne pour nous des charrettes à bœufs. (D'après une photographie.) 370
La jonque du deuxième roi, qui a, l'an dernier, succédé à Norodom. (D'après une photographie.) 371
Le palais du roi, à Oudong-la-Superbe. (D'après une photographie.) 371
Sculptures de l'art khmer. (D'après une photographie.) 372
EN ROUMANIE
Par M. Th. HEBBELYNCK
La petite ville de Petrozeny n'est guère originale; elle a, de plus, un aspect malpropre. (D'après une photographie.) 373
Paysan des environs de Petrozeny et son fils. (D'après une photographie.) 373
Carte de Roumanie pour suivre l'itinéraire de l'auteur. 374
Vendeuses au marché de Targu-Jiul. (D'après une photographie.) 375
La nouvelle route de Valachie traverse les Carpathes et aboutit à Targu-Jiul. (D'après une photographie.) 376
C'est aux environs d'Arad que pour la première fois nous voyons des buffles domestiques. (D'après une photographie.) 377
Montagnard roumain endimanché. (Cliché Anerlich.) 378
Derrière une haie de bois blanc s'élève l'habitation modeste. (D'après une photographie.) 379
Nous croisons des paysans roumains. (D'après une photographie.) 379
Costume national de gala, roumain. (Cliché Cavallar.) 380
Dans les vicissitudes de leur triste existence, les tziganes ont conservé leur type et leurs mœurs. (Photographie Anerlich.) 381
Un rencontre près de Padavag d'immenses troupeaux de bœufs. (D'après une photographie.) 382
Les femmes de Targu-Jiul ont des traits rudes et sévères, sous le linge blanc. (D'après une photographie.) 383
En Roumanie, on ne voyage qu'en victoria. (D'après une photographie.) 384
Dans la vallée de l'Olt, les «castrinza» des femmes sont décorées de paillettes multicolores. 385
Dans le village de Slanic. (D'après une photographie.) 385
Roumaine du défilé de la Tour-Rouge. (D'après une photographie.) 386
La petite ville d'Horezu est charmante et animée. (D'après une photographie.) 387
La perle de Curtea, c'est cette superbe église blanche, scintillante sous ses coupoles dorées. (D'après une photographie.) 388
Une ferme près du monastère de Bistritza. (D'après une photographie.) 389
Entrée de l'église de Curtea. (D'après une photographie.) 390
Les religieuses du monastère d'Horezu portent le même costume que les moines. (D'après une photographie.) 391
Devant l'entrée de l'église se dresse le baptistère de Curtea. (D'après une photographie.) 392
Au marché de Campolung. (D'après une photographie.) 393
L'excursion du défilé de Dimboviciora est le complément obligé d'un séjour à Campolung. (D'après une photographie.) 394
Dans le défilé de Dimboviciora. (D'après des photographies.) 395
Dans les jardins du monastère de Curtea. 396
Sinaïa: le château royal, Castel Pelés, sur la montagne du même nom. (D'après une photographie.) 397
Un enfant des Carpathes. (D'après une photographie.) 397
Une fabrique de ciment groupe autour d'elle le village de Campina. (D'après une photographie.) 398
Vue intérieure des mines de sel de Slanic. (D'après une photographie.) 399
Entre Campina et Sinaïa la route de voiture est des plus poétiques. (D'après une photographie.) 400
Un coin de Campina. (D'après une photographie.) 401
Les villas de Sinaïa. (D'après une photographie.) 402
Vues de Bucarest: le boulevard Coltei. — L'église du Spiritou Nou. — Les constructions nouvelles du boulevard Coltei. — L'église métropolitaine. — L'Université. — Le palais Stourdza. — Un vieux couvent. — (D'après des photographies.) 403
Le monastère de Sinaïa se dresse derrière les villas et les hôtels de la ville. (D'après une photographie.) 404
Une des deux cours intérieures du monastère de Sinaïa. (D'après une photographie.) 405
Une demeure princière de Sinaïa. (D'après une photographie.) 406
Busteni (les villas, l'église), but d'excursion pour les habitants de Sinaïa. (D'après une photographie.) 407
Slanic: un wagon de sel. (D'après une photographie.) 408
CROQUIS HOLLANDAIS
Par M. Lud. GEORGES HAMÖN
Photographies de l'auteur.
À la kermesse. 409
Ces anciens, pour la plupart, ont une maigreur de bon aloi. 409
Des «boerin» bien prises en leurs justins marchent en roulant, un joug sur les épaules. 410
Par intervalles une femme sort avec des seaux; elle lave sa demeure de haut en bas. 410
Emplettes familiales. 411
Les ménagères sont là, également calmes, lentes, avec leurs grosses jupes. 411
Jeune métayère de Middelburg. 412
Middelburg: le faubourg qui prend le chemin du marché conduit à un pont. 412
Une mère, songeuse, promenait son petit garçon. 413
Une famille hollandaise au marché de Middelburg. 414
Le marché de Middelburg: considérations sur la grosseur des betteraves. 415
Des groupes d'anciens en culottes courtes, chapeaux marmites. 416
(p. viii) Un septuagénaire appuyé sur son petit-fils me sourit bonassement. 417
Roux en le décor roux, l'éclusier fumait sa pipe. 417
Le village de Zoutelande. 418
Les grandes voitures en forme de nacelle, recouvertes de bâches blanches. 419
Aussi comme on l'aime, ce home. 420
Les filles de l'hôtelier de Wemeldingen. 421
Il se campe près de son cheval. 421
Je rencontre à l'orée du village un couple minuscule. 422
La campagne hollandaise. 423
Environs de Westkapelle: deux femmes reviennent du «molen». 423
Par tous les sentiers, des marmots se juchèrent. 424
Le père Kick symbolisait les générations des Néerlandais défunts. 425
Wemeldingen: un moulin colossal domine les digues. 426
L'une entonna une chanson. 427
Les moutons broutent avec ardeur le long des canaux. 428
Famille hollandaise en voyage. 429
Ah! les moulins; leur nombre déroute l'esprit. 429
Les chariots enfoncés dans les champs marécageux sont enlevés par de forts chevaux. 430
La digue de Westkapelle. 431
Les écluses ouvertes. 432
Les petits garçons rôdent par bandes, à grand bruit de sabots sonores.... 433
Jeune mère à Marken. 433
Volendam, sur les bords du Zuiderzee, est le rendez-vous des peintres de tous les pays. 434
Avec leurs figures rondes, épanouies de contentement, les petites filles de Volendam font plaisir à voir. 435
Aux jours de lessive, les linges multicolores flottent partout. 436
Les jeunes filles de Volendam sont coiffées du casque en dentelle, à forme de «salade» renversée. 437
Deux pêcheurs accroupis au soleil, à Volendam. 438
Une lessive consciencieuse. 439
Il y a des couples d'enfants ravissants, d'un type expressif. 440
Les femmes de Volendam sont moins claquemurées en leur logis. 441
Vêtu d'un pantalon démesuré, le pêcheur de Volendam a une allure personnelle. 442
Un commencement d'idylle à Marken. 443
Les petites filles sont charmantes. 444
ABYDOS
dans les temps anciens et dans les temps modernes
Par M. E. AMELINEAU
Le lac sacré d'Osiris, situé au sud-est de son temple, qui a été détruit. (D'après une photographie.) 445
Séti Ier présentant des offrandes de pain, légumes, etc. (D'après une photographie.) 445
Une rue d'Abydos. (D'après une photographie.) 446
Maison d'Abydos habitée par l'auteur, pendant les trois premières années. (D'après une photographie.) 447
Le prêtre-roi rendant hommage à Séti Ier (chambre annexe de la deuxième salle d'Osiris). (D'après une photographie.) 448
Thot présentant le signe de la vie aux narines du roi Séti Ier (chambre annexe de la deuxième salle d'Osiris). (D'après une photographie.) 449
Le dieu Thot purifiant le roi Séti Ier (chambre annexe de la deuxième salle d'Osiris, mur sud). (D'après une photographie.) 450
Vue intérieure du temple de Ramsès II. (D'après une photographie.) 451
Perspective de la seconde salle hypostyle du temple de Séti Ier. (D'après une photographie.) 451
Temple de Séti Ier, mur est, pris du mur nord. Salle due à Ramsès II. (D'après une photographie.) 452
Temple de Séti Ier, mur est, montrant des scènes diverses du culte. (D'après une photographie.) 453
Table des rois Séti Ier et Ramsès II, faisant des offrandes aux rois leurs prédécesseurs. (D'après une photographie.) 454
Vue générale du temple de Séti Ier, prise de l'entrée. (D'après une photographie.) 455
Procession des victimes amenées au sacrifice (temple de Ramsès II). (D'après une photographie.) 456
VOYAGE DU PRINCE SCIPION BORGHÈSE
AUX MONTS CÉLESTES
Par M. JULES BROCHEREL
Le bazar de Tackhent s'étale dans un quartier vieux et fétide. (D'après une photographie.) 457
Un Kozaque de Djarghess. (D'après une photographie.) 457
Itinéraire de Tachkent à Prjevalsk. 458
Les marchands de pain de Prjevalsk. (D'après une photographie.) 459
Un des trente-deux quartiers du bazar de Tachkent. (D'après une photographie.) 460
Un contrefort montagneux borde la rive droite du «tchou». (D'après une photographie.) 461
Le bazar de Prjevalsk, principale étape des caravaniers de Viernyi et de Kachgar. (D'après une photographie.) 462
Couple russe de Prjevalsk. (D'après une photographie.) 463
Arrivée d'une caravane à Prjevalsk. (D'après une photographie.) 464
Le chef des Kirghizes et sa petite famille. (D'après une photographie.) 465
Notre djighite, sorte de garde et de policier. (D'après une photographie.) 466
Le monument de Prjevalsky, à Prjevalsk. (D'après une photographie.) 467
Des têtes humaines, grossièrement sculptées, monuments funéraires des Nestoriens... (D'après une photographie.) 467
Enfants kozaques sur des bœufs. (D'après une photographie.) 468
Un de nos campements dans la montagne. (D'après une photographie.) 469
Montée du col de Tomghent. (D'après une photographie.) 469
Dans la vallée de Kizil-Tao. (D'après une photographie.) 470
Itinéraire du voyage aux Monts Célestes. 470
La carabine de Zurbriggen intriguait fort les indigènes. (D'après une photographie.) 471
Au sud du col s'élevait une blanche pyramide de glace. (D'après une photographie.) 472
La vallée de Kizil-Tao. (D'après une photographie.) 473
Le col de Karaguer, vallée de Tomghent. (D'après une photographie.) 474
Sur le col de Tomghent. (D'après une photographie.) 475
J'étais enchanté des aptitudes alpinistes de nos coursiers. (D'après une photographie.) 475
Le plateau de Saridjass, peu tourmenté, est pourvu d'une herbe suffisante pour les chevaux. (D'après une photographie.) 476
Nous passons à gué le Kizil-Sou. (D'après des photographies.) 477
Panorama du massif du Khan-Tengri. (D'après une photographie.) 478
Entrée de la vallée de Kachkateur. (D'après une photographie.) 479
Nous baptisâmes Kachkateur-Tao, la pointe de 4 250 mètres que nous avions escaladée. (D'après une photographie.) 479
La vallée de Tomghent. (D'après une photographie.) 480
Des Kirghizes d'Oustchiar étaient venus à notre rencontre. (D'après une photographie.) 481
Kirghize joueur de flûte. (D'après une photographie.) 481
Le massif du Kizil-Tao. (D'après une photographie.) 482
Région des Monts Célestes. 482
Les Kirghizes mènent au village une vie peu occupée. (D'après une photographie.) 483
Notre petite troupe s'aventure audacieusement sur la pente glacée. (D'après une photographie.) 484
Vallée supérieure d'Inghiltchik. (D'après une photographie.) 485
(p. ix) Vallée de Kaende: l'eau d'un lac s'écoulait au milieu d'une prairie émaillée de fleurs. (D'après une photographie.) 486
Les femmes kirghizes d'Oustchiar se rangèrent, avec leurs enfants, sur notre passage. (D'après une photographie.) 487
Le chirtaï de Kaende. (D'après une photographie.) 488
Nous saluâmes la vallée de Kaende comme un coin de la terre des Alpes. (D'après une photographie.) 489
Femmes mariées de la vallée de Kaende, avec leur progéniture. (D'après une photographie.) 490
L'élément mâle de la colonie vint tout l'après-midi voisiner dans notre campement. (D'après une photographie.) 491
Un «aoul» kirghize. 492
Yeux bridés, pommettes saillantes, nez épaté, les femmes de Kaende sont de vilaines Kirghizes. (D'après une photographie.) 493
Enfant kirghize. (D'après une photographie.) 493
Kirghize dressant un aigle. (D'après une photographie.) 494
Itinéraire du voyage aux Monts Célestes. 494
Nous rencontrâmes sur la route d'Oustchiar un berger et son troupeau. (D'après une photographie.) 495
Je photographiai les Kirghizes de Kaende, qui s'étaient, pour nous recevoir, assemblés sur une éminence. (D'après une photographie.) 496
Le glacier de Kaende. (D'après une photographie.) 497
L'aiguille d'Oustchiar vue de Kaende. 498
Notre cabane au pied de l'aiguille d'Oustchiar. (D'après des photographies.) 498
Kirghizes de Kaende. (D'après une photographie.) 499
Le pic de Kaende s'élève à 6 000 mètres. (D'après une photographie.) 500
La fille du chirtaï (chef) de Kaende, fiancée au kaltchè de la vallée d'Irtach. (D'après une photographie.) 501
Le kaltchè (chef) de la vallée d'Irtach, l'heureux fiancé de la fille du chirtaï de Kaende. (D'après une photographie.) 502
Le glacier de Kaende. 503
Cheval kirghize au repos sur les flancs du Kaende. (D'après des photographies.) 503
Retour des champs. (D'après une photographie.) 504
Femmes kirghizes de la vallée d'Irtach. (D'après une photographie.) 505
Un chef de district dans la vallée d'Irtach. (D'après une photographie.) 505
Le pic du Kara-tach, vu d'Irtach, prend vaguement l'aspect d'une pyramide. (D'après une photographie.) 506
Les caravaniers passent leur vie dans les Monts Célestes, emmenant leur famille avec leurs marchandises. (D'après une photographie.) 507
La vallée de Zououka, par où transitent les caravaniers de Viernyi à Kachgar. (D'après une photographie.) 508
Le massif du Djoukoutchiak; au pied, le dangereux col du même nom, fréquenté par les nomades qui se rendent à Prjevalsk. (D'après une photographie.) 509
Le chaos des pics dans le Kara-Tao. (D'après une photographie.) 510
Étalon kirghize de la vallée d'Irtach et son cavalier. (D'après une photographie.) 511
Véhicule kirghize employé dans la vallée d'Irtach. (D'après une photographie.) 511
Les roches plissées des environs de Slifkina, sur la route de Prjevalsk. (D'après une photographie.) 512
Campement kirghize, près de Slifkina. (D'après une photographie.) 513
Femme kirghize tannant une peau. (D'après une photographie.) 514
Les glaciers du Djoukoutchiak-Tao. (D'après une photographie.) 515
Tombeau kirghize. (D'après une photographie.) 516
L'ARCHIPEL DES FEROÉ
Par Mlle ANNA SEE
«L'espoir des Feroé» se rendant à l'école. (D'après une photographie.) 517
Les enfants transportent la tourbe dans des hottes en bois. (D'après une photographie.) 517
Thorshavn apparut, construite en amphithéâtre au fond d'un petit golfe. 518
Les fermiers de Kirkebœ en habits de fête. (D'après une photographie.) 519
Les poneys feroïens et leurs caisses à transporter la tourbe. (D'après une photographie.) 520
Les dénicheurs d'oiseaux se suspendent à des cordes armées d'un crampon. (D'après une photographie.) 521
Des îlots isolés, des falaises de basalte ruinées par le heurt des vagues. (D'après des photographies.) 522
On pousse vers la plage les cadavres des dauphins, qui ont environ 6 mètres. (D'après une photographie.) 523
Les femmes feroïennes préparent la laine.... (D'après une photographie.) 524
On sale les morues. (D'après une photographie.) 525
Feroïen en costume de travail. (D'après une photographie.) 526
Les femmes portent une robe en flanelle tissée avec la laine qu'elles ont cardée et filée. (D'après une photographie.) 527
Déjà mélancolique!... (D'après une photographie.) 528
PONDICHÉRY
chef-lieu de l'Inde française
Par M. G. VERSCHUUR
Groupe de Brahmanes électeurs français. (D'après une photographie.) 529
Musicien indien de Pondichéry. (D'après une photographie.) 529
Les enfants ont une bonne petite figure et un costume peu compliqué. (D'après une photographie.) 530
La visite du marché est toujours une distraction utile pour le voyageur. (D'après une photographie.) 531
Indienne en costume de fête. (D'après une photographie.) 532
Groupe de Brahmanes français. (D'après une photographie.) 533
La pagode de Villenour, à quelques kilomètres de Pondichéry. (D'après une photographie.) 534
Intérieur de la pagode de Villenour. (D'après une photographie.) 535
La Fontaine aux Bayadères. (D'après une photographie.) 536
Plusieurs rues de Pondichéry sont larges et bien bâties. (D'après une photographie.) 537
Étang de la pagode de Villenour. (D'après une photographie.) 538
Brahmanes français attendant la clientèle dans un bazar. (D'après une photographie.) 539
La statue de Dupleix à Pondichéry. (D'après une photographie.) 540
UNE PEUPLADE MALGACHE
LES TANALA DE L'IKONGO
Par M. le Lieutenant ARDANT DU PICQ
Les populations souhaitent la bienvenue à l'étranger. (D'après une photographie.) 541
Femme d'Ankarimbelo. (D'après une photographie.) 541
Carte du pays des Tanala. 542
Les femmes tanala sont sveltes, élancées. (D'après une photographie.) 543
Panorama de Fort-Carnot. (D'après une photographie.) 544
Groupe de Tanala dans la campagne de Milakisihy. (D'après une photographie.) 545
Un partisan tanala tirant à la cible à Fort-Carnot. (D'après une photographie.) 546
Enfants tanala. (D'après une photographie.) 547
Les hommes, tous armés de la hache. (D'après une photographie.) 548
Les cercueils sont faits d'un tronc d'arbre creusé, et recouverts d'un drap. (D'après une photographie.) 549
Le battage du riz. (D'après une photographie.) 550
(p. x) Une halte de partisans dans la forêt. (D'après une photographie.) 551
Femmes des environs de Fort-Carnot. (D'après une photographie.) 552
Les Tanala au repos perdent toute leur élégance naturelle. (D'après une photographie.) 553
Une jeune beauté tanala. (D'après une photographie.) 553
Le Tanala, maniant une sagaie, a le geste élégant et souple. (D'après une photographie.) 554
Le chant du «e manenina», à Iaborano. (D'après une photographie.) 555
La rue principale à Sahasinaka. (D'après une photographie.) 556
La danse est exécutée par des hommes, quelquefois par des femmes. (D'après une photographie.) 557
Un danseur botomaro. (D'après une photographie.) 558
La danse, chez les Tanala, est expressive au plus haut degré. (D'après des photographies.) 559
Tapant à coups redoublés sur un long bambou, les Tanala en tirent une musique étrange. (D'après une photographie.) 560
Femmes tanala tissant un lamba. (D'après une photographie.) 561
Le village et le fort de Sahasinaka s'élèvent sur les hauteurs qui bordent le Faraony. (D'après une photographie.) 562
Un détachement d'infanterie coloniale traverse le Rienana. (D'après une photographie.) 563
Profil et face de femmes tanala. (D'après une photographie.) 564
LA RÉGION DU BOU HEDMA
(sud tunisien)
Par M. Ch. MAUMENÉ
Les murailles de Sfax, véritable décor d'opéra.... (D'après une photographie.) 565
Salem, le domestique arabe de l'auteur. (D'après une photographie.) 565
Carte de la région du Bou Hedma (sud tunisien). 566
Les sources chaudes de l'oued Hadedj sont sulfureuses. (D'après une photographie.) 567
L'oued Hadedj, d'aspect si charmant, est un bourbier qui sue la fièvre. (D'après une photographie.) 568
Le cirque du Bou Hedma. (D'après une photographie.) 569
L'oued Hadedj sort d'une étroite crevasse de la montagne. (D'après une photographie.) 570
Manoubia est une petite paysanne d'une douzaine d'années. (D'après une photographie.) 571
Un puits dans le défilé de Touninn. (D'après une photographie.) 571
Le ksar de Sakket abrite les Ouled bou Saad Sédentaires, qui cultivent oliviers et figuiers. (D'après une photographie.) 572
De temps en temps la forêt de gommiers se révèle par un arbre. (D'après une photographie.) 573
Le village de Mech; dans l'arrière-plan, le Bou Hedma. (D'après une photographie.) 574
Le Khrangat Touninn (défile de Touninn), que traverse le chemin de Bir Saad à Sakket. (D'après une photographie.) 575
Le puits de Bordj Saad. (D'après une photographie.) 576
DE TOLÈDE À GRENADE
Par Mme JANE DIEULAFOY
Après avoir croisé des bœufs superbes.... (D'après une photographie.) 577
Femme castillane. (D'après une photographie.) 577
On chemine à travers l'inextricable réseau des ruelles silencieuses. (D après une photographie.) 578
La rue du Commerce, à Tolède. (D'après une photographie.) 579
Un représentant de la foule innombrable des mendiants de Tolède. (D'après une photographie.) 580
Dans des rues tortueuses s'ouvrent les entrées monumentales d'anciens palais, tel que celui de la Sainte Hermandad. (Photographie Lacoste, à Madrid.) 581
Porte du vieux palais de Tolède. (D'après une photographie.) 582
Fière et isolée comme un arc de triomphe, s'élève la merveilleuse Puerta del Sol. (Photographie Lacoste, à Madrid.) 583
Détail de sculpture mudejar dans le Transito. (D'après une photographie.) 584
Ancienne sinagogue connue sous le nom de Santa Maria la Blanca. (Photographie Lacoste, à Madrid.) 585
Madrilène. (D'après une photographie.) 586
La porte de Visagra, construction massive remontant à l'époque de Charles Quint. (Photographie Lacoste, à Madrid.) 587
Tympan mudejar. (D'après une photographie.) 588
Des familles d'ouvriers ont établi leurs demeures près de murailles solides. (D'après une photographie.) 589
Castillane et Sévillane. (D'après une photographie.) 589
Isabelle de Portugal, par le Titien (Musée du Prado). (Photographie Lacoste, à Madrid.) 590
Le palais de Pierre le Cruel. (D'après une photographie.) 591
Statue polychrome du prophète Élie, dans l'église de Santo Tomé (auteur inconnu). (D'après une photographie.) 592
Porte du palais de Pierre le Cruel. (D'après une photographie.) 593
Portrait d'homme, par le Greco. (Photographie Hauser y Menet, à Madrid.) 594
La cathédrale de Tolède. 595
Enterrement du comte d'Orgaz, par le Greco (église Santo Tomé). (D'après une photographie.) 596
Le couvent de Santo Tomé conserve une tour en forme de minaret. (D'après une photographie.) 597
Les évêques Mendoza et Ximénès. (D'après une photographie.) 598
Salon de la prieure, au couvent de San Juan de la Penitencia. (D'après une photographie.) 599
Prise de Melilla (cathédrale de Tolède). (D'après une photographie.) 600
C'est dans cette pauvre demeure que vécut Cervantès pendant son séjour à Tolède. (D'après une photographie.) 601
Saint François d'Assise, par Alonzo Cano, cathédrale de Tolède. 601
Porte des Lions. (Photographie Lacoste, à Madrid.) 602
Le cloître de San Juan de los Reyes apparaît comme le morceau le plus précieux et le plus fleuri de l'architecture gothique espagnole. (Photographie Lacoste, à Madrid.) 603
Ornements d'église, à Madrid. (D'après une photographie.) 604
Porte due au ciseau de Berruguete, dans le cloître de la cathédrale de Tolède. (Photographie Lacoste, à Madrid.) 605
Une torea. (D'après une photographie.) 606
Vue intérieure de l'église de San Juan de Los Reyes. (Photographie Lacoste, à Madrid.) 607
Une rue de Tolède. (D'après une photographie.) 608
Porte de l'hôpital de Santa Cruz. (Photographie Lacoste, à Madrid.) 609
Sur les bords du Tage. (Photographie Lacoste, à Madrid.) 610
Escalier de l'hôpital de Santa Cruz. (D'après une photographie.) 611
Détail du plafond de la cathédrale. (D'après une photographie) 612
Pont Saint-Martin à Tolède. (D'après une photographie.) 613
Guitariste castillane. (D'après une photographie.) 613
La «Casa consistorial», hôtel de ville. (D'après une photographie.) 614
Le «patio» des Templiers. (D'après une photographie.) 615
Jeune femme de Cordoue avec la mantille en chenille légère. (D'après une photographie.) 616
Un coin de la Mosquée de Cordoue. (Photographie Lacoste, à Madrid.) 617
Chapelle de San Fernando, de style mudejar, élevée au (p. xi) centre de la Mosquée de Cordoue. (D'après une photographie.) 618
La mosquée qui fait la célébrité de Cordoue, avec ses dix-neuf galeries hypostyles, orientées vers la Mecque. (Photographie Lacoste, à Madrid.) 619
Détail de la chapelle de San Fernando. (D'après une photographie.) 620
Vue extérieure de la Mosquée de Cordoue, avec l'église catholique élevée en 1523, malgré les protestations des Cordouans. (D'après une photographie.) 621
Statue de Gonzalve de Cordoue. (D'après une photographie.) 622
Statue de doña Maria Manrique, femme de Gonzalve de Cordoue. (D'après une photographie.) 623
Détail d'une porte de la mosquée. (D'après une photographie.) 624
Note 1: Suite. Voyez page 181.[Retour au texte principal]
Note 2: Suite. Voyez pages 181 et 193.[Retour au texte principal]
Note 3: Suite. Voyez pages 181, 193 et 205.[Retour au texte principal]
Note 4: Suite. Voyez pages 181, 193, 205 et 217.[Retour au texte principal]
Note 5: Suite. Voyez pages 181, 193, 205, 217 et 229.[Retour au texte principal]