
Title: Amours d'Extrême-Orient
Author: Olivier Diraison-Seylor
Illustrator: Amédée Vignola
Release date: December 7, 2021 [eBook #66897]
Language: French
Credits: Gaëlle Vutron (This book was produced from images made available by the HathiTrust Digital Library.)

AMOURS D’EXTRÊME-ORIENT
Droits de reproduction réservés pour tous pays, y compris la Suède et la Norvège.

Française née au Tonkin.
O. DIRAISON-SEYLOR
Illustrations d’après nature
PAR
Amédée VIGNOLA
PARIS
CHARLES CARRINGTON, LIBRAIRE-EDITEUR
13, FAUBOURG MONTMARTRE, 13
1905
Je pense vous intéresser, Mesdames, à vos sœurs lointaines. Ne craignez pas que je m’efforce à un parallèle dans lequel votre charme pâtisse auprès du leur, charme de rêve. L’avantage, par avance, vous serait acquis. Car, si j’ose le risque de dire les tendresses exotiques, il en est de moins lointaines, de toutes proches mêmes, qui demeurent indicibles.
Je ne regretterai rien, je n’évoquerai que pour vous. Et non plus je ne vous lasserai point en des souvenirs de géographie, perdus aussitôt fermé l’Atlas. Dans chaque coin du monde où nous placerons une amoureuse, elle y paraîtra seule comme Eve dans l’Eden, Eden miraculeux et impossible à situer. Aussitôt connu, nous l’y laisserons, et je tâcherai, d’une place à l’autre, d’avoir franchi des milliers de lieues avant que soit effacée la vision de curiosité, avant que j’aie recommencé le labeur périlleux de vous apporter une autre et toute diverse amante.
Il faut promettre, Mesdames, d’abandonner, en même temps que la science de géographie, le frisson des effarouchements. Des mots de tous les temps détailleront les précisions de tous les lieux. Il suffira qu’il vous plaise de vous souvenir, Mesdames, que ces sœurs lointaines, d’âmes non pareilles aux vôtres, sont faites comme vous, seulement comme vous, exactement comme vous.
O. SEYLOR.
PSYCHOLOGIE DE L’EXOTISME

Fellahine d’Egypte.
Amours d’Extrême-Orient
Il faut tenter une définition. Et l’étymologie n’aurait ici rien à faire. Nommez à un marin, non point à un globe-trotter, nommez Cadix ou Constantinople, joignez à ces mots la qualification « d’exotique », le marin se récriera. Citez Tahiti ou les Canaries : tout de suite il aura compris qu’on lui parle d’exotisme. Pourquoi ? Pourquoi, au jeu de faire tourner une mappemonde, n’importe lequel des errants, soulignera-t-il, dans la nomenclature des lieux de la terre, les uns exotiques, les autres quelconques ? Et, pour une même terre à classifier, le vote réunira l’unanimité des suffrages.
C’est que reste, dès l’abord, en dehors du monde exotique, le monde cosmopolite. Les termes, à les peser, ne jurent pas ensemble. Des fragments de l’univers se sont unifiés et soudés, soit qu’ils fussent adjacents, comme les Etats d’Europe, ou qu’ils fussent rattachés aux précédents dans une tapisserie seulement plus lâche, la comparaison se décalquant sur l’écheveau des chemins qui juxtaposent l’Amérique du Nord à l’Europe. Le va-et-vient, l’échange mécanique, renouvelé surtout, est ennemi de l’exotisme : il apparaît, pour nous du moins, récepteurs dans la psychologie actuelle, il apparaît qu’une première condition de l’exotisme est de se limiter aux lieux « que l’on ne voit qu’une fois. » La règle souffre peu d’exceptions : l’évocation de Tong-Tabou ne saurait se préciser dans les mêmes lignes, après deux séjours entre lesquels fut de la vie. On signifie la collectivité entière du cosmopolisme, représentée par les membres qui s’en séparent momentanément, en route pour les buts inhabituels. Si vague que se présente cette collectivité, cette peuplade de la masse soudée du monde, son sens est assez net pour écarter le ridicule d’appliquer la première remarque au cas du rustre qui ne s’en vient qu’une fois à la ville, pour la conscription.
Du principe découle aussitôt que le monde exotique comprend seulement des lieux où l’on ne vient que par mer. Non qu’avec cette limitation, les îles seules répondent à la définition. Y correspondent encore la multitude des cités, des sites, centres de rayonnement vers les cités, auxquels les communications mécaniques et terrestres ne sont pas imposées. Mais déjà il ne faut pas reculer devant l’inévitable conclusion, par delà l’analyse, l’évidence que la finalité de l’exotisme soit de ne s’appliquer qu’aux îles.
Le langage usuel choisit encore, parmi le choix auquel nous sommes limités. Pour la plupart des gens, exotisme équivaut à perruches, bananes, hamacs, chaleur enfin. Bref, le royaume de l’exotisme est aussi celui du soleil, du soleil souverain. Si l’on joint à cette qualité celle révélée par les mots ordinaires aux marins, eux qui se plaisent à répéter les senteurs australes, la houle du Sud, le ciel austral, les mers australes, on fixera presque complètement les bornes des choses exotiques.
Enfin il ne semble pas douteux que les souvenirs les plus intenses, conservés de l’exotisme, empruntent quelque peu de leur force à la conscience d’une individualité tout autrement développée qu’à la surface du monde cosmopolite. L’exotisme conditionne des collectivités amorphes, et non point concentrées et rigides, au long de leurs codes ; celles-là aussi on ne les trouve plus guère au nord de l’Equateur.
En résumé : séjour unique ; chemin de la mer ; ciel de chaleur et particulièrement austral ; liberté de primitif ; telles sont les caractéristiques qui définissent les lieux d’exotisme. Elles les limitent autant qu’elles les définissent. Et c’est pour cette raison qu’il était nécessaire, à l’origine, de poser autrement la question pour un marin et pour un globe-trotter.
De celui-ci nous ne nous occuperons pas. Bien certainement l’avis n’en est point négligeable. Même il est juste de déférer au reproche habituellement adressé par lui au marin. « Le marin, remarque le globe-trotter, à de très rares exceptions près, ne connaît qu’une mince bordure du bord, les franges du tapis universel. » Rien de plus exact. Mais précisément ces franges teintent ou non une terre d’exotisme. Au sens strict du mot, peut-être exotisme signifie simplement être hors de chez soi ; au sens réel et vérifié, il signifie un monde à côté d’un autre monde pour un être qui n’a « pas de chez soi » : pour le marin. Et tandis que le globe-trotter, inconsciemment, différencie chaque place, cosmopolite ou exotique, d’avec une base ferme, sa maison, le marin ne différencie qu’entre elles ces diversités, dont aucune ne constituera un critérium d’appréciation.
Dans les bornes ainsi tracées, confirmation intéressante, l’exotisme passionnel se confond avec l’exotisme géographique. Et peut-être, sans une loyauté critique, sans l’effort de se placer, serein, devant la cinématographie des errances, il suffirait, pour nombrer l’exotisme, d’additionner les passades lointaines, permises au cours des campagnes qu’institue l’organisation des divisions militaires. En tout état de cause, après avoir nettement encerclé l’exotisme, après avoir appris en quels lieux le tâter, nous ne pourrons l’analyser que dans ses échanges avec les passants, ainsi dans le plus éternel et le plus varié en même temps, l’échange des désirs.
Or le fait est celui-ci : la nostalgie reporte les marins, pour la plupart, et paradoxalement, vers les départs. Ils ont, presque unanimement, en eux, la hantise de l’exotisme. Les étreintes lointaines leur restent plus frissonnantes, et leur chair se languit, comme on dit à Toulon, aussi bien des vahinés que des congaïs, des mousmés que des faufinées. Est-elle donc meilleure, autre, et révélatrice la volupté glanée au travers de l’exotisme ?
Voici ceux qui l’affirment. Ils ont quitté les classes après la troisième latine, souvent plus tôt. Et leur intellectualité s’est spécialisée à l’étude des sciences mathématiques. Au plus grand nombre la tâche a été rude d’emmagasiner la provision nécessaire pour franchir le passage entre le lycée et le Borda ; le plus grand nombre, suivant l’expression juste des cancres sensés, « apprend par cœur » et ne saisit en aucune façon la méthode et la philosophie des choses enseignées, géométrie analytique ou algèbre supérieure. Les sorties sont rares, la timidité trop grande, ou pis des abords des lupanars trop surveillés par des envoyés du proviseur, pour que l’immense majorité des chastetés ne demeurent pas intactes, du moins à l’égard de la femme. Ceci n’est point l’exception. Mais le Borda continue et exagère cette réclusion morale et physique. Quelques-uns des futurs officiers, une dizaine à peine sur 80 ou 100, se risquent délibérément aux passades d’une après-midi de dimanche, une fois par mois, ou beaucoup moins, à cause de la facilité avec laquelle les mêmes « libertins » amassent les points de punition qui suppriment le droit de descendre à terre. Les autres, effarés par la discipline nouvelle, traqués par leurs correspondants, renseignés sur l’inquisition de l’Ecole qui les notera d’infamie ou reculera leur classement, en châtiment d’un accouplement, les autres, deux ans encore, ignorent la femme. Cependant des brimades écœurantes, à bord, évoquent continuellement la sensualité, et les plaisanteries s’assortissent perpétuellement à une hantise pédérastique. Plaisanteries seulement, il faut l’affirmer.
Pendant la croisière d’été, cinq ou six des élèves se décident à la douce aventure ; Rouen, Saint-Malo, Dunkerque resteront dans leur mémoire maritime. Ensuite, c’est l’embarquement sur la frégate-école, et, au retour des Antilles dont les maléfices contés ont renforcé les défenses disciplinaires, c’est Barcelone, tombeau des virginités. Cependant les familles, à tous les courriers, supplient le commandant de restreindre encore la liberté des aspirants, pauvre liberté de quatre heures, une après-midi d’une semaine, les familles maritimes dont le chef jadis subit le même entraînement d’anormalité. Le stage est terminé ; les aspirants sont officiers, essaimés aux quatre coins ; sur les cent de la promotion, 70 environ sont encore vierges.
La première campagne, l’exotisme les déniaisera. Tahiti, Nossi-Bé, Fort-de-France, Yokohama, autant de lupanars immenses ouverts à la faim des ex-internes de la classe de troisième, sans aucun pion mouchard, sans aucun compte à rendre, le soir, aux parents, de l’emploi du temps. Dans la foule des femmes offertes, même le désir conserve son anonymat, et lentement, sans aucune honte, à son gré, il passe de la respectabilité apprise à la fanfaronnade d’impudeur.
Aucune crainte du ridicule, aucune terreur des maladresses n’arrête désormais l’élan vers la femme. Qu’importe les railleries échangées sur le passant entre deux filles dont il ne sait pas la langue et qui ne comprennent que ses gestes ! Les camarades pourront choisir la même passade. Si une comparaison, si un souvenir s’évoque chez l’impassible mousmé ou la vahiné malicieuse, elles ne la communiqueront pas au second amant, elles ne pourront la communiquer. Elle est loin la France, la France où dans les ports, dans les séjours de congé, l’aspirant n’ose point se risquer à entreprendre une fille, défiant de ses brutalités et de ses moqueries ; où la route vers les maisons closes passe devant des guetteurs dangereux, tandis qu’un poids sur le cœur alourdit la marche.
Et pourtant ce n’est point quand même le lupanar, cet exotisme sexuel qui grouille. L’illusion, l’illusion chère aux cœurs latins, demeure. Car avec eux les officiers, pareils à tous ceux de leur race, transporteront deux dogmes par delà les mers : le mépris du lupanar, et la persuasion d’être amant avec l’une quelconque des hétaïres en liberté. Donc les yeux ne voient plus les mêmes maisons, les mêmes fonctionnaires du désir, le même choix, la même passivité. Un catéchisme se forme et s’apprend en même temps, dont les explications satisfont pleinement à la croissance de la petite fleur bleue.
Un lupanar, dites-vous, du moins le gigantesque Yoshivara de Yokohama ? Non point. Ne savez-vous pas que les mousmés y demeurent de leur plein gré, que les rues, formées par les maisons de plaisir, s’éclairent plus brillamment que les autres, que le mouvement de la cité y ondule tous les soirs, qu’enfin derrière les grilles ou les transparents, protégeant les expositions des Nipponnes, s’agite tout simplement la ruche d’une pension de famille ? Ignorez-vous que ces petites femmes, la plupart, y ramassent une dot ? Que beaucoup d’autres y sont envoyées, en pénitence, par leurs maris ? Enfin, sans prendre tant de peine à raisonner un grincheux, Loti ne vous a-t-il point délicieusement fait sentir l’abîme entre le Yoshivara et le Chapeau-Rouge ?
Loti ! Ecrasé, le grincheux n’insiste point.
Et pour bien se convaincre qu’il a tort d’avoir raison, il récapitule, lorsque revient la discussion classique, après un passé de plusieurs campagnes, il récapitule la diversité du cadre et la force de son enchantement. Le cadre ! Quelque spasme qu’ils y sertissent, les globe-trotters de la marine s’assurent ainsi la précision de souvenir qu’il souligne et qu’il limite. Oubliées les ordinaires préparations à l’étreinte hygiénique, évanouis les bruits de derrière le paravent, fondus les détails d’un confortable où ne saurait muser une véritable chair d’amants ! Il reste l’odeur d’encens emmêlée à la plainte du chamicen, il reste les valses gargarisées par l’accordéon tandis que pâme le « tiaré », il reste la chute des mangues mûres dans l’ombre que traverse le relent des flamboyants. En vérité, il n’y a que l’ombre elle-même, deux épidermes qui se confondent en s’ignorant, et une fantaisie qui peut, dans l’incertitude de son objet, l’harmoniser aux lignes du cadre. Les sens sont rois et comblés ; peut-être la vision seule est-elle confuse, peut-être se vérifie ce paradoxe « que la contemplation n’a plus aucune importance lorsque les deux faces sont rapprochées en deçà du punctum proximum ! »
Si elle est bien réelle cette hantise du cadre ? Si le désir fort des marins a le temps d’y songer sur l’heure ? Mais certainement oui, je sais, vous savez, Madame, fort convenablement sous-entendre l’énergie, générale et particulière des hommes de mer ; et vous doutez que cette… cette énergie dont on vous a conté merveille s’occupe à autre chose qu’à son activité. Veuillez vous détromper. On pourrait se contenter, en toute explication, d’affirmer que la mer n’a qu’une seule fois engendré Aphrodite. La thèse demande plus de généralité.
Ce qui est vrai, Madame, c’est qu’ici comme en bien d’autres choses, le temps ne fait rien à l’affaire. Et, bien plus, la dureté du service en campagne, les obligations des veilles sur des navires où les officiers sont beaucoup moins nombreux qu’en escadre, le peu de générosité de la nourriture, mille causes ne permettent au marin que de songer à son devoir, et fort peu à l’escale.
L’empressement est assez modéré pour que les souvenirs, heureusement, ne pèsent guère aux rêves, mais, à l’escale, il est trop réel pour qu’un dilettantisme de beauté ou de volupté promène un choix averti parmi une foule de possibilités. L’effort, déjà mince, se réduit au minimum en présence de la quantité, et, seuls quelques hasards d’accouplement se rehaussent de la qualité : Tahiti et Nossi-Bé, si extrêmes, si dissemblables dans la variété de leurs courtisanes rustiques, sont les succursales équivalentes de l’Eden à bon marché et sans garantie.
Les séjournants, comme il sied, ont eu le loisir et la nécessité de trier le tas. Pour le passant, pour le marin, il ne reste à sa soif qu’un lait, très abondant, mais sans la crème. Or, fonctionnaires ou négociants anémiques toléreraient, encore moins que sur la terre de France, l’infidélité de leur maîtresse, et encore moins celle-ci risque-t-elle la banale méprise de « perdre sa situation ». Ainsi se décante et s’agglomère une pâte de chair qui demeure à jamais la « femme d’officier de marine ». Quelques diamants y luisent, ou plutôt y resplendirent. Après des années les nouveaux-venus s’empressent encore à les faire chatoyer, parce qu’on les leur vanta.
L’exotisme a sa vieille garde. Sans fard et sans apprêt quelques vahinés, quelques Houves ou Betsimisarakas survivent, jeunes, à leurs années. Et les globe-trotters maritimes confondent candidement, pour retrouver les amantes telles que les leur dépeignirent des aînés, le cycle d’une saison et celui d’une campagne. Les noms fort peu variés aident à la confusion inverse et ainsi se renouvelle l’éternel baiser de Rara-Hu ou de Sammba sous les lèvres de leurs homonymes, successives adolescentes.
D’ailleurs il faut dire que le culte des amantes historiques n’a que peu de fidèles. Partout, au contraire, domine la recherche des primeurs, recherche que ne limitent plus des codes ou des apophtegmes. Non que la loi du climat s’impose souverainement au marin. Son geste n’est pas spontané de transposer les pubertés en même temps que les âmes ; c’est l’écume mauvaise qui vient de mousser au bord du désir. Et, la chair d’une jeunesse ridicule, le rut encore désordonné, la caresse mal apprise, s’il s’attache quand même à tenter les expériences permises ici, c’est parce que là-bas, en Europe, elles sont le murmure honteux ou le crime. Et l’inconsciente fanfaronnade fait mentir les préférences.
A quoi s’appliqueraient-elles d’ailleurs ces préférences ? La volupté de l’exotisme est très médiocre, et les lignes en sont uniformes. Ne craignez pas d’avoir à courber la tête pour avoir blasphémé, sous la malédiction des errants don-juanistes. Sans doute, graves, car, plus haut que Suez, la grivoiserie se limite à la gauloiserie, graves et un tantinet mélancoliques, ils auront sous-entendu, du fumoir au boudoir, les étreintes étranges que l’on ne peut dire, et des frissons que l’on ne peut doser. Vous avez droit de rire ; aucun ne précisera, et l’ésotérisme quelque peu ridicule de l’exotisme continuera d’être le panache.
La très simple vérité est que, fausse honte ou fierté, le jeu d’amour est français, pas même Européen. Non seulement les femmes semées dans les îles ignorent les caresses qu’on invente sans les apprendre ; mais elles répugnent à la plus prenante des leçons. Monotone est l’échange, obsédant comme la mer est le geste. Et l’on estimerait vainement que la première résistance chez la première amante serait seule difficile à vaincre, puisque la reconnaissance infinie doit suivre la haine qui se débat. Au même rythme, à un seul rythme, restent asservis les corps des maîtresses exotiques, sans qu’aucune crainte, aucun dogme, aucune raison ne la conditionne aussi unique. Entêtement de demi-brutes sans doute, ou plus probablement et très mystérieusement, volonté de réserver aux mâles de la race le détail des litanies sexuelles.
Et c’est ainsi que commence l’indignation des partenaires à la première des générosités de l’amant, le premier cadeau repoussé avec ardeur, celui dont les Saxonnes ont imposé le nom à travers les océans, le « French game » qu’elles méprisèrent jadis.
Ainsi l’on possède des vahinés, des congaïs, des mousmés pour les avoir possédées, et les marins, globe-trotters par force, se persuadent ainsi, comme les autres, de la douceur de voyager pour avoir voyagé. A quoi bon s’étonner ou railler ? L’extension à l’être, la règle immuable des intellectualités, ne saurait mieux se vérifier que dans les corps. Du moins c’est un devoir de guérir l’envie à ceux qui écoutent les évocations des lointaines hétaïres qu’ils ne verront jamais, et de leur assurer très sincèrement qu’aucune nuit australe ne vaut une passade de Paris.
Vaine serait, pour échapper au radicalisme de cette conclusion, la tentative d’une sélection entre les escales. L’exotisme, c’est le bloc. Seulement un tapis le recouvre, chatoyant comme un arc-en-ciel.
Voici la Chine d’abord : voici « toute la lyre » de Saïgon ; Che-Fou, Trouville d’Extrême-Orient ; l’horreur de Nan-King ; les affranchies jaunes de Frisco, et les ribaudes des troupes, autour de Port-Arthur ; Shang-Haï, rehaussé par des Oteros jaunes, Shang-Haï, marché de primeurs, puis le sadisme de Tien-Tsin, et les hasards étranges au cœur de la Chine des supplices.
A côté, un peu plus loin sur l’espace de la Terre si petite, Madagascar s’apprête. Y bruissent les cigales, créoles de Diégo-Suarez ; les Betsimisarakas aux chevelures roulées suivant les Sénégalais en colonne. La volupté et le sang se mêlent parmi les insurrections de la Grande-Terre ; Majunga apporte la révélation des Houves aux chevelures splendides. Le grand rut surgit de Vohémar à Fort-Dauphin. Et Nossi-Bé, laineux de verdure, dresse un fantôme de Tahiti.
Encore dénombrons les étreintes semées par les îles du Pacifique énorme : à Macassar, caricature de l’Inde ; à Nouméa, hideux des surprises de bagne et enjolivé par les métisses ; aux Nouvelles-Hébrides où point à peine une aube de féminité. Le flirt le plus précis comble les heures de Christchurch en Nouvelle-Zélande. L’Eden, le vrai, se découvre sous les arbres de Tonga. Tabou, Wallis et Mingareva, dans une même supplication, à l’Istar malaise, confondent des balbutiements d’hétaïres impubères et des tendresses de forbans. Sydney d’Australie ressuscite le Quartier Latin autant que le passage d’Auteuil ; et si le rêve casse en désillusion sur les routes de Tahiti, aux Marquises le royaume d’Aphrodite éblouit les plus merveilleuses des voluptés imaginées.
Ainsi s’agite, ondoie, rayonne, fulgure, hypnotise, le tapis splendide de l’exotisme, sous la mousson fraîche, au souffle des alizés parfumés, au gré du Khamsin de feu, au frisson des bouffées qui viennent de terres mystérieuses et inconnues. Puis, lorsque le vent de France, suroît ou mistral, a effiloché l’étoffe colibri, l’a dispersé aux profondeurs informes de l’espace et du rêve, il demeure le bloc tout nu, le bloc de l’exotisme. Pour le bâtir, les chairs diverses des mousmés, des congaïs, des vahinés, se sont trouvées extraordinairement pareilles, et les mêmes passivités, les mêmes gestes appris, le même sourire où la mièvrerie s’efforce d’être de la douceur en même temps que du désir, ont été brassés pour la coulée sans fêlure, avec laquelle s’ébauchera la statue érectée en symbole des femmes du lupanar mondial, silhouette résumée entre le nombril et les pieds.
Si les caractéristiques de chaque morceau d’exotisme n’importent guère, tôt uniformisées, si la différenciation des maîtresses lointaines ne s’impose pas à un même amant, la succession des cadres dissemblables peut seule faire croire à une variété infinie d’étreintes. Car le cadre en soi ne saurait magnifier davantage la volupté exotique. Qu’il soit le plus souvent splendide, neuf surtout, c’est accordé. Mais il n’apparaît pas que des souvenirs de chair rattachés à Venise ou aux lacs de Westmoreland doivent se préciser moins que ceux de Manille ou de Mangareva. Il faudrait joindre à l’explication une sentimentalité, pour le moment hors de cette psychologie, à savoir que moins d’amants unissent au souvenir d’une femme l’évocation de Manille ou de Mangareva, que par suite ils estiment leur possession plus complète et plus « historique », si l’on peut dire, que la possession révolue dans Venise ou dans Windermere. Cette sentimentalité-là n’est, à bien voir, qu’un des avatars de la multiforme extension à l’être ; n’y revenons donc pas.
Plutôt concevons-la dans la plus certaine et la plus forte de ses manifestations rapportées à l’exotisme, sa lutte pour la perpétuité, sa haine de l’instabilité. Non qu’il s’agisse de développer une théorie de l’arrachement : l’œuvre de Loti en demeure à jamais le plus merveilleux et le plus saignant des commentaires. Et la terrible analyse, avec des mots douloureux de toutes les petites morts avant la mort suprême, et aussi inadmissibles qu’elle, l’analyse a joint implacablement la psalmodie d’un de Profundis au chant de la joie de vivre, en les îles délicieuses. Du moins les livres admirables, s’ils n’ont pas fait penser tous les marins mal habitués à la pensée, ont souligné, pour les tiers impartiaux, la majeure des relations psychologiques qui, entre toutes les étreintes, spécialisent celle de l’exotisme.
Le dogme de perpétuité qui, si facilement, si inconsciemment, se glisse parmi les moindres échanges dans la terre-patrie, est, au lointain, par avance aboli. Aucune illusion de baisers éternels ne pare le premier baiser, si longue doit être l’escale, par exemple deux ans, sur une goélette de Tahiti. La séparation s’effare au milieu des plus ardentes communions ; et la spiritualité des lois chrétiennes se matérialise, implacablement heure par heure, dans le cauchemar du départ inévitable, des fins dernières. L’arrachement ! Voilà le véritable motif d’aimer l’exotisme en aimant sa douleur. Les plus intellectuels s’enfièvrent davantage à jouir de la minute sachant que les minutes pareilles sont comptées. Les autres, stupéfaits, se lamentent à la dernière minute, et, non rassasiés, se souviendront mieux qu’ils n’avaient jamais pensé que cette minute dût venir et combien alors elle leur fut lamentable. L’archange qui garde l’Exotisme s’appelle « Nevermore ».
Outre la réalité de cet arrachement, un atavisme maritime de deux siècles ou plus renforce le goût de l’exotisme, salé des larmes de la séparation. Répétons qu’aujourd’hui, à l’exception de deux ou trois stations, desquelles quitte à peine le navire affecté, les plus longs séjours à l’escale ne dépassent guère six semaines.
Autrefois la vie de mer n’était pas organisée comme elle l’est maintenant, et l’on aurait tort, une fois de plus, laudator temporis acti, de penser qu’elle était plus mâle et plus glorieuse. Il suffit, pour être renseigné, d’écouter les récits des officiers supérieurs ou généraux, les fois, très rares d’ailleurs, où il leur plaît de se souvenir avec sincérité. Les traversées étaient plus longues au temps de la navigation à la voile, mais, contrairement à l’opinion reçue, elles se présentaient assez souvent. L’escale consistait vraiment à attacher un morceau d’existence comme un lieu d’exotisme. Cinq, six mois, la frégate demeurait à Tahiti, ou en un port du Sud-Amérique. L’échange se fortifiait, les liens se créaient, la vie de France s’oubliait complètement, remplacée par la vie présente. Et si ce déracinement n’était pas pour faire plaisir aux femmes demeurées à Toulon ou à Brest, du moins il conditionnait pour les maris un arrachement réel autant que douloureux.
C’est donc cet atavisme qui suggestionne les marins de l’heure actuelle. La durée de l’escale a été complètement réduite, une campagne s’écoule presque entière entre des traversées multiples et courtes. Malgré tout, l’âme des pères s’agite dans les corps des fils, et, naïvement ridicules, ils apportent à la conclusion de leurs six semaines de repos exotique la farouche désespérance que les marins de Cook ou de Bougainville manifestaient en terminant six mois de nirvana autant que de volupté.
Cependant, puisque nous avons prononcé le mot de Cook, n’imaginons pas que les marins de toutes les nations ont la même chair devant l’étreinte de l’exotisme. Rappelons-nous comment la petite fleur bleue ne pousse que sur le sol français. Il serait malaisé de prétendre connaître exactement les frissons saxons, germains ou slaves. Peut-être le masque d’impassibilité des autres races que la race latine conserve-t-il des tendresses insoupçonnées pour le lointain ou des arrachements aussi saignants que celui de Rara-Hu. C’est peu probable. En tous cas, Italiens et Espagnols ne paraissent point suffisamment retournés par le charme de l’exotisme pour qu’un Loti y puisse germer, et il semble qu’ils ne comprennent guère l’essence de son adorable génie.
Seules les haines, les jalousies, les puérilités, les folies de l’amour français se transportent dans la sérénité des Iles. Et, ainsi que dans la statistique d’Europe, le bilan des catastrophes passionnelles se solde par un passif au désavantage de la France ou plutôt de ses officiers. Car, pour les chairs chaudes et les cœurs simples des matelots, le mirage affolant est le même, et, depuis l’ère des découvertes, la proportion des déserteurs, grisés par la douceur australe, doit être pareille dans toutes les marines.
Pardonnables, respectables même, seraient l’ardeur et la tendresse enfantine de ces passades lointaines, si elles correspondaient à l’éternelle recherche de l’unisson. Oui, il importerait peu, et les tiers sceptiques n’auraient alors aucun droit à juger que la science de volupté est nulle dans l’exotisme, que la caresse y est monotone, que les chairs y sont sans imprévu. Etre amant et maîtresse, mettre entre soi l’infini de ces deux mots, ne suppose pas absolument le devoir et la hantise de faire vibrer toutes les cordes de la lyre. Aussi bien que sur le sol de France les hyménées attendries jailliraient vers les « deux fondus en un », à Tonga ou bien à Diégo, à Tien-Tsin ou bien à Manille.
Hélas ! L’inquiétude d’un geste qui froisse l’étreinte, la félicité de voir des yeux qui voient comme les nôtres, l’angoisse du désir partagé, la supplication humble ou passionnée, l’accord parfait, lettre morte que tout cela pour les hallucinés d’exotisme ! Ils embellissent leur spasme en le sertissant dans un cadre splendide, c’est tout.
D’ailleurs elles, congaïs, mousmés, vahinés, petites dispensatrices de rêve, leur donnent généreusement l’illusion haïssable. Mais s’ils peuvent croire à leur communion c’est qu’ils n’auront jamais visité l’éden le plus complet d’entre ceux semés sur la mer Pacifique, la terre qui semble pétrie de volupté, et où la langue n’a pas de mots pour traduire le mot « baiser ».
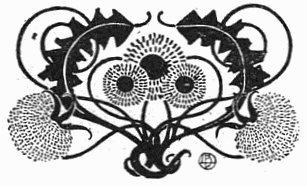
JAPONAISES

Japonaises. Chinoises. Annamites.
Les Prostituées au Tonkin.

La classique prostitution de jadis n’est plus celle d’aujourd’hui. Ce gros mot de prostitution, laid, banal, s’applique mal, ou plutôt s’appliquait mal à la joliesse mièvre des mousmés. Désormais, son équivalent, dans la langue nipponne, se retrouve et se comprend mieux. Il y a des « femmes du monde » ; il y en a toujours eu, et de haute branche, dans l’Empire du Soleil ; seulement, désormais celles-là, en parlant des autres, disent tout comme en Europe « les filles ».
Le Japon a réalisé pendant des centaines de siècles l’Eden rêvé par les jeunes hommes conquérants, le séjour de délices où toutes les heures sont vouées au spasme. Pourquoi ? Il serait malaisé d’en trouver des raisons psychologiques. Et, non plus, la physiologie n’explique rien. Le tempérament des poupées au sourire perpétuel est plus que modeste. Un Européen, un étranger, ne saurait l’affirmer d’après ses propres expériences, sans songer aux ironiques attitudes de ses maîtresses de passage. Mais les confidences loyales des hommes de la race confirment les apparences.
D’ailleurs la religion ne prêche nullement ce communisme des chairs. Elle n’a pu décider la formation d’un peuple de courtisanes. Le climat ? Il est de genre tempéré ; les froids de l’hiver y sont rigoureux. Quant au motif d’un sol d’abondance, sur lequel la luxuriance des fruits, la profusion naturelle, activeraient des désirs en harmonie avec la vigueur des corps comblés, ce motif se formulerait difficilement : les ressources des terres japonaises, abondantes et variées, n’écrasent pourtant pas l’homme sous la nature.
Reste donc, quelque paradoxal qu’en soit le commentaire, en suffisante explication, le résultat d’une philosophie raisonneuse et raisonnée.
Ainsi que pour son proche voisin, l’Empire du Milieu, la vieillesse de l’Empire du Soleil-Levant est un garant de ses incommensurables méditations à travers le temps. Or, tous deux, à n’en pas douter, avaient, bien avant l’aurore de notre Europe, résolu à leur guise le problème de l’Etre. Leur point de départ, en même temps l’aboutissant de leurs conceptions métaphysiques, est le même. Et, qu’on veuille bien pardonner cette incursion dans les domaines insexuels, à propos de volupté ! L’« être » s’impose, absolu et relatif à la fois, conclurent de chaque côté mandarins et daïmios.
Comment se montrer égal à la fatalité d’exister ? La Chine a choisi l’opium, c’est-à-dire la solution de croire cette fatalité monstrueusement inconsciente, et de la mépriser en refusant d’employer l’activité qu’elle apporte. Le Japon préfère adhérer à une fatalité consciente, et la comprendre éternellement en la renouvelant sans trêve, dans l’action sexuelle.
Mais la transcription de cette acceptation, du domaine de l’idée au royaume des faits, s’est faite sans le moindre ésotérisme. Le peuple du Nippon, certainement enseigné, comprit vite le rôle de la vie, et des affirmations philosophiques de ses prêtres se dégagea pour lui l’évidence assez inébranlable pour asseoir dessus une société :
« Il y a sur terre des hommes et des femmes ; c’est pour que ces hommes jouissent des femmes, et celles-ci des hommes. »
On chercherait vainement la moindre justification de cette hypothèse que l’on sent, partout à travers les siècles, l’origine du Nippon-lupanar. L’origine de cette vocation des mousmés se perd dans la nuit des temps. Des empires ont certainement disparu où elles apportaient leurs gestes d’amour, dans un exode coutumier, des empires qui précédèrent, de longs âges, la gloire d’Alexandrie, cette Alexandrie où l’admirable roman d’Aphrodite nota, avec l’indécision nécessaire, l’existence de ces inconnues d’alors, dans les jardins de la Déesse.
« Il en venait de plus loin encore : des petits êtres menus et lents, dont personne ne savait la langue et qui ressemblaient à des singes jaunes. Leurs yeux s’allongeaient vers les tempes ; leurs cheveux noirs et droits se coiffaient bizarrement. Ces filles restaient toute leur vie timides comme des animaux perdus. Elles connaissaient les mouvements de l’amour mais refusaient le baiser sur la bouche. Entre deux unions passagères, on les voyait jouer entre elles, assises sur leurs petits pieds et s’amuser puérilement. »
Depuis les jours de Chrysis, la timidité des Nipponnes s’est évanouie. Ou plutôt les débauchés d’Alexandrie appréciaient mal leur réserve et leur sérénité. Le calme japonais, avec tout ce qu’il signifie et tout ce qu’il cache, devait être un état d’âme inconnu à l’âme extérieure de la ville cosmopolite. Mais, autant qu’elles faisaient dans les jardins, les mousmés jouent encore entre elles, au milieu des passades, maniant les osselets, et n’accordant à l’étreinte finie ou à celle qui va commencer aucune attitude de repos qui en soulignerait une ridicule importance. Telles elles furent dans le parc d’Alexandrie, telles elles demeurent au Kanagãwa.
De quelque nom que s’appellent les quartiers lupanars, Kanagãwa, Yoshivara, ce n’en sont pas moins des cités énormes. Mais pourtant la cité de volupté se limite, se restreint, se recroqueville. Encore un coup, la prostitution a pris son titre ; bientôt Yoshivara et Kanagãwa ne seront plus guère que des « quartiers réservés », tels ceux des ports ou des Cosmopolis du monde.
Jadis cette partie de la ville était la ville même : les rues marchandes s’y accolaient, médiocres, dédaignées, permises seulement, semblait-il, autant que les imposait la nécessité pour l’approvisionnement et l’entretien du lupanar géant. Du moins, à cette heure encore, le bruit, la gaîté, la lumière, l’art, se mêlent et grouillent dans les artères qui sectionnent le Kanagãwa de Yokohama ; ou le Yoshivara de Tokio. Qui ne connaît, par Loti ou par cent autres, les « expositions », étalages des mousmés pomponnées, en devantures de boutiques, poupées réunies en phalanstères candidement indécents, et que viennent visiter, après le dîner, le soir illuminé, les amis et les amies des parents affectueux, ou les maris qui, par châtiment temporaire, confient leurs épouses à la méditation d’une de ces maisons si ouvertes, qui, ailleurs, sont des maisons closes ?
… Lepassant avait voulu voir si un corps et une âme de maîtresse pouvaient être dans un corps et une âme de japonaise. Car, par hasard, à ce stade d’exotisme, Loti n’avait pas pensé pour toutes les générations de marins. Leurs tendresses enthousiastes de chérubins à perpétuité s’étaient attristées aux dernières pages de « Madame Chrysanthème » ; et il les gênait d’avoir su, par son aveu, que l’aimé, revenu en cachette après les adieux, trouva la mousmé sans larmes, faisant sonner, comme un changeur de la rue, les pièces d’argent reçues le matin. De cette fin, ils gardaient une défiance, une incrédulité, une impossibilité de s’intéresser complètement à une histoire d’amour dont les paroles suprêmes ne seraient pas une douceur. Lui n’espérait ni ne souhaitait ce soir découvrir l’amoureuse ; il s’informait comme à Tahiti, comme partout.
Sa femme de la nuit s’appelait Susu-Sàn. Il ne lui demanderait rien de ces choses d’échange où la question force la réponse. Il verrait et il écouterait. D’ailleurs, une oisiveté, on veut le croire toujours, l’avait seule mené au Kanagãwa. Autrement il occupait, avec plus de sincère satisfaction, ses repos dans les confortables intérieurs des blanches dénichées à l’escale. Et, en attendant Susu, occupée hors de sa chambre à de minuscules préparations d’hôtesse menue, il fixait déjà l’histoire de son temps entre la rue et le logis.
Depuis le crépuscule il pleuvait. Alors, pour venir, il avait chaussé ses bottes. Il sourit, songeant qu’elles avaient effrayé la maison parce que, distrait, il avait marqué le blanc vestibule d’empreintes de boue. Mais, leur stupeur passée, les suivantes s’étaient bientôt précipitées et lui barraient les marches, peureuses encore mais résolues, avec des cris plus suppliants qu’indignés. Puis, rassurées par sa bonne volonté, elles s’étaient toutes jetées à terre pour enlever les grosses choses noires, redevenues vite espiègles, le secouant de leurs forces réunies et amusées de le voir chanceler.
Pourquoi il avait préféré Susu-Sàn entre les mousmés accroupies dans la salle de réception ? Mon Dieu ! sans aucune raison bien nette et pourtant certain qu’elle était, pour l’épreuve, la plus intéressante des femmes-enfants qui fumaient, accroupies, ou jouaient aux osselets. On l’avait guidé vers une chambre, non pas elle, mais l’une des suivantes, car elle, le rejoindrait un peu plus tard ; à lui, on donnait le loisir des réflexions de « mariée ».
Une amie de Susu-Sàn entra. Elle parla, courbée et souriante. Il comprit qu’on avait craint qu’il s’impatientât de sa solitude et, très poliment, elle s’était chargée de le distraire une minute. Elle s’assit devant lui, le « chamicen » aux mains, elle chanta. Elle chanta la mélopée qui emplit les rues du Nippon, et qui montait à cette heure de tous les coins du Kanagãwa et les syllabes de Ko-bé, Yoko-ha-ma, se prolongeaient presque en pleurs retenus. Quand Susu parut, suivie d’une servante, l’amie se releva, fit une révérence et sortit, sans avoir manqué d’échanger avec Susu un regard de moqueuse pitié.
La servante portait un en-cas sur un plateau. Oh ! non pas des mets compliqués, pas de crevettes au sucre, pas de céleri aux confitures, pas même de poisson cru. Du thé seulement, quelques fruits confits et une sorte de gâteau de Savoie. A côté, la fumerie de la mousmé. Le plateau fut posé au coin de la natte, presque trop près de leur main.
Puis Lepassant fut seul avec Susu-Sàn.
Brusquement, tandis qu’elle le regardait, immobile, il eut un élan de reconnaissance comique pour elle déjà, pour le cadre de jolie mièvrerie, pour la simplicité gaie de l’heure. Il la prit dans ses bras et lui dit des mots qu’il essayait de trouver petits et pourtant sérieux.
Cela dura peu ; il l’abandonna, et se rejeta sur la natte, étonné de sa tendresse éclose à ce moment, un peu honteux aussi de craindre, au fond de son transport, la flottante écume d’un désir de vieux devant cette femme-enfant. Elle demeurait impassible, le front penché, le regard clair sous les paupières abaissées. Il sut ainsi qu’elle attendait de deviner quelle chose il préférait, de donner ou de recevoir les caresses, dressée à ne pas froisser les fantaisies d’amants quelconques, autant par sa politesse de race que par sa complaisance de courtisane. Quand elle le vit rire, elle devint plus grave.
D’ordinaire, probablement, elle ne connaissait que des traits figés, malgré l’effort, dans l’anxiété du spasme prochain, ainsi que les autres hétaïres d’Europe ou d’Amérique. Mais plus qu’elles, elle versait sur le moment l’ironie d’un éternel sourire. Et le rire franc de ce passant la démontait, lui portait l’inquiétude d’une maladresse professionnelle, surtout d’une impolitesse. Lepassant la rassura, vaguement heureux de l’avoir devinée.
Ses mains cherchèrent tout de suite à dévêtir la mousmé et, content de l’heure, c’est à peine, si, brièvement traverse son souvenir le regret des maladresses, impossibles à cause de la simplicité des voiles, les chères maladresses des « avant » de là-bas, en France.
Sous « l’obi », la ceinture à nœud énorme fixé sur le dos, elle ne portait que le kimono en place de robe, et ses dessous drôles se composaient de diverses ceintures à diverses places sur son corps mignon. Lepassant prit le bout de la première et tira. Puis le bout de l’autre. A la troisième, il disparaissait déjà sous les écharpes. Alors il reprit l’extrémité, marcha vers le fond de la chambre en feignant un labeur, et lorsqu’il eut tendu la ceinture, il se remit à tirer avec quantité de grimaces. Cette fois, Susu-Sàn éclata de rire ; elle levait les bras, se prêtait au déroulement, tournait sur elle-même, infiniment gracieuse. Quand les rubans eurent été dénoués jusqu’au dernier, elle était nue.
Et ce fut le tour de Lepassant de redevenir grave. Rapidement il la prit contre lui ; il se mit du côté de la veilleuse d’huile amère, et lui tourna le dos, pour faire la nuit entre ses lèvres et celles de Susu-Sàn. Il l’étreignait avec précaution, et savourait la peur de froisser sa gracilité. Pourtant elle lui frappa sur les doigts, et, comme il la quittait, elle assura tranquillement, sur l’escabeau creusé en demi-lune, sa chevelure d’art dont l’harmonie ne voulait pas être dérangée. Puis elle se rapprocha de Lepassant…
Maintenant ils causaient. Lepassant avait ouvert son kimono très large, et, comme dans un manteau, il avait caché tout contre lui, le frêle objet qu’était le corps de Susu. D’abord, il ne put lui rien traduire de ses pensées ; mais entre eux, par la voix pressante et chaude de l’amant, il y avait la musique des mots. Il marqua son impatience d’écouter en vain quand elle parlait à son tour. Elle lui fit signe de lui permettre de se lever, puis alla prendre un livre sur une tablette.
Proprement recouvert ainsi qu’un livre de petite fille, traversé de signets, c’était moitié un dictionnaire, moitié une grammaire d’anglais. La mousmé suivit du doigt, en épelant dans un gazouillis, et Lepassant comprit qu’ils pourraient échanger des mots saxons, et les piquer, sans essayer les verbes difficiles, comme des jalons nets et bien en ligne, à travers le sol inconnu de leurs âmes. Susu avait déjà essayé ; il ne s’en était point aperçu, à cause de son étrange prononciation, de sa nécessité d’adoucir les consonnes et de nourrir des diphtongues avec un gazouillis de baisers. Elle disait : « soulipou » au lieu de « sleep », — « wouritou » au lieu de « write ». — Et il lui fut reconnaissant de ce premier essai d’échange.
Quand elle ne douta plus de son application, elle lui expliqua confusément qu’elle suivait des cours, l’après-midi, pour apprendre l’anglais. Aussitôt Lepassant l’évoqua au milieu d’une centaine de mousmés semblables à elle, à une sortie d’école, babillarde et gazouillante. Mais l’idée mauvaise de la femme-enfant passa plus vite cette fois ; il ne resta que la figure sérieuse de Susu-Sàn, embellie d’une extraordinaire volonté de réussite.
D’ailleurs son visage ne gardait rien des traits qu’on imagine le plus souvent, d’après les potiches ou les écrans. Les joues épaisses et fraîches, la bouche débordante, le front proéminent, sont la beauté des Nipponnes du sud, celles de Nagasaki. Au contraire, Susu-Sàn, comme les femmes de Yokohama, avait l’ovale allongé et pur, le nez de lignes franches, le front petit et bien diminué, la bouche mignonne.
Lepassant avait repoussé le livre : il baisait la mousmé à petits coups, et partout, patiemment attentif à la révélation d’une caresse spontanée, il ne s’irritait point de la docilité de sa maîtresse. Il attarda ses lèvres sur les seins piriformes ; la fraîcheur de la peau suffisait au plaisir profond de sa bouche. Car aucun frisson ne passait sur la poitrine de Susu, malgré cette caresse qu’il avait si souvent vu vaincre l’indifférence des amantes lointaines. Il épuisa, et attendri de le faire, les ressources de son baiser, obligé lui-même de se ressaisir pour ne pas mordre gloutonnement à la saignée des bras, aux oreilles, à la nuque, pour ne pas donner à l’ironique mousmé le spectacle d’un véritable abandon de chair, qui serait grossier devant sa correction.
Un moment, il releva la tête, et, légèrement écarté d’elle, appuyé sur ses mains pour se soulever au-dessus d’elle, il la vit assez tôt pour savoir qu’elle avait fermé les yeux, au moins engourdie par le bercement des gestes.
Ensuite elle le regarda de nouveau, placide, les yeux grands ouverts et calmes. Mais Lepassant voulut s’assurer de sa première impression, de cette béatitude surprise qui l’étonnait. Il retrouva ses baisers à la place où il les avait laissés et repartit de cette place. Susu le laissait faire. A un moment elle comprit ce qu’il voulait ; elle se déroba, lui pinça les joues pour l’arrêter, et avec son indignation si mesurée, son parler anglais si travesti, elle lui cria des mots que Lepassant feignit de ne pas traduire. Pourtant il avait bien entendu le joli nom de la grande caresse, nom qu’il avait toujours aimé, et qui est le même de Saïgon à Sydney. « French game, no ! » disait Susu-Sàn. « No French game ! »
Il la poursuivit un moment ; il lui sembla qu’elle s’échappait mollement, plus mollement dans chaque fuite. Moqueur, il n’insista plus. Dès lors, doutant s’il l’avait déçue et riant de nouveau et plus gaminement, il mit sa main sur la bouche de Susu, lui murmurant en nippon : « Franzomenzei » (vivent les Français).
Une fois encore, la nuit se fit entre leurs chairs, et de même que l’autre fois, Lepassant pensa qu’il devait être avec la fragile mousmé la femme de leur tendresse. Pendant le songe divin, il sentit que soudain s’ouvraient chaudement les lèvres de Susu-Sàn, obstinément fermées jusque là. Elle le fit rouler sur les nattes de toute la force de ses bras d’enfant, sans dénouer l’étreinte et, stupéfait, Lepassant dégrisé vit que les yeux de Susu-Sàn tremblaient au-dessous des siens, dans un enlacement qu’elle ne dénouait pas…
Lorsqu’il se fut habillé, lorsque Susu eut enroulé autour d’elle ses nombreuses ceintures, Lepassant ne s’approcha point, mais il la fixa longuement. Impassible, elle soutint son regard, le sourire d’idole plus mystérieux qu’auparavant. Elle lui versa le thé. Sur son ordre elle ouvrit la porte à la tiédeur de l’ombre. Au même étage, de l’autre côté de la terrasse, un couple dont l’homme était japonais, fumait l’opium dans des chambres pareilles à la leur.
Lepassant montra l’homme du doigt à Susu-Sàn, et dit, oubliant qu’elle ignorait sa langue : « Me le préférerais-tu vraiment ? » La mousmé comprit le geste qui unissait les deux mâles ; son sourire s’élargit. Elle mena par la main Lepassant en pleine lumière, et elle indiqua du doigt aussi son propre corps d’abord puis celui d’une femme d’Europe dessiné sur une réclame de parfumerie qui pendait au mur. Puis, plissant ses paupières aux cils écartés, elle attendit.
Et l’homme de France n’osa point répondre par le geste d’un choix qui aurait menti…
L’aventure, dans la volupté japonaise, le plus souvent se trouvera plus banale. Et l’aventure ainsi, du moins au premier contact pris avec le Nippon, se limite aux mousmés communes. Vain serait l’espoir qui, même au prix d’un séjour prolongé, escompterait la curiosité de l’adultère dans le monde japonais. Les grandes dames sont très peu certaines encore que l’amant étranger ne les confondrait pas avec ses petites amies des rues chaudes. S’il existe chez elles, peut-être, une solidarité avec les filles, conservée des siècles où elles furent à peu près les pareilles, si cette fraternité se découvre parfois peu lointaine, comme dans l’élan d’apporter des yens à la souscription pour le trésor de guerre, les mondaines de Yokohama et de Tokio en refoulent soigneusement les manifestations.
L’énorme orgueil de la race frémit de voir trop souvent reparaître chez leurs hôtes la conception du Nippon-lupanar. Alors les femmes du monde japonais affichent les plus terribles mépris pour les mousmés irresponsables, ou, mieux, plus cruellement, ne manquent point de rappeler aux Français gaffeurs la réputation de la Ville-Lumière et les archives de la tournée des grands ducs.
Mousmés et femmes du monde ne résument pas la légende d’amour du Japon. En tout lieu du monde le globe-trotter n’observe qu’une bordure, ne juge que sur la côte, par les ports ou mieux par les grosses villes. Mais, sur la terre nipponne, plus qu’ailleurs, il ne convient pas d’ignorer la masse épaisse et remuante des campagnes. Certes les paysannes menues, rencontrées en excursion, ou cherchées dans la solitude locale qui recommence à deux lieues des voies ferrées, ne sont pas différentes des complaisantes courtisanes de la ville, et, comme elles, sont fort disposées à contenter sans façon le passant. Mais, précisément, ce caractère du peuple sur la glèbe, ne peut être soupçonné d’avoir subi des empreintes, corruption ou civilisation. Il atteste plus fortement que le Yoshivara la conception de vie, admise par la race qui fonda sur les jeux de l’amour sa raison et son plaisir d’être.
Parmi leurs bonnes volontés, le plaisir des paysannes compte peu ; mais la curiosité de voir et de savoir, les intéresse aux étrangers en quête d’hospitalité. La porte fermée, au moment du tub, se rouvre d’elle-même ; pendant le changement de linge il sied de demeurer impassible, sourd aux rires qui gargouillent au moindre trou, derrière les cloisons de papier. D’ailleurs le personnel des lupanars se renouvelle naturellement dans les femmes de la campagne. Point n’est besoin d’embauchage, ni de résolutions désespérées pour amener les filles des champs à la ville. Elles y viennent tranquillement amasser un pécule, s’instruire dans l’intervalle de leurs passades, et préciser avec sang-froid leurs notions sur les différentes marines d’Europe.
Yokohama et Tokio, et la banlieue entre les deux énormes agglomérations, sont assez vastes pour disperser discrètement l’orgie rude et sincère des matelots. D’ailleurs, sur cette rade, de luxe en quelque sorte, ils se trouvent moins souvent, et plus rarement on leur y accorde la liberté de la terre mauvaise conseillère. Aussi est-ce Nagasaki qui, non seulement parmi celles du Japon, mais parmi toutes les escales des Océans, leur donne les paradis dont on parle vaguement aux pays bretons comme sur la Clyde, à Naples autant qu’à Hambourg. Le charme des mousmés même est assez puissant pour lutter contre l’emprise de l’alcool. Les eaux-de-vie nipponnes ne sont pas meilleures, à beaucoup près, que le genièvre et le trois-six pour les cerveaux des grands enfants. Mais d’abord la peine est rebutante de découvrir le cabaret, de s’y faire entendre, et les petites poupées sont si proches ! Et elles sont si drôles ! Et leur chambre est si propre ! Car cette extraordinaire blancheur des nattes du parquet, des bambous, des papiers, ravit le matelot habitué à s’humilier de la moindre tache, de la plus petite poussière, à bord. La langue, les mots gazouillés, il ne les comprend pas et les devine encore moins que ses officiers. Alors une étrange combativité descend en lui et double sa volupté : il lui paraît que la mousmé complaisante est le fruit d’une victoire, qu’il l’a conquise sur un ennemi héréditaire, et c’est le langage inconnu qui forme la totalité de cette illusion confuse dans un cœur simple, le Nippon scandé en lequel le marin breton imaginera soudain le parler « anglish », en lequel le « jacktar » découvrira un bafouillage de « frenchy ».
A vrai dire les consonnances japonaises ne rappellent aucunes autres très particulièrement. Peut-être, avec quelque raison, et si bizarre paraisse le rapprochement, assimilerait-on la langue de l’Empire du Milieu avec celle de l’Italie, au point de vue très superficiel de l’oreille, s’entend. Peut-être aussi y a-t-il autant de différence entre la phonétique de Nagasaki et celle de Yokohama qu’entre le type de la Japonaise joufflue et courte et celui de la Japonaise allongée, au visage d’un ovale ravissant. La sélection, dans cette race, s’est exercée avec une force unique et les aristocraties européennes auraient peine à soutenir la comparaison, pour la tradition du sang. Des dizaines de siècles durant, les unions dans la caste supérieure ont été triées aussi implacablement que par les soins d’un reproducteur professionnel, et cependant la caste était assez nombreuse et saine pour qu’une affinité trop proche n’affaiblît pas les meilleures combinaisons. De là la différence si marquée entre les deux types de femmes, apparente au point que, à prendre des extrêmes, on y évaluerait autant de dissemblance qu’entre un setter et un loulou.
De la race supérieure sont sorties et se sont renouvelées à travers le temps, les guéchas ou « geishas » puisque Sada-Yacco nous conserva la couleur du mot. Recluses d’abord comme des religieuses, éduquées aussi complètement que dans les plus célèbres maisons, dressées comme des courtisanes sacrées, elles ne sont pourtant ni l’une ni l’autre de ces closes. L’école des Geishas n’a que peu de rapports avec ce qui fut jadis le Didascalion d’Alexandrie. Au mieux, il conviendrait de l’assimiler à l’un de nos conservatoires, conservatoire à la méthode duquel s’adjoindrait une indispensable prédestination. La fille, préparée dans le recueillement de l’Ecole, doit servir bien plus à la collectivité qu’à des individualités. Elle sera principalement danseuse et chanteuse, mais son élocution et son geste serviront à perpétuer la légende des gloires nationales. Entre toutes les manifestations d’art, la plus classique est aussi la plus symbolique, cette danse des Samouraï, qui, malgré la modernisation de l’Empire du Milieu, conserve le souvenir de son passé moyenâgeux.
Ce serait peu, à dire vrai, du moins pour la question de volupté, que de spécialiser ces Geishas telles que des aèdes homériques. Dans son amour de la vie et son acceptation de l’amour qui le conditionne, le Nippon n’a pas manqué d’associer l’exaltation de la pensée aux délices des corps qui la supportent. Et voilà certainement pourquoi en place de faire déclamer leurs fastes par des rhéteurs ou de les laisser nasiller par des enfants, les hommes de la race ont décidé que le cours des années révolues s’enroulerait autour des souplesses de la femme.
La souplesse, telle est la caractéristique des Geishas : on comprend que les charmes de l’étreinte s’en déduisent aussi bien que l’évocation des figurations guerrières. A la fin des dîners somptueux, les geishas viennent, chair moins banale que celle des joueuses de flûte alexandrines, intellectualité plus désirable à conquérir, par delà la résignation.
Il n’empêche que la souplesse n’exclut pas les autres arts érotiques, appris de la même sorte, avec des années d’étude : les complications de la caresse, les procédés secrets du glottisme, l’usage des regards, sont la même science acquise avec le rythme varié des mouvements du corps.
Le Japon n’a pas seulement, dans son sens de l’art, une admiration de dilettante pour les efforts d’une souplesse qui se cherche et qui se réalise en multitude de gestes. Sa conception atteint à un certain degré d’utilitarisme, si l’on peut parler ainsi, puisque c’est dans cet empire du Milieu que des générations, les unes après les autres, s’efforcèrent à la tâche d’élargir la fatalité sexuelle qu’ils acceptent, dès l’abord, joyeusement.
Par les soins de ces générations, le symbolisme d’une ruée, dans la multitude des êtres soumise à cette fatalité, s’est traduit avec la plus magnifique des obscénités, obscénité inégalée par la recherche des civilisations desquelles naquit l’Europe.
La fantaisie des chèvres saillies par des satyres, ou celle des bacchantes en délire sous la griffe de bêtes apocalyptiques, a été continuée et développée par une imagination multiforme. On croirait à une hantise de malade : il n’y a, dans le fait, que de la grivoiserie placide, et le terme si français de grivoiserie correspond bien aux seuls Japonais. Sans parler des ventes spéciales ou des reproductions classiques en la matière, le plus minuscule ivoire acheté dans un bazar, offre, sous un certain angle, quelque scène merveilleusement travaillée, qui dépasse de loin les plus célèbres Rops. Inutile d’insister sur les mécomptes de ces surprises faites, de la meilleure foi du monde, aux parents et amis désireux de japonaiseries.
Le livre consacré, l’Evangile, pour ainsi dire, de cette collection, consiste dans la « Légende des Pêcheurs ». A l’obscénité de ses détails dessinés, l’ouvrage a l’avantage de joindre un texte vraiment drôlatique, et, des feuillets crissants du papier japonais, aucun n’est banal : l’arrivée des pêcheurs nippons, poussés par une tempête dans une île inconnue où ne vivent que des femmes ; la ripaille première ; ensuite l’enseignement parfait des caresses ; les exigences de la population s’arrachant les trois hommes ; la fuite heureuse des malheureux efflanqués, courant de nouveau à l’incertitude de le mer plutôt que de demeurer aux bras des furieuses d’amour.
Les images dressent invariablement des phallus énormes, des phallus anatomiques zébrés de nerfs et d’artères, taillés en profils irritants, exacts néanmoins, suant jusqu’au sol, puérilement figuré, des ruisseaux de sève, aplatis en mare sur la vignette. A d’autres pages, des vagins baillent comme des antres, ou bien leur ovale velu, démesurément étendu, dresse de fantaisistes arcades, comme émondées en forêt. Et partout l’enchevêtrement des membres pour la rencontre des sexes, les corps simplement linéés, l’ignorance des ombres, transforment la curiosité d’un dessin en une difficile intellectualité pour percevoir le rythme d’amour représenté.
De cette souplesse, sur laquelle nous avons insisté, qui précise les geishas et explique les livres de volupté, la Japonaise qui désormais symbolise sa race aux yeux de la France ne saurait nous illustrer l’exemple. A considérer, au contraire, Sada-Yacco dans son jeu scénique, on ne retient qu’une grâce tâtonnante, des pas incertains, un inachevé de mouvements, lesquels, s’ils préparent ensuite par leur soudaineté et leur déséquilibre même, l’émotion dramatique, ne commandent pas à l’harmonie d’une continuité tragique. Mais, en vérité, la contradiction n’existe pas : et la manière de l’actrice souligne au contraire, par sa contre-partie, la sérénité pliante et souriante de sa race.
Car la conception dramatique des protagonistes japonais n’adopte aucunement la transposition sur les planches, pour sa représentation, de la vie ordinaire avec ses accidents. Ce que nous appellerions réalisme, en dépit de toute opinion préconçue, ne se retrouve pas, et la tranche de vie n’est jamais servie au public. On conçoit donc le parallélisme irréductible de deux sortes d’attitudes : Sada-Yacco, au Japon s’entend, est d’autant plus grande artiste que ses expressions et leur substratum sont « différents de la vie japonaise. » Hors cette brève analyse du reste, qu’on veuille seulement s’imaginer quelle conception réalise la tragédienne expositionnelle. L’Empire du Soleil Levant ne connaît pas les artistes femmes : leurs personnages, là-bas, sont toujours tenus par des mâles costumés.
Acceptons donc que le geste symbolique de la race nipponne réside dans le sourire, non pas dans la mobilité du masque d’une Sada-Yacco, encore qu’admirable. Et ce sourire, dont le leit-motiv remplit le plus bref récit de voyageur, s’évoque, pareil et perpétuel, sur le visage de la mousmé caressée comme sur le facies du cocher que l’on insulte. Il serait long d’en fouiller la psychologie ; mais aussi le sourire est trop essentiel à l’histoire de la volupté pour qu’il ne s’impose pas un devoir de le définir. Ainsi l’homme d’Europe, étonné, gagnera du moins l’avantage de ne pas interpréter l’apparence de ces visages comme un signe de stupidité ou de platitude.
Un Japonais, au service d’un Américain, et jadis de haute race, avait dû, dans le besoin, engager les armes d’un aïeul samouraï. Le maître, averti, les racheta, et la reconnaissance du serviteur loué lui fut acquise, sans bornes. Or, dans l’emportement d’une colère, l’Américain, un jour, frappa son valet. Une seconde, déjà calmé et navré de son emportement, il lui parut que l’homme s’était redressé terrible, et que, de son poignard court, il allait égorger l’insulteur, sans souci d’une actuelle différence sociale. Cependant le domestique, presque instantanément, se courba pour sortir, le visage traversé de l’immuable sourire. Le soir en rentrant, l’Américain le trouva mort ; il s’était ouvert le ventre avec le sabre de l’aïeul samouraï. Or, voici ce qu’il avait écrit : « Tu m’as insulté de telle sorte que la fin de l’un de nous est indispensable. Mais je te dois la reconnaissance d’avoir pu conserver ces armes, patrimoine qu’il m’eût été insupportable de laisser en des mains étrangères. Elles ne peuvent donc se retourner contre toi ; c’est donc à trancher mon destin qu’elles serviront. »
Cette impassibilité, tellement différente du flegme saxon, cette impassibilité traditionnellement soulignée d’urbanité gracieuse, se retrouve, on ne saurait trop le répéter, dans les actes les plus tumultueux de l’être selon toute autre conception humaine. La méthode des lutteurs en est l’exemple le plus extraordinaire. Au Japon, pas d’enlacements, point de chairs en sueur, jamais de nerfs roidis par l’effort de bras gonflés, de jambes arcboutées. La lutte du Nippon, le « jiutsu » est une science statique, une science d’anatomie. Les professionnels occupent leurs longues années d’entraînement à apprendre le plus mince fonctionnement de la machine humaine : aucune fibre ne leur demeure inconnue, dans ses rapports avec la dynamique générale des mouvements. En même temps, ces lutteurs se sont engraissés démesurément, jusqu’à ne présenter plus qu’une masse et une surface gélatineuse, sous laquelle ne transparaisse aucune ligne du squelette.
Alors, l’heure venue du combat, les deux monstres se touchent, se tâtent, se palpent, sans la moindre brutalité. Des jours, parfois, ils demeurent en présence, immobiles l’un devant l’autre, ou occupés à cette mystérieuse auscultation de leur corps. Puis, une minute soudaine, rompant en gloussements admiratifs le silence du public, l’un des deux athlètes s’écroule sur l’arène. Il est vaincu ; le vainqueur, après de patientes recherches, a découvert sous la graisse de l’adversaire un muscle à casser, un tendon à rompre, un seul ressort à fausser pour entraîner la chute de l’ennemi, et sans doute l’estropier à jamais.
Une exacte réflexion sur les multiples traductions d’un masque japonais, barré du sourire, conduira à une plus juste défiance des mousmés rieuses et caressantes. Toutes les manifestations qui s’appliquent aux hommes de la race ont leurs correspondances chez les femmes. Aussi, parlant des premiers, commente-t-on les autres. Et à ces autres, à ces poupées mystérieuses, à ces minuscules âmes de lupanar, s’appliquera la conclusion de crainte, que la première impression de joliesse et de joujou n’aurait pu présager en aucune manière.
Est-ce trop dire ? En tous cas une impression demeure des nuits passées au Kanagãwa ou dans le Yoshivara : quelque bien seul qu’on soit avec la maîtresse de passage, il semble que chaque étreinte s’enlace dans les yeux d’un tiers ironique.

FEMMES DE CHINE

Femmes Malabar. Japonaise. Chinoise.
Tagal de Manille. Cochichinoise.
Femmes des Iles Java et Sumatra.

Les Concessions d’abord, c’est-à-dire l’Extrême-Occident, puis des quais bâtis, des ponts par-dessus des arroyos vaseux et fétides, les quais élargis en boulevard d’arbres, et soudain toute cette avancée de grande ville familière, gaie, brisée contre un mur circulaire où une porte met plus d’ombre encore, béant, sur l’ombre de la cité chinoise : cela, cette hésitation, cet étonnement, cette inquiétude, cette peur enfin, c’est l’exacte rencontre du désir européen avec la femme chinoise.
D’ailleurs bien rare est la rencontre vraie. Shang-Haï, sans doute un des quatre premiers centres de transit au monde, n’a pas vu, comme les autres Babels de matelots ou de rouliers de mer, affluer la marchandise avantageuse ; une fois encore la Chine a pu, même dans ce port si peu chinois, annihiler un principe du fonctionnement économique d’Occident, déséquilibrer la loi d’offre et de demande. Car il faut compter pour rien toute la chair parquée dans cette enceinte absolument circulaire. Au soir tombant les portes se ferment, et toute volonté de savoir, d’essayer, exaspérant un corps latin, saxon ou slave, succomberait sous le poids de l’horreur physique qui monte des immondices jointe à « l’horror » qui tombe des dragons larvés sur les temples déformés.
Alors il reste le Shang-Haï de nuit célestiale enclavé dans les concessions étrangères.
Deux rues, Nanking Road et Soo-Chow Road, rayent la ville, aussi lumineuses que des rues de capitales. Mais elles n’ont point été laissées ou faites pour une curiosité de visiteur, pour un essai maladroit de reconstitution expositionnelle. Non, elles sont chinoises, par leurs passants, leurs hôtes de restaurants, leurs restaurants, leurs scènes. Et c’est à l’entrée de ces music-halls que l’on voit s’arrêter les chaises à porteurs des Otéros jaunes.
A l’intérieur, devant des spectateurs maintenant sortis de leur impassibilité, petits marchands de canards aplatis, au lieu de petits Sucriers, vieux mandarins à boutons de cristal en place de vieux marcheurs, sur des planches elles chantent, des bijoux cliquetant qui ont payé leurs faveurs du même prix au moins que les faveurs des étoiles européennes.
Souvent elles miment.
Dans le rythme de leurs attitudes, quelques gestes, des déformations de lignes surprennent. A ces moments-là, par exemple, quand les coudes viennent caresser les hanches, raidis, quand le trait de la bouche s’agrandit extraordinairement jusqu’à barrer, semble-t-il, tout le bas du visage, à ces moments-là l’assemblée chinoise ploie au même frisson. Et le « diable étranger » s’irrite de ne pas comprendre, et il va jusqu’à croire, en contentement d’explication, que des mouvements de volupté chinoise lui seront toujours aussi mystérieux que des sérénités faciles aux mêmes nerfs dans la douleur physique.
Du moins une grande partie du thème mimique lui plaît, facile à suivre, gracieuse dans son déroulement classique : la femme qui fait souffrir et les hommes qui acceptent. La pièce est finie ; l’étoile est rentrée dans la coulisse. Il serait inutile, même avec des coffres pleins de taëls, de l’y chercher : on conte qu’un souverain « présomptif » en voyage ne put y réussir ; on conte que l’une de ces femmes, sauvée par un officier français, plutôt que de se donner par remerciement, l’invita à la venir voir mourir…
Pour retrouver l’apparence et le souvenir des Chinoises, on va près du quai, on passe sous des voûtes, à travers un pâté de hautes constructions qui sont pareilles à des habitations ouvrières, on va dans les Sassoon Builds, chez les Macaïstes. On y va pour les Macaïstes elles-mêmes, à parler franc. Pourtant l’appréhension est grande quand on ne les a point vues, quand on les voit d’abord.
Elles sont nées, ces Macaïstes, de l’union chinoise et portugaise ; les hommes de la race sont affreusement laids, coiffés, principal signe, d’un chapeau d’astrologue, violet, penché en arrière ; ils sont taciturnes et savent vendre. Elles, l’immense majorité exportée de Macao, comme dit le nom, sont très blanches de peau, plus blanches que les blanches ; leur face est aplatie, leurs yeux aussi bridés que ceux des Japonaises, mais si grands qu’ils apparaissent beaux.
Elles sont des fruits de toute première saison, jetés toute l’année en primeur aussi sur le marché. A dix-huit ans, il n’en reste plus qu’une mollesse bizarrement laiteuse : elles font songer aux Levantines. De là-bas, de Macao, elles viennent, simplement achetées à leurs familles où elles grouillaient comme des petites filles chinoises. Et à Shang-Haï, leurs virginités deviennent aussi peu mets de luxe que le saumon aux bords des lacs poissonneux…
Elles caquettent, elles sautillent, leurs élans inharmonieux plaisent par leur fréquence et leur soudaineté. On leur a appris, comme à toutes les filles de joie en tout pays, les mots les moins convenables de chaque langue. Et Français, stupéfait, l’on est accueilli par une vingtaine de ces perruches roulant une même phrase de bienvenue : « Bonjour, Monsieur, cochon, c…, sal… » sans qu’à aucune insulte elles joignent un autre sens que celui du bonjour donné. Leur vice reste charmant.
Réunies à trois ou quatre parfois elles supplient l’ami de passage d’apprendre à une très jeune amie la caresse qu’elle ignore, et, avidemment curieuses, se précipitent tôt, trop tôt dans la chambre pour questionner, interviewer l’amie. Elles rient, on rit. Quelques-uns demandent et emportent leurs photographies, le plus grand succès des chambres d’officiers au cours d’autres campagnes, sûrement partout ailleurs.
Avec les Macaïstes seulement, au reste à peu près semblables à leurs femmes ordinaires, les Chinois prennent des habitudes nouvelles d’amour. Non qu’ils aient la répugnance de l’Européenne. A Manille, les plus ravissantes filles espagnoles pur sang ne se donnent qu’aux prêtres, par terreur, et aux millionnaires chinois par vénalité et certitude de discrétion.
A Shang-Haï, la Chinoise n’est point celle qu’on représente trop semblable à la Japonaise, comme fragilité de corps et chiffonnage de figure. Surtout au bas de la rivière, à Woo-Sung, où mouillent les navires de guerre, dans la pleine campagne, travaillent de fortes filles. En chassant au crépuscule le faisan, les paysannes rencontrées apportent la parfaite ressemblance des plus belles Bretonnes ou Normandes. Avec un fichu de poitrine, une sorte de coiffe sur les cheveux, elles tiendraient leur place dans un paysage de Beauce. Les matelots sont de cet avis. Parfois, quand le dimanche ils ont congé sans la permission de monter à Shang-Haï, ils errent dans la campagne de Woo-Sung, et plusieurs y trouvent, comme dans les rues borgnes de Brest, de fortes filles qui les font boire et les aiment. L’eau-de-vie et l’amour chinois leur sont aussi mauvais que l’amour et l’eau-de-vie bretons.
Ces paysannes sont leurs rares femmes, puisqu’ils ignorent le plus souvent les Macaïstes. Et les Américaines coûtent trop cher, trop cher aussi pour bien d’autres qu’eux. Américaines, elles sont en majorité, les hétaïres étrangères de Shang-Haï, de tout l’Extrême-Orient ; mais le nom est plutôt générique. Leur souvenir d’ailleurs, reste quelconque au passage ; hétaïres comme tant d’autres, mais plus douces, agréables partenaires de causerie, partenaires d’intérieur très luxueux, jolie note au cadre de la promenade classique, Bubling-Well, où elles conduisent des tonneaux, tribune élégante, mais rigoureusement séparée, au pesage du champ de courses.
Et la curiosité toujours insatisfaite va vers une autre tribune séparée, lors des meetings sérieux de printemps et d’automne, la tribune de gros marchands chinois où s’asseoit discrète leur femme légitime, toute menue, vêtue de blouses et de pantalons lamés et pailletés comme ceux des bébés bretons à Plougastel, les mains invisibles sous des brillants qu’écrasent des ors jaunes, la figure émaillée sans une ligne de fêlure, les petites femmes aux regards perdus que les maris, après avoir joué des sommes énormes, ramènent en coupé vers des gynécées qui sentent l’opium et la cire des bougies rouges brûlant devant l’ancêtre.
L’amoncellement de la saleté, la variété affreuse de ses détails, deviennent du cauchemar. La vie ainsi déformée et souillée ne se distingue plus de la pourriture ; et sur les condamnés qu’on heurte rivés à la cangue dans des recoins d’arcade, sur ces corps que le carcan paraît séparer absolument de la tête, icônes anatomiques, les mouches se posent comme sur une charogne. Autour des bêtes éventrées qui suent leur corruption au soleil, des corbeaux et des buses ivres, le bec dégoulinant et les plumes dégoûtantes, des entassements prodigieux d’excréments apportés et renouvelés par la main d’hommes, la nourriture vendue aux étaux presque semblable aux déjections qui rendent gluante la rue.
Dans ce cadre, une touche étrange de sadisme teinte l’amour. Sans doute, cette attirance entre l’horrible et le désir anormal est cataloguée dans de spéciales pathologies. On s’étonne, malgré cela, de la voir, à Tien-Tsin, sinon fréquente, du moins pas rare parmi des Occidentaux que des inquiétudes diplomatiques laissent presque continuellement autour des légations en poste armé et avancé. Pour dire davantage, dans les maisons de femmes semées ou groupées parmi ce cloaque, moins qu’indifférents, attirés par le relent du flot des immondices, des gens s’égarent dont la large et artiste souvenance de globe-trotters vous ravissait tout à l’heure à table, au milieu des causeurs les plus avertis. Qu’en rapportent-ils de ces maisons ? Ils n’y vont point chercher du document ; ils n’en parleront pas demain, et il ne faut que s’étonner, se reporter à des livres lus qui n’étaient pas médicaux, quelques pages peut-être de la « Maison de la Vieille » !…
Le document est plus spécial encore, mais moins incompréhensible quand on a eu jadis le loisir de bien connaître Naples, quand on a voulu bien regarder Saïgon et le Tonkin.
A Tien-Tsin, il n’existe pas que des maisons de femmes, et des séjournants assurent, excuse quêtée ou réalité vérifiée, s’être aperçus très vite d’une particularité commune à la race chinoise et à la race annamite, la beauté réservée seulement au sexe fort.
Oh ! le joli lac, plein d’îles si vertes cerclées de flots si bleus ! Les îles pour la plupart, sont plates, et alors ce vert et ce bleu, aussi franc l’un et l’autre, semblent aussi liquides, et l’on se demande, à les voir bizarrement et nettement séparés, comment ils demeurent sans se mêler. La nappe d’eau, flaque arrondie entre des terres régulièrement réparties en cercle ; ou bien elle court en ruisseau quand deux taches vertes sont rapprochées, tellement rapprochées qu’on les pense ridicules de n’avoir pas bu le filet qui se promène entre elles ; ou bien elle défile en fleuve devant de minuscules falaises tranchées comme des morceaux de gâteau sec ; ou encore, comme une fille qui gamine sous un drap, elle fait trembler au-dessus d’elle une étendue de lotus graves.
On est infiniment loin de Shang-Haï ; aucune canonnière, jusqu’à ce jour, n’est venue jusqu’ici. Et la monnaie, ce sont de grossiers lingots d’argent dont on coupe un morceau au hasard des équivalences.
L’idée sérieuse de pénétration, l’idée orgueilleuse de conquête se fond en douceur pastellée de ce vert et de ce bleu tranquilles. Sur une rive de la grande terre, des hommes et des femmes attendent l’embarcation. Et les étrangers ne sont plus des diables étrangers. Pourquoi ? Pourquoi ce coin charmant au cœur de la Chine des supplices ?
Malgré les défiances ordinaires, les étrangers se sont un peu séparés les uns des autres, oh ! seulement de toute l’étendue d’une pudeur d’homme. Car les femmes trouvées sur la rive, auxquelles d’ailleurs on ne tenait pas du tout, mais pas du tout, les petites femmes beaucoup plus drôles que les fortes paysannes de Woo-Sung, se sont précipitées sur les étrangers qui débarquent. Et les diables étrangers n’ont point sujet d’en être très fiers ; c’est pour voir, rien que pour voir, que les petites femmes ont apporté de l’amour aux nouveaux venus. Au bout d’un instant elles s’enfuient, roulant sur leurs jambes tordues, riant de rires craquelés. Eves chinoises !
Le Trouville chinois. On y vient du sud, on y descend du nord. A côté de la plage, Watering-Place ou ville d’eaux ; la pauvre vieille sale cité a tenté en vain de se nettoyer. Ce n’est plus le méchant mendiant qui tue comme il vole, c’est le mendiant en loques qu’on plaint. Malgré tout, une petite colline, qu’escaladent des villas de tout style, marque la frontière, l’abîme. La plage est la plage, et Che-Fou est Che-Fou. Des navires de guerre sont toujours mouillés dans cette baie de houle longue, soudaine, les obligeant à prendre le large. Mais, le temps beau, les musiques des « flag-ships » jouent tour à tour en haut de la dune, les flirts palpitent ou raillent, les officiers convalescents de l’hôpital tout proche viennent attendrir des sourires et savoir quand on appareillera…
Aussi, de ce bord de mer européanisé, il ne resterait qu’un souvenir d’escale coupant l’exotisme, n’était la vision en même temps retrouvée de quelques ombres célestiales passant dans cette miniature de Trouville. Des femmes chinoises, des filles, errent à l’heure de la marée sur la lisière de la plage, quelquefois même à toucher les groupes. Elles ont remarqué, plusieurs étés durant, la joie animée de ce coin de Che-Fou où elles sont nées ; elles s’imaginent que toutes les Européennes qu’elles coudoient dans leur pleine gaieté sont des courtisanes : et le plus sérieusement du monde elles viennent pour les imiter, pour plaire à des matelots ensuite, prendre une leçon en plein air.
Or, elles ont une grande régularité de traits ; beaucoup d’entre elles gardent le sang tartare. Et on les écoute parfois la nuit, au seuil des portes ; et, la porte close, on ignore bien des nuits la leçon qu’elle répètent lorsque, devant l’amant impatient, se balançant dans un rocking-chair acheté au « store-house », pareil à ceux du bain, elles lui font l’hommage de leur moue copiée et de leurs gestes aussi parfaitement élégants que ceux des flirteuses russes ou saxonnes.
N’importe où, par exemple, à Canton. Aussi aucune note de volupté nouvelle. Un confortable emploi d’après-dîner, ainsi qu’en un lieu quelconque de la terre. Seulement le cadre est joli, fraîcheur d’eau et fraîcheur d’appartement, coloris de soirs uniquement émeraudés, coloris de femmes et coloris de glycines en grappes. Seulement les femmes, longues filles aux yeux morts, flottant dans des matités de peau comme deux astéries sous une nappe immobile, les femmes impassibles, savent mieux qu’aucune au monde quelles caresses successives ou simultanées casseront le dîneur qui les attend après leur chant, et, plus qu’aucune au monde, les donnant, ne s’y intéressent point.

Laotienne. Cambodgienne. Tonkinoise.
Femmes du Cambodge.
Il vente grand vent sur le fleuve ; les rafales d’amont descendent larges et s’enflent aux vallées ; elles paraissent lutter de vitesse avec le courant boueux ; et l’eau bat les rives avec un glougloutement gourmand d’inondation. Il gèle 10 degrés au-dessous de zéro. Les jonques se sont toutes réfugiées dans le canal qui monte vers Nan-King, et l’enchevêtrement de leurs agrès simples au lieu de parer le fond du paysage, salit davantage encore sa lividité. Deux portes, l’une sitôt après la grève, l’autre à l’horizon, dressée en arc triomphal, marquent un chemin d’immense tristesse vers un Golgotha d’ombre : entre elles, sur la route, des peupliers se froissent. Des Chinois, démesurément grossis par les peaux de bêtes, passent, portés par des ânes lilliputiens ; sans timbre, les clochettes des colliers toussent ainsi que des asthmatiques. Et de l’autre côté du fleuve roi, les biches brament sous un tournoiement d’aigles malpropres.
Nous sommes entrés au hasard dans une maison. L’embarcation tarde, le froid n’est pas supportable auprès de l’arroyo ; nous cherchons où nous chauffer.
L’intérieur est à peu près sombre, le feu rougeoie à peine ; comment donc se réchauffent-ils là-dedans ? Avec une mèche de poche, nous avons vu. Nous avons vu ceci : deux tas énormes, indéfinissable à l’abord, sont élevés face à face sur deux cadres de planches très larges ; des vêtements, des toisons apparaissent dont nous éventrons prudemment l’épaisseur ; et alors se découvrent deux pareils grouillements : sur chaque lit de bois, une femme, large comme le cadre, est étendue ; et sur elle, autour d’elle, sous elle, en travers d’elle, pour avoir chaud, sont serrés des mâles de tout âge, seulement pour avoir chaud, dans des positions de la plus diverse débauche.
Une odeur, définissable par celle de la volaille vidée jointe à une aigreur d’ancienne étable, couvre ou renforce le relent des chairs dégoûtantes… Et l’impression est semblable à celle d’un fumier retourné où surgirait un nid de couleuvres.
A Manille, à Tahiti, à San Francisco, les Chinois qui viennent s’établir sont accueillis par des huées et des pierres ; à coups de pied on les mène dans des bureaux d’immatriculation où ils laissent leur dignité d’homme et leur premier pécule. Puis ils disparaissent dans la foule toujours grossissante des travailleurs jaunes, dans un ghetto où ils vivront de rien pour économiser l’argent du cercueil qui les ramènera dans une plaine de tombeaux, quelque part autour de Canton.
Les femmes de ceux-là sont heureuses. Peut-être, les Chinoises richissimes exceptées, peut-être sont-elles les seules Chinoises vraiment femmes, vraiment capables d’un pouvoir sur l’homme. Les maris travaillent ; elles jouissent de repos gras et qui engendrent des coquetteries étudiées ; elles ont le temps de songer à l’adultère. Et les Tagals splendides de Manille, les nègres hercules de San Francisco font assez souvent avec elles des couples réels d’amant et maîtresse.
Le contraste est saisissant, lorsqu’on vient du Petchili, quand, la veille, on a quitté Takou, Takou où l’on mouille dans une eau de sable sans voir la terre. Takou dont les forts seuls se distinguent de la hune. Ici, à Port-Arthur, la baie s’ouvre comme un fjord entre deux pans de falaises ; puis, au delà, l’aridité reprend, plate ou bosselée, sans caprices de lignes.
Des troupes chinoises sont campées aux environs de la ville ; elles n’ont pas encore évacué cette Corée que la guerre laisse au Japon ; leur apparence est une apparence de force ; les réguliers tartares, coiffés en bonnets ronds, en loutre, moustachus, les sourcils broussailleux, la bouche énorme, rappellent les hommes d’Attila.
Aux angles du camp hexagonal, bruissent les tentes des femmes à soldats ; des ribaudes marchent avec ces reîtres, et les mots moyenâgeux correspondent bien à la forme de ces groupes. Le verbe haut, la danse prompte, l’ivresse continuelle, elles sont à tous ; nulle admiration de courage physique, de bravoure au combat, ne les décide au choix d’un amant. De l’amour, elles ne conservent que le goût de la douleur ; ce sont les harpies du meurtre, les prêtresses de supplices qui, sans exception, se rapportent à des atrocités sexuelles.
Le moins terrible d’entre eux, pour les hommes ennemis, est leur épouvantable caresse de la main prolongée plus loin que l’épuisement, plus loin que le jaillissement du sang, jusqu’à la mort.
Et c’est pour échapper à ces ribaudes que les blessés de la colonne Seymour acceptaient le coup de grâce donné par leurs camarades.
Il faut s’arrêter à cette place, qui n’est pas encore la Chine. Non que la transition, entre le paquebot et les cités immondes du Yang-Tsé, s’y marque dans une gradation d’accoutumance à l’horreur. Aussitôt voici le fossé : il faut le franchir, malgré que quelques coins odorent le cloaque.
Et Saïgon c’est aussi l’oasis merveilleusement variée entre des escales mornes ou inquiètes.
La Rivière y conduit, méandreuse, brusque, follement contorsionnée, comme si elle retardait le plus possible l’arrivée de joie, comme si elle défendait naturellement l’humus plein de tombeaux, autant que les enchevêtrements artificiels protègent partout, depuis le cap Saint-Jacques, vers le Nippon, le mystère des choses d’Asie. Le navire peine dans l’effort d’assortir continuellement sa rigidité aux dessins de la rive grasse, échappé aux bancs pour piquer l’étrave sur des bosquets chevelus d’où pleuvent les fourmis rouges. A droite et à gauche du sillon bruissant de la Rivière, la rizière fume. Et la rivière soudain brise et éparpille la certitude de son chemin en une multitude d’arroyos éventaillés. De nouveau il semble que cette traîtrise lutte pour le secret des choses vers lesquelles on va, tâche à égarer la conquête. Et, au bord de l’eau, les buffles qui rôdent, le muffle dans le vent, dociles pourtant au boy qui les parque, s’apprêtent à foncer sur l’étranger qu’ils hument.
Qu’est-ce donc que l’on voulait cacher ? Où donc le trésor qui demeure par-dessus les siècles, hostile au conquérant ? Cinq heures, l’après-midi : le « tour de l’Inspection » grouille ; le mouvement, malabars, phaétons, cycles des palanquins rares, le mouvement se diversifie et se renouvelle avant le crépuscule bref. Les phaétons sont les phaétons, attelés seulement d’une paire de chevaux nains, venus de Manille ; les malabars sont les « sapins ». Et la halte où l’on boit les apéritifs gigantesques, comme on y boira le lait, vers l’aube, se nomme le Pré Catelan. L’Inspection, le Bois ? On ne sait plus bien ; à côté, au flanc de la promenade, comme là-bas en France, un jardin botanique où des fauves en amour commencent à miauler. Maintenant la file des voitures est doublée, triplée même. Au pas l’on défile ou bien l’on frôle ; les petits chevaux, qui ne stoppent pas, encensent, parmi l’ondoiement de leurs crinières non rasées. Monocles sur presque toutes les faces ; smokings blancs, les revers de soie thé ou mauve ; blanches aussi toutes les robes, blanches surtout les robes sans tailles, les fourreaux des congaïs qui mènent leur charrette anglaise… Des landaus plus graves, désagrègent la terre rougeoyante : le général a passé ; le lieutenant-gouverneur passe…
La nuit s’abat avec la durée seule du tournoiement d’un oiseau monstrueux frappé à mort. Le bruit meurt, les voitures filent d’un seul élan… Pour les avoir suivies, on est à la lisière de l’Inspection, du Bois, et l’on voit : on voit que la bordure bruyante n’encercle que la plaine mystérieuse et vide. Tout près, si près de la ville franque, recommence le mamelonnage de la terre, crevée des cadavres en myriades… Le tour de l’Inspection bifurque à la Route des Tombeaux.
Mais, pour revenir s’asseoir aux terrasses, dans la rue Catinat, les beaux et les belles ont pris une autre route. A peine, comme tous les soirs, ont-ils près du pont de bois, sur l’arroyo, fixé les payottes, devant lesquelles s’accroupissent, autour du riz, des créatures aux dents laquées. Le faubourg étrange, bientôt disparu, importe peu. Quelle curiosité d’ailleurs intéresserait, aujourd’hui que le paquebot a débarqué la troupe théâtrale, engagée pour la nouvelle saison ?
L’enchère, depuis le midi, est haute déjà. Pour réussir des accords, des gens ont presque supprimé leur sieste, oui, vous avez bien entendu, la sieste. Et d’autres ont fumé une vingtaine de pipes d’opium en moins que la ration journalière, résignés à mâcher des boules, pour ne pas perdre le temps du marchandage. Autour de l’absinthe, qu’une bizarrerie du climat fait vraiment meilleure, aussi différente de l’absinthe d’Europe qu’un bordeaux de crû d’un vin au litre, les nouvelles s’échangent :
— L’avocat défenseur du boulevard Charner donne 1500 piastres par mois à la dugazon.
— La soprano a accepté les 1200 piastres que lui offrait le président du cercle.
— Il paraît que la chanteuse légère a un béguin parmi ses camarades ; elle ne le lâchera pas contre 2000 piastres.
— Je vous dis, moi, que le lieutenant-gouverneur s’est déjà entendu avec elle.
— A propos, combien vaut la piastre aujourd’hui.
— 2 fr. 69, mon cher.
— Parbleu ! »
La bienvenue de la troupe, c’est de jouer le soir même de son installation. Combien les soupers seront, après la représentation, plus fastueux encore qu’à l’ordinaire ! Les noctambules qui ne peuvent se payer une théâtreuse au titre de maîtresse, ou qui se sont trop tard présentés, afficheront à des tables voisines le luxe de leurs agapes, et signifieront de quel prix se paiera une passade furtive, entre la sieste et le tour de l’Inspection. Puis, le poker formidable, cette nuit s’enflera plus formidablement encore : qui sait si la veine d’une relance sur trois fulls et un carré ne permettra pas à quelqu’un de devancer, au matin, les messages du lieutenant-gouverneur à la chanteuse légère ?
En attendant de s’assembler autour des marquises au champagne ou des tables de jeu, il reste la distraction de visiter les « Moldos » du boulevard Charner. Leurs cabarets, qui seraient des bars à Singapour ou à Shang-Haï, sont éparpillés au long du terrain vague qui, plus tard, très tôt quand même, sera le « boulevard ». Moldos, le mot abrège celui de Moldo-Valaques, décrété jadis par on ne sait quel géographe officiel des mœurs. Tchèques ou juives, Roumaines courtes, Viennoises épaisses, et combien d’autres de toutes races uniformisées dans l’appellation slave, tziganes femelles de l’Extrême-Orient, elles roulent sans trêve et sans fatigue sur leur cycle inévitable : le Caire, puis Port-Saïd, puis Singapour, ensuite Saïgon, enfin Hanoï. Commerçantes apathiques, mais dont les gestes ne se départissent jamais d’une suite machinale, elles n’ouvrent leur lit qu’après les volets clos sur la salle d’en bas.
Alors, brisées par la journée que ne repose guère leur sieste intermittente, elles dorment comme un roulier, aussitôt sous, ou plutôt sur les draps. Et l’amant de passage qui veille, se résigne à leur inconsciente bonne volonté, surpris par l’automatisme de leurs gestes accoutumés, tel un enfant qui tette sans se réveiller…
Et le matin, quand on s’évade du lit moite, il faut chercher loin la douche, à l’hôtel ou dans la batterie du ponton-stationnaire. Quelle rancœur ! Quel subit et franc élan vers des chastetés lustrales ! On se méprise d’avoir payé la réclusion du paquebot par l’abandon précipité aux étreintes déjà connues, courtisanes de trottoirs, théâtreuses, Moldos. Le châtiment, qu’aggravera avant de l’effacer le jet implacable de la douche, solde le rut de France transporté ici, inharmonisé avec la terre d’Asie. Et, tandis qu’une nouvelle hâte grouille de se purifier en des chairs exotiques, tandis que se précise parmi l’ébrouement de l’eau, l’évidence du sacrilège nocturne, on ne pense pas que seul a dévasté le désir fort et l’ordinaire hygiène, seul le Soleil, sensible même parmi l’ombre de volupté, le Soleil qui maintenant, calme, balance ses semences de mort dans son vol de clartés…
Et l’on va vers Chôlen. Qu’a-t-on besoin des repos renouvelés qui permettent des minutes d’activité entre chacun d’eux ?… Partout la sieste pantèle, sieste d’après-midi après la sieste du matin, avant la sieste d’après le tour d’Inspection… Les jambes fermes, on saccade la promenade vers le bourg annamite ; on ne sait pas la raison de ces torpeurs qu’on méprise indulgemment. On saura trop tôt… Dans la lumière vide et sèche, les flamboyants ne peuvent odorer. Des champs engraissés monte l’haleine infecte des déjections.

Fumerie d’opium au Tonkin.
Enfin voici Chôlen, discret, Chôlen que l’on verra mouvant splendidement des cortèges du Dragon ; car, au premier jour d’escale, s’entassent, sous les tempes chaudes, le tas du devenir… A cette heure, sur les rues, les profils minces des cases en vis-à-vis ne se joignent même pas au milieu du sillon. Il n’y a qu’une plaque d’ombre, étroite, géométrique, où s’inscrit le relief d’une créature figée sur un escabeau ; des fumées d’opium, parfois, crépues et roulées, barbouillent cette plaque. Ou bien c’est un rideau, entre l’ombre et le réduit ombreux ; la femme annamite attend derrière ce vélum loqueteux, peut-être rien, ou seulement ce qui est venu.
Eux, ceux qui sont venus, reculent. Comment ces hideurs sont-elles sœurs des congaïs pimpantes, qui, dans leur sarreau blanc, mènent sur l’Inspection les charrettes anglaises ? Ce n’est pas possible ; non, vraiment, il est impossible d’imaginer le plus lointain des rapprochements avec cette femme, indifférente et muette pendant la délibération des étrangers ! Car les visiteurs n’ont vu et ne voient, ils ne verront toujours que la joue grimaçante dans l’effort du bétel chiqué, les dents mi-noircies, mi-rougeoyantes, offrant l’image d’une tête suppliciée dont on aurait retourné des lèvres, le jus mal essuyé qui balafre un coin de la joue.
D’ailleurs, en surmontant le dégoût, l’effort d’une sereine curiosité ne révèle pas, supprimée la tête, un corps de beauté. L’impression est reçue ineffaçable, dans cette première rencontre. Et l’on ne s’intéressera point, plus tard, aux confidences d’amis intrépides qui ont usé de femmes à Chôlen, dans la pleine obscurité pour ne les voir point, et qui affirment alors la science des rythmes éprouvée, et, pour la première fois peut-être dans une étreinte exotique, l’exception aux passivités insupportables…
Mais, sur la même route, au retour, dans le faubourg épars, tranché par les boulevards et les voies ferrées, s’offre une station encore d’épreuve, un port sans doute où s’abriter des Moldos… Ecoutez… n’est-ce pas ? Vous avez aussitôt reconnu le grêlement du chamicen ; la mélopée, qui, à la même heure, remplit les rues du Nippon, monte de tous les coins de ces maisons développées autour de Calnelages. Les syllabes de Ko-bi, Yoko-ha-ma se prolongent presque en pleurs retenus. Oh ! la bonne aubaine : tout près de nous, des Japonaises, des mousmés !
Hélas ! ces exilées du Nippon sont de pauvres et laides choses. Le caprice de quelques gros fonctionnaires autant que l’humeur vagabonde a transporté dans cette campagne empuantie d’ordures et pâmée aux relents de flamboyants, un coin du Kanagãwa, la débauche mièvre et multiple de Yokohama. La transplantation n’a pas réussi et les greffes sont impossibles. Ainsi songe-t-on, après une heure dans la chambrette, sans les nattes merveilleuses de là-bas, à Nagasaki et sans la nuit fraîche du fiord où s’ébattent les poupées de volupté. Et, déçu, abruti par cette exploration de l’exotisme de Saïgon, sous le soleil méchant, on regarde vers l’arroyo où les sampans se heurtent, remplis sans doute du grouillement qui parfait l’horreur, serrant autour de la résine qui pleure les faces au rictus du bétel.
Pendant l’entière durée de l’escale, la contrition est vaine qui veut revenir aux Européennes, d’en haut ou d’en bas sur l’échelle cochinchinoise, même aux Moldos. Car il y a des raisons que l’on n’a pas sues le premier jour. Les blanches, là-bas, n’ont guère de mérite à la résistance, si un désir réussit à les pâmer. Pauvres femmes d’Europe, loques malpropres et honteuses ! Elles portent la peine biblique, semble-t-il, de n’être point restées où elles naquirent pour leur rôle d’amantes, plus simplement pour la soumission à leur féminité. Une à une elles s’en vont, effondrées peut-être pour la vie, l’une après l’autre elles désapprennent de changer les camélias, et leur intimité n’est plus que la réclusion à perpétuité…
Il reste les congaïs, les femmes annamites, pimpantes, mièvres, musquées, dont le sarreau blanc jalonne l’Inspection. A quoi bon parler de celles-là : chair domestiquée par des conquérants, elles n’apprennent rien au passant puisque ses pareils leur ont tout appris. Leur nom pourtant complète la trilogie des symboles de l’exotisme : congaïs à côté des mousmés et des vahinés. Même ce nom, promené sur toutes les mers, demeure le plus généralement employé par ceux qui, à une terrasse de café, en France, diraient « une femme ». Et il y demeure vraiment une empreinte plus souveraine de possession, de « chose » qui appartient sans restriction, et, dans la légende de volupté, une signification de passivité prête à tous les sadismes.
Comment exprimer que la beauté de la race a été surtout donnée à leurs frères ? Il est malaisé de faire comprendre que les déracinés fiévreux de là-bas s’en aperçoivent trop, et de rappeler trop longuement que Saïgon est la patrie des boys. Il vaut mieux entendre conter au fumoir des histoires étranges, en lesquelles se transposent exactement les termes du langage éternel, passion, étreinte, jalousie, et il suffit de retenir que l’échange diffère de ceux pareils, nés de brutalités sahariennes ou de solitudes de steppes. Car là-bas, entre l’Inspection et la rizière, où rôdent les buffles, ce n’est pas à sa propre joie que songe l’Européen…
Voici, pour balayer cette effluve malsaine que s’enfle le souffle de mer, venu du cap Saint-Jacques. Il faut peser les hasards du chemin à cette escale. Car Saïgon n’est qu’un entr’acte entre l’anormal splendide de l’Inde et l’anormal immonde de la Chine.
CRÉOLES

Créole française de la Guyane.

Pour parler encore d’elles, il n’est pas trop tard. Le cyclone a enlevé les toits, la terre a remué pour écrouler les murs, l’incendie n’a même pas laissé les pierres des ruines. Quand même les maisons ont recommencé de s’élever devant les palmiers de la Savane, roucoulantes des rythmes zézayés. Et aujourd’hui que non seulement les toits, non seulement les murailles et leurs ruines ont été projetées par une trombe d’Apocalypse, aujourd’hui que la moitié des abeilles bruissantes ont été anéanties avec la plus belle des ruches, celles qui restent rebâtiront les demeures des mortes. Sans doute dans l’affolement du tourbillon, elles s’essaiment confusément ; il paraît que la panique les enlèvera toutes vers des villes, au Sud, envahies de lianes, haletantes sous un soleil blanc qui n’est plus le dispensateur bon des désirs, rafraîchi par l’averse des « lamentins ». Sans regarder derrière elles, elles bruissent dans la fuite, les abeilles éperdues et brûlées. Il semble que jamais plus ne raillera en s’attendrissant, entre les allées de Fort-de-France, la chanson de promesse et d’attente où s’ébat précisément la
Et déjà on croit entendre se gargariser dans l’Ile à prendre l’Ile qui n’est même pas à vendre, les « Chan songs » des yankees d’Alabama.
Eh bien ! la désespérance aura tort, et le feu du ciel n’aura pas dévasté à jamais les Antilles, plus que l’incendie, plus que les cyclones ou les tremblements de terre. Ce qui sera, recommencera ce qui a été, pour que ceci fut la joie. Et, nombrant les gestes rencontrés de noblesse, de tendresse et de caresse, on aura peut-être fait un peu pour renouveler à la tendresse des « Doudous » la confiance de vivre.
Si les mots vivent, eux aussi, si de la souffrance ou de la puissance s’écartèle au long de leurs syllabes, le mot qui là-bas signifie amant, le mot de « Doudou » renferme dans la simplicité de sa redondance le cycle des baisers espérés autant que des baisers perdus, le bégaiement de l’unisson extasié dans des larmes et la lamentation des vains appels. Mais la douceur infinie est trop vite devenue l’afféterie, et l’afféterie s’est prolongée en puérilité ridicule.
Mais les Doudous, ce sont les blanchisseuses presque noires du Fort-de-France, ce sont les marchandes d’ananas qui n’ont pas désarmé bien au delà de la cinquantaine, ce sont des quasi négresses tout en croupe et en seins, qui marchent en tendant le ventre. On les connaît tôt. Elles envahissent la frégate-école. Leur rôle est d’apporter l’agréable en même temps que l’utile, fournisseuses de leurs marchandises et de leur chair. La tradition d’année en année se perpétue. Et la tradition ne leur déplaît point. Car, pour le plus grand nombre, hors les exceptions de toute jeunesse, et d’avance éliminées les vieilles véritables, l’âge est indiscernable. Les aspirants, vierges la plupart, choisissent à l’aveuglette les Doudous maternelles, celles qui ont vu paraître déjà vingt fois les vergues de la frégate depuis leur puberté, se réjouissant des jeunes corps qu’elles combleront pendant la sieste. Le soir ne les en trouve pas plus lassées, près des bosquets, sur la Savane, lorsqu’elles s’attardent, au hasard des rencontres, sur les bancs.
Cependant les Doudous qui promènent ainsi leur madras, à l’abri de la lune, se différencient, heureusement pour les autres, des tendres blanchisseuses dont le repos du soir s’écoule avec l’amant sérieux, au seuil de la case. Les femmes de la Savane rappellent un peu trop les pierreuses, si l’on enlève au terme infâme son âpreté de misère et son frisson de crime. Et alors il reste les mêmes caresses sans unisson, payées aussi peu et prises aussi peu confortablement… Plus loin, au milieu de la place, blanchit la statue de l’Impératrice parmi les palmiers superbes, « orgueil de la nature à côté de l’orgueil de la femme », et dont la tête sert à faire « une bonne salade », comme expliquent tranquillement les livres-guides.
Errantes ou sédentaires, péripatéticiennes du square mal famé que demeure la Savane à certains moments ou bien travailleuses défatiguées par les jeux de la volupté, Florises Bonheur des tropiques, toutes les Doudous effarent, à la prime approche, le désir qui veut choisir. Car à parler franc, on attendait des chairs, sinon blanches, du moins agrémentées par le pigment sous lequel vaudraient mieux les lignes, et l’on trouve, sous sa caresse, des peaux noires. Oui, c’est méchant, c’est inexact que de dire « noires » ; nous nous mettrons d’accord, voulez-vous ? en les définissant « chocolat éclairci ». Malgré tout, malgré les différences essentielles dans le visage, la tentation est forte de qualifier dédaigneusement de négresses les amoureuses Doudous. Dépit d’un jour, de la première rencontre, car, avant deux nuits remplies, les récits mêmes des Doudous auront éclairé le passant sur l’abîme approfondi entre elles et les femmes noires.
Les filles de Béhanzin ont intéressé longtemps les potinières de la Savane. Elles suivirent jadis l’exil de leur royal père, séparées par quelques égards du harem, transportées avec lui jusqu’à la Martinique. Et leurs sens ne s’atrophièrent point dans la béatitude de la défaite. Or Béhanzin autant que le seul monarque, se trouvait le seul mâle de la horde. Il fit courtoisement comprendre les naturelles nécessités de ses filles ; le Seigneur Qui de droit ne s’opposa point à ce qu’une grande latitude d’approche fut concédée aux hommes de bonne volonté, quand les demoiselles s’ébattaient autour du fort.
Or les Doudous assurent qu’aucun ne s’avança. Le mépris de la chair nègre l’emporta sur la vanité d’avoir forniqué avec une princesse. A Madagascar jadis, et pour une fille beaucoup moins belle, un officier général pensa différemment. Bref, après des semaines d’attente, les filles de Béhanzin se découragèrent. Elles durent organiser quelques divertissements dans l’intimité de la famille, et enfin, depuis l’introduction jusqu’à la fin, recommencèrent l’épisode des filles de Loth.
D’ailleurs, après gorges chaudes sur cette vaine recherche d’un mâle, la Martinique ne songeait point à s’effaroucher ni à s’étonner des autres ébats entre les jeunes princesses. Et cette fois, dans le terme de la Martinique, il faut comprendre davantage que la catégorie des Doudous pour navires et passagers. Le saphisme naquit sans doute en d’autres îles que Lesbos. On peut ici l’observer, quelque paradoxe ce semble, avec la gravité d’un étymologiste en voyage de documentation.
Loin de considérer le fait comme un mal déplorable ! Les mères les plus franches, de causerie loyale et avertie par toute cette terre chaude, décrètent tranquillement la chose d’utilité publique. A sa pratique ne se mêle pas la grivoiserie vicieuse, plus que la honte ne se confondait avec la nudité de l’Anadyomène.
Même l’élégante explication d’art tomberait à faux, essayant d’apporter l’excuse qui proclame : « Tout ce que vous faites, vous, femmes, est délicieux. » La vérité est que la puberté des filles créoles se déchaîne plus irrésistible encore que celle de leurs sœurs continentales.
Alors, avec une belle audace, les mamans sans hypocrisie favorisent une solution qui préserve la race des vices solitaires, et surtout qui diffère la victoire sans garanties du mâle, le plus longtemps possible. Ainsi se créent des couples de « Z’Amies », comme ailleurs, comme partout, mais sur ce sol, encore un coup, sinon affichés, du moins aussi largement tolérés, dirigés que des fredaines de jeunes hommes, sans que des unes comme des autres il convienne de causer au salon.
Les résultats cherchés sont-ils acquis ? Ce serait fatuité et imprudence d’en discuter. Sans sourire on peut presque affirmer que l’effort est louable, et que toutes assument avec conviction la tâche de démentir le prêtre maladroit dont un sermon, assez récent, débuta par cet exorde. « Mes sœurs, nous célébrons aujourd’hui l’office de sainte Rose de Lima, vierge quoique créole ».
Le culte de la chasteté est célébré dans ces Antilles suivant les mêmes rites que le catholicisme ordonnance partout, indifférent aux latitudes. La terre est chaude, mais les chairs s’efforcent de ne s’harmoniser point avec elle. Les créoles ne sont ni blanches ni noires. Leurs désirs ne sont pas tout à fait primitifs, ni tout à fait civilisés. On est loin des îles voluptueuses du Pacifique, loin de l’abandon au spasme et à la lumière. Ainsi que par dessus le septentrion froid et cérébral, la Vierge aux lèvres scellées se dresse pour commander la voie à des théories d’adolescentes. Et celles-ci, soumises, se souviennent que la Maria divinement authentique, fut noire.
Par les allées, elles vont, côtoyant la Savane, enfants de Marie, dont le symbole de blancheur raille étrangement la chair chocolat. Deux par deux elles balancent leurs pas entre l’Eglise et la maison de sainteté, deux par deux, comme défilent les pensionnaires dans les villes de France. Impuissance des disciplines ! Voici que l’expérience des mamans avisées se confirme sur le troupeau des adolescentes enrégimentées ; voici que les chastes couples ne sont plus que des accouplements…
On secoue l’impression mauvaise, trop souvent heurtée. Les Doudous, les z’amies, blanchisseuses rebondies et adolescentes mûries, est-ce là le résumé de la volupté languide qu’on imaginerait ? Où donc trouver la chair mate de créole blanche, lassée des gestes de la vie banale, mais lassée parce que ses gestes, elle les a multipliés et splendidement dépensés dans la besogne d’amour ?
Des guides, éphèbes rabatteurs, vous proposent un chemin vers ces délices. Et aussitôt la défiance naît, plutôt que la joie d’une réussite, accrue par le mystère. Pourquoi en effet ces créoles rêvées restent-elles inapprochables ? Comment, si des gynécées imprévus les renferment, confient-elles à des négrillons le soin de leurs caprices ? En définitive elles sont Françaises, elles sont femmes libres de la civilisation…
Alors le débat s’engage entre la méfiance largement interrogative du passant et l’impudence de l’adolescent, le premier signifiant par gestes comiques et par répétition des mêmes mots sa ferme volonté de ne point retomber à l’aventure trop connue d’une mulâtresse, l’autre affirmant par sa pantomime et répétant « la femme blanche, tout blanche, ça o très bon femme pour France ». Enfin l’on va.
La déconvenue, chaque fois renouvelée, aurait tort de se retourner furieusement contre le guide. Il n’a pas menti, le plus souvent, c’est bien chez une blanche qu’il a conduit le promeneur. Quelle blanche ! Epave d’une troupe théâtrale qui jadis remplit une saison à la ville, un jadis très lointain, quand Mademoiselle déjà jouait les duègnes. Ou bien nourrice demeurée par débauche ou mollesse, dans l’île où elle accompagna une femme d’officier maintenant archi-galonné ; encore une ex-femme de chambre à bord d’un paquebot, débarquée pour s’établir ici, sans le souvenir gênant de l’âge canonique exigé par son premier métier. Malgré tout elle fait de bonnes affaires ; elle n’a plus d’âge, elle est blanche, cela suffit, suffit aux trois quarts chez lesquels s’enracine le goût pour la chair blanche, aussi vivace sans doute que chez leurs quasi-congénères d’Amérique, sans que ceux d’ici du moins aient seulement la ressource du viol payé par le lynchage.
L’énormité est unique, parmi la volupté mondiale, d’hommes d’une race convoitant jusqu’à la mort les femmes d’une race étrangère. Il semble que la malédiction des livres saints pèse sur la descendance de Cham. Le supplice est pitoyable, à bien y penser. Vues à travers l’orgueil européen, ces manifestations d’un désir irrésistible pourraient paraître flatteuses autant que naturelles. Alors, pour bien sentir l’étrange exception, que l’on se souvienne du Japon, où la fatuité des Latins, des Saxons, ou des Slaves, d’abord hautaine et railleuse vis-à-vis des mâles nippons, se déconcerte et tâtonne devant la placidité méprisante d’un sourire de mousmé.
Ainsi adulée par les nègres, mulâtres, comblée par eux dans son été de la Saint-Martin, l’ancienne duègne ou nourrice, ou chambrière de paquebot, s’étonne d’abord du recul marqué par le passant d’Europe, au seuil de la chambre où le conduisit un guide. Puis lentement, douloureusement aussi, elle comprend. Par bonheur, car la psychologie triste n’aurait ici rien à faire, la galanterie compatissante du Français a recouvert aussitôt la désillusion. La politesse le fait asseoir, au ravissement du guide. Pendant les dix minutes accordées à la vieille hétaïre, si l’échange ne se borne qu’à des paroles, du moins le globe-trotter aura retrouvé un peu de ce qu’il cherchait, un peu de l’atmosphère nationale, parmi laquelle s’ébat l’histoire de « celle qui fut la fille d’un officier supérieur et que séduisit un homme marié ».
Faut-il donc, las de ces piètres rencontres, renoncer à l’aventure de la créole blanche « ardente et belle » ? A peu près. La réponse en tout état de cause, serait plus formelle, appliquée au passant, à l’officier de marine, au globe-trotter, à tous ceux qui voyagent pour avoir voyagé, qui aiment pour avoir aimé. Les femmes des Antilles, car désormais (et nous reviendrons à cette solution) il faut distinguer entre elles et les femmes de Bourbon, avec l’amour de leur terre mêlent une forte conception de son honneur particulier.
Toutes, de toutes leurs volontés, rarement amollies par une passade, s’efforcent de détruire la facile légende de volupté accolée aux récits de là-bas. Il ne leur plaît point que la Martinique, les Saintes, la Guadeloupe s’assimilent à d’autres Tahitis. Parce que le climat y trahit, parce que l’air est chaud de tendresse et de caresses, parce que même les nécessités du vêtement en font souvent un appât au désir, les créoles luttent pour apporter l’oubli de ces prémices alliciants. Non qu’elle ne veuillent point se souvenir, elles-mêmes.
Aucune pruderie ne gêne leurs mots, ou leurs gestes de beauté, et ces corps, harmonisés avec l’ardeur de leur cadre, ne se dérobent point à leur destin d’étreintes précoces et multipliées. Mais, pour les posséder, il faut accepter avec eux le destin doux du sol qui les porte.
A quoi bon insister ? On aurait mauvaise grâce à reprocher à ces créoles désirées de ne vouloir point être confondues avec des filles de joie, et de se dérober au dénombrement des passades lointaines, suivant la litanie des escales et des ruts.
Ailleurs qu’à la Martinique et qu’à la Guadeloupe, d’autres raisons prévalent qui empêchent, pendant un court séjour, de documenter un avis sur la sincérité des apparences créoles, ailleurs, c’est-à-dire aux Saintes. Devant ces terres calmes, qu’un seul jour dans l’histoire bouleversa, lorsque luttaient à mort les escadres françaises et anglaises, sur ce sol alterné de bois et de sables, les uns et les autres tranquilles éternellement, la fierté de maintenir un dogme réfrénerait mal les élans voluptueux. Et le nom de l’archipel minuscule, les Saintes, n’est pas pour signifier un isolement consacré aux mortifications et hostile à la volupté. Pourtant l’île habitée nourrit un phalanstère, en vérité.
Les patriarches sont, pour la plupart, d’anciens révolutionnaires, non point ceux de la commune, mais des rêveurs plus antiques, expulsés de leur rêve au temps du « crime de décembre » ainsi qu’ils disent. De collinette à collinette, d’anse en anse, ils joignent, sur ce sol des Saintes leurs mains fraternelles pour s’unir dans la sérénité de leur repos, et pour former, contre un ennemi imaginaire, un cercle autour des progénitures étayées sur des générations quadruples. Et il se trouve comme un jeu classique, que les moutons, d’ailleurs faciles à compter, sont bien protégés du loup. D’ailleurs, l’idée passe vite d’aider ici l’élément à prendre sa revanche sur le dogme. On finit par s’attendrir, dans la compagnie des vieux, sur la grâce des filles qui se pressent à la fontaine et remontent, gracieuses, les sentes. Ils ne les voient point à travers leur chaude beauté. Ils ne comptent que par leur patronymie, avec les souvenirs qu’ils imaginent être de l’histoire.
Alors, sans savoir, on hoche la tête gravement quand ils disent, pointant une adolescente que furieusement l’on évoque pâmée dans un viol au coin des plus proches taillis : « C’est la nièce du fameux Combalot ».
Avec des vierges inquiètes des Saintes on n’entrelace ainsi que des idylles. Brèves soirées, plus cruelles sûrement pour elles que l’étreinte, soirées où l’on se joint, seulement pour parler d’amour et se baiser la bouche, à la lisière du cimetière, si joli entre les coudriers qui arrêtent la dune, et la route piquée de flox en myriades, le cimetière où n’apparaît pas le mamelonnement funèbre des tombes, où la place de ceux qui furent se garde, pareille pour tous, sans bousculade, étiquetée par deux valves de coquilles, telle une foule de papillons endormis parce que leur bruissement soyeux serait même de trop parmi le silence… Avec les vierges des Saintes on n’entrelace que des idylles cruelles…
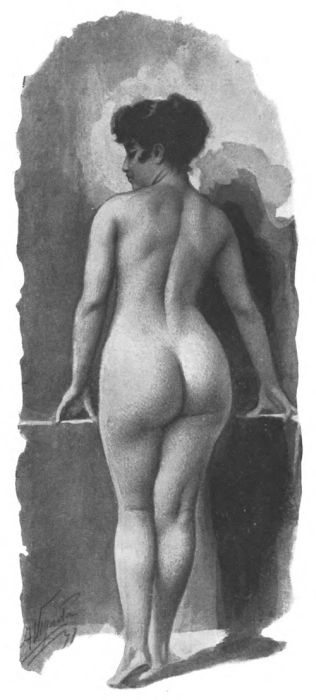
Mulâtresse.
Près du marché à Basse-Terre. Deux aspirants piétinent sur place ; ils ont fait mine d’aborder un mulâtre qui les fixe ; puis ils ne se décident plus. Alors, lui, venant à eux, amer et grandiloquent.
« Oui, je sais, Messieurs… vous cherchez des femmes, n’est-ce pas ?… Vous alliez vous informer près de moi des bons coins, près de moi qui « suis du pays ». Pardieu ! si j’en suis de ce beau pays, une perle de votre couronne coloniale, Messieurs. Est-ce que la France s’en occupe seulement ? Si la France se souciait de la colonie, alors, Messieurs, vous ne chercheriez pas honteusement bonne fortune, au hasard et sans conseils. Couronnées de fleurs, le sein gonflé d’émoi, les filles de cette terre vous attendraient à la descente des embarcations, et vous convieraient aussitôt à célébrer les mystères de l’amour !… La voix de l’homme s’attendrit, son geste officie :
« Tandis qu’à cette heure, reprend-il en criant, nous n’avons même pas de lupanar dans notre ville, pas de lupanar entendez-vous, Messieurs ? La métropole ne s’est pas préoccupée d’organiser un lupanar. Et négligemment, tandis qu’il s’éloigne :
« Du moins, accorde-t-il avec noblesse, quand vous désirerez quelque repos, voici la carte de ma sœur, je me porte garant de ses bons soins pour vous ».
Rencontre d’exception, mais qui valait d’être notée. Une autre rencontre, plus exceptionnelle encore, si étrange que l’on hésite à transcrire sa réalité, si irréelle qu’un moment après s’en être abstrait il semblait déjà s’être échappé d’une extase opiacée, aussi merveilleuse, aussi sensuellement attestée que logiquement bâtie. Et voici la vision, quelle elle soit, exacte comme elle fut dans sa matérialité.
Il convient que le détail s’en déroule brièvement, aussi soudain qu’il fulgure, à son évocation, dans la mémoire de ceux que sa lueur traversa une seconde, malgré que cette seconde emplit une fin d’après-midi.
Ceux-là, ceux qui ont peur de se souvenir et qui pourtant sont certains que la chose fut, ceux-là avaient erré depuis le matin dans les grands bois, au-dessus de Basse-Terre, entre les fraîcheurs touffues du Matouba et les cirques velus, successifs, jusqu’à la Soufrière. Au moment où l’eau des bassins, remplis par les cascades, cesse de s’attiédir sous la chaleur du soleil déclive, ils se baignèrent. Or, comme ils levaient les yeux, secoué le premier ébrouement lustral, ils virent une oréade, une nymphe nue comme eux, comme eux, livrant son corps au courant rafraîchi. Elle s’ébattait au-dessus d’eux, dans une vasque qui surplombait, sur la pente naturelle du torrent, leur piscine. Et, parmi ce cadre d’eau et de bois, parmi cette sérénité où des loisirs d’Olympiens se seraient harmonisés avec toutes les légendes, les deux globe-trotters ne s’étonnèrent point de l’apparition. Il fallut, pour que la stupeur comblât brusquement leurs esprits, que la fuite de l’oréade les persuadât qu’une femme d’admirable beauté s’échappait devant eux guidant leur poursuite par son rire, alors, habillés en hâte, appelés par la voix de raillerie, ils la suivirent, haletants, au travers des halliers.
Le crépuscule tomba avec le silence. Mais, si le rire ne guidait plus les chasseurs, il les avait menés au sentier net, frayé, sans doute, vers un mystérieux séjour. C’est ainsi qu’ils entrèrent, précédés par les aboiements d’une meute, dans la maison où deux femmes les reçurent, comme attendus. Pourtant, dans la silhouette de la plus jeune, rien ne rappelait aux deux hommes la nymphe poursuivie. Comment eussent-ils pu se rappeler, pour les comparer ici, des lignes et des carnations ? Les hôtesses se trouvaient vêtues en dames du grand siècle, sans mascarade aucune, sans le moindre geste d’emprunt, et les étrangers, abasourdis, comprirent cependant que « certainement », ces deux femmes, qui se révélaient d’ailleurs mère et fille, n’avaient jamais revêtu d’autres vêtements. Elles ne questionnaient pas leurs visiteurs, la conversation se déroula comme un questionnaire d’histoire, uniquement rapporté au grand Roi. L’heure marcha jusqu’à une heure pareille en 1650. Les globe-trotters sans conscience désormais, s’émerveillèrent de savoir que l’admirable vierge, paisible devant eux, se trouvait petite cousine de Mlle d’Aubigné née sur cette terre, et, le plus sérieusement, ils s’accordèrent le don divin de prescience pour avoir aussitôt senti que Mlle d’Aubigné s’appellerait plus tard Mme de Maintenon.
Quand cessa l’envoûtement, lorsque leur pensée effroyablement tendue se détendit, les visiteurs avaient quand même devant eux les deux femmes à falbalas, mère et fille presque appareillées par la splendeur de chair. Et il ne demeura pour les hommes, dans l’incompréhensible fantasmagorie, que leur rut formidable, dans cet isolement, vers les étreintes qui leur semblaient préparées. Mais la vierge impassible arrêta d’un seul geste un élan, et, comme l’étranger repoussé, hagard et furieux, la suppliait avec des mots fous autant que le moment lui rappelant le bain, la nudité, la fuite par les bois. « Oui, dit-elle, calme, c’était moi ».
— Mais pourquoi nous avoir attirés ? nous n’avons rien à faire avec vous.
Elle reprit :
« Si, à désirer ma beauté ».
Et, désignant aux deux hommes sa mère qui resplendissait comme sa sœur, « d’ailleurs, termina-t-elle, ma mère comblera vos désirs à tous deux ».
Or, la chose se passa comme la vierge créole qui vivait le temps de sa cousine d’Aubigné, l’avait commandé.
Hors une semblable folie, une hallucination des gloires de femmes dans le passé créole, un même sentiment de fierté traditionnelle perce chez tous les êtres de là-bas qui savent mieux la légende de Joséphine que la légende de l’Aigle. Ce sentiment, c’est la forme la plus habituelle de la « Grandesse », grandesse qui fait aussi bien l’espoir des adolescentes aux songes impériaux que la bravoure physique et indiscutable des jeunes hommes ; grandesse qui avait d’instinct la culture de la beauté du geste, avant d’en entendre formuler le dogme. La statue de l’Impératrice Joséphine, blanche, dressée sur la savane de Fort-de-France, plane en réalité sur toutes les Antilles. En elle s’est résumée, pour ses compatriotes, l’apothéose de la femme et, facilement, avec une candide sincérité, ils déduisent de cette élection providentielle la preuve d’une royauté des corps créoles sur tous les corps de femme au monde.
Malgré tout, cette conviction et cette fierté demeurent au tréfonds des âmes. Apparente et affirmée cette foi deviendrait insupportable. Pleines de tact, les créoles, les vraies créoles blanches le sentent, et leurs hymnes ne sont plus que des chansons où le charme des rythmes correspond bien à une sorte d’urbanité qui traduit en musique, pour ne blesser aucun étranger, un amour vraiment fier et profond du sol où s’unissent l’instinct de la volupté première et des variantes psychologiques qui le raffinent, empruntés à la France maternelle et vieillie.
Le caractère des chansons créoles est mal exprimé d’ailleurs lorsqu’on veut n’en vanter que le rythme. A l’encontre des refrains traditionnels qui, partout dans le monde exotique halètent l’étreinte par des répétitions de sons et d’onomatopées pressantes, les morceaux, chaque jour nés sur les Savanes, valent par leur sens et leur humour. La malice, la plaisanterie gaie, le trait juste d’observation, y ressortent à chaque ligne. Si ces caractéristiques définissent peu son mode voluptueux il ne faut pas oublier le désir qui palpite en raillant, s’affirme avec plus de force et plus de spasme, quand il s’angoisse jusqu’à la gravité. Ici encore l’apparence tromperait ; et l’on serait cruellement ridicule d’apprécier en badinage et en passe-temps l’amour physique des créoles.
Sans doute plusieurs d’entre elles demandent beaucoup à l’amour et lui donnent peu. La plainte charmante des Doudous abandonnées, les tendres lamentations pareilles à celles que débite la fameuse cantilène des Aspirants, mettent une sourdine de lamento dans un cadre de joliesse. Mais ce n’est point là l’expression adéquate à l’unisson créole, aussi souvent réalisé qu’ailleurs. Malgré le sophisme, en dépit de la fierté traditionnellement raidie sous le masque d’accordailles sans importance, l’étreinte à mourir s’étire, prête à enlacer sans désunion possible.
Une preuve presque toujours retrouvée, marque la violence des ardeurs par leur simplicité. La débauche, à prendre le mot dans la plus compréhensible de ses acceptions, est à peu près ignorée. Alors que les pratiques du saphisme encore sembleraient engendrer le plaisir multiforme, et vite lassé, il arrive que les créoles, après avoir donné leur virginité, demeurent simplement des amoureuses plus que des passionnées. Peu leur importe les complications de l’étreinte. Le désir fond sur leurs chairs de volupté comme l’épervier sur l’alouette. Elles s’étonneraient de souhaiter autre chose que la plus pleine et la plus rationnelle de ses réalisations. Bref, s’il est permis de former un avis définitif, avis que sa défiance même peut infirmer dès l’abord, on peut dire qu’un nom souvent employé, serait bien spécialisé aux véritables créoles blanches « L’eau qui dort ».
Et cela est meilleur, nul doute, que la comédie des déhanchements et des castagnettes, plus souhaitable que le mensonge des filles aux lèvres rouges, contentes de la moindre passade, où l’amant ne sait même pas quelle part exacte elles prennent.

FEMMES DE MADAGASCAR

Femme Misti. Quarteronne. Mulâtresse.
Capresse.
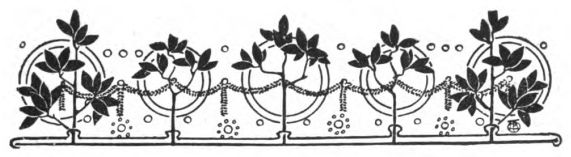
La première femme, après celles du paquebot, quand la longue escale du navire nous apprend des habitudes, c’est une créole de Bourbon. Elles sont, par toute l’île, les filles de « Port-Louis », les marchandes d’une denrée rare, marchandes sans prévoyance du reste, toujours pauvres, cigales trop endormies seulement pour chanter. L’effort pour elles est, un jour, de venir sur un pont de bateau. Elles ne le recommencent pas. Même ici, à Diégo, elles vivent et meurent cabaretières ou blanchisseuses, ou simplement hétaïres discrètes, qu’on ne voit pas souvent dans Antsirane, dont on ne connaît les cases qu’après des promenades d’impatiente recherche, après l’indication très vague donnée par les nouveaux amis, qui s’étonnent, tous unis à des Betsimisarakas, de votre préférence européenne. Surtout c’est presque encore la chair blanche. Et Hermine Baluzet explique davantage pourquoi les nouveaux venus lui fourniront des amis, chaque fois : « Tu sais, mon ché, ma peau est comme celle de tes doudous là-bas ; mais surtout mes caresses sont blanches. » Elle sourit, malicieuse, puis, sérieuse, continue des comparaisons graves et impudiques… On est dans une chambre où les murs sont plaqués de chromos sacrés, le lit a des rideaux et il y a la machine à coudre. Dehors, de l’eau tombe continuellement d’un robinet sur une dalle, fraîcheur inusitée sous le soleil de deux heures ; la rumeur d’une école, de l’autre côté de la cour, s’enfle avec la brise de mer. Hermine Baluzet, un moment m’intéresse à sa « tite fa-mille ». — A cette école, tout près, elle a plusieurs enfants, et, comme je m’étonne : « Oh ! tu sais, mon ché, dit-elle, c’est si souvent embêtant de se lever après avoir fait l’amour ! » Elle zézaie horriblement ; elle est créole ; elle est Port-Louis. Et en dépit de cela, accablé déjà par l’idée fixe sous la chaleur de Diégo, je songe au Directoire, et la petite âme bête d’Hermine Baluzet s’introduit de force dans un corps ridiculement gracile de merveilleuse. Puis je veux savoir son idée sur les indigènes, sur les Betsimisarakas. Alors indulgente : « Mon ché, elles sont gentilles quand on fait des zamies ! » — Oh ! comme ce z révélateur m’empêche d’insister ! Comme pourtant j’ai envie de me documenter sur le saphisme d’ici ! Mais décidemment Hermine Baluzet est lasse de causer, et les rares minutes de l’après-midi où je rêve un peu, je me complais dans l’idée de son nom, si délicieusement bourgeois avec une pointe de grandesse coloniale, avant l’inconnu de toutes les Tombou et toutes les Samba de l’île.
La première noire. — Un ami me l’a prêtée, pour voir. Il est navré que je réserve mon avis. J’ai retenu que Saboutsi racontait des histoires de fées et de revenants malgaches. Et aussi, du côté de la montagne d’Ambre, elle a des parents qui possèdent pas mal de bœufs. L’ami part fréquemment en excursion avec elle de ces côtés-là. — Saboutsi porte le carnier et les provisions. Avec la famille, les nuits, on chasse le sanglier en battue, et la bête, dirigée par une meute dont un seul chien est dressé, défile devant l’un des chasseurs, et lui la traverse de sa sagaie à trente mètres. « Oui, oui, mon cher, mais votre femme Saboutsi, parlez-m’en un peu ? le soir et le matin, qu’est-elle ? Pareille ou différente ? » L’ami me regarde railleur. Je suis pris : il sait trop que je veux toujours voir pour avoir vu et il me répond froidement : « Pareille ; les moustiques ne la gênent pas. »
A la halte du soir, les Sénégalais ont fini de préparer le pacage des bêtes. Ils ont porté le bois et l’eau. Silencieusement gais, ils regardent leurs femmes autour des feux. On leur a donné, selon la coutume, des femmes malgaches. Entre eux ils ne se comprennent pas ; de langue et de gestes différents. Mais ils sont aux petits soins pour elles, des choses de bonté et de tendresse s’agitent dans leurs cerveaux. Ils savent apporter le fruit, même la fleur qui fait plaisir. Ils admirent leurs compagnes de la saison dans leur attitude de repos et d’occupations ménagères, et leur bouche distendue bée devant l’intimité permise, tandis que leurs yeux cherchent par instants les yeux des camarades voisins heureux de la même joie. Elles, Sakalaves, ou Betsimisarakas, se composent une dignité et, loin des servitudes dans leur race, elles comprennent ce très vague respect des mâles, en sentant naître des caprices. Seulement la nuit, sous le rut trop rapide des soldats, elles regretteront l’étreinte continue des Anjouanais.
Pour les gens de Nossi-Bé, la Grande-Terre signifie le rivage de Madagascar, en face d’Herville et tout proche. Des bandes de partisans malgaches, les Marovyels, ont soudain brûlé et tué. La colonne formée de marins et de Sénégalais, campe au centre du pays dévasté. Et l’on raconte tout bas que les Sakalaves auraient longtemps encore accepté l’impôt et les prestations, mais qu’ils ont vengé la petite princesse, la Pandjaka, que le commis d’administration voulait prendre après l’avoir séquestrée. Toujours la même histoire ; toujours des vaincus lassés de résignation quand il s’agit de défendre les femelles. On dit aussi : « Le commis, potentat au petit pied, avait une maîtresse emmenée de Nossi-Bé ; jalouse de la Pandjaka, elle a prévenu les Marovyels, elle a présidé à l’émasculation et à la torture de Montin, de son amant ».
Justement voici qu’on amène la femme, des matelots l’ont trouvée dans la brousse à quelques pas du camp. Et le lieutenant l’interroge : « Sais-tu quelque chose ? Comment Montin est-il mort ? Ont-ils brûlé beaucoup de propriétés ? Par où s’est enfuie la bande ? » D’abord elle répond en malgache, puis, confiante, elle compose des phrases en français, simples d’idées et claires de sens. Elle ne sait rien, le soir terrible, elle s’est sauvée quand les brigands ont enfoncé la porte. Elle a erré, maintenant elle est lasse et a faim…
Très tard, quand le lieutenant a fini sa ronde, vérifié les sentinelles, il revient pour dormir quelques heures dans le grand hangar fermé de toiles où il couche au milieu des hommes. Sur une estrade on lui a dressé son lit de campagne et des étoffes de lamba le gardent bien clos. Quand il a soulevé ce rideau, il est tout contre Alimou, étendue sur sa couchette. Comment est-elle là ? L’officier, furieux, va crier. Mais deux yeux qui ne cillent pas, des yeux simples de supplication intense, le fascinent. Et, tandis qu’il hésite, la Sakalave a déjà allongé le bras et, sans le quitter du regard, sans bouger autrement son corps, elle a fait le geste de la caresse souveraine. Elle est nue. Dans l’ombre, ses anneaux d’oreille, grands cercles de cuivre, brillent. Maintenant qu’elle ondule lentement, ses cheveux en touffes énormes, où s’agglomèrent les coques pressées, froissent le drap, avec un bruit doux de jupon qu’on enlève. Son quintuple collier de corail bleui bat la pointe de ses seins. Et tandis qu’elle épand son odeur forte, adoucissant en désir la supplication de ses yeux, elle laisse deviner dans l’ombre le bas de son corps prêt pour la caresse que les blancs lui ont apprise…
A l’aube, Alimou songeuse, secoue l’officier, qui dort : « Va veiller, dit-elle ; puisque tu es mon mari, je ne veux plus de mal à Montin. »
Binaô, souveraine d’Ankify, vassale fidèle du général-gouverneur, a prié que le croiseur, actuellement au repos de Nossi-Bé, la vînt chercher, ainsi que toute sa cour. Elle désire vivement passer à Hellville les fêtes du jour de lan. L’état-major du navire s’inquiète du solennel protocole, mal averti de l’entourage de la reine. Surtout la question est débattue de savoir qui des officiers ira diriger l’embarquement de la maison royale. Car Binaô, dont les suivantes assurent de douces récompenses à cette corvée de direction, Binaô, à cinquante ans passés, ne cède à personne l’honneur de compléter, la première, son hospitalité plénière.
Et la cour embarque, et la pandjaka a vraiment grand air au milieu du caquetage discret des petites filles qui se relaient à son service immédiat. Même elle a donné les ordres les plus sévères pour que la majesté du croiseur ne soit point troublée par de rapides passades. Sous son œil infaillible, le troupeau se parque, rieur, défiant aussi bien des matelots que des officiers.
Trois heures sont nécessaires pour venir d’Ankify au mouillage de Hellville, trois heures en outre jusqu’à la nuit close où sous les manguiers, les cases étant trop peu nombreuses devant l’irruption des passagères amoureuses, commencera la saturnale de la nouvelle année. Alors, dociles, les petites suivantes clignent quand même de l’œil vers le personnel du croiseur, et s’étonnent des indignations qui accueillent les gestes naïvement cyniques par lesquels elles conseillent de remédier à l’attente insupportable.
C’est un pays d’Islam, c’est la race, solidement perpétuée, qui peuple lentement Madagascar et qui demeurera, disparus les Houves, fondus les Sakalaves, partis peut-être même les Francs.
Des femmes voilées passent ; des gandourahs blanches se confondent avec la blancheur des murs, et la tache des chéchias pique les profils d’une cité en Kasbah. Des ânes, des porteurs d’eau, des traînées de pas comme de lents pèlerins vers la Mecque. Et le cheik vénéré, le maître, autant qu’il lui plut, de cette île, fut le Français Humblot, Humblot qui vécut l’aventure d’avoir un royaume pour lui seul, et un jour de l’offrir à son ancienne patrie. Maintenant il vit sur la montagne, au creux de vallées qu’emplissent des nuages d’eau, vallées où la flore merveilleuse réunit tous les spécimens connus au monde et en invente de nouveaux.
En bas, dans la ville, les femmes passent muettes, voilées. Mais, musulmanes, ce sont plus les habitantes des harems inviolables. Apres au gain, elles se donnent la nuit ; plus âpres encore, leurs maris ou leurs pères les prostituent.
Le carré de leur front, l’ovale de leur visage est déliné par le sillon blanc d’une poudre de riz mêlée de colle. Du moins leur chair patinée et ferme l’emporte de beaucoup sur l’épiderme gras des Betsimisarakas. On a tort, disant qu’elles se donnent ; elles se prêtent à peine, horrifiées par la souillure du chrétien, jusqu’à en repousser brutalement l’intimité suprême.
« Le Bâl est roi de l’heure et l’heure est longue à vivre. » De la lumière qui fait mal et du sable entre Majunga et Mabib, le village indigène. D’un côté la mer, grasse d’alluvions, et, par delà le chenal, le rougeoiement des falaises d’Ankaramy sous leur toison verte ; de l’autre côté, le bois surchauffé qui exhale de la pourriture. On va, par un sentier où les pas ont tassé le sable, rigole abaissée qui partage l’étendue de la plaine miroitante. Mais le désert montre tôt sa borne ; l’humus ferme se relève et s’accote à une première ligne de manguiers géants, à travers lesquels pointent les cases de Mabib.
Dans le village logent la plupart des bourjanes. A ce moment en particulier ils sont nombreux, car le général-gouverneur est descendu de Tananarive à la mer. Ce sont les parias de l’île, la race inférieure, vouée aux fardeaux. Et sans doute ils répugnent un peu à l’œil. Plus de nudité aux lignes splendides, une couverture en haillons rejetée sur l’épaule les vêt ; ils se couvrent la tête des restes détressés d’un chapeau de paille. Et leur barbe, échevelée par places, enlevée à d’autres places, ajoute à leur hideur de malades mystérieux. Malades, ils le sont, mais leurs femmes et leurs filles sont belles entre toutes les Malgaches. Leur race est sœur des races polynésiennes ; comme elles, elle a gardé dans son sang le fléau que les mères de marins bretons nomment discrètement « la maladie des colonies » et comme elles, elle continue de produire des filles aux traits charmants et aux chevelures admirables, des chevelures adorées après le supplice des toisons crépues à fouiller.
Et nous allons chercher une de ces Hovas, une Houve, comme on dit ici. Le docteur du bord s’est complètement informé et nous a rassurés. Pas tous cependant, quelques-uns ne surmontent pas l’effroi classique à cause du nom prononcé. Mais les autres sont curieux d’une autre chair que celles des Sakalaves ordinaires, curieux aussi du village que les Sénégalais ont failli saccager l’autre jour. Une de leurs femmes s’était enfuie du quartier des casernes à Majunga ; réveillés par le mari malheureux, ils ont pris leurs armes et sont venus donner l’assaut aux cases de Mabib. Il y a eu du sang et les femmes Houves se réjouissaient en secret.
La case est ignoble où l’on nous fait entrer, surtout basse à étouffer, Et, parce que l’attente se prolonge, des autres il ne reste plus qu’un enthousiaste… Quand il nous rejoint, il nous dit tous les détails, mais nous retenons qu’il a revécu une sensation d’Océanie. Il a retrouvé dans ce corps de Houve toutes les souplesses inconnues sur la terre malgache de la côte, les abandons et les refus qui font si diverse l’aimée passagère, la science des baisers qui touchent à peine, l’ardeur des vahinés de Tahiti et des Marquises. Il conte encore l’enfantillage gracieux des mouvements, la brusquerie des attitudes, l’élégance complète du geste d’amour, Puis, comme il se perd en de comiques évocations, quelqu’un essaye de définir, ironique, en disant : « la femme-bilboquet, n’est-ce pas ? »
Mais le temps de rire, ceux qui ne restent pas songent qu’ils reviendront demain.
Nossi-Bé, l’autre Tahiti. Petite île, comme l’île délicieuse ; comme elle, terre chaude d’amour. Mais ici il faut s’étonner d’abord que ces douceurs de rêve puissent germer ; il faut dire avec des mots prudents très francs aussi, quelle distance sépare les amantes polynésiennes des sakalaves ; il faut pardonner aux officiers de marine, pour avoir connu l’Eden du Pacifique, de l’avoir rebâti à Nossi-Bé avec la tendresse du sol et la docile illusion des filles très nombreuses, avec aussi le contentement facile de désirs très jeunes. Et alors, la mauvaise part faite, revient à tous l’âme amie des nuits australes… Depuis la jetée, on marche sous la voûte des manguiers ; les mangues mûres tombent, coupant la faible voix des jets d’eau invisibles ; ou bien un « jack » détaché de la branche qui s’ébroue ensuite dans l’ombre, roule en tonnerre sur le zinc d’une toiture de case.
Des voix parlent un moment, des noms se répondent, piquant des roucoulements de rires, étouffés ou lointains. Puis dans le silence repris, le jet d’eau balbutie, mal remis d’une peur, semble-t-il.
L’île dressée, laineuse de verdure, sous la seule clarté stellaire apporte le mensonge de son fantôme à toucher la hauteur d’Hellville ; la baie, en bas, s’oublie dans l’union des deux terres. Et parmi la fragrance de vanille qui traverse d’un relent de spasme l’effluve continu des flamboyants, on marche plus vite, sans le savoir, vers les femmes dont la peau sent fort.
Leurs noms ? D’abord toute la dynastie des Tombou-Tombou-Safy, Tombou-Helli, Tombou-Lava ; puis Tani-Kelli, Saniwa, Anngui ; encore des noms français, Victoire, Marie, Rose ; tous de nuance claire ou de pensée légère.
Comment elles se déshabillent ? Oh ! les étoffes drapées, les lambas, ne donnent chacun en tombant que la sensation de la chère chemise de France, et rien de l’autre linge compliqué de France ne permet l’attardement et les délices successifs. Seulement parfois des colliers à plusieurs rangs s’embrouillent, et l’on aide, femme de chambre méchante, à prolonger l’impatience de l’amie…
Si elles vous aiment ? Si on en est sûr ? Mon Dieu ! comment dire cela à d’ironiques amants ? Comment ne pas mériter, restant sincère, leur pitié étonnée ? Tant pis ! Non, on n’est jamais sûr, et ce sera crié très haut. On ajoutera, bien bas, qu’elles ont appris des gestes pour qu’aucun ne serve seul à une heure meilleure ; plus bas encore, que dans une monstrueuse hypocrisie, candide quand même, elles veulent ne point terminer leur toilette d’avant, pour permettre l’illusion…
D’ailleurs, elles croient plaire davantage dans leur effort d’intellectuelles que dans leur simplicité d’amoureuses. Oui, d’intellectuelles, elles ne savent pas le français tout uniment. Marie Rose lit des romans de George Sand et, après avoir fermé Indiana, elle dit très sérieuse à son ami… : « Mon ami, si j’en juge par ce livre, tes femmes de France sont de vraies p… » Heureusement d’autres que Marie Rose ignorent George Sand. Celles-ci se contentent d’apprendre des chansons obscènes de lycée ou de caserne ; et les unes et les autres adorent la limonade très sucrée.
Sur toutes règne Charlotte ; Charlotte, qui habite au faubourg d’Andouane, est la proxénète-reine. Elle a des troupeaux. Le général-gouverneur lui accorde une concession à la Grande-Terre et elle viendra voir l’Exposition. C’est une camarade et une maman. Elle passe des matinées à bord. L’après-midi on reste à causer chez elle à Andouane, et l’on s’intéresse à ses nièces, mignonnes impubères, dont la virginité est promise à de longues échéances. Il y a aussi chez Charlotte, des cousins et des neveux, assez nécessaires depuis un certain 14 Juillet où elle se trouva trop seule devant les matelots en bordée.
Une chose marque d’originalité les amours d’Hellville ou ceux de l’île entière. De ces passades aussi bien que des unions plus longues qui retiennent en ménage une Sakalave et un officier, il reste presque toujours des traces ; les femmes souhaitent que le moment se prolonge, que l’amour devienne amitié.
Alors très souvent l’amant et l’amante se font « frère et sœur de sang ». Une cérémonie consacre l’échange. On s’attendrit un peu ce jour-là dans un cadre familial et l’on se fâche contre les sceptiques qui assurent que la solennité sert simplement à procurer aux petites femmes une orgie de limonade. Au reste, en dehors de cette manifestation sacrée, la langue de Nossi-Bé exprime d’un seul mot l’idée de si douce chimère, hélas ! aux blancs, de : « celui qui a été l’amant d’une femme et qui est resté son ami ».
Si les abandons des femmes Sakalaves ne se donnent que rarement aux Européens, ils se donnent presque aussi rarement aux mâles de leur race.
Mystérieuse, intelligente, méprisante, solide, une autre race existe dont les hommes sont là-bas les amants ardemment désirés : ce sont les Anjouanais, Arabes de sang presque pur. Effacés devant l’Européen, heureux seulement de le tromper en affaires, ils dressent leur souvenir irritant parmi les nuits. Et s’ils voulaient, ils veulent d’ailleurs parfois, ils organiseraient sur la terre malgache un syndicat d’alphonses souverains et chéris… Pourquoi ? Ils sont beaux, mais d’autres charmes les imposent aux femmes Sakalaves ; on pourrait presque dire des philtres. Outre leur virilité remarquable, ils ont gardé le secret des aphrodisiaques. L’ont-ils reçu de l’Orient passé ? Peut-être. Ils vivent en tout cas pour le spasme. Sous les allées d’Hellville des adolescents avec du sable émeuvent par avance la sensibilité de leurs muqueuses.
Le spectacle est comique, en passant, tout à fait en passant. Il est artificiel aussi ; cependant il s’est glissé au milieu des choses non oubliées.
Le résident s’est composé un harem de petites Houves. Elles s’habillent à l’européenne, et elles valsent. Vraiment, le premier étonnement envolé d’une tête noire sur des corsages bleus ou roses, elles ne sont point grotesques. Le bal devient charmant, la fin de nuit est exquise, remplie du déshabillage si rare et de la science d’amour des petites filles aux belles chevelures.
Quelle désolation que cette baie qui pourtant enferme le plus de passé ! Un fort d’avant Richelieu encombre la falaise ; des collines se bousculent et au lointain s’estompent de tristesse au-dessus de lacs sans vie. La houle énorme et continuelle envahit le cirque trop étroit ; une plage de sable coupée d’épaves, garde des attitudes de long squelette blanchi où se reposent des corbeaux.
Et des matelots ont vécu là un mois, après le naufrage d’un navire de guerre. La terre, une fois de plus, peu habituelle, leur a soufflé des idées de sang et de viol. Et une nuit ils ont brisé les clôtures du campement, ils ont forcé les cases éparses des indigènes ; ils ont forcé des femmes, non pas des filles complaisantes, comme celles d’Hellville ou de Majunga, mais des femmes farouches qui les mordaient ou déchiraient leur sexe. Et l’antique histoire des races étrangères, condamnées à fournir toujours des vainqueurs et des vaincus, s’est revécue une fois près de flots lourds qui ne sont plus les vagues des tropiques, qui sont les houles mystérieuses de l’océan du Sud.
Des blanches, des Sakalaves, des Houves, des créoles, même des Japonaises. Mais comme le fait remarquer un fonctionnaire honoraire d’une fonction honorifique : « la Japonaise, comme l’anti-cléricalisme, n’est pas un objet d’exportation ».
C’est vrai. Alors il reste des chairs trop connues. Il reste autre chose, la blanche ignorée depuis un an, et qui vous refait un peu l’Aventure.
Il faut bien en parler, puisque le quartier chaud de la capitale très vite devient un Yoshivara, que les mousmés y prennent un monopole que leur disputent mal les Sakalaves et dont se désintéressent les créoles. Et depuis des siècles, des dizaines de siècles, elles continuent le métier d’apporter leur chair par le monde, devançant les Colomb et les Cook, rencontrées partout avant que l’on sût la place de l’Empire du Soleil, semées dans la Carthage de Flaubert et l’Alexandrie de Louÿs. « Il en venait de plus loin encore : des êtres menus et lents, dont personne ne savait la langue… leurs yeux s’allongeaient vers les tempes… Elles connaissaient les mouvements de l’amour, mais refusaient le baiser sur la bouche… Entre deux unions passagères, on les voyait jouer entre elles, assises sur leurs petits pieds et s’amuser puérilement. »
Etrangeté ! elles paraissent plus faites pour cette grosse île éloignée du Nippon, que pour d’autres transplantations, celle de Saïgon par exemple. Leur goût exclusif du poisson cru déjà leur crée une fraternité matérielle avec les Sakalaves. Dans le sable des avenues elles enfoncent leurs socques aussi décidément qu’elles les claquaient sur le sol caillouteux de Nagasaki. Leurs veilleuses, leurs papiers dorés, leurs bâtonnets rouges sur l’autel minuscule des ancêtres, ont pu ne froisser ni étonner les Malgaches, seule race peut-être au monde qui ignore la moindre des conceptions de l’au-delà.
Ce ne sont plus des mousmés, ce ne sont plus des geishas, mais elles demeurent quand même de frêles choses, dont on a toujours la tentation de faire joujou, et c’est ainsi que les créoles, d’autres encore, s’en amusent trop et trop complètement. Vis-à-vis du mâle, elles demeurent, comme là-bas dans le Nippon, aussi dédaigneuses, aussi mystérieusement railleuses, aussi indifférentes ; mais elles exagèrent encore les défiances de leur propreté d’hermine. Et avant certains baisers, qu’ici elles consentent assez souvent à donner, elles se capitonnent les bajoues d’un rempart de papier.
Paquebot Yang-Tsé, Février 1899. — C’est seulement après une presque demi-journée d’installation à bord ; seulement par le hasard des causeries avec ceux qui y sont, à ce bord, depuis la Réunion, comme Elle ; ce n’est que l’étonnement, rapide mais aussitôt renseigné, de voir occupée la cabine de luxe ; ce seul examen bref, bien juste précisé dans l’accoutumance aux allers et aux retours, qui révèle la passagère royale, Ranavalo. Le gouvernement de France a jugé bon de lui prendre son oisiveté après son pays. Sans doute, il est meilleur juge que l’errant dont la pensée, après des heures en ce voisinage, ne trouve une curiosité de la Houve, suprême « pandjaka », qu’au loisir de l’absinthe plus émeraudée sur la glace plus cailloutée et plus lisse. Cependant, après avoir écouté ceux qui peuvent savoir, il ne paraît pas que l’exil dans l’autre île, à trois jours de Fort-Dauphin, maintenait aux souvenirs des vaincus l’énergie d’une présence lointaine…
Au reste, Ranavalo quitte la Réunion avec joie.
De la hâte brutale parmi laquelle on la fit dévaler les pentes de l’Emyrne, jusqu’à la mer geôlière ; du filanzane, galopé entre les troupes, semées encore presque jusqu’à Tamatave, disparus les quelques-uns que la fortune mena coucher au Palais d’Argent ; des robes et des trésors, perdus entre les haltes et la reprise de la chevauchée, à l’aube, Ranavalo n’a regretté que les robes. Et elle en a commandé beaucoup d’autres à Paris, Paris qu’elle va voir, déjà ivre de sa légende.
Car elle a compris, elle raconte, elle confie au commandant du navire ; aux officiers entourant, goguenards, le capitaine chargé de sa personne, que le président Faure, à qui elle écrivit son désir éperdu, va lui offrir le spectacle de la Ville en Exposition…
Donc le temps est mesuré où elle pourra épuiser ses malles pleines, trop fièrement coquette pour ne point rechanger le trousseau neuf, lorsqu’elle aura mis le pied sur les Champs-Elysées. Les Champs-Elysées, comment cela est-il ? Mais, une allée, conservée dans une forêt de jadis, semblable aux bois d’Emyrne, sans que les fûts s’en dressent plus altiers, et c’est l’allée sur laquelle défilent les cortèges de rois, sur laquelle a roulé le gala du tsar… Ranavalo rêve ; même des larmes du bonheur escompté embuent ses yeux en gouttes de café.
Voici Aden déjà et pas une fois la reine ne s’est mise à table, vêtue comme une autre fois auparavant, depuis le premier repas. Elle mange dans le salon des premières, mais à une table réservée, en retrait de la ligne occupée par les rares passagers.
Elle s’amuserait d’avoir une place au milieu de tous, reconnaissante quand même de cette déférence gardée à sa personne, malgré d’autres lèse-majesté. Car, si elle n’a jamais été qu’une reine fainéante, une « pandjaka » de gaieté, couvrant des Richelieus Houves, il lui reste néanmoins le vif sentiment de son extériorité de souveraine, et la conscience qu’il en doit demeurer immuablement un symbole : faire pour elle ce que l’on ne fait pas pour tous les autres. Humble protocole, protocole de Gérolstein ! A la même table, il faut que siège, en face d’elle, son interprète ou factotum, vague première utilité, peut-être apparenté à la Houve pandjaka, en tous cas pour lequel elle déroge à la solitude du festin royal. Et le troisième convive est une femme de son rang du moins, sa tante.
Cette tante seule occupe l’attention des passagers, les amuse, hélas ! surtout. En vain la reine l’a grondée, en vain, au départ, le général d’infanterie coloniale, avec une discrète fermeté, lui a fait écouter des recommandations : la tante, majestueuse, immense, le regard fixe parmi les bouffissures de peau et sous la crépelure de ses cheveux, différents de la belle chevelure de Ranavalo, la tante s’oublie entre le Bourgogne, le Champagne et le Whisky. Le plus souvent, sa faiblesse ne gêne personne ; seule Ranavalo s’en désole et ne se promène, calme, sur l’arrière, qu’après s’être assurée du profond sommeil de la parente. Mais voici qu’un soir, la mer plate, le repas s’est prolongé dans le salon, et nombre de gens sont encore à table que derrière eux la tante continue de boire. Soudain exaspérée de sa solitude, des gestes et des voix des dîneurs, qui sait ? peut-être crachant la rancœur de vaincue, d’exilée et d’abandonner, que la frêle et mélancolique Ranavalo cache ou ne sent plus, la grosse femme hurle. Or on écoute, par loisir, et parce que Ranavalo n’est pas là. On entend que la tante insulte tous les hommes présents et leur dit son mépris de n’avoir encore été forcée par aucun d’eux. Puis incapable de se lever, elle boit, boit toujours. Ranavalo est accourue ; la tante méconnaît la majesté royale ; on a peine à la coucher et la petite reine désespérée pleure à chaudes larmes le scandale, appuyée contre un bastingage. Le capitaine Bon……, son cavalier servant, celui qui doit la remettre à Marseille au chargé du gouvernement, essaie vainement de l’entraîner, de lui offrir son bras pour une promenade sur le pont.
Quel vraiment gros chagrin ! Car la joie de Ranavalo est précisément de marcher ainsi au bras du capitaine. Et souvent l’officier, dérangé dans son whist, peste contre la timide apparition de la reine qui, sans oser parler, va et vient devant le fumoir, attendant le cher appui et préparant la solennité d’un pas pour son pied menu.
Elle se couche comme un enfant sage. Depuis les craintes de la guerre, de la fuite, de l’exil, elle imagine des sujétions continuelles. Très humble, elle se persuade que seule la bonté du capitaine Bon……oy lui permet des fantaisies et des libertés, et alors, pour ne point le faire punir lui-même par quelque diable méchant et galonné, elle se retire très tôt dans la cabine de luxe, plus près de Paris que la veille, avec la douceur sommeillante d’être plus près encore au matin proche.
Sur la carte, comme tous, elle s’intéresse au point marqué. Mais des professeurs complaisants n’ont pu lui faire comprendre l’échelle des milles. Les explications de distance tournaient dans sa cervelle de femme-enfant. Elle ne compte que par nuits, avant l’éblouissement de Marseille, dans le soleil dont on lui parle. Rien ne l’occupe, hors l’arrivée, hors Marseille pour Paris.
L’enfant royal mange, sans crier, dans l’avant-carré, sous la surveillance d’une nourrice. Ranavalo d’ailleurs n’est point sa mère. Il croît, celui-là, inutilement puisqu’il n’y a plus de trône où le hucher, sélectionné quand même dans un cercle de familles traditionnelles, choyé avec l’aveugle intelligence d’une communauté d’abeilles dispersées.
Et lorsque le Yang-Tsé s’amuse au raz, lorsque Ranavalo haletante de l’écrasant espoir de Paris, se pencha pour voir un messager du président, elle aperçut le préfet accompagné ainsi que pour recevoir le Masque de Fer ou Eyraud, et elle sut que le lendemain, à midi, un autre paquebot l’emporterait en Algérie, encore vers des hommes noirs, encore loin de Paris.
Alors elle défaillit, plus vaincue qu’au Palais d’Argent. En route, à Suez, au premier crépuscule de froidure, elle avait appris la mort du président Faure ; ici, elle adjura son ombre, et pensa qu’un méchant génie avait remplacé le bon chef de jadis… Maintenant elle voudra lui pardonner puisqu’il l’appela ; surtout elle aura eu le temps de comprendre que son titre de « pandjaka » est demeuré toujours une chose grande et terrible pour les Francs ; elle se sera étonnée que la gracieuse chose qu’elle est, ait pu effrayer. Et, désormais consciente que ses caprices d’enfant-reine ont droit du moins à d’autres amusements que ceux ordinaires aux enfants, elle prendra à pleines mains son énorme joujou souhaité, Paris.
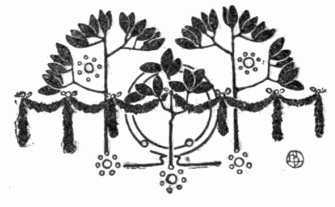
FEMMES DU PACIFIQUE
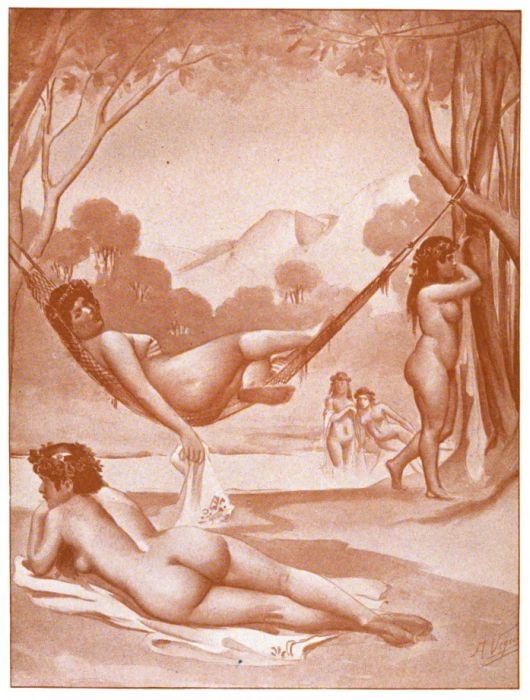
Femmes d’Hawaï.

Il faut avoir su beaucoup de géographie pour se rappeler cela, la grosse ville de Célèbes, Célèbes ? Ah ! oui, l’île bizarrement découpée, poulpe nourri entre des mers d’Inde et des flots du Pacifique. Mais, dans cette dernière terre contre qui viennent se chauffer à la fois les deux océans, la sensation d’Inde domine très pleine : le mélange des bois et des eaux en des calmes de divinité, des sommeils et des réveils de fauves, les fleurs qui semblent devenir et les hommes qui paraissent se figer. Par-dessus cet humus antique, les bons et gras Hollandais ont étendu un semis de souveraineté colonisatrice. Puis leur nirvâna habituel, parmi la bière rêveuse, s’est accommodé du nirvâna autochtone.
Leurs croisements avec la race ont réalisé des types invraisemblables, nés, croirait-on, de la fantaisie d’un journal amusant.
L’épaisseur du mâle, accouplée à des maigreurs hiératiques de femmes, s’est portée au hasard sur la ligne des formes. A côté de filles dont la poitrine s’offre, moins large que la taille, d’autres soutiennent à peine des seins débordants sur une taille raide et étroite comme un bambou. Des croupes chevalines abondent ; des silhouettes effilées, traçant dans une verticale le dos et les jambes, sont fréquentes. Parfois des faces de bébés joufflus, parfois des visages tels ceux des affamés du Gange ; des bras courtauds ou des perches de moulins à vent, des cheveux crêpés ou des cheveux nattés jusqu’aux chevilles.
Seulement la diversité d’apparence ne se continue pas en diversité de tempéraments.
La femme, à Macassar, c’est l’esclave biblique, indifférente le plus souvent ; et, si elle ne l’est pas, trop humble pour oser le montrer de quelque façon. On vient, on ne revient pas, ignorant même si les charmeuses de serpents, entrevues au seuil des temples, ont gardé, elles seules, la lascivité de leurs pareilles du Népal.
Le beau temps est passé où Nouméa, en train de devenir la cité du nickel, regorgeait de cocottes dans les rues et de bar-maids autour des comptoirs. Les miniers, les rouliers, les entrepreneurs improvisés dix-huit mois au long des routes entre le gisement et la côte, sont rentrés dans leurs rangs ordinaires, libérés qui ne sont plus que des demi-individus, ou commis dans les innombrables bureaux d’Etat. Sydney a repris les bar-maids ; les Françaises si recherchées, en veine d’aventure, ont trouvé plus loin, aux Amériques, des amis, ainsi que disait l’une, « aux pieds moins nickelés ». Les popinées ont reparu à la musique ; Nouméa est redevenu et pour toujours le bagne.
Les histoires sont effroyables que l’on conte des condamnées, parquées toutes, affolées par leur sexe. Les dernières sont celles-ci : quinze à vingt de ces femmes assuraient les services du principal hôpital de la pénitentiaire. Un caporal-fourier vint, vers le midi, faire signer des papiers. Tandis qu’il cherchait le major, quelques-unes le conduisirent, l’égarèrent dans les couloirs, l’enfermèrent enfin dans un cabinet reculé. Puis, rassemblant le troupeau des harpies, ensemble elles le violèrent, forcèrent sans relâche son désir, l’épuisèrent à mort.
Autre chose. Après avoir satisfait une folie, elles tentèrent d’assouvir une haine. Comme elles avaient fait de l’homme le matin, elles se mirent le soir sur une religieuse détestée. De toutes leurs caresses, elles polluèrent cette chasteté et cette sainteté. Puis elles s’efforcèrent, par des manœuvres inouïes, que le viol du caporal leur servît à déshonorer jusque dans l’avenir la chair de la vierge consacrée.
Leur vision est du cauchemar. Encore ne voit-on à peu près que celles dont un forçat a voulu pour femme. Et alors celles-là le gardent avec une jalousie atroce, qui tue et lacère au premier doute…
Cependant les indigènes fixées dans la ville, les anthropophages d’il y a cinquante ans à peine, promènent à la musique leur coquetterie enfantine et leur douceur d’animaux inférieurs. Le nom dont on les appelle les confond presque avec les vraies filles du Pacifique, popinées ainsi unies aux faufinées des Samoa ou aux vahinés de Tahiti. Simplicité et caprice des mots. Car, popinées, elles ne sont que des négresses aux cheveux crêpus et lèvres déformées, encore sœurs des Canaques errant par les monts de l’île, qui forcent eux-mêmes les cerfs et tuent avec le casse-tête et la sagaie.
Le soir, sur la place, dans l’ombre tiède alourdie par les relents des flamboyants énormes, elles tournent par bandes autour du kiosque. Elles marchent pieds nus ; leur tête floconneuse est nue ; mais, sans le moindre linge, sur leur corps, elles ont passé une robe éclatante de confection française, coupée et ornementée ni mieux ni plus mal que celles des Européennes de Nouméa, et qu’elles ont pu, au prix d’extraordinaires économies, acheter cent cinquante francs à la maison Ballande. Elles parlent français très suffisamment ; la surprise de leur chair est une chaleur impossible à présager, aussi amollissante que des vapeurs de bain ; et leurs enfants, la plupart, naissent avec de gros ventres comiques.
Il arrive que des hasards de conception les font mères de filles aux lignes pures, la peau à peine éclaircie, mais le visage plaisant et les yeux beaux. A ces filles, elles conservent par des précautions plus efficaces que des morales… la virginité, jusqu’au marché conclu avec quelque amateur riche, qui paiera le plaisir de couper lui-même et non pas au figuré, les derniers fils qui attachaient l’adolescente à son état de chasteté.
Puis ces métisses, maîtresses de leurs corps, deviennent les hétaïres ordinaires de Nouméa. Comme partout ailleurs, elles aguichent le passant, et comme partout, les cochers vous mènent à leur case.
Or, l’argent est rare dans la petite ville anémique ; bien souvent des libérés, travailleurs énergiques, amassent quelque pécule, en vendant des légumes ou des fruits. Et avec les métisses ils dépensent des virilités longuement mûries aux bagnes. Cela, c’est le rendez-vous honteux, caché. La métisse qui se donne à un libéré crève sous le mépris des fonctionnaires, est poussée du pied par eux, ne doit plus rien attendre de cette clientèle, la plus nombreuse naturellement. Oh ! la laide chose ! En tout lieu du monde, il faut trouver une étreinte criée en injure par les blancs tyranniques, quand même elle serait chauffée d’un vrai désir.
Juif, Chinois, ou libéré, sus à la bête immonde ! Et c’est encore Madagascar où glapit la note moins féroce, quand les Betsimisarakas, s’injuriant entre elles, l’une lance à l’autre un seul mot :
« Lilinaweï. » « Va coucher avec un caïman ! »
La nuit australe, merveilleusement stellaire et furtive, mêle à l’onde large des effluves de l’oranger l’âcreté brève du varech. Et c’est chose rare. D’ordinaire la mer Pacifique, sans flux, est aussi sans odeur. Ici, la brise absente, un clapotis flaque cependant, au lieu de la sérénité d’eau coutumière ; mais léger, à peine doux, tel à intervalle l’écrasement d’une large goutte de ruisselet sur une dalle de fontaine, à travers des mousses. Le murmure cassé perce des lignes de bananiers, la dernière ligne indiquant le sable. Parmi les premières lignes, des cases ; plus loin, tassées d’ombre, d’autres cases, et, si l’on monte, perdant le clapotis, une vibration qui halète comme des fléaux sur une aire où l’on bat du blé. Plus près, le parfum d’oranger s’étale en nappes, semble-t-il. Plus près encore, voici :
Des noirs, hommes et femmes dansent. Rythme enfantin d’ailleurs. Ils se tiennent par la main, en cercle, sans alterner les sexes. Le chant qui les balance, à ce que l’on en comprend, déclame deux vers, en crie un troisième, assourdit en plainte le quatrième. Les danseurs s’en vont à droite, à gauche, gagnent un pas à peine après chaque double couplet. Et la rapidité de ces courses alternées sur place, imite bien le halètement des fléaux.
Ces gens paisibles le soir, effrayés et cruels dans le soleil, sont primitifs entre les primitifs. Leurs femmes sont des femelles velues ; le musclage de leur corps déconcerte un peu le désir, mais leurs seins sont de marbre. Les colons épars et les missionnaires qui, depuis longtemps, s’efforcent d’en grouper autour des récoltes de bananes et de cocos, leur ont appris la valeur de la grande pièce d’argent. Depuis ils recherchent l’Européen, lui donnent, même consentants, l’illusion d’un vil préhistorique, et d’ailleurs, horrifiées par la souillure de son contact, en repoussent brutalement l’intimité suprême.
Le lieu, ville anglaise de colonie, n’est point déplacé dans des rappels du Pacifique, et son passage de maisons à bow-windows et tuileries gaies, ne bouleverse pas la cinématographie des Iles. Il est vrai que c’est une comparaison, étrange, mais exacte absolument, qui ramène à l’évocation la gentille cité de Nouvelle-Zélande. Après le flirt trouvé aux Tonga ou à Wallis, comment ne pas songer au flirt des filles saxonnes, le plus précis ?
Tennis, rallyes, thés dansants vous accueillent ; l’année précédente, l’Affaire avait fermé aux Français toutes les portes de jardinets. Entre toutes les sœurs et amies de l’hôte, il faut choisir, et c’est délicieux. Choisir la moins sport des jeunes filles, parce que le temps des autres est sportif en vérité ; cependant, que le sweetheart sache monter, et pratique ! A l’heure des crépuscules froids sur le fiord profond dont l’évasement forme rade, l’hiver frissonne, et des bois palpitent, sont proches, où des corbeaux serrés en bande croassent le Nevermore…
Voyez, Annie, le thé se refroidit vite comme votre main, et le cake s’effrite, gelé… Mais demain, petite chérie, nous prendrons les chevaux joujoux et nous aurons au galop la chaleur des yeux. Maintenant, racontez-moi, pour convertir le vilain Français qui ne sait pas aimer, comment Lucy et Blundell sont restés cinq ans fiancés ?
Le matin, sur la route sonore, au galop, les yeux chauds. L’hiver est oublié ; voici midi qui sue. Annie a voulu que l’on attachât les chevaux nains à un arbre ; elle sait un banc où l’on sera bien, car il faut déjà s’abriter des rayons.
On est bien, oh ! on est très bien, si bien qu’il y a un moment dont on ne se souvient plus. Comment, que dites-vous ? Avec Annie. Oui, mais Annie est quand même la vierge blonde, et comme on lui fait remarquer qu’elle a perdu son mouchoir sous les arbres, elle sourit divinement : « J’en ai toujours un autre, dit-elle. »
En revenant : « Dites-moi, sweetheart, est-ce que Lucy et Blundell, quand ils étaient fiancés… ? — Mais oui, darling ! »
Puis avec élan : « Oh ! j’attendrais pour vous tout le temps que vous voudriez ! »
Bien plus que Tahiti, plus que toute terre où s’accroche la nostalgie, voici venir, dans une sérénité et une volupté à la fois de mémoire, l’île délicieuse. La capitale, la grand’ville s’aperçoit, aussitôt déroulée la dernière sinuosité d’un chenal aux caprices fous. Le front au lac intérieur où le passage serpente depuis la haute mer, le dos à des arbres qui bruissent comme des tombeaux, Nuku-Alofa montre, à cent mètres du mouillage, des allées d’ombre, des enclos de fruits et de fleurs, des murs bas coupés de marches en pierre ainsi que dans la campagne bretonne. Et le nom de la cité : Nuku-Alofa, signifie l’endroit où l’on aime.
L’île est indépendante, absolument. Elle a un roi, un roi que l’on va saluer en grande tenue.
L’évêque des missions, interprète, lui explique le discours de l’amiral, et le monarque lui fait répondre qu’il est heureux de la venue des Français. Cependant son visage est grave. L’amiral s’arrête de nouveau après un second paragraphe : l’évêque déclare que le prince est enchanté de voir des amis. Sa figure est devenue soucieuse. Enfin, tandis que la péroraison répand ses fleurs, Monseigneur s’écrie : « Le roi est au comble du bonheuret de l’enthousiasme. » Le roi semble avoir enterré le matin le plus cher de ses proches.
Et cependant il s’amusait. Il vient à bord en uniforme de général allemand ; au grand mât on frappe son pavillon particulier et trois salves de vingt et un coups saluent au pied de la coupée, au départ de terre et au retour.
D’ailleurs c’est un monarque malheureux : superbe de prestance, crevant de santé, dans ce pays dont il est le maître et où aucune femme n’est laide, il vit chaste. Il doit vivre chaste. Exil ou mort, il ne reste plus à Nuku-Alofa qu’une seule personne digne de son alliance, une royale personne de deux ans. Dix ans d’attente, oh ! le supplice, et pourtant la loi tongienne est inflexible.
Plus inflexible encore est la rigueur des filles de Tonga-Tabou pour les étrangers.
Un français charmant, fonctionnaire du royaume, nous avoue qu’il se passa dix-huit mois entre son établissement à Nuku-Alofa et le moment où il put discrètement prendre une maîtresse.
On s’étonne, on admire la puissance des religions semées sur cette terre, aussi bien catholique que Wesleyenne, sans compter un troisième culte indigène inventé par un wesleyen dissident. Mais non. Cela ne suffirait pas, ne suffit pas car entre les mâles et les femmes de la race, ardentes et belles, le nombre des naissances illégitimes est de une sur deux. Cela, Monseigneur nous le conte, désolé. Du moins, il a quand même, lui ou d’amères prêtres, trouvé une ingénieuse limitation à l’œuvre de chair, et si les filles superbes repoussent l’étranger, c’est parce qu’elles ont été persuadées des maladies et des démons qui leur passeraient sûrement dans le corps. Cela, Monseigneur ne nous le dit pas. Mais lorsque nous sommes avertis, sa bonne grâce réussit à peine, même au prix des festins bibliques, à gagner notre pardon.
Il a trop réussi ; en vain chercherait-on un marin, qui depuis trente ans, ait été l’amant d’une femme à Tonga-Tabou.
L’amant complet du moins. Et il n’est pas très certain que Dieu ait sujet d’être absolument satisfait des résultats obtenus par Monseigneur. Les jeunes filles de Nuku-Alofa ont découvert le flirt et inventé les demi-virginités. Quelqu’un a dit cette aventure : invité, le soir à un « Kawâ » avec d’autres officiers, il s’était échappé du cercle officiel. Dans la cour, envahie par les curieuses de Nuku-Alofa, il tenta une fois de plus, et aussi vainement, de fléchir le désir d’une fille. Alors, avec de comiques gestes de découragement qui amusèrent la bande, il vint s’asseoir au bout de la galerie, au milieu de toutes les femmes serrées en ce coin comme des hirondelles. Des rires lui éclataient aux oreilles, des grimaces l’enrageaient, des poses inconsciemment lascives l’affolaient. Ses voisines de droite et de gauche, par dessus lui, se prirent à jouer à la main chaude. Soudain, les rires redoublant, des menottes, toutes les menottes qui purent, se fourrèrent dans ses poches de pantalon. Il ne protesta point, d’ailleurs submergé, et depuis il n’a point confessé sa honte.
Peut-être est-ce le même qui, oublieux de toute Europe, voulut, par un matin d’Eden, violer une pêcheuse rencontrée ? Probablement c’en est un autre.
Dans cet Eden-Tantale, la moindre réunion, le plus petit Kawâ, comme on dit là-bas, assemble des dizaines de beautés. Elles chantent et dansent adorablement. Sous les allées ombreuses, des enfants, alignés et graves, jonglent avec des oranges, jusqu’à huit ensemble ; des théories s’enroulent et se déroulent aussi flexibles et eurythmiques que celles de l’Hellade.
Puis, on entre, pour se reposer ou pour boire, dans des cases. La nuit claire descend du toit ; quelle que soit l’heure, toute la famille s’éveille, vous entoure, apporte les cocos frais, et attend indéfiniment qu’il vous plaise de sortir. Des sourires vous détendent ; une case est catholique, une autre wesleyenne, la troisième tongienne.
Partout même accueil, partout même désir. Et quand on demande à une aïeule le droit de poser sa bouche sur la bouche d’une jeune fille, avant de partir, elle accorde et rit, étonnée, femme d’une terre où la langue n’a point de mot pour traduire baiser.
Dans la salle de classe à la case des Sœurs enseignantes, une fille de douze ans cause avec la religieuse. C’est une grande, une de celles que l’on peut à grand’peine jusqu’à cet âge faire rentrer au dortoir, dès neuf heures le soir, loin des hommes du village.
La fille. — Il y a longtemps que tu n’as vu le prêtre de Vâo ?
La religieuse. — Oui, pourquoi ?
La fille. — Tu dois être bien gênée.
La religieuse. — ? ?
La fille. — Le grand bon Dieu a bien fait de mettre dans l’île en même temps que toi un homme de ceux que tu peux avoir dans ton lit, n’est-ce pas ? Mais tu feras bien de lui en commander un autre, car le père de Vâo est déjà vieux.
La religieuse. — Veux-tu te taire, malheureuse ! Que dis-tu ! Ne te souviens-tu pas que tu me vois toujours seule au dortoir ?
La fille (très calme). — Sûrement ! mais je pense que ton corps n’est pas fabriqué pour les hommes d’ici, et que seul le père Vâo peut lui donner la caresse.
La religieuse. — Mon enfant, je vous en prie, taisez ces vilaines choses ; récitez la prière que je vous ai apprise.
La fille (têtue). — Le grand bon Dieu a envoyé les hommes noirs (les prêtres) parce qu’il y a les femmes blanches (les sœurs).
La religieuse. — Mon Dieu !
La fille (docile). — « O Vierge immaculée, daignez, etc… »
Au dehors, le rivage est proche. Le corail blanchit dans la mer saphirine. Le crépuscule bref se fond en tiédeurs, et les pêcheurs de nacre chantent vers l’Istar malaise.
« What do you think about our beautiful harbour ? » La question sort aussi naturellement qu’un bonjour des lèvres de tous les hôtes, de tous les amis de passage, même des voisins de tramway qui devinent l’étranger. Eh ! oui, la rade est extraordimaire, formée, après un goulet qui lèche des falaises, d’innombrables baies distinctes, cases successives disposées, semble-t-il, pour remplir d’itinéraires un mois d’excursion. Mais à quoi bon s’arrêter à cette joliesse ? Un peu Fort-de-France, un peu Diégo, beaucoup Nagasaki, et voilà l’aquarelle linéée et teintée.
Le « beautiful harbour » n’échappe pas plus que n’importe quel rivage du monde à l’inquiétude vicieuse des errants, l’interrogation irritante : « A quoi cela ressemble-t-il ? »
Ce qu’il y a de curieux, de quelque peu nouveau, c’est le faubourg énorme Wolloomoloo découvert à un détour de cap et dont la masse des maisons alors donne l’illusion, se chevauchant, d’un troupeau qui serait descendu boire et qu’on effraierait. Wolloomoloo plein de matelots, avec ses quais bordés de quatre-mâts qui regorgent de laines, est le royaume des filles à pirates et baleiniers.
Mais aussi c’est le domaine des blanchisseuses, accortes et fraîches, sous leur bonnet et leurs cheveux pâles, Mimi Pinson sans anémie. Les ordonnances qui, du bord, s’en vont leur porter du linge souvent prétexté, en causent entre eux après dîner, et les officiers ne peuvent ignorer souvent quelles faveurs ils ont partagées.
D’ailleurs les lieutenants de l’escadre anglaise n’en font point fi, meilleurs garçons que leurs camarades du Channel Squadron, par exemple. Quelquefois ils les paient avec des invitations reçues pour les bals du Town Hall. Quelques-unes, bien nippées, en profitent, et à un aspirant français qui s’informait, enthousiaste, du nom d’une danseuse assise dans un coin de l’immense salle, on répondit : « Her name ? Two pounds ! »
D’autres coûtent plus cher. Sur les champs de courses s’exhibent les filles cotées. Elles s’habillent avec un goût très sûr, et leur charme est certainement celui du monde le plus semblable à celui des Parisiennes. Peut-être connaissent-elles mieux les pedigrees, peut-être savent-elles trop la carrière de Trenton ou Carnage, ou Aurum. Leur société est charmante et vaut presque son prix, prix tel que les Australiens eux-mêmes, pour désigner ces horizontales, se servent du mot « harpers ».
Le théâtre leur fait peu ou point de concurrence. La mise en scène des ballets est splendide, les danseuses sont jolies. Mais ici, la pruderie reprend ses droits et les exagère en chantage. Si, confiant dans les regards échangés, l’on fit porter sa carte à l’entracte par un boy de service, l’enfant, tôt après, vous indique le chemin des coulisses. On va, on trouve le rat choisi, on se réjouit de n’avoir aucune désillusion, et l’on cause. Soudain apparaît une mère en furie ; le manager herculéen la suit. Elle hurle, il s’indigne : la loi est avec eux. Il faut être bien calme pour n’être point intimidé par la menace de quatre-vingts livres d’amende à payer.
Après ces épreuves au milieu de harpers ou beautés de music-hall, il fait bon retrouver les douces filles ou sœurs des hôtes. Les parties de campagne se succèdent. Dans les ferrys, on chante ; presque toujours une harpe et un accordéon se trouvent là pour soutenir les voix, ces voix de Sydney qui diphtonguent les voyelles. Le thé sous les arbres, s’accompagne de raisins miraculeux et des balançoires s’envolent au rythme de la musique en vogue, la Geisha ou le Mikado.
Comme à Christchurch, les sweethearts ont toujours en poche deux mouchoirs, mais, en outre, les mamans apportent parfois autre chose.
Sérénité ! Pourtant les gens qui sont là, Américains rudes et barbus, y sont pour faire fortune, au sens le plus banal, le plus romanesque aussi, du mot. Les uns disposent pour l’embarquement dans la goélette le tas de coprat, et cette odeur de cocos vidés est l’odeur du Pacifique. Les autres peinent pour la nacre ; quelques-uns enfin surveillent les plongeurs qui ramènent les huîtres perlières. Derrière un rideau d’arbres le camp fume ; des enfants bruns pincent des cordes de banjo, et la ritournelle sonne à la bordure du lagon. L’eau, encerclée par la dune, s’alourdit en splendeur ; des barques d’écorce, nombreuses, mortes depuis des ans, mamelonnent le fond. La goélette tirée au sable, s’affaisse. Aucun cri d’oiseau.
Les hommes de Frisco, qui resteront exilés de l’Ouest cinq ans, dix ans peut-être, ont pris avec eux, dans l’île plate, des filles de Tahiti ou des Marquises. Et avec elles ils vivent, sans obsession du but lointain mais sûr. Ces femmes sont heureuses, et les aiment. Car, Américains ou autres, ces lutteurs sont des mâles. Pionniers, pêcheurs, baleiniers, déserteurs des navires, tous ont la colère qui fait trembler délicieusement ou les tendresses maladroites qui attendrissent. Jadis des pareils à eux, s’emparèrent de la Bounty et, avec les aïeules des amantes d’aujourd’hui, colonisèrent une terre ignorée longtemps. Maintenant, il n’y a pas six ans, le drame de la Ninhuoariti a reporté des rêves vers les forbans splendides, et les frères Rorique, avant d’émouvoir les belles dames de Brest, avaient, en de nombreux Mangareva, semé du désir aux vahinés.
Quand même sur eux et sur elles, sur un passé de meurtre ou sur un avenir de dollars, le ciel profond de Mangareva épand sa sérénité.
Plusieurs resteront qui songeaient à des orgies prochaines, dont les sommeils se peuplaient d’« enfers » mexicains ou de Monte-Carlos contés vaguement ; plusieurs ont désappris déjà de frapper la femme avec le fouet court à lanière large ; plusieurs resteront parce qu’un regard, la voix est trop humble pour s’élever, parce qu’un regard les aura suivis jusqu’à la goélette…
Syphilitiques, phtisiques, et alcooliques, telles sont, et toutes, les vahinés de l’île chantée. Des Rara-Hu se sont trouvées, nombreuses à l’âge d’or des découvertes dans le grand Océan, en plus petit nombre quand les Chiliens ont envahi, et infecté la terre au long du siècle, éparses depuis la possession française et l’absinthe. Mais une seule peut-être, en des jours aussi prochains que ceux du Livre, put symboliser la volupté du Pacifique, brisante d’étreintes nouvelles, mélancolique au travers de l’éternel arrachement. D’ailleurs, qui ne se souvient des dernières pages : « Depuis que tu as quitté l’île, la petite fille s’est prise à boire… » Maintenant la fierté des officiers de marine qui parlent des nuits de Papeete se traduit pareillement : « Oui, mon cher, tout le temps que j’ai passé avec elle, elle n’a jamais bu que du lait de coco. »
Hélas ! Frêles vahinés, pardonnables malades gourmandes d’alcool ! Longtemps après avoir quitté la marine, le duc de Fitz-James, énumérant des bonnes fortunes variées comme un caprice d’homme, donnait encore sa plus chère préférence de souvenir aux filles de Tahiti. Et un commandant cria à un aspirant, sans larmes au moment de l’appareillage : « Monsieur, vous déshonorez la jeunesse du Corps ! »
Jadis les vierges des cantons demeuraient douces et naïves, loin de Papeete. Les liqueurs maintenant s’en vont par le courrier dans tous les villages. Et l’argent gagné dans le commerce de la vanille fuit en rasades. Une année les gens du district de Papara, établis en une sorte de communisme, amassèrent plus de cent mille francs. Longtemps le courrier n’eut plus de rapports avec eux, longtemps on n’en vit plus un seul au marché de Papeete. Lorsqu’enfin un percepteur d’impôts fit la tournée des villages, il ne trouva que tonneaux défoncés et silence : le district entier était ivre depuis trois mois.
La lucidité des filles du moins est rieuse. Elles chantent par plaisir, elles chantent de l’amour ou des légendes guerrières, et les choses d’amour ont imposé leur nom aux traditionnels récitatifs que sont les hyménées. La gloire de l’île s’y exalte : la tendresse pour le sol, la conscience de ses délices uniques, enlacent leur merci aux appels de chair. C’est une sorte de litanie qui détaille les places d’adoration de la terre aussi bien que celles de l’amant, des Français chéris, « Rupe Farani ! » Des tribus de chanteurs ont recueilli les airs vagabonds depuis deux siècles, et les orchestrent à leur façon. Au 14 juillet, fête sacrée où s’étalent les robes nouvelles, il y a concours d’hyménées ; des groupes de quarante ou cinquante personnes s’en viennent de tous les districts, ou de Moréa, même des Iles-sous-le-Vent. Et pendant deux jours la plainte ardente à Aphrodite s’élève sur la Grand’Place de Papeete.
Les troupes ambulantes miment aussi des scènes en parties. Ce sont des danses piétinées où se déroule, par exemple, la figuration de la pêche à la baleine depuis le départ des barques jusqu’au dépeçage de la bête ; ou bien encore la vie d’un pâtre qui devient roi ; ou bien les aventures d’une Belle au Bois dormant. La grâce est beaucoup moins naturelle que dans les spectacles à peu près semblables au Japon ; la félinité des geishas ne se répète pas ici. Seul l’assemblage des masses dans le rythme retient le regard, et la suite du récit mimique matérialise mieux que tout rappel classique les mouvements du chœur antique. Strophe, antistrophe, épode, chacun des trois temps est nettement marqué. Ces coryphées ont le geste puissant de précision ; les ondulations des rangs font fleurir le désir, et le tiaré couvre le moment de sa fragrance.
Le tiaré ? Avec ses grappes sont tressées les couronnes, cerclées sur Les épais cheveux des Tahitiennes, dans la moindre photographie rapportée de là-bas. Son parfum pesant est l’âme de l’île, lourde comme la volupté. Le soir, sur le marché, les étals se couvrent de la fleur d’amour. Par deux ou par bandes, les vahinés vont et viennent entre les haies de marchandes. Quelques lanternes éclairent la place embaumée. C’est l’heure où les officiers descendent à terre ; les amants retrouvent là les maîtresses, et les solitaires y errent pour ne point s’en retourner seuls à la case.
Dans la petite demeure, la vahiné, femme d’un enseigne ou d’un lieutenant de vaisseau, joue bien les maîtresses de maison, au moins une heure, tant qu’elle se retient de boire. On voisine, on s’invite, on chante et on danse tous les soirs, furtivement les dédaignées prennent leur place au cercle de leurs amies avantageusement établies ; qu’importe une bouteille vidée de plus ? Lorsqu’à minuit le punch flambe, le couple des hôtes maugrée contre les invités qui leur diffèrent l’étreinte. En vain. Il leur faudra passer dans leur chambrette, sans essayer de remuer des corps de vahinés raides d’alcool. A leurs amants elles tressent des chapeaux. La paille en est surfine et la façon parfaite. Le chapeau souvent remplace la déclaration d’amour ; en tous cas, il dit l’invitation au double adultère. Alors « surgissent des drames, un peu grotesques sous les bananiers et autour des nattes qui potinent, un peu tristes quand des rancunes les transportent dans le service avec la différence des grades. Les vahinés y prennent rarement une part active, chair facile, à peu près indifférentes au goût exclusif d’une seule chair d’homme.
Le plaisir pour elles, presque toujours partagé dans l’étreinte, est plus tard d’avoir un enfant blanc. L’orgueil de cette maternité est inouï, et, non loin de Papeete, un fils du plus vert de nos actuels vice-amiraux croît parmi l’admiration du district.
Toujours à court d’argent, malgré la générosité des officiers, et toujours dévorées de coquetteries, les vahinés sont venues vite à l’ordinaire alliance de l’amant de cœur et du monsieur sérieux. Le monsieur sérieux ici, c’est le Chinois. Oh ! ne racontez pas cela à un officier de marine. La petite fille lui a quelquefois confié, le matin surtout, au lever, qu’elle allait manger quelque chose, un rien, chez le Chinois d’en face, restaurateur. Et, reconnaissant de la nuit, il l’a crue…
Sensations monotones, passé quelconque, un peu d’écœurement d’orgies trop complètes, un peu de lassitude de voluptés trop faciles, voilà donc ce qui reste à un sceptique de l’île délicieuse. Pourtant ? Oui, il hésite à conclure, il craint d’affirmer. Ne s’est-il point trompé, seul, honni des enthousiastes ? Avait-il tressailli trop souvent déjà, ou était-il trop rigide encore pour vibrer simplement ? Il est malaisé de parler haut après Fitz-James, et devant Atéri, la vahiné délicieuse, maintenant vieillie, qu’un officier intelligent traîna après lui, dans sa famille même de Touraine, et pour laquelle il vola.
Des îles au doux nom du passé, les Marquises. Mais ce sont des profils dressés en un temps de cataclysme ; et des châteaux-forts de rocs, quand on attendait des grâces de femmes. C’est ici la véritable patrie des vahinés, c’est ici que paraissent les visages adorables d’Espagnoles sur des corps bruns et graciles de Malaises. Pour les « goélettes », pour les officiers, hors de Tahiti, Taï-o-ha, c’est la passade, loin de la solide tendresse qui attend à Papeete. Et souvent le lieutenant de vaisseau ou l’enseigne accordent passage aux errants qui abandonnent leur paradis pour les délices imaginés de Papeete trop sûrs d’ailleurs que, n’était cette indulgence, ils trouveraient aussitôt au large, des femmes cachées dans tous les coins du yacht militaire.
Mais, hélas ! sur cette terre d’amour, autour de Taï-o-Ha, pullulent les lépreux. Cid Campéador arracha son gant pour serrer la main d’un effroyable malade. Ici, lorsqu’un homme se marie, après la cérémonie religieuse, il s’asseoit sur la place du village ; et, les mains aux hanches de l’épousée, il la tourne vers le désir de tout venant. Le village entier défile, et, s’il plaît à chacun, use de la vierge : or, après le roi, les lépreux ont droit de contenter aussitôt leur envie.
Un nom domine des noms, dans ces îles, royaume de l’Aphrodite, celui de la baie des Vierges, c’est là que vraiment les civilisés rebâtissent l’Eden. Mais :

FANTAISIE SUR L’AVENTURE
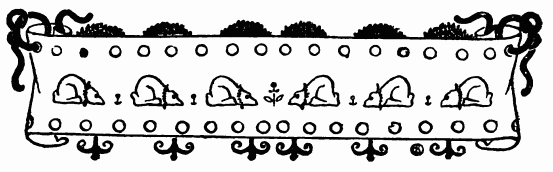
Pour l’aventure, il faut être deux. Il faut pour qu’il « arrive » quelque chose, celle d’abord par qui la chose arrivera. Hyménée donc ! Gloire à la volupté parmi les « cas » de l’exotisme ? Voici que par-dessus les Cloches de Corneville, badine l’officier de marine, en veine de souvenir ; le voici qui, suivant l’expression classique, « raconte ses campagnes », il dirait presque, le gaillard, ses compagnes :
Ah ! que c’est gaulois ! Ah ! que c’est français ? La naïveté du musicien s’ébat délicieusement dans la définition donnée du Français par ses voisins, « un homme qui ne sait pas un mot de géographie ». Et vous de pâmer, mères et grandes sœurs, à l’évocation de ces baisers si lointains qu’ils en deviennent charmants, si nombreux qu’ils en demeurent chastes, baisers prodigués, sans doute, suivant la loi de Planquette, par des gretchens à des amiraux suisses, ou par des filles du « Pont des Caravanes », à des maquignons persans. Les matelots certes sont rigolos, mais les petits bateaux qui vont sur l’eau jamais n’arriveront au pays des « Alsaciennes ou Circassiennes ».
« Eh ! quoi ! raillez-vous trop facilement l’ingénuité du couplet ? et n’avez-vous point, quand même, senti se gonfler les cœurs des futures amantes ? Ne connaissent-elles point ainsi comment, par-delà des couchants et des îles, des femmes, leurs pareilles, après des seins palpitants supporteront des seins raidis par le spasme ? »
Oui, Madame. Peut-être même un jour, si elles furent celles vers qui venaient des étrangers, un jour elles ont vérifié leur hypothèse de délices, et balbutié, dans la communion suprême, le « Bojé Tsara Krani ». Oui, Madame, mais alors, ce fut pour l’alliance !
Pour la peau, il faut être deux aussi. Le premier nous le connaissons, globe-trotter épiant les jalousies lourdes du soleil de la sieste, ou bien officier, nez au vent, dans le frisson de fraîcheur, avant la nuit brusque, au saut du canot-major. L’autre, ah ! l’autre, elle apparaît peu ou prou. Pourquoi ?
La brutale esquisse de ces déambulations, candidement romanesques, à travers les cités ou les villages de la nuit, se résume en deux pages d’un livre. « Vénus ou les Deux Risques » de Michel Corday. L’œuvre pourtant n’étreint aucun exotisme et ne prétend aucunement à théoriser l’aventure. Les termes en sont néanmoins précis et définitifs, soulignant les difficultés de parler la langue en laquelle seule germera l’idylle, les grotesques méprises dans l’enfilade fiévreuse des portes et des couloirs d’ombre prometteuse ; les quolibets acceptés, tête basse, en échange des questions ridiculement cyniques ; la promenade harassante guidée par des associations chimériques d’idées ; la solitude enragée au pied de fenêtres tranquilles ou énigmatiques, comme partout, comme on veut les imaginer ; enfin, par le hasard où se dilate une joie inavouée, la rencontre d’un cabaret ou d’une vieille, havre assez souhaité pour n’hésiter point à le déclarer très sûr ; et alors, la passade confuse qui prépare pour le matin la hantise du risque vénérien.
Celui-ci, les bons apôtres l’invoquent pour se soustraire au « devoir d’aventure ». Ils sont rares, et, apôtres, ils sont devenus. D’ailleurs, il leur paraîtrait indigne que la tâche ne fût point dévolue à des camarades, et que l’exotisme n’apportait point, par quelques-uns, à la collectivité, des légendes où se redore l’auréole. A parler franc, les sages existent peu, aussi bien chez les aspirants que chez les capitaines d’âge : tout au plus ceux-ci, Homais du spasme, ne manquent-ils point de porter, avec leur désir, un attirail de préventifs. Mais certainement la crainte du risque vénérien ne limite en rien la volonté exaspérée vers l’Aventure.
Il semble que Loti ait dressé un bilan définitif de cette aventure. Sa nomenclature résume, en quelque sorte, la sexualité géographique, et, si les noms d’Aziyadé et de Rara-Hu saillent particulièrement sur le tas des maîtresses, chacune néanmoins, à travers les pages, offre curieusement un « cas d’aventure ». Heureux soit-il lui qui les vécut ! Es basse envie de ses camarades, et l’ignominie qu’ils attachèrent ingénieusement au souvenir du divin mélancolique, suffiraient à authentiquer les récits et à identifier les héroïnes.
Et pourtant ! Pour qui a vécu la vie d’officier embarqué, une incompatibilité déconcertante surgit trop souvent entre les libertés permises, dans l’œuvre, aux fringales d’amour, et le service tellement astreignant des quarts à bord. Le don-juanisme heureux d’un globe-trotter s’accorderait assez bien avec ces chevauchées, ces réclusions, ces départs et ces retours ; moins évidemment cadre avec cette volupté aventureuse la sujétion des journées découpées par fragments de quatre heures, entre le carré, le pont et la terre.
Mais il faut croire, nous voulons croire : la foi en ces amantes est assez merveilleuse. Il n’en apparaît pas moins que le substratum de ce désir mondial fut le plus souvent très humble. Aziyadé, Rara-hu, la chevrière monténégrine, les autres, ne furent pas des aubaines différentes à l’abord, de celles ordinaires aux maritimes échappés des canots-majors. Du moins il sut, lui Loti, les abstraire de leur chair universelle, les isoler dans son laboratoire de sexualité psychologique, traduire leur âme après leur en avoir donné une, en cataloguer les étreintes et en léguer la suite à des solutions futures. D’autres que Loti sans doute tentèrent cet effort avec des filles de bar ou des chanteuses de café-concert : de ceux qui, parmi ceux-là, ne se brûlèrent pas la cervelle ou n’éventrèrent pas la caisse, plus d’un goûta des délices uniques « d’aventure ». Mais le cadre où ils sertirent leurs nuits se comparerait mal au cadre des natures naturantes empreignant la jouissance de Loti, près des eaux du Bosphore ou dans les verdures malaises. Ainsi les petites femmes de Loti se sont érigées au socle des grandes amoureuses, et l’amant qui eut à ce point le sens cérébral de l’Aventure, méritait bien celle d’être porté au triomphe sur des épaules nues de femmes, dans un salon académique.
S’il fallait définir l’Aventure — la différencier par le temps de tous les autres désirs, depuis leur conception jusqu’à leur satisfaction ; si l’on s’attachait néanmoins à lui conserver ce caractère, étymologique, d’une chose advenant et autre que celles de même finalité — on pourrait hésiter à trancher si le phénomène se rapporte aux liaisons ou bien aux passades.
Le propre même de l’Aventure est de se sentir d’une autre essence qu’un rut épisodique : donc un loisir est indispensable, pendant lequel étudier l’objet, la partenaire. Mais aussi un caractère essentiel de l’Aventure comporte que la partenaire, évoquée dans l’avenir, ne s’appellera jamais maîtresse : donc il s’impose que la brièveté des rapports entre, dans l’événement, en principal facteur.
Que conclure ? Dira-t-on que l’Aventure est une liaison dont le terme s’aperçoit aussitôt que se compte le départ ? Ou bien une passade telle que, les sens comblés, subsiste la nécessité de prolonger moralement la sensation par enquête réciproque des amants ?
Admettons, voulez-vous ? En tout état de cause, une part prépondérante de la volonté dans l’Aventure. On cherche aventure, dit l’expression ; et, si l’histoire de Joseph avec Mme Putiphar fut indiscutablement une aventure pour Joseph, les mâles, sans exception, préparent le geste final avec science et conscience. Que cette volonté se manifeste en ses dernières énergies, le cas est beaucoup plus rare, et voilà comment tant de rapprochements et de possibilités ne seront jamais devenus des aventures. Le viol vraiment recule à des temps trop préhistoriques. Tant pis pour les « aventuriers » ! Car puisque l’événement les place, par définition, en dehors de l’ordinaire, ils devraient songer que leurs moyens aussi ont besoin d’échapper à la banalité. La nécessité de l’assaut saute aux yeux aussi bien qu’à la pensée… mais combien de fois après l’affaire manquée.
L’Aventure c’est le Viol tendre,
A Las Palmas, une fleur est tombée de derrière une jalousie ; à Fort-de-France, au balcon, par dessus le crépuscule de la Savane, la femme d’un tabellion, offrait une splendeur unique d’octavonne ; et, le matin où quelqu’un s’était trompé de porte, dans un hôtel d’Honolulu, il a paru que la miss auburn, aux goûts de sang, ne s’était guère retournée, penchée sur sa glace. Ah ! pourtant que ces chairs sont demeurées lointaines !
D’ailleurs les problématiques partenaires n’eussent pas pu dire le « ni vu, ni connu » si commun de l’acceptation. Car les blanches d’outre-mer, piquées comme de hauts lys en un jardin, ne sauraient escompter aucune complicité de la foule ou de la nuit. Et c’est ainsi que l’exotisme, Eden des désirs multiples et sans mystère, surchauffe, jusqu’à la tuer immédiatement, l’Aventure.
Mais, entre les terres d’Europe que l’on quitte et les Iles vers qui l’on va, il existe un terrain où la tendresse a, pour fleurir, le même temps que le désir pour se combler, un lieu où des amants entrent inconnus l’un à l’autre et duquel ils sortiront oubliés l’un de l’autre ; un coin de monde où la femme peut imaginer borner indéfiniment son rêve tandis que l’homme songe sur quelle courte durée il peut étendre les précisions de ce rêve. N’est-ce point là le royaume de l’Aventure ? Ce sol béni c’est le plancher des paquebots.
Ne riez point, sans doute le lyrisme a tort devant la banalité immense le plus souvent, des rencontres entre la Sicile et Tamatave, Marseille et Saïgon, Bordeaux et la Havane. Pourtant beaucoup des caprices échangés entre le ciel et l’eau furent de véritables aventures, et, nulle part ailleurs, les caractères de la possession ne se retrouveront plus complets et en même temps plus particuliers, nulle part la réalité d’un rêve ne se bornera mieux, pour un double agrément, dans le temps des amants et l’espace des baisers.
… Le piano s’est tu à l’arrière. Un timonier vient de hisser, sous le taud, le fanal « de la pudeur ». Des points de cigare piquent encore la houle des fauteuils et des pliants. La tente cache tout le ciel. Pleurée par les étoiles et la lune qui court une clarté tombe, puis se blottit, apportée par le rebroussement de l’eau. C’est la nuit du navire. Des ombres, quelque temps encore, ont passé sur vos yeux mi-clos. Parmi ces ombres, l’ombre chère. Et, à un moment, comme si sa course seule se balançait devant votre piège d’amour, vous en avez cassé le rythme, brutalement et tendrement. Vos mains maladroites, vos mains fermes quand même pressent, comme pour les rapprocher, les hanches presque nues de la passagère.
Comme il y a longtemps, semble-t-il, que vous la connaissez, que vous la désirez, cette femme ! N’y a-t-il pas des mois que le navire s’en est allé de la Joliette et vous a emporté avec l’amie, avec elle… Résistante, la voici qui, peu à peu, s’asseoit sur vos genoux, suppliée par les mains fermes et maladroites. S’il y avait quelqu’un encore à l’arrière du paquebot, il ne verrait qu’elle, sur la chaise d’ombre, contre le mât… Vous ne lui demandez rien, à la passagère ; sincèrement elle croirait ne pouvoir rien donner. Mais vous savez, vous, les délices spéciaux et coquets des navires qui s’en vont droit, portant sur eux l’amour… Et l’amie, en son Aventure, s’étonnera d’apprendre, à l’arrière du paquebot énorme, comment, pour s’être laissée attirer vers votre bouche, elle s’est délicieusement assise au sein de son rêve.
Pointe de sadisme, grain de tendresse, marine, hors d’œuvre des désirs affamés sur l’océan, l’Aventure !
Et la passagère, au bout du voyage, ira se perdre dans le petit groupe des blanches que l’exotisme défend contre l’aventure, et l’ami cher de la traversée, redeviendra au bout du voyage, l’officier que les heures immuables du canot-major ramèneront à bord quand il pourrait, peut-être, essayer de rencontrer une solitude comme celle d’après-minuit à l’arrière du paquebot. Et ce sera fini pour lui de l’Aventure jusqu’à revenir au doux pays de France.
Pour elle, la femme, un peut-être plus probable germera du jour où elle sera devenue femme d’outre-mer.
Blasphème du mot joli, interprétation, nul doute, trop large de la passade sentimentale, il faut pourtant effleurer cette façon d’aventure qui est la curiosité mauvaise de la blanche déracinée pour le nègre. L’habitude de voir constamment les hommes de couleur d’abord vainc la répugnance ; les entretiens naïvement impudiques de la domesticité noire, peu à peu, intéressent la maîtresse ; des histoires soufflées au vent des pankas, après dîner, l’étonnent ; et lui reviennent à la mémoire les bilans des viols et des lynchages transatlantiques. Elle a ri, elle s’est moquée. Mais, avant la semaine écoulée, elle essaie. N’est-ce point insolent d’admettre les affirmations des dîneurs bien renseignés, savoir que l’étreinte de ces horribles femelles avec leurs époux ou leurs amants se prolonge toute la nuit, et que la virilité des mâles ne cesse de s’affirmer jusqu’à la séparation des amoureux ? Alors, si c’était vrai, avec les blanches pour le baiser desquelles ils risquent périodiquement la mort, que serait…
Ce que c’est, oh ! les curieuses éclairées en font rarement la confidence : la merveilleuse physiologie des partenaires ne suffit sans doute pas à renverser l’obstacle éternel, l’incompatibilité des races devant le désir.
Que nous voilà loin, sur ce même chemin de l’Aventure, loin des échanges préparés par les cartes postales, la petite correspondance des journaux, les photographies contemplées dans des albums ou sur des cheminées. Demeurez donc dans les villes de la vieille Europe, vous tous « aventuriers », et vous « aventurières ». Souvenez-vous que Carnegie donne ce premier conseil pour conquérir le monde des affaires : séjourner dans les cités anciennes où l’argent est plus concentré. Ainsi plus de baisers sont amassés dans les rues où l’on aima depuis plus de siècles. Et le livre délicieux de Pierre Veber, le livre exact qui s’appelle l’Aventure, tient fort bien entre Montmorency et le Bon Marché.
Que si la paresse, mols aventuriers et aventurières veules, si la paresse vous empêche, la souhaitant, de chercher l’Aventure, vous affirmerez qu’il y a pourtant des pays, des nuits, où l’Aventure vous cherche ; qu’ainsi il apparaît du dernier mauvais goût de théoriser comment l’imprévu des étreintes n’existe pas ; et qu’à tout bien considérer l’impertinence de ces conclusions se pardonne dédaigneusement à un « exclu ». Halte ! je pourrais dire…, mais je ne dirai rien.
Je dirai seulement : « Vous avez raison, Monsieur, et vous Mesdames, d’assurer qu’en prenant le train pour Séville, pour Naples, ou seulement pour la Riviera, vous partez à l’aventure. Certes, dans le moindre hall d’hôtel entre Cannes et Menton, devant le passant du Long’Arno, auprès des bénitiers de la cathédrale à Séville, vous aurez le droit d’espérer, avec beaucoup de raisons, qu’il va « vous arriver quelque chose ». D’ailleurs l’inimitable Lorrain ne vous a-t-il pas dénombré les frissons épars sur la Côte d’Azur ? Parbleu, vous vous y arrêterez, et, s’il vous plaît d’aller à Venise, qui vous empêchera de trouver la chose dont on se souvient entre la place Saint-Marc et l’hôtel Danieli ? Quant à Naples… il suffit.
Oui, il suffit, Monsieur, de votre sourire, du vôtre surtout, Madame…
Et j’aime mieux me taire, ne pas dire que Tartarin aussi, partant sur l’Alpe, s’attendait à ce qu’il « lui arrivât quelque chose », et que Bézuquet eut peine à lui expliquer comment catastrophes, éboulements, abîmes, tout était prévu par un programme parfait… Arrêtez ! Bézuquet pour une fois, n’eut pas raison.
… Il y avait une fois, une fois, il y a bien longtemps…
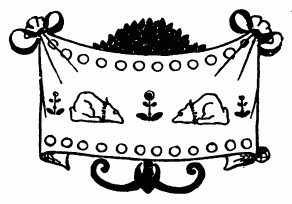
LE RESTE
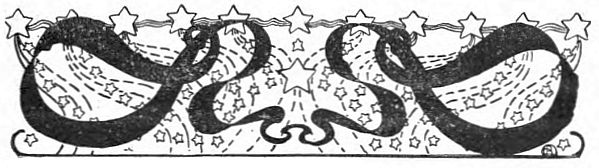

TABLE DES MATIÈRES

| Préface | |
| PSYCHOLOGIE DE L’EXOTISME | |
JAPONAISES | |
| La volupté Vie | |
| Mousmés | |
| La tradition du geste | |
| Swa-Youv | |
| Le Sourire | |
FEMMES DE CHINE | |
| Shang-Haï | |
| Tien-Tsin | |
| Chine intérieure | |
| Che Fou | |
| Bateaux-fleurs | |
| Nan-King | |
| Chinoises d’exportation | |
| Port-Arthur | |
| Saïgon | |
CRÉOLES | |
| In Memoriam | |
| Les Doudous | |
| Des Blanches | |
| Les Saintes | |
| Rencontres | |
| L’Ame des corps | |
FEMMES DE MADAGASCAR | |
| Passades lointaines. — Diégo-Suarez | |
| En colonne | |
| La Grande-Terre | |
| Binaô | |
| La Grande Comore | |
| Majunga | |
| Nossi-Bé | |
| Nossi-Komba | |
| Vohémar | |
| Fort-Dauphin | |
| Tamatave | |
| Japonaises de Tamatave | |
| Sur Ranavalo | |
FEMMES DU PACIFIQUE | |
| Passades lointaines. — Macassar | |
| Nouméa | |
| Nouvelles-Hébrides | |
| Christchurch | |
| Tonga-Tabou | |
| Wallis | |
| Sydney | |
| Mangareva | |
| Tahiti | |
| La baie des Vierges | |
| FANTAISIE SUR L’AVENTURE | |
| LE RESTE | |
