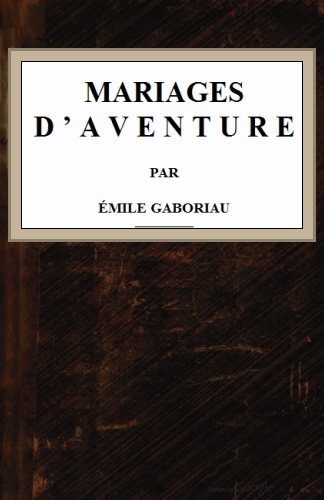
The Project Gutenberg EBook of Mariages d'aventure, by Émile Gaboriau This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Mariages d'aventure Author: Émile Gaboriau Release Date: July 11, 2014 [EBook #46253] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MARIAGES D'AVENTURE *** Produced by Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images available at The Internet Archive)
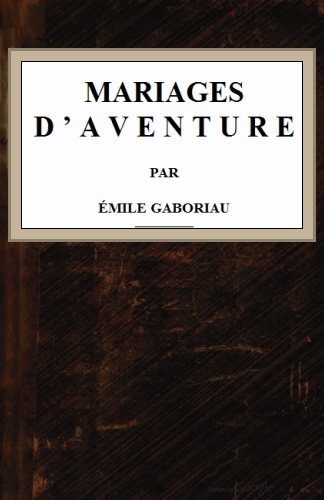
MARIAGES
D ’ A V E N T U R E
PARIS.—IMPR. DE E. DONNAUD, RUE CASSETTE, 9.
PAR
ÉMILE GABORIAU
————
Troisième édition

PARIS
E. DENTU, ÉDITEUR
Libraire de la Société des Gens de Lettres
PALAIS-ROYAL, 17 ET 19, GALERIE D’ORLÉANS
——
1873
Tous droits réservés
A
Madame Georges COINDREAU
Cet automne, chère sœur, au retour de nos courses dans les montagnes des Eaux-Chaudes, j’ai écrit ce volume.
Je te le dédie—témoignage de notre inaltérable affection.
Émile GABORIAU.
| TABLE |
AMBASSADEUR MATRIMONIAL
Pourquoi Pascal Divorne donna sa démission moins de quinze jours après sa sortie de l’École des ponts-et-chaussées, dont il était un des élèves distingués, on ne l’a jamais su au juste.
Il ne prit pas la peine de l’expliquer, et ne donna aucune raison, peut-être parce qu’il n’en avait pas de bonnes à donner. J’entends de ces raisons admirables, basées sur un intérêt certain et un égoïsme prudent, seules admissibles et concluantes pour des juges payant patente.
Les occasions ne lui manquèrent pourtant pas de dire la vérité ou même de mentir. Tout ce qu’il avait à Paris de parents éloignés et de connaissances, le sondèrent habilement. On croyait flairer quelque secret, qui sait, quelque petit scandale-c’était tentant. Il eut la cruauté de tromper l’attente de ces excellents curieux, qui, pour s’immiscer dans les affaires d’autrui, ont l’éternel et banal prétexte d’un intérêt tendre qu’ils n’eurent jamais. Il rit au nez de ces obligeants, toujours prêts à ouvrir leur cœur à une confidence, leur bouche à un bon conseil, mais qui pour rien au monde n’ouvriraient leur bourse s’il en était besoin.
Quelques-uns s’acharnaient. Ceux-là, Pascal les prit à part, et tout bas, mystérieusement, après avoir jeté de tous côtés des regards de conspirateur inquiet, il prononça ce gros mot de politique, lui qui de sa vie ne s’était occupé de politique. Le moyen lui réussit, les entêtés s’enfuirent pleins d’épouvante, croyant déjà voir s’entrebâiller pour les engloutir les portes du mont Saint-Michel.
De guerre lasse, on laissa Pascal tranquille, mais non sans déclarer que c’était un jeune homme peu sociable, qui manquait de franchise et dont il était prudent de se défier, d’autant qu’il avait des opinions par trop avancées.
Restaient les amis. Il leur avoua simplement, sans détails, que, bien que Français et même très bon Français, il avait en horreur toute espèce d’uniforme, fût-il plus brodé qu’une châsse, et qu’un emploi du gouvernement ne pouvait convenir à son caractère; les chances aléatoires de la fortune lui semblaient préférables à des appointements fixes, petits ou gros, gagnés ou non; enfin, son indépendance lui paraissait plus précieuse mille fois que tous les honneurs administratifs, qu’un portefeuille de ministre même, fût-ce de Dieu le père.
Naturellement, ses amis se souciaient infiniment peu du motif caché de ses actions; que leur importait qu’il fît une chose ou une autre? Ils déclarèrent en chœur que la sagesse elle-même parlait par sa bouche et qu’il avait incontestablement raison.
Un seul blâma hautement le jeune ingénieur, et d’un ton paterne lui reprocha son imprudente précipitation. Mais c’était l’intime de Pascal, son confident, son copain du collége Henri IV. Ils avaient fait leurs études ensemble, et depuis ils étaient inséparables.
Ce fidèle Achate transformé en Mentor se nommait Eugène Lorilleux. Il était de deux ou trois ans plus âgé que Pascal. Muni depuis dix-huit mois du diplôme de docteur en médecine, il cherchait péniblement à se faire une clientèle.
Il en était encore aux débuts, plus difficiles, plus hasardeux dans cette carrière que dans toute autre. Il avait des clients, mais des clients qui payaient mal ou même ne payaient pas. Ses malades habitaient les étages supérieurs, tristes habitants des mansardes. Il lui fallait gravir quatre-vingts marches pour signer une ordonnance. Il avait des consultations gratuites et des consultations payantes; mais, comme aux unes et aux autres il ne venait que des pauvres, ce n’était vraiment pas la peine d’établir une distinction.
Mais il prenait patience. Il attendait cette occasion heureuse qui, trois fois dans la vie, dit-on, passe à la portée de chaque homme et qu’il s’agit de savoir saisir.
Travailleur acharné, il comptait sur sa science et sur son talent pour arriver à la réputation et à la fortune. En quoi il se trompait et se trompe encore aujourd’hui. Il est savant, c’est incontestable, mais il lui manque le coup d’œil, le sang-froid, l’audace. Sûr de lui dans son cabinet, imperturbable en théorie, il n’a pas, près du lit du malade, ce sens divinatoire, cette inspiration soudaine qui font les grands, les véritables guérisseurs.
Lorilleux n’est cependant pas un homme ordinaire. Son grand malheur est de n’avoir jamais connu l’enthousiasme. Il n’a eu ni adolescence ni jeunesse. Il est né vieux. Tel vous le voyez aujourd’hui, tel il était à quatorze ans, sur les bancs du lycée, lorsqu’il achevait sa troisième. Rien de changé en lui: ni la taille, ni le caractère.
C’est un petit homme compassé et solennel. Il exagère la gravité, la dignité et le respect de soi-même, au point d’en paraître parfois ridicule.
Sa figure insignifiante n’est certes pas le miroir de son esprit, c’est une page blanche où il n’y a rien à déchiffrer. Plus délié qu’un paysan normand, il a la faiblesse de supposer à tout le monde la même manie de finasserie. Il ne croit pas aux actions indifférentes, et toujours il veut découvrir un but caché.
Vous ne lui ferez pas entendre qu’on agit souvent spontanément, sans plan médité; il vous répondra invariablement: «—Il y a quelque chose là-dessous.» Ses jours se passent à déjouer par d’habiles manœuvres des complots fantastiques, ou à démêler laborieusement le fil imaginaire de quelque trame bien compliquée. Ces craintes exagérées, ces investigations font le malheur de sa vie. Souvent ses amis se sont moqués de ces singulières appréhensions. Lorsqu’ils le rencontrent plus préoccupé qu’à l’ordinaire:
—Eh bien! Lorilleux, lui demandent-ils, as-tu trouvé la petite bête?
Enfin, ce calculateur traite la vie comme une suite de problèmes d’algèbre dont les gens habiles ont toujours la solution en poche. Depuis dix ans, il s’est tracé une règle de conduite qui, croit-il, ne laisse aucune prise au hasard, il ne s’en est jamais écarté d’une ligne.
Faut-il, après cela, s’étonner de son esprit borné, de ses idées étroites? Il est le contraste vivant de Pascal, qui a, lui, des idées larges, une certaine audace de conception et un grand courage d’initiative. Aussi lui reproche-t-il d’être romanesque.
L’opposition des caractères suffirait à expliquer la grande amitié des deux jeunes gens, mais il y avait autre chose encore.
Depuis longtemps déjà le médecin avait des vues sur son ami, qui ne s’en doutait guère. Cela datait du collége.
Lorilleux avait une sœur de dix ans plus jeune que lui, qu’il aimait avec passion. Souvent, à l’âge où les autres adolescents n’ont que des idées de plaisir, il s’inquiétait de cet enfant. Leur mère, madame Lorilleux, était veuve; une rente viagère composait presque toute sa fortune et devait s’éteindre avec elle. Que deviendrait la jeune fille si sa mère venait à mourir? Et même, en écartant ce malheur, quel serait son sort plus tard? Une demoiselle sans dot ne se marie guère, et sa famille, qui avait déjà de la peine à joindre les deux bouts tous les ans, ne pourrait certes lui en donner; son frère n’aurait pas encore eu le temps de lui en amasser une, lorsqu’elle atteindrait ses vingt ans. Où lui trouver un mari?
Voilà les idées qui tourmentaient ce précoce calculateur de dix-sept ans, lorsqu’il vint à penser que son ami Pascal serait plus tard—dans une dizaine d’années—un excellent parti pour cette sœur chérie.
Cette idée parut sublime au prévoyant collégien. Il s’y accrocha, elle ne le quitta plus. A force de la tourner dans tous les sens, de l’envisager sous toutes ses faces, de calculer toutes les probabilités, il en vint à la considérer non-seulement comme admirable, comme nécessaire, mais encore comme devant réussir avec un peu de patience et d’habileté.
—La fortune, se disait-il, ne sera pas un obstacle: la famille de Pascal est riche, et lui est le plus désintéressé des hommes. Ma sœur sera jolie, modeste, bien élevée, elle fera le bonheur de son mari et sera la meilleure des mères de famille. Elle plaira certainement à Pascal. D’ailleurs, s’il ne l’épouse pas pour l’amour d’elle, il l’épousera par affection pour moi, son meilleur ami, afin de resserrer les liens de notre amitié et de devenir mon frère. Ainsi j’assure le bonheur de deux êtres que je chéris. Toutes mes actions doivent tendre vers ce but.
Et voilà pourquoi Lorilleux devint et resta l’intime de Pascal, pourquoi il prit un si tendre intérêt à tout ce qui le touchait. Il savait, à un centime près, le chiffre de la fortune qui devait lui revenir un jour, et il était allé passer quinze jours en Bretagne dans la famille de son «futur beau-frère,» uniquement pour étudier le caractère des parents qu’aurait sa sœur. Il revint convaincu qu’il ne trouverait pas d’obstacles de ce côté.
D’ailleurs, jamais un mot, une allusion ne lui échappèrent. Il ne dit rien qui pût faire soupçonner ses projets ou donner l’éveil. Il était trop prudent pour cela. Sa sœur était encore trop jeune, Pascal n’était pas même sorti du collége. Il fallait attendre, il attendit.
Mais aussi de quels soins il entoura cet ami! Comme il le choyait! comme il s’informait avec sollicitude de tout ce qui avait trait à sa famille! N’y avait-il pas, comme cela arrive si souvent en province, quelque petite cousine élevée à la brochette, quelques projets d’union? Non, rien de tout cela.
Lorsque Pascal fut reçu à l’École polytechnique, Lorilleux était certainement le plus content des deux. Comme il félicita son ami! Quel hymne il chanta à sa gloire! Et en lui-même il disait:
—Allons, ma sœur épousera un officier d’artillerie.
Mais Pascal sortit avec le numéro trois et opta pour l’École des ponts et chaussées.
—Bravo! se dit Lorilleux, qui n’était pas étranger à cette décision, la vie de garnison eût déplu à ma sœur, elle sera la femme d’un ingénieur. Cela m’arrange beaucoup mieux.
Et il se frottait les mains.
On peut juger de son désappointement lorsque le jeune ingénieur donna sa démission, sans l’avoir consulté, sans rien lui avoir fait pressentir. Cet acte d’indépendance déplut fort au médecin; même il le considéra comme une indélicatesse: abandonner une position sûre, une carrière magnifique!
—Peste soit de l’étourdi! répétait-il du ton dont il aurait dit: Ma pauvre sœur a un mari qui fait des folies.
Cependant il cacha un peu son ressentiment. Pascal était Breton, c’est-à-dire qu’il tenait assez à ses idées. Le faire revenir sur une détermination était chose impossible. Lorilleux ne l’essaya pas. C’eût été jeter inutilement du froid sur des relations toujours si chaudement amicales. Mais il blâma énergiquement l’étourdi. La folie était faite, il fallait en tirer parti, et déjà le médecin avait en vue certaine position d’ingénieur.
—Que vas-tu faire, maintenant? demanda-t-il à Pascal, voici cinq années de perdues.
—Tu trouves, cher ami, moi qui croyais avoir mis le temps à profit.
—Mais, encore une fois, à quoi vas-tu te décider?
—Tu verras, j’ai mon projet.
—Ah! fit Lorilleux avec dépit, tu ne m’en avais pas parlé.
—C’est une surprise.
—Enfin! nul plus vivement que moi ne souhaite que tu réussisses. Mais la vie n’est pas un roman. Attends-toi à des déceptions. En tout cas, mon amitié me commande de ne te pas cacher mon opinion: tu as fait une sottise.
Malheureusement l’avis de Lorilleux fut aussi l’avis de M. Divorne le père, avoué licencié près le tribunal de première instance de Lannion (Côtes-du-Nord).
La nouvelle de cette démission intempestive le frappa comme un coup de foudre; il fut atteint au cœur. C’en était fait de ses plus chers désirs, des projets qu’en bon père de famille il avait bâtis sur la tête de ce fils unique.
Voir Pascal, l’héritier de sa fortune et de son nom, ingénieur à Lannion, se promener par les rues avec ce fils, superbe sous l’uniforme brodé, épée au côté, claque sur la tête, tel avait été le rêve de sa vie, et voilà que, par un incompréhensible caprice, il s’évanouissait au moment de devenir une réalité. M. Divorne disait «caprice,» parce que Pascal annonçait purement et simplement qu’il se retirait, sans explication aucune, sans excuse.
On eût été furieux à moins. L’avoué ne se fit pas faute de se mettre en colère. Il envoya à Pascal sa malédiction. Il y avait certes de quoi justifier vingt malédictions.
Cependant, le premier étourdissement passé, le père malheureux essaya de réfléchir. Peut-être eût-il dû commencer par là. Il se demanda jusqu’à quel point un jeune homme de vingt-quatre ans qu’on a réussi à faire admettre à l’École polytechnique d’abord, à l’École des ponts et chaussées ensuite, dont l’éducation représente un capital de plus de trente mille francs, a le droit de donner sa démission sans le consentement de ses parents ou de ses tuteurs. En avait-il vraiment le droit?
L’avoué essaya d’en douter. Il consulta. Hélas! il dut se rendre à l’évidence, et c’est avec une profonde amertume qu’il reconnut une lacune dans la loi. Il maudit le législateur et l’accusa d’imprévoyance, lui, l’interprète, l’admirateur passionné des décrets et ordonnances.
Puis, comme s’il eût été besoin d’aviver sa douleur et d’attiser sa colère, il ne rencontrait dans les rues de Lannion que des figures dolentes; on semblait s’être donné le mot. C’est qu’en moins de rien, la nouvelle avait fait le tour de la ville. Le soir même on en parla en dix endroits différents.
On plaignait le père, on condamnait le fils sans appel.
De ce jour, Pascal fut un homme toisé. Ses compatriotes décidèrent que c’était un garçon perdu, qui n’arriverait jamais à rien, et qui certes finirait mal. Un avoué était bien malheureux d’avoir un fils semblable qui le déshonorerait peut-être quelque jour.
Quelqu’un avança même que M. Divorne avait en deux jours vieilli de dix ans. Encore un peu on eût affirmé que ses cheveux avaient blanchi dans une nuit; on cite des exemples de ce miracle, après d’épouvantables catastrophes.
Bref, Pascal eût ruiné sa famille, fait des faux, mérité le bagne, qu’il n’eût guère été plus honni; tant est grande l’aménité des âmes charitables de province.
Madame Divorne reçut vingt visites dans la semaine; jamais elle n’avait eu tant d’amies. Toutes les femmes qui la connaissaient un peu trouvèrent un bon prétexte pour venir savoir au juste ce qui en était, s’assurer par elles-mêmes de la vérité, et retourner un peu le poignard dans la blessure, si blessure il y avait.
Il faut dire que, tout en condamnant le fils, en compatissant à la douleur du père, on trouvait généralement que cette punition frappait juste. L’avoué avait toujours été heureux, et le bonheur est un tort qui se pardonne difficilement dans les petites villes de province. Le succès de l’un est pour tous une cruelle injure. La jalousie dort au fond de tous les cœurs. Que de haines sourdes et envenimées qui n’ont pas eu d’autre point de départ!
Plus que tout autre M. Divorne était envié. On l’avait connu pauvre, et il était riche. On se souvenait de sa veste de ratine lorsqu’il était petit clerc chez son prédécesseur, et il avait une des plus jolies maisons de la ville. Ah! il avait fait de bonnes affaires.
—Quelle chance il a! disaient ceux qu’une prudence imbécile ou qu’une notoire incapacité attachaient à une immuable médiocrité, quelle chance il a!
Un petit héritage lui avait permis de faire quelques études, la dot de sa femme lui avait payé sa charge d’avoué, et depuis il avait toujours prospéré. Ses économies avaient fait la boule de neige.
Et que de pères il avait humiliés jadis, en comparant leurs fils au sien! Avait-il assez fait parade de la satisfaction que lui donnait cet enfant qui tous les ans revenait chargé de couronnes et n’avait que des boules blanches à ses examens! Et, plus tard, avait-il chanté assez haut ses espérances!
Ce qui arrivait était donc une punition méritée, une preuve qu’il faut se défier de ces collégiens modèles, de ces jeunes gens de tant d’esprit: ils croient à leur supériorité, ils veulent faire autrement que n’ont fait leurs pères, et tournent mal. Il y a longtemps qu’on l’a dit, l’esprit est immoral.
Ainsi, pendant quinze jours, tous les gens qui abordaient l’avoué, ravis au fond de l’âme, croyaient de bon goût de mettre leur visage au diapason supposé de la douleur paternelle. Au palais, il recevait des compliments quotidiens de condoléance; au cercle, des poignées de main de consolation.
Son irritation s’accroissait d’autant, il n’était pas loin de croire que Pascal avait commis un crime. Il rentrait chez lui plus furieux que jamais, et, faute de mieux, il s’en prenait à sa femme dont la faiblesse maternelle, aveugle et imprudente, comme on sait, avait causé tout le mal.
Cependant, à force d’envisager la situation, de l’étudier, M. Divorne finit par se persuader que le mal n’était pas irréparable.
Il songeait sérieusement à écrire au ministre de l’intérieur, à faire le voyage de Paris pour solliciter une audience, lorsque Pascal, un beau soir, tomba comme une bombe dans la maison paternelle. Il arrivait par la voiture qui fait le service entre Rennes et Brest.
Certes, on ne l’attendait guère! Josette, la vieille bonne, qui était allée ouvrir en grondant contre l’impertinent qui se permettait de sonner si fort à pareille heure, faillit tomber à la renverse en reconnaissant son jeune maître. Car elle le reconnut du premier coup, ainsi qu’elle s’en vantait plus tard, bien qu’il fût terriblement changé, et «grandi et renforci,» depuis trois ans passés qu’elle ne l’avait vu.
Elle poussa un cri de joie, de surprise, et, lâchant la chandelle, s’élança dans les escaliers en appelant à elle tout le monde, comme si le feu eût été à la maison.
Pascal, pendant ce temps, avait fermé la porte et s’avançait à tâtons.
—C’est moi, criait-il en riant, c’est moi, n’ayez pas peur.
Aux cris perçants de Josette, la porte du salon s’était ouverte.
—Eh bien! qu’est-ce, qu’est-ce donc? demandait l’avoué surpris de ce désordre.
Josette, tout émue, n’était pas près de recouvrer la parole. Mais déjà madame Divorne avait reconnu la voix de son fils et se précipitait à sa rencontre. Et l’avoué répétait encore: «Qu’est-ce, qu’est-ce?» que déjà Pascal était dans les bras de sa mère qui pleurait de bonheur, tout en le serrant à l’étouffer sur son cœur.
Par lui, par ce fils chéri, elle avait bien souffert depuis quinze jours; mais sa présence seule était une justification complète, une compensation plus que suffisante. Il parut, et tout fut pardonné, ou plutôt oublié.
Quant à M. Divorne, il crut de sa dignité de rester impassible. Pouvait-il faire moins pour le principe d’autorité paternelle? Il réussit, ma foi, à dominer son émotion, non sans peine, non sans une légère grimace qui dissimulait une larme. Mais enfin il demeura convenablement froid et sévère, et sa figure exprima le mécontentement, même en embrassant ce fils, autrefois sa joie et son orgueil.
Par exemple, c’est tout ce qu’il put prendre sur lui. A l’étreinte de son fils, il sentit que sa colère se fondait comme les neiges aux brises d’avril. L’attendrissement le gagnait. «Il ne voulut pas donner sa faiblesse en spectacle,» et, prétextant une affaire urgente,—une affaire urgente à Lannion, à neuf heures du soir!—il sortit précipitamment, en se mouchant plus fort que de raison.
L’enfant prodigue était revenu, et le père, comme celui de l’Ecriture, n’avait pas ordonné de tuer le veau gras pour fêter le retour. Il est vrai que le père de l’Ecriture n’était pas un avoué au tribunal de première instance.
Pascal resta donc seul avec sa mère. Il fallait s’occuper de faire souper le voyageur.
Il avait l’appétit d’un homme qui depuis deux jours vit d’à-comptes dérobés à la hâte aux buffets des chemins de fer, c’est-à-dire que, n’ayant pas voulu s’étouffer, il mourait de faim. Josette s’empressait de dresser la table devant la cheminée. Elle allait, venait, du salon à la cuisine, de la cuisine au salon, perdant la tête, faisant dix tours pour un; de temps à autre elle essuyait une larme ou cassait une assiette, preuves manifestes de son émotion.
Madame Divorne s’était assise vis-à-vis de son fils qui dévorait. Elle était en extase, elle l’admirait, elle eût voulu pouvoir rester ainsi des années. Mais une explication était imminente entre Pascal et son père, cette explication pouvait être orageuse. Ne fallait-il pas prévenir Pascal, obtenir de lui quelque concession? Elle voulait s’interposer, au risque d’attirer sur elle le poids de deux colères.
—Ton père est bien irrité, méchant enfant, dit-elle; tu nous donnes, tu lui donnes du moins bien des tourments.
—Mais non, chère mère, je t’assure; va, sois tranquille, ce ne sera rien.
—Au moins fallait-il le prévenir, lui demander conseil.
—Certain d’avance d’un refus! Quelle folie! j’aurais passé outre: juge alors.
—Au moins promets-moi d’être raisonnable s’il te gronde, de ne pas te mettre en colère.
—Je te le promets; mais tu verras comme j’ai eu raison.
—Ah! je le souhaite, murmura tristement madame Divorne.
Pascal l’embrassa, et sa cause fut gagnée. Désormais elle était prête à se ranger du côté de son fils, sûre qu’il ne pouvait avoir tort.
Voilà pourtant comme toutes les mères sont difficiles à convaincre! Ah! elles ne se paient pas de mauvaises raisons!
Il paraît que l’avoué ne recouvra pas son courage en route. Lorsqu’il revint, l’affaire urgente terminée, sa figure était loin d’avoir gagné en sévérité. Il ne fut question de rien. Il causa fort amicalement avec son fils. Il rit, plaisanta, mais de la démission, pas un mot.
Il n’en fut pas question davantage le lendemain, ni les jours suivants. Dieu sait pourtant qu’on ne se faisait pas faute de lui demander partout où il paraissait:
—Votre fils est donc ici? Eh bien?...
Le bruit de ce retour s’était en effet répandu très vite. On avait vu le facteur entrer chez l’avoué avec une malle et un carton à chapeau: les visites assiégèrent la maison. Mais madame Divorne défendit sa porte. Elle s’est fait ce jour-là des ennemis qui ne lui ont pas encore pardonné.
Une fois, Pascal s’avisa de sortir. Il n’avait pas fait cent pas dans la rue que cinq personnes déjà, dont deux qu’il ne connaissait guère et une qu’il ne connaissait pas du tout, étaient venues lui serrer la main et lui demander hypocritement des nouvelles de l’École des ponts et chaussées.
Il rentra tout courant, maudissant ses compatriotes, et se jurant bien de ne plus mettre le nez dehors.
Les jours se passaient, et M. Divorne semblait avoir complétement oublié ses griefs contre son fils. Vingt fois celui-ci, que cet état d’incertitude tourmentait, serait allé au-devant de l’explication qu’il était venu chercher; sa mère le retint toujours.
—Attends, lui disait-elle. Je connais ton père, il est très long à prendre un parti. Il réfléchit depuis ton arrivée. Lorsque sa décision sera bien arrêtée, il t’en fera part, sois tranquille.
Un matin, en effet, après déjeuner, lorsque la nappe fut ôtée, l’avoué, d’un air grave, pria son fils de lui prêter toute son attention.
—Allons, pensa Pascal, le moment est venu.
M. Divorne était prolixe d’ordinaire, on le lui reprochait au palais; mais jamais, comme en cette circonstance solennelle, il n’abusa du don précieux de la parole.
L’exorde de son discours fut une sorte d’invocation à l’amour paternel. Qui mieux que lui en avait compris les devoirs? Il en faisait son fils juge: avait-il assez donné de preuves de son affection? Et quelle avait été sa récompense?
Puis il passa à l’énumération des soucis sans nombre que donnent les enfants. Rien ne fut oublié, ni les inquiétudes de la première dentition, ni un voyage en poste à Paris, à une époque où Pascal avait été malade. Ce fut le premier point.
Le second traita des sacrifices pécuniaires. Ce fut le plus long. L’avoué calcula, chiffra tout ce qu’il avait déboursé,—à une paire de souliers près,—pour donner à son fils les bienfaits de cette éducation qui lui avait manqué à lui-même.
Enfin, comme de juste, dans une troisième partie, il aborda le chapitre des compensations: il tint compte des satisfactions de tout genre qu’il devait à Pascal. Elles étaient nombreuses, il n’en omit pas une seule.
En un mot, ce discours fut comme la lecture du grand-livre en partie double de la paternité, avec ses chagrins, ses pertes d’une part, ses joies, ses bénéfices de l’autre. Jusqu’alors, M. Divorne le constatait, la balance était en faveur de son fils, et lui, le père, se reconnaissait débiteur.
—Et maintenant, ajouta-t-il en manière de conclusion, j’espère, Pascal, que tu ne voudras pas changer cet état de choses. Tu as dû réfléchir depuis que tu es ici, tu dois regretter d’avoir si follement brisé ta carrière. Reviens sur ta décision, adresse-toi au ministre, il ne te refusera pas ta réintégration, et je suis prêt à te pardonner le vif chagrin que tu m’as causé.
L’effet produit fut loin d’être celui qu’attendait M. Divorne. Pascal garda quelques instants le silence, comme s’il eût rassemblé toutes ses forces. On eût pu croire qu’il hésitait à répondre. Enfin, d’une voix ferme:
—Mon père, dit-il, ce que vous désirez est impossible. Ma demande, croyez-le, serait repoussée; d’ailleurs, je ne saurais me décider à la faire.
—Fort bien, reprit l’avoué de l’air le plus mécontent; il est si facile aujourd’hui de se faire une position. Sans doute, vous avez trouvé mieux?
—Sinon mieux, au moins plus à mon goût. Vous devez penser que j’ai réfléchi avant d’agir. Quant à mes intentions, je suis venu ici précisément pour vous en faire part. C’était d’autant plus nécessaire, que j’aurai besoin de vous.
—C’est vraiment fort heureux. Je comprends alors que tu aies songé à moi. Et en quoi pourrai-je t’être utile?
—Avant de rien entreprendre, il est nécessaire que je me procure des fonds, et j’ai compté...
—Ah! nous y voici donc, dit l’avoué d’un ton goguenard; il te faut des fonds... Mais il me semble qu’avant de quitter une position toute faite, tu devais t’assurer de ma bonne volonté. Si je te refusais... et certes, je refuserai...
—Mais, mon père, reprit Pascal avec un peu d’impatience, il me semble qu’il y a dix ans à peu près une de mes tantes m’a laissé par son testament une quarantaine de mille francs.
Une vieille plaideuse de soixante ans, à peu près certaine du gain d’un de ses procès, serait venue dire à l’avoué: «—J’y renonce,» elle l’eût certes moins surpris qu’il ne le fut aux paroles de son fils.
—C’est-à-dire que tu me demandes des comptes, prononça-t-il avec amertume. Ah! c’est une surprise cruelle.
Pascal eut beau se défendre, le coup était porté. Il essaya d’expliquer ses projets à venir, il voulut se justifier, faire connaître l’emploi de l’argent qu’il demandait, M. Divorne se refusa même à l’écouter.
—Eh! que m’importe, disait-il, je ne veux rien savoir.
En effet, il était bien loin de la discussion présente. Il avait oublié jusqu’à la démission; il ne songeait plus qu’au moyen de sauver cet argent que Pascal, il devait bien se le dire, était en droit de réclamer.
Il cherchait quelque moyen pour donner le moins possible, convaincu qu’un si jeune homme ne pouvait faire qu’un détestable usage d’une somme aussi forte.
—Voyons, Pascal, dit-il enfin, je comprends que tu aies besoin d’argent. Cependant, tu pouvais t’y prendre d’une autre façon pour m’en demander. Suis-je donc un père ridicule? T’en ai-je jamais refusé? Tu n’as pas abusé, je le reconnais. Mais voici cinq ans que tu travailles beaucoup, peut-être désires-tu te distraire, faire un voyage...
—Mais non, mon père, si vous me laissiez parler, je vous...
—Tais-toi, écoute: tu as sans doute des dettes. Eh! mon Dieu! tous les jeunes gens en ont...
—Je ne dois pas un sou.
—Mais écoute-moi donc, je ne te demande rien. Sois franc, tu as besoin de cinq mille francs?
—Mon cher père...
—Il te faut davantage... soit, tu auras dix mille francs.
Et l’avoué, se levant, comme pour annoncer que la discussion était close, se dirigea vers la porte. Pascal comprit qu’il fallait en finir.
—Mon père, dit-il, j’ai besoin de tout ou de rien.
—Rien alors, répondit M. Divorne d’un ton menaçant, en revenant sur ses pas; rien. Crois-tu que je vais, jeune insensé, te laisser dissiper ta petite fortune?
—Cet argent m’est nécessaire, pourtant, indispensable.
—Ah! c’est indispensable; soit. Ta tante t’a laissé une ferme, une ferme que je te rendrai en bon état, avec un bail avantageux. Soit, reprends tes biens et arrange-toi. Qu’en feras-tu?
—Je les vendrai.
—Et tu crois que cela te donnera de l’argent du jour au lendemain? Il faut attendre une occasion, chercher un acquéreur, poser des affiches...
—Je chercherai, je poserai des affiches.
—Mais tu n’y penses pas, malheureux! et que dirait-on à Lannion, si on te voyait vendre seulement un franc de terre! Sais-tu ce qu’on dirait?
—Eh! que m’importe! s’écria Pascal avec vivacité. Je vais commander les affiches de ce pas.
M. Divorne connaissait son fils. Il comprit que sa détermination était prise.
—Arrêtez, dit-il, je veux vous éviter cette honte. Je trouverai l’argent, dussé-je faire un sacrifice.
Pascal, qui regrettait de s’être un instant laissé emporter, voulut prendre les mains de son père; mais il le repoussa.
—Epargnez-vous d’inutiles protestations, fit-il; et il ajouta d’un air d’ironie: Vous voudrez bien, je l’espère, m’accorder huit jours.
Et il sortit en fermant la porte avec violence.
Pendant cette discussion, madame Divorne n’avait pas prononcé une parole; elle pleurait. Pascal, que la colère paternelle avait affermi dans sa résolution, se sentit faible devant les larmes de sa mère.
Il s’agenouilla près d’elle, et lui prenant les mains:
—Mère, dit-il, chère mère, un mot, dis un mot, et je renonce à mes projets, et j’essaie de retirer ma démission.
Un éclair de joie brilla dans les yeux de madame Divorne, éclair de triomphe aussi. Comme son fils l’aimait! que ne lui sacrifiait-il pas, lui si ferme tout à l’heure!
—Non, mon Pascal, non, suis tes inspirations, j’ai confiance, moi.
—Chère mère, au moins faut-il que tu saches...
—Rien, je ne veux rien savoir. Je te le répète, j’ai confiance; comprendrais-je, d’ailleurs?
Et comme il s’obstinait, elle lui ferma la bouche de ses deux mains.
La maison fut bien triste pendant les jours qui suivirent. L’avoué était sombre et ne disait mot. On ne le voyait qu’aux heures des repas; le reste du temps il s’enfermait dans son cabinet. Madame Divorne se cachait pour pleurer.
Pascal n’avait pas idée d’un tel supplice. Il aurait donné deux ans de sa vie pour pouvoir partir. Si encore il avait pu causer de ses projets, étaler ses plans. Mais non, il fit près de son père deux ou trois tentatives inutiles, et sa mère lui répondait toujours: «—J’ai confiance,» sans vouloir lui laisser dire une parole.
Enfin, le jour indiqué, M. Divorne conduisit son fils dans son cabinet.
—Voici, dit-il, en lui montrant une liasse d’actes, vos comptes de tutelle. Voyez si j’ai administré vos biens en bon père de famille. Lisez, et donnez-moi quittance.
Pascal prit une plume.
—Non, lisez, insista l’avoué.
Et comme le jeune homme s’y refusait, il prit les actes, et lui-même lut à haute voix, insistant sur certains détails, et de temps à autre s’arrêtant pour demander:
—Êtes-vous satisfait de ma gestion?
Les actes étaient longs. Pascal se mourait d’impatience, lorsqu’enfin cette lecture, véritable supplice qui dura près de trois heures, fut terminée.
—Maintenant, dit le père, voici votre argent. Il vous revient, comme vous avez pu vous en convaincre, quarante-trois mille sept cent cinquante-six francs soixante centimes. Comptez si tout y est.
Pascal mit les billets et l’argent dans sa poche; son père l’arrêta:
—Non, comptez, vous dis-je, j’y tiens.
Il fallut obéir.
—Nous sommes quittes, n’est-ce pas? dit alors l’avoué. Quand partirez-vous?
—Mais le plus tôt possible, dès demain, si je puis avoir une place dans la voiture... On m’attend à Paris.
—En effet, vous auriez tort de vous faire attendre.
—Cependant, mon père, je ne voudrais pas nous quitter ainsi; vous êtes injuste à mon égard, et je...
—Chansons que tout cela! fit l’avoué avec impatience; laissez-moi, j’ai à travailler.
Le lendemain matin, à neuf heures, le garçon des messageries vint avertir Pascal qu’on attelait les chevaux à la diligence, et qu’il n’avait que le temps de se rendre au bureau.
Les adieux furent pénibles. Madame Divorne sanglotait. A la voir étreindre son fils, on aurait pu croire qu’elle l’embrassait pour la dernière fois. Pascal n’était guère moins ému que sa mère; à peine s’il pouvait retenir ses larmes; il lui eût été impossible de prononcer une parole.
C’est en cette circonstance que M. Divorne montra bien quelle était la force de son caractère et l’énergie de sa volonté,—une volonté de fer.—Non-seulement il ne voulut pas embrasser son fils, mais encore il refusa de lui donner la main. Il affecta même un ton railleur et dégagé.
—Souvenez-vous, dit-il à son fils, que vous portez avec vous toute votre fortune. Lorsqu’elle sera dissipée, ce qui, je présume, ne sera pas long, vous me ferez sans doute l’honneur de recourir à moi; je vais toujours faire préparer votre chambre.
Pascal se rendit seul à la diligence. Les gens de Lannion en conclurent qu’il venait d’être chassé par son père.
Il y aura six ans, vienne le mois de février, que Pascal est de retour à Paris après son expédition en Bretagne. Il arriva à la gare de Montparnasse par le train de cinq heures du matin.
Il faisait un joli petit froid de sept à huit degrés au-dessous de zéro. On ne trouva cependant aucun voyageur de gelé dans les wagons: cet accident arrivait parfois en hiver, avant l’heureuse idée, qu’ont eue les Compagnies, d’utiliser au profit des voyageurs la vapeur perdue de la locomotive.
Pascal avait fait un triste voyage. Il adorait ses parents, et l’idée du chagrin qu’il venait de leur causer lui pesait sur le cœur comme un remords. Jamais route ne lui parut plus longue; il lui semblait que la locomotive roulait sur place: il lui tardait d’être à Paris. Quelques heures de sommeil auraient trompé son impatience, mais c’est vainement qu’à plusieurs reprises il prit ses dispositions pour reposer: à peine fermait-il les yeux, qu’il était réveillé par quelqu’un des nombreux agents que la Compagnie entretient et paie pour empêcher les voyageurs de dormir; à chaque moment on lui demandait son billet, pour y faire des trous de forme variée avec un petit instrument de fer.
Il faut dire aussi que le jeune ingénieur n’avait pas été élevé à se promener avec 40,000 francs dans son porte-monnaie. La liasse de billets de Banque qu’il avait en poche ne laissait pas de l’inquiéter un peu. En homme prudent, il garda la main dessus, de Lannion à Paris. En arrivant, il avait le bras engourdi.
Harassé de fatigue, les jambes brisées, il gagna la salle où il est d’usage que les voyageurs attendent leurs bagages pendant quelques quarts d’heure. Il venait de s’asseoir, lorsqu’il s’entendit appeler par une voix joyeuse.
—Eh! monsieur l’ingénieur! monsieur l’ingénieur!
Il se retourna, et le long de la grille si ingénieusement disposée pour séparer les arrivants de leurs amis venus au-devant d’eux, il aperçut un gros homme à face épanouie qui lui faisait toutes sortes de signes d’amitié. Il courut à lui.
—Enfin, vous voilà, monsieur l’ingénieur, dit l’homme, j’ai reçu votre lettre, je vous attendais. Avez-vous fait bon voyage, au moins?
—Pas des meilleurs. Ah! père Lantier, si vous n’aviez pas eu ma parole! Enfin, j’ai l’argent.
—Chut!... plus bas, au nom du ciel... si on vous entendait! Est-ce qu’on parle d’argent comme cela tout haut? Le mien est prêt aussi; je l’ai porté à la Banque. Chez moi, il m’empêchait de dormir. Nous allons le faire un peu travailler, cet argent, s’il vous plaît.
—Oui, dit Pascal avec un soupir, il s’agit de ne pas perdre la partie.
—Perdre la partie, monsieur l’ingénieur, avec tous les atouts en main; vous voulez rire, sans doute. Ah çà! vous descendez chez moi, ici, à deux pas.
—Mais, mon brave ami, je vais vous gêner horriblement.
—Me gêner! un homme comme vous. Ah! vous ne me feriez pas l’injure de descendre à l’hôtel! Vous ferez un bon somme jusqu’au déjeuner, nous causerons après. Allez, j’ai déniché une fameuse affaire. Je vais toujours chercher une voiture.
Si Lantier ne tira pas le canon pour M. l’ingénieur, c’est qu’il n’avait pas de canon. Mais la maison avait été mise sens dessus dessous; une bonne chambre bien chaude, une bouteille de vieux vin, un bouillon délicieux attendaient Pascal. Lorsqu’il fut prêt à se mettre au lit:
—Je vous quitte, lui dit Lantier; s’il vous manque quelque chose, appelez...
—Merci, je n’ai besoin que de sommeil. A tantôt, mon cher associé.
Le brave homme referma doucement la porte et s’éloigna sur la pointe du pied.
—C’est pourtant vrai, se disait-il, je suis son associé. Qui m’aurait dit cela, que je deviendrais l’associé d’un homme comme lui, qui était le premier des ponts et chaussées!
Jean Lantier, l’associé de Pascal, est à cette heure un des entrepreneurs aisés de Paris. Il ne sera jamais très riche, parce qu’il n’est pas ambitieux. Il compte se retirer des affaires aussitôt qu’il pourra donner 50,000 écus à chacune de ses filles; il en a trois, tout en gardant pour lui une vingtaine de mille livres de rentes.
Il y a vingt ans, Jean Lantier roulait la brouette sur une grande route, au service des ponts et chaussées. Il était gai et bien portant. Comme il gagnait 67 francs par mois,—déduction faite d’une retenue pour la caisse des retraites,—comme il avait une bonne conduite et qu’il n’était pas mal de sa personne, il trouva un bon parti pour s’établir.
Il se maria, et reçut en dot, de son beau-père, une somme ronde de 6,000 francs en bons écus sonnants. Sa femme était douce, jolie, bonne ménagère; il se trouva le plus heureux des hommes.
Mais les enfants vinrent. La famille augmenta, les appointements restèrent les mêmes, la gêne entra dans le ménage. Jean Lantier ne gagna plus que juste de quoi s’empêcher de mourir de faim, lui et les siens. On mettait de côté autrefois, il fallut prendre au sac.
—«Cela ne peut durer ainsi,» grommelait sans cesse Lantier. Et un beau jour il fit un coup de tête.
—«Au petit bonheur,» dit-il. Il rendit à l’administration pelle et brouette, malgré sa femme qui l’engageait à patienter.
A la tête d’un capital de 2,000 écus, il se lança dans les entreprises de terrassements. Mais en tout il faut un apprentissage: il l’apprit à ses dépens. Sa première affaire engloutit la moitié de son avoir. Il ne se découragea pas. Sentant l’insuffisance de son instruction, il travailla, le soir, et même fit la dépense de quelques leçons. Après deux ou trois entreprises de blanc, c’est-à-dire sans profits ni pertes, il regagna le capital perdu, le risqua de nouveau, l’augmenta, et finalement le doubla.
A quarante ans, il était à la tête de 40,000 francs qui ne devaient pas un centime à personne. Et il avait bien vécu, et ni la femme ni les enfants n’avaient enduré de privations.
C’est vers ce temps que Jean Lantier fit la connaissance de Pascal, qui dirigeait les travaux dont il avait la concession.
Le jeune ingénieur se prit d’amitié pour son entrepreneur. C’était un homme laborieux, intelligent, on pouvait compter sur lui. Tous ceux qui le connaissaient l’estimaient. Ses confrères l’appelaient un gâte-métier, parce qu’une fois un traité signé, il avait l’habitude de l’exécuter, dût-il y perdre.
Il arriva que Pascal eut l’occasion de rendre un assez grand service à son entrepreneur. Contre l’ordinaire, l’obligé fut reconnaissant. Jean Lantier, qui avait toujours professé une grande vénération pour les ponts et chaussées, reporta tout cette vénération sur le jeune ingénieur. Bientôt son admiration n’eut plus de bornes, il allait partout chantant ses louanges, et tout le bien qu’il disait, il le pensait.
Les travaux terminés, l’entrepreneur ne perdit point Pascal de vue. Il allait le voir assez souvent, tantôt pour le seul plaisir de causer avec lui, tantôt pour lui demander un conseil. Sans trop savoir pourquoi, Lantier se serait jeté dans le feu pour son ami l’ingénieur.
Cependant, la dernière année d’études de Pascal touchait à sa fin, et déjà il songeait sérieusement à donner sa démission. S’il hésitait, s’il tardait encore, c’est qu’il désirait trouver tout de suite à utiliser son activité et ses aptitudes. Il attendait avec impatience le résultat de certaines démarches qu’il venait de faire près d’une grande Compagnie de chemin de fer.
La réponse tardait à venir.
Jean Lantier, sans s’en douter, mit fin aux incertitudes du jeune homme.
On était alors au fort des démolitions de Paris, si toutefois elles ont diminué. Des quartiers entiers recevaient congé, des rues populeuses tombaient, et étaient comme par enchantement remplacées par des voies nouvelles. Lantier rêvait de devenir démolisseur.
C’est une profession toute moderne, qui a ses héros et ses dupes, mais qui compte bon nombre de millionnaires.
Avant de rien tenter, cependant, avant de confier son sort et son argent à une soumission cachetée, l’entrepreneur était venu consulter le jeune ingénieur. Le brave homme se grisait de ses espérances, ses projets lui montaient à la tête. Il en parlait sans cesse, et avec la volubilité de l’enthousiasme; il les exposait avec la clarté de la conviction.
Il eut vite mis Pascal au courant. Il lui expliqua les mystères d’un métier alors bien moins connu qu’aujourd’hui, et lui en montra le fort et le faible. Il parlait en expert, ayant longtemps étudié «le bâtiment,» aussi bien pour la démolition que pour la construction. Lorsqu’on a mis quarante ans à amasser sou à sou 40,000 francs, on ne les expose pas volontiers sur une seule carte.
Mais Lantier était sûr de son fait. Il avait déjà essayé quelques petites spéculations qui lui avaient réussi; il avait eu des huitièmes, des douzièmes de lots, et il ne regrettait qu’une chose, d’avoir été trop timide, trop prudent. Il avait au reste la vocation. Jamais démolisseur ne tira plus ingénieusement parti des vieux matériaux: il est le premier qui ait eu l’idée d’entreprendre en grand la vente des bois de démolition comme bois à brûler. Il occupe vingt hommes dans le vaste chantier qu’il a établi près de l’ancienne barrière de Monceaux, et chaque jour il s’y débite des centaines de stères de gros bois, qu’achètent les gens aisés, et des milliers de petits fagots à cinq sous, chauffage économique des pauvres ménages.
Involontairement, Pascal prêta toute son attention à un homme si sûr de réussir qu’il se faisait fort de doubler son capital en moins d’un an.
—Voyez-vous, monsieur l’ingénieur, disait Lantier, voici comment la chose se passe: La ville veut démolir un quartier pour le reconstruire, n’est-ce pas? Il lui faut bien déblayer le terrain et jeter bas les vieilles constructions. Que fait-elle, alors? elle divise son quartier par lots de deux, de quatre, de dix maisons, cela dépend; puis elle met ces lots en adjudication. Les entrepreneurs soumissionnent, et celui qui offre les conditions les plus avantageuses a le lot. Vous comprenez bien qu’entre gens du métier, on est assez raisonnable pour s’entendre et ne pas laisser tomber les prix. Qu’on ait donc une adjudication sur cinq ou six, et on fait joliment ses affaires...
—Mais il faut beaucoup d’argent, objecta Pascal.
—Pas tant que vous croyez. La ville fait crédit. Elle se contente d’un cautionnement qui varie selon l’importance du lot. Mais on n’est pas longtemps à se faire de l’argent comptant. Tout se vend, voyez-vous, dans une maison, du pignon aux fondations, de la cave au grenier. On construit, si on démolit, et ceux qui font construire ont du bénéfice à acheter du vieux qui fait d’ailleurs tout aussi bon usage que du neuf; ils ont vite débarrassé les démolisseurs de leurs marchandises. On leur cède les ardoises, les portes, les fenêtres, les cheminées, les carreaux, les escaliers, tout enfin, de la pierre, du bois et du fer. Des lattes de la toiture, on fait des fagots à deux sous, on débite les poutres trop vieilles pour resservir, on nettoie les briques, et on trouve encore à se défaire des platras...
—Mais gagne-t-on vraiment de l’argent?
—A boisseaux, monsieur l’ingénieur, à boisseaux...
Et tenez, vous connaissez bien le grand Joigny, n’est-ce pas, qui travaillait avec moi? eh bien! à cette heure il a une voiture, oui, monsieur, une voiture, et il l’a payée, et elle est à lui... Pourtant il était bête et paresseux, et il a commencé avec deux sous qu’il avait empruntés. Ah! si j’avais cent mille francs au lieu de quarante mille, et le bonheur d’avoir un homme comme vous avec moi...
Lantier s’arrêta, s’apercevant que son auditeur ne l’écoutait plus.
—Ah! murmurait Pascal, répondant à ses pensées secrètes, c’est bien tentant.
—Quoi! comment! que dites-vous! s’écria l’entrepreneur, le cœur vous en dirait-il? Non, ce serait trop de chance. C’est pour le coup que ma fortune serait faite. Qu’est-ce qui me manque à moi? c’est de voir en grand. Les grosses affaires me font peur, et je manque les meilleures occasions. Ensuite il faut se faire des relations, comme on dit, voir l’un, voir l’autre, causer avec les gros bonnets pour se tenir au courant, et moi je n’ose pas; tandis qu’avec vous!... ah! je n’aurais plus peur de m’enfoncer; j’irais trouver le préfet lui-même, oui, et je lui dirais: «Vous voulez démolir Paris; soit, je m’en charge, et voilà monsieur l’ingénieur qui vous le rebâtira, et un peu mieux, j’ose le dire, que tous vos architectes.»
L’enthousiasme du brave homme fit sourire Pascal.
—Vous riez, continua-t-il, je ferais pourtant comme je le dis. Ce n’est pas tout d’abattre, il faut reconstruire: voilà votre affaire. Et à cela encore on gagne gros. De trois vieilles maisons on en fait une neuve. Ce n’est pas plus malin que ça... Mais bast, est-ce que vous songez seulement à ce que je vous débite là?
—Écoutez, Lantier, reprit Pascal, j’ai besoin de réfléchir à tout ce que vous venez de me dire. Je puis compléter les cent mille francs, et il est possible que je réalise votre idée d’association. Repassez dans trois jours, et je vous rendrai réponse.
Au jour indiqué, longtemps avant l’heure, Lantier, qui ne vivait plus, se présentait chez l’ingénieur, le cœur battant de crainte et d’espoir.
—Eh bien! lui dit Pascal, dès qu’il entra, j’ai réfléchi, c’est une affaire conclue.
Lantier faillit devenir fou de joie.
—A nous Paris! s’écria-t-il.
Et dans son exaltation, il embrassa son ingénieur, et ensuite lui demanda pardon de la liberté grande.
Il fut alors convenu que Pascal allait partir pour la Bretagne afin de se procurer l’argent nécessaire. L’entrepreneur, de son côté, devait, pendant le voyage de son associé, réunir ses capitaux et se mettre en quête de quelque bonne affaire, car il s’agissait de ne pas perdre une minute.
Les deux associés prouvèrent bien qu’ils connaissaient la valeur du temps. Dès le jour de son arrivée, Pascal trouva la besogne préparée. Il avait à peine déjeuné, après s’être bien reposé, que Lantier alla chercher une grande feuille de papier sur laquelle il avait pris ses notes, et lui démontra la nécessité d’acheter une demi-douzaine de maisons de la rue de la Harpe, qu’on démolissait alors pour faire place au boulevard Saint-Michel.
Lorsque Lantier eut fini, ils convinrent d’aller ensemble le lendemain visiter leurs acquisitions futures. Il s’y rendirent en effet, et, après une journée passée à mesurer, à calculer, à estimer la valeur approximative de chaque chose, ils arrêtèrent leur prix définitif, et le soir même Pascal rédigea la première soumission de la société Pascal et Lantier.
Ils avaient toutes chances d’être adjudicataires, car leur offre était élevée; mais pour leur première affaire ils étaient décidés à se contenter d’un très-petit bénéfice, suffisant cependant, eu égard aux chances de perte: une trentaine de mille francs environ, à leur estimation. Cela fait, ils n’avaient plus qu’à attendre le résultat.
Cependant Pascal ne pouvait demeurer éternellement chez son associé, bien que celui-ci l’eût vivement désiré. Il se mit à la recherche d’un domicile, recherche pénible, et, après avoir gravi une centaine d’étages, il finit par arrêter un petit logement tout meublé qui ne lui convenait pas le moins du monde; mais cet appartement était à deux pas de l’Hôtel de Ville, désormais le centre de ses opérations. C’est en effet sous les combles de l’hôtel de la préfecture de la Seine, dans une galerie vitrée, à cent quatre-vingts marches au-dessus du sol, que se traitent toutes les affaires de grande voirie.
Pascal était à peine installé dans son nouveau domicile, qu’il vit accourir Lorilleux, prévenu enfin de son retour. Le médecin n’avait pas été sans inquiétude depuis un mois. Qu’était devenu le futur mari de sa sœur? que comptait-il faire? reviendrait-il? Et il se désespérait. Aussi venait-il vite prendre de ses nouvelles.
En entrant chez son ami, il se heurta contre Jean Lantier qui sortait, mais il ne prit pas garde à cet homme qui portait le costume des ouvriers aisés.
—Enfin, je tiens mon déserteur, cria-t-il dès la porte; le voici revenu, le pigeon voyageur; laisse-moi te serrer les mains et me poser en point d’interrogation. Ah çà! que signifie cette fugue, daigneras-tu me l’apprendre?
—Oh! très volontiers, d’autant qu’il n’y a plus à revenir maintenant sur ma détermination...
—C’est-à-dire que tu redoutais mes conseils, ta folie se défiait de ma sagesse. Très bien! je suis fixé; tu as dû faire des choses insensées.
—Je ne le pense pas.
—Excuse-toi, alors, défends-toi, j’écoute.
—Eh bien, mon cher ami, je suis marchand de maisons en vieux, maçon en gros, entrepreneur de démolitions, si tu l’aimes mieux.
—Oh! c’est impossible! exclama le médecin, toi, un ancien élève de l’École polytechnique?... tu veux sans doute plaisanter.
—Pas le moins du monde, et ce gros homme couvert de plâtre que tu as heurté en entrant est mon associé; il venait m’apprendre que nous sommes adjudicataires de neuf maisons rue de la Harpe; nous allons y mettre le pic dès demain.
Alors il raconta au médecin l’histoire de l’association, du voyage en Bretagne, des quarante mille francs, de la colère de M. Divorne.
Lorilleux, en l’écoutant, semblait plus surpris qu’un homme qui tombe des nues. A chaque instant il poussait des exclamations d’étonnement, des oh! des ah! il levait vers le ciel des bras désespérés. Enfin, lorsque Pascal eut fini:
—Cher ami, lui dit-il, tu as perdu la tête, il n’y a rien à faire à cela. Tu crois que la vie est un roman, et tu as agi comme un héros de feuilleton. Quand Paul Féval veut du bien à un de ses personnages, il lui fait cadeau d’un million, sans bourse délier. Mais dans la vie réelle, on ne trouve pas de millions comme cela.
—Qui sait? répondit Pascal avec une nuance de fatuité.
—Ce n’est pas un conseil qu’il te faut, reprit le médecin, mais bien une douche. Tu n’es qu’un poète égaré à l’École des ponts et chaussées, qui pourtant est bien loin du Parnasse. Aurait-on cru cela d’un mathématicien? Mon pauvre ami, tu ne sais rien de l’existence, ni de ses difficultés, et je vois avec douleur que tu vas l’apprendre à tes dépens. Je devais pourtant te servir d’exemple.
—Sais-tu bien que tu n’es pas encourageant!
—Hélas! c’est que je suis dans le vrai.
Sur ce sujet, la conversation en resta là. Comme l’avait dit Pascal, il était trop tard pour revenir sur ses pas, et Lorilleux aurait inutilement froissé son ami.
Mais le médecin sortit plus mécontent qu’il ne l’avait jamais été. Cette frasque de son ami coûtait, il se le disait au moins, quarante mille francs à sa sœur; car il considérait cet argent comme perdu, et il en faisait son deuil. Une chose cependant le consolait, c’est que probablement cette expérience refroidirait singulièrement Pascal, et le ramènerait à des idées plus positives. On dit que les folies passées sont un gage de sagesse pour l’avenir. Mieux valait que l’étourdi dépensât quarante mille francs avant son mariage que de se ruiner lorsqu’il serait père de famille. Cette école, d’ailleurs, ne le ruinait pas. Il avait encore à attendre de sa famille une jolie aisance.
Telles étaient les réflexions de Lorilleux. Enfin, comme à quelque chose malheur est toujours bon, il songeait, non sans une certaine satisfaction, que cet événement mettait Pascal sous sa main. Ainsi, il restait près de lui, et il comptait bien redoubler de soins et l’entourer d’une plus sévère surveillance. Ainsi, il ne lui échapperait certainement pas; tandis que, nommé ingénieur en province, il aurait fort bien pu se marier sans prévenir son ami. Que seraient alors devenus ses projets?...
On peut penser après cela que le médecin fut l’hôte fidèle de Pascal, il venait presque tous les jours passer la soirée avec lui.
—Comment va le roman? demandait-il de temps à autre.
—Mais pas mal, répondait l’associé de Jean Lantier.
En effet, si l’entreprise était romanesque, les bénéfices étaient réels. Les maisons de la rue de la Harpe avaient donné moins qu’on ne l’espérait, mais quelques autres avaient rendu davantage. Deux lots importants près de Saint-Lazare avaient surtout procuré des bénéfices tout à fait inespérés.
Il est vrai que les deux associés, Pascal la tête et Lantier les bras, ne ménageaient pas leurs peines, ni leurs démarches. Pascal courait du matin au soir, faisait dix visites, rédigeait les marchés et les soumissions, assiégeait les commissions et les bureaux de l’Hôtel de Ville. Lantier, dans le plâtre jusqu’aux genoux, comptait les pierres et les poutres, et ne reculait pas devant les litres de vin nécessaires à la conclusion des petites ventes.
Cette activité donnait beaucoup à penser à Lorilleux, et il n’était pas sans remarquer l’air heureux des deux associés. Pascal prenait plus d’assurance, on devinait à son aplomb l’homme qui réussit. Le ventre de Lantier s’arrondissait.
—Il ne me trompe donc pas, se disait le médecin, il réussit donc. C’est prodigieux, c’est invraisemblable; mais enfin, tant mieux, c’est pour ma sœur qu’il travaille, et je dois doublement me réjouir, comme ami et comme beau-frère.
Les parents de Pascal avaient naturellement été les premiers instruits du succès de ses entreprises. On n’avait pas voulu l’écouter lorsqu’il était à Lannion, il savait bien qu’on le lirait. Il ne se faisait pas faute d’écrire souvent; mais madame Divorne seule répondait. Toutes les semaines, régulièrement, elle adressait à son fils une bonne lettre, bien longue, bien tendre, comme savent seules en écrire les mères. Pour l’avoué, il s’obstinait à garder le silence; il semblait avoir perdu l’usage de la plume.
Dans les commencements, Pascal s’affligea beaucoup de cette obstination de son père; peu à peu, il s’en inquiéta moins, sachant bien qu’il se rendrait et que sa rancune ne tiendrait pas devant de bons et solides arguments, sur l’État ou sur première hypothèque.
Et ces arguments, le jeune ingénieur était en état de les fournir. Les affaires allaient de mieux en mieux, les démolisseurs ne savaient où donner de la pioche; si bien que les associés, lorsqu’ils firent leur inventaire, au bout de deux ans, trouvèrent que chacun d’eux possédait un peu plus de cent soixante mille francs. Les pièces de vingt sous étaient devenues des pièces de cinq francs, pour parler comme Jean Lantier.
Ce résultat féerique éblouit Lorilleux. Il voulut douter, mais il fallut bien se taire, les chiffres étaient là.
—Peut-être devrais-tu t’arrêter, dit-il à son ami; ne compromettras-tu pas dans tes spéculations futures ce que tu as si heureusement gagné?
Pascal n’entendait pas de cette oreille. Il ne s’était pas fait, comme il le disait, maçon en gros pour s’arrêter en si beau chemin. Le médecin dut imposer silence à la voix inquiète qu’il nommait sa prudence. Il se résigna à penser que sa sœur aurait voiture, et il se promit bien de la lui emprunter quelquefois, pour éblouir certains clients qui s’obstinent à ne pas croire au talent qui va à pied.
Mais Pascal ne songeait pas encore à la voiture, ou du moins n’en parlait pas. Seulement, comme il se trouvait fort mal dans son petit logement, il résolut de se donner un peu ses aises. Il aimait le confortable, et pensait l’avoir bien gagné.
En conséquence, il loua dans la rue de Rivoli un joli appartement dont les fenêtres donnaient sur le square Saint-Jacques. Il ne le paya guère plus de trois fois ce qu’il valait. La vue, il faut tout dire, était comprise dans le prix.
Cette vue était une des plus belles de Paris, elle n’était pas encore masquée par ces deux malencontreux théâtres, niaises et prétentieuses constructions, près desquelles la tour Saint-Jacques, cet inimitable bijou, semble une protestation de l’art et du bon goût.
En homme prudent qui veut pouvoir faire une réparation ou un embellissement, sans risquer le lendemain d’être augmenté ou de recevoir congé, Pascal fit un bail. Outre le prix de son loyer, il avait à acquitter divers petits frais qui augmentaient d’un sixième le prix convenu; mais il ne voulut pas chicaner pour si peu: il faut bien se conformer à l’usage.
Il paya six mois d’avance, prêta entre les mains du portier le serment de se conformer aux usages de la maison, signa un état de lieux qui lui coûta cent dix-sept francs cinquante-cinq centimes, remplit diverses autres formalités, et enfin fut chez lui. A Paris, avoir un chez-soi n’est pas plus difficile que ça.
Puis il mit les ouvriers dans son appartement. Des sept pièces qui le composaient, il en fit trois, et alors il put recevoir plus de deux personnes à la fois, étendre les bras sans danger de se faire du mal aux mains, et éternuer sans risquer de casser le globe de sa pendule.
Le propriétaire le laissa tailler à sa fantaisie, se promettant bien de lui faire payer très cher, plus tard, ces dégradations à son immeuble.
C’est alors que Pascal fit vraiment des folies. Il trancha du Crésus, et ne dépensa pas moins d’une douzaine de mille francs pour dorer ses lares. Pour ce prix il eut quelques beaux meubles, des tapis, des étoffes de bon goût et trois ou quatre de ces bronzes qu’on ne rencontre pas sur toutes les pendules des coiffeurs élégants.
Chose singulière! Lorilleux en cette circonstance parut oublier son rôle de Mentor. Loin de prêcher l’économie, il poussa presque à la dépense. Il avait calculé que l’appartement serait assez grand pour un jeune ménage, et il pensait que l’achat des meubles était une dépense nécessaire qu’il valait autant faire de suite. S’il s’intéressait si vivement aux dispositions de l’appartement, au bois des meubles, à la couleur des tentures, c’est qu’il meublait par la pensée l’appartement de sa sœur. Sa conviction était telle, qu’il empêcha son ami d’acheter un petit tableau de Boucher, un chef-d’œuvre, parce qu’il trouvait le sujet peu convenable.
C’était cependant une occasion unique.
C’est vers cette époque que, tout à coup, le bruit des immenses richesses de Pascal se répandit à Lannion. Il avait remué ses louis d’or, et leurs tintements étaient venus aux oreilles de ses compatriotes. Toute la ville sut bientôt à n’en pas douter que le fils de M. Divorne était trois ou quatre fois millionnaire, pour le moins.
Cette incroyable nouvelle avait été apportée par deux enfants de la ville, qui, après être venus tenter fortune à Paris, retournaient au pays, Gros-Jean comme devant, plus pauvres de quelques mille écus, mais riches de cette conviction qu’il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. Ils avaient eu besoin de Pascal et l’avaient trouvé au moment critique.
Les braves gens mesurèrent le luxe de leur compatriote à leur reconnaissance, et ils racontèrent à qui voulut les entendre qu’il roulait voiture et habitait dans la capitale un palais des Mille et une nuits.
On ne les croyait qu’à demi, lorsque tous les faits qu’ils avaient avancés furent confirmés et au-delà par un jeune étudiant auquel Pascal avait prêté une fois quatre-vingts francs pour aller au bal masqué, et cent francs un autre jour pour apaiser un tailleur menaçant.
Ce jeune homme, qui avait dîné quelquefois chez Pascal, ne tarissait pas à son sujet. Les meubles de chêne et les bronzes l’avaient ébloui: on ne sait pas encore au Quartier Latin tout ce qui se fabrique à Paris de vieux chêne avec du carton-pâte verni, et de bronze florentin avec du mastic préparé par la galvanoplastie.
Cet étudiant, qui en était encore à s’étonner des magnificences et de la générosité de Pascal, stupéfia ses compatriotes par ses descriptions, faites de bonne foi. Selon lui, l’ingénieur se lavait les mains dans l’or, et, la nuit, reposait sur des matelas de billets de banque.
Les exagérations admises comme choses certaines, Pascal fut plus admiré qu’il n’avait été honni. Les pères qui avaient tremblé autrefois d’avoir un pareil fils, le citèrent en exemple à leurs enfants; ceux qui l’avaient le plus maltraité ne se pardonnaient pas cette offense, ce crime de lèse-capital. Ah! l’argent est un avocat puissant!
Le résultat immédiat et le plus clair de ce revirement d’opinion fut pour Pascal une avalanche de lettres: on se rappelait à son souvenir, on sollicitait sa protection pour un neveu, on lui dénonçait les gens qui avaient mal parlé de lui. Un conseiller municipal se hasarda à lui écrire et à faire un appel à «son bon cœur, au nom des pauvres de Lannion, sa ville natale.»
Pascal ne répondit à personne, mais il mit sous pli cinq cents francs pour les pauvres. A cette munificence royale, on vit bien que sa fortune n’avait pas été exagérée; on reconnut à ce trait l’homme dont la signature sur un chiffon de papier donne à ce chiffon la valeur de l’argent comptant. On le salua millionnaire. Quant à demander où et comment il avait gagné cette fortune énorme, personne n’en eut l’idée. Ce sont là d’indiscrètes questions qu’on adresse seulement aux pauvres diables.
Par suite de ces petits événements, l’importance de M. Divorne s’accrut singulièrement; sa considération grandit de cent coudées. Il recueillit les bénéfices des succès de son fils. Il rejaillit sur son front quelques-uns des rayons d’or qui faisaient l’auréole de Pascal. On salua avec vénération le père d’un homme si riche.
Et pourtant, l’avoué était le seul à ne pas ajouter foi à ce qu’il appelait des cancans de petite ville. Pascal avait bien écrit qu’il gagnait de l’argent; mais était-ce probable? Il avait prédit à son fils qu’il se ruinerait; la prédiction devait s’accomplir, car un père ne doit pas se tromper, et tous les jours il s’attendait à le voir revenir réduit à la besace.
L’envoi des cinq cents francs, bien vite connu de tout le monde, ébranla ses convictions. Qui lui garantissait la fausseté de tous ces on-dit? Tous les jours on voit des choses plus surprenantes. Il s’inquiéta, et son esprit fut singulièrement troublé. Toutes ses idées étaient bouleversées, et il ne savait pas encore au juste s’il devait s’affliger d’avoir été mauvais prophète, ou de se réjouir du succès de son fils, à supposer que ce succès fût réel.
Cet état d’incertitude était insoutenable pour l’avoué. Mais il ne voulait pas que l’idée d’aller s’assurer des faits parût venir de lui. Il amena fort adroitement sa femme, qui ne demandait pas mieux, à le presser de faire le voyage de Paris. Pour sauver les apparences, il résista quelque temps, faiblement il est vrai, et enfin eut l’air de se rendre aux sollicitations d’une mère inquiète. Un beau jour il s’avoua vaincu, et comme il avait pris ses mesures à l’avance, il se décida tout à coup, et partit sans crier gare. Il voulait surprendre son fils, qu’il ne surprit pas le moins du monde.
Pascal causait fort tranquillement avec Lorilleux, qui lui consacrait presque toutes ses soirées, lorsque son père entra. Il fut médiocrement étonné, mais très-joyeux; depuis longtemps il espérait et attendait ce petit triomphe. C’est avec un bonheur réel qu’il embrassa son père, lequel en cette circonstance se départit de sa froideur habituelle, et s’attendrit, bien qu’il y eût un témoin de sa faiblesse.
Du premier coup d’œil, l’avoué comprit qu’il devait y avoir du vrai dans les lettres de Pascal; aussi fut-il un peu honteux de sa longue «fermeté,» mais il n’en laissa rien paraître, et prit à tâche de se montrer aimable et affectueux.
Comme il voulait des renseignements, il raconta longuement et gaiement les bruits qui avaient agité Lannion. Pascal, tout en riant beaucoup de l’imagination fertile de ses compatriotes, ne voulut pas laisser plus longtemps son père dans le doute, et en quelques mots il lui exposa le chiffre de sa fortune. Il possédait environ huit mille livres de rentes, gagnées en un peu plus de deux ans.
Il y avait loin de ce revenu modeste aux millions dont on l’avait gratifié; c’était peu en comparaison. Mais ce peu sembla encore énorme à l’avoué. Faisant un retour sur lui-même, il se rappela qu’à l’âge de vingt-six ans, qu’avait alors son fils, il était, lui, simple second clerc dans une étude de province, aux maigres appointements de mille francs l’an. Tant d’argent gagné en si peu de temps choquait toutes ses idées. Il ne put s’empêcher de dire que ce bien était, à son avis, trop facilement acquis. Il vanta l’époque où l’on mettait vingt-cinq ans à amasser quatre mille livres de rentes, sans penser que cent mille livres de cet âge d’or représentaient presque cent mille écus de notre âge de fer.
Puis, comme il était de ces hommes qui veulent avoir raison encore, lorsque l’évidence leur a démontré leur erreur, il remonta son dada favori, et prouva clair comme le jour à son fils qu’il avait eu le plus grand tort de donner sa démission et de ne pas écouter les conseils sensés d’un père qui avait plus d’expérience que lui. Mais il le fit sans amertume et uniquement pour conserver ses avantages.
—Tu aurais les millions qu’on te prête, dit-il à son fils, je te le répéterais encore: tu as eu tort. Je suis trop ferme en mes principes pour qu’un succès les fasse varier. Tu as réussi, mais tu devais échouer. Une exception ne fait rien à la règle, et tu es une exception.
Pascal convint de tout avec la meilleure grâce du monde. A quoi lui aurait servi de combattre des opinions plus solides que le roc, que la mer use à la longue? Il aurait eu d’ailleurs affaire à deux adversaires, car Lorilleux prêtait à l’avoué l’appui de son éloquence. Lorilleux triomphait enfin, il trouvait quelqu’un qui entendait la vie comme lui; il abusa de ses avantages.
Cette première soirée mit au mieux l’avoué et le médecin, et les quinze jours qui suivirent ne firent qu’accroître l’estime et l’amitié qu’ils ressentaient l’un pour l’autre. Plus ils causaient, et mieux il leur était démontré qu’ils s’entendaient sur tous les points. Le machiavélique Lorilleux profita très habilement de cette bonne fortune pour s’établir solidement dans le cœur du père de son ami. Même, avec des précautions et une délicatesse infinies, il osa parler de l’établissement futur de Pascal, et fut au comble du bonheur lorsqu’il crut découvrir que M. Divorne ne regarderait pas à la dot de la femme que choisirait son fils.
Quinze jours passèrent comme un songe pour l’avoué; il aurait été parfaitement satisfait, si Pascal avait eu quelqu’un de ces titres qui font si bon effet sur une carte de visite; mais il n’en avait aucun, car on ne peut décemment s’intituler «démolisseur.» Il ne put s’empêcher de communiquer son chagrin à son fils.
—Si on me demande ce que tu fais, lui dit-il, que répondrai-je?
—Eh! cher père, répondit Pascal, ne suis-je pas toujours ingénieur et plus que jamais architecte? Dites, si vous le voulez, que j’ai rebâti Paris.
—Tu plaisantes toujours, fit l’avoué avec humeur. Quand donc seras-tu sérieux comme M. Lorilleux! voilà un homme posé, au moins, et qui entend la vie. Tu es heureux en tout, car tu peux te vanter d’avoir là un ami qui t’est dévoué, et c’est chose rare.
Jean Lantier aussi plut beaucoup à M. Divorne. Il avait bien été un peu surpris de voir à son fils un tel associé qui aurait porté la veste ronde avec plus d’aisance que la redingote, mais la rondeur du bonhomme le charma. L’entrepreneur, en l’honneur du père de son associé, avait donné un grand dîner, et l’ordonnance du repas, la magnificence de la vaisselle, l’excellence des vins, mirent le comble à l’étonnement de l’avoué, qui ne se doutait pas que le même homme pût passer ses journées dans les débris et les gravats, et rentrer le soir dans un intérieur si confortable, pour ne pas dire si luxueux.
Enfin, M. Divorne partit enchanté, en faisant promettre à son fils de venir tous les ans au moins une fois passer quelques jours à Lannion.
—Décidément, dit-il à sa femme, lorsqu’il fut de retour, notre fils est dans une très belle position.
On peut juger du ravissement de madame Divorne.
—Sans doute, se disait-elle, Pascal songera bientôt à se marier, et c’est à moi de chercher une jeune fille digne d’avoir un tel mari.
La même idée, à peu près, était venue à Jean Lantier.—Si je pouvais marier une de mes filles à monsieur l’ingénieur, quel bonheur pour elle, quel honneur pour moi: avoir dans ma famille un homme qui était le premier à l’École des ponts et chaussées! Il faudra voir. J’ai trois filles qui seront bientôt en âge, elles sont jolies, bien élevées... ma foi! je lui donnerai le choix.
Ainsi, de trois côtés à la fois, la liberté de Pascal était menacée; lui ne s’en doutait guère.
La visite de M. Divorne, deux voyages en Bretagne pour embrasser sa mère, tels furent, pendant six ans, c’est-à-dire jusqu’à l’année dernière, les plus grands événements de l’existence de Pascal.
C’est dire le calme de sa vie, la régularité de ses habitudes. Tous les plaisirs étaient à sa portée, il avait ce qui manque si souvent à la jeunesse, l’argent et la liberté, mais il n’en abusa pas. Le diable s’était fait ermite avant d’être vieux. Jamais jeune homme ne vécut plus loin des jouissances stupides et peu avouables où se ruent avec fureur la jeune finance, monnaie de billon des gros traitants du siècle passé, et la phalange grotesque des gandins, troupe idiote qui vise aux vices des princes de la fatuité et n’atteint qu’au ridicule. Sans être l’idéal de la vertu, Pascal eût bien mérité d’une belle-mère.
Mais il ne faudrait pas lui faire trop honneur de cette sagesse exemplaire. Une bonne partie des éloges doit revenir à Lorilleux, qui veillait sur son ami avec la sollicitude d’une mère, non sur son fils, mais sur sa fille. Nuit et jour, Argus aux cent yeux toujours ouverts, le médecin montait la garde autour de son futur beau-frère. Il aurait rendu des points au dragon qui faisait sentinelle devant la porte du jardin des Hespérides, et qu’Hercule tua dans sa guérite, autant pour voler des pommes que pour donner une grande leçon aux factionnaires à venir.
Une ou deux fois Pascal faillit avoir une liaison un peu sérieuse. C’est alors que le médecin montra toute son habileté. Il était bien l’homme des petits moyens; petites ficelles, petites ruses, il ne recula devant rien pour se jeter à la traverse. S’il dépassa les bornes de la stricte honnêteté, il ne s’en inquiéta guère. Pascal était pour lui un dépôt dont il devait compte. Il le défendit avec la conscience d’un dépositaire scrupuleux, et avec tant d’adresse qu’il n’éveilla aucun soupçon, à ce qu’il crut au moins.
Ce que redoutait surtout Lorilleux, c’était de voir son ami s’en aller dans le monde. Les bals parisiens sont tapissés de toiles d’araignées ourdies par les mamans jalouses de se débarrasser de leurs fillettes, et où viennent se prendre les célibataires étourdis. Le jeune homme à marier marche dans les salons, au milieu de piéges toujours tendus. Qu’il perde la tête un soir, c’en est fait de lui; il est guigné, amadoué, circonvenu, étourdi, pris, lié et marié avant d’avoir eu le temps de se reconnaître. Il n’est pas encore bien décidé à prendre femme, il n’est pas encore sûr de son choix, que déjà il a prononcé le oui fatal.
Le médecin savait fort bien tout cela, sinon par expérience, au moins de bonne source. Aussi mit-il tout en œuvre pour empêcher Pascal de profiter des belles relations qu’il avait et qui lui ouvraient à deux battants toutes les portes. Ne voulant pas que son ami allât dans le monde où il n’aurait pu le suivre toujours, il fit venir le monde à lui. Par ses soins, le salon de Pascal devint le centre, le point de réunion d’un groupe d’hommes de son âge, de société agréable, de relations sûres, tous remarquables à un titre quelconque. Lorilleux les avait sévèrement passés au crible avant de les admettre. Aucun d’eux n’avait de sœur à marier.
Pascal laissait faire. Il s’était fort bien aperçu des petites manœuvres du médecin, mais il ne s’en était pas inquiété. Il était loin d’en deviner le but. Il l’aurait su, qu’il ne s’en serait pas épouvanté. Les gens seuls qui se savent assez faibles pour céder à une obsession, pour sacrifier leur volonté à la volonté d’autrui, redoutent la tyrannie; ils connaissent leur irrésolution, et croient partout voir des attentats à leur liberté: ces gens-là, toujours flottants entre l’opinion de Pierre et l’avis de Paul, sont de terribles compagnons; au moindre mot, ils lèvent l’étendard de l’indépendance, se posent en révoltés, et finissent par en passer où l’on veut. S’ils se marient, leurs femmes portent sous leur crinoline le vêtement qui en ménage est le privilége, à ce qu’on prétend, du sexe fort.
Lorilleux n’eut pas à combattre ces petites révoltes à propos de rien. Pascal était beaucoup trop sûr de sa volonté pour redouter l’influence d’autrui, et, loin d’en vouloir à son ami, il était fort touché de ses attentions. Ce genre de vie, au surplus, était tout à fait dans ses goûts; il n’aimait pas à sortir, et pourtant il aimait la causerie. Jamais il n’était si content que lorsqu’il avait quatre ou cinq bons camarades, et cela arrivait presque tous les soirs, au grand désespoir du portier qui, les jours de pluie surtout, trouvait très mauvais qu’on osât faire monter tant de monde par des escaliers cirés.
Tout le reste du temps de Pascal était pris par ses travaux, dont l’importance croissait de jour en jour. Il suffisait à tout, descendant sans peine aux plus menus détails. Jamais on ne vit entrepreneur plus actif, et cette fièvre d’activité, il avait l’art de la communiquer à tous ceux qui l’entouraient. Il savait reconnaître le zèle, et ne lésinait jamais; il se défiait des économies ruineuses. Aussi ses employés ne se ménageaient pas, et ne gaspillaient jamais son temps; certains de recevoir double salaire s’ils faisaient un travail double, ils se jetaient sur la besogne en gens qui voient au bout un bénéfice assuré. Ainsi, il obtint de si prodigieux résultats, que les confrères rivaux se demandaient s’il n’était pas un peu sorcier. Ils se creusaient la tête à chercher une chose bien simple: Pascal savait se faire aimer et sacrifier à propos un billet de 1,000 francs.
Après avoir bien démoli, les deux associés avaient abordé «la bâtisse,» spéculation épineuse, où le plus habile est exposé à se tromper. Mais en cela aussi ils furent heureux, parce qu’ils avaient raisonné juste.
Pascal et Lantier, sans avoir besoin d’un livre de statistique, savaient que le nombre des gens riches, à Paris comme ailleurs, est fort limité. Ils firent leurs calculs là-dessus. Malheureusement, nos seigneurs les propriétaires, détenteurs aimables du capital, ne sont pas encore convaincus de cette fâcheuse vérité. Leurs architectes ne construisent plus que des palais, somptueuses demeures aux balcons sculptés, aux vestibules dallés de marbre. Le premier étage est destiné aux millionnaires, et il faut avoir des intelligences avec la Banque pour habiter sous les combles. On dit bien à ces entêtés qu’ils font fausse route, que le nombre de ceux qui peuvent mettre plus de 1,000 écus à leur loyer n’est pas grand: paroles et peines perdues.
Plus tard, quand ces palais n’auront trouvé d’autre habitant qu’un portier maussade et insolent, quand les écriteaux auront pendant bien des termes essuyé la pluie et le vent sans amener un locataire, alors les tristes propriétaires de ces improductifs monuments écouteront les plaintes de leur bourse lésée. A grand renfort de cloisons, ils diviseront et subdiviseront leurs appartements magnifiques; mais ils n’en feront pas des logements commodes, et encore seront-ils forcés de les louer très cher. Beaucoup se ruineront à ce métier, et cela sans doute fera réfléchir; ils renonceront aux palais, et reviendront aux maisons.
Plus modestes et plus sensés, Pascal et son associé se contentaient de bâtir des habitations habitables. Un honnête homme qui avait des enfants et moins de vingt mille livres de rentes,—il en est dans ce cas—y pouvait loger. Aussi, à peine terminées, étaient-elles louées de la cave au grenier, à des prix raisonnables, assez avantageux cependant, pour faire suer à l’argent placé sept ou huit pour cent, bénéfice qui n’est pas à dédaigner.
De telles maisons, si facilement louées, se vendaient plus aisément encore. Le bouquet de fête que les maçons placent sur la dernière cheminée n’avait pas le temps de se faner que les acheteurs se présentaient. Pascal se faisait un nom parmi les architectes sérieux, et le capital social grossissait à vue d’œil.
Ce bonheur constant, dû à beaucoup d’habileté et de savoir-faire, taquinait prodigieusement Lorilleux. Faute de savoir se l’expliquer, il se consolait en répétant ce refrain banal, pavé dont les sots qui restent en chemin assomment les gens d’esprit qui réussissent:
—Il a de la chance.
Et lui, Lorilleux, n’avait pas de chance, il le reconnaissait, non sans amertume. Semeur patient, il ne récoltait rien, à l’encontre de ce que promet l’Évangile. Chaque matin il était éveillé par quelque petite déception; tous les jours il trouvait dans ses combinaisons si savantes une erreur de calcul. Et au lieu de s’en prendre à lui, il s’en prenait aux événements; comme si toute l’habileté ne consistait pas en cela: dominer les événements, ou tout au moins les faire tourner à son avantage.
Le médecin avait rêvé la gloire et la fortune, et gloire et fortune semblaient le fuir. Son nom était toujours obscur, et son plus gros client était un droguiste retiré, qui, depuis qu’il habitait la campagne et respirait un air pur, ne pouvait plus respirer.
Aussi, insensiblement, le caractère de Lorilleux s’était aigri; son teint avait pris ce ton bilieux qui est la livrée de l’envie; il devenait tyrannique, susceptible, cassant. Il prenait les choses au pis, et ne cachait plus sa haine ni son mépris pour les hommes. Partout il voyait les intrigants et les fourbes plus adroits que lui, et il déplorait son peu d’adresse.
Le médecin avait encore d’autres soucis qui troublaient son sommeil et assombrissaient son front. Pascal allait être décidément très riche. Cette fortune, venue si vite qu’elle avait déconcerté toutes ses prévisions, l’inquiétait horriblement. Ne serait-elle pas un obstacle? A ne considérer que l’expérience, Pascal, avec vingt mille livres de rentes, devait être beaucoup moins désintéressé que lorsqu’il était relativement pauvre. Lui qui jadis, à chaque spéculation heureuse de son ami, se frottait les mains en pensant à sa sœur, il en était réduit à lui souhaiter quelque bonne petite faillite qui ébréchât un peu son capital.
Il se reprocha amèrement d’avoir tant attendu et résolut de démasquer ses batteries, non tout d’un coup, mais avec une sage lenteur.
Démasquer est bien le mot. Personne au monde ne pouvait se douter des intentions de Lorilleux; sa mère même n’était pas dans la confidence. Ce profond diplomate n’avait jamais rien laissé percer de son secret. Sa sœur, aussi bien que son ami, ignorait ce projet amoureusement caressé pendant quatorze ans. Et quel secret! le rêve d’une vie entière.
Avec une prudence au-dessus de son âge, Lorilleux s’était bien gardé d’admettre son ami dans l’intimité de sa famille. Il avait deviné qu’un mariage est presque impossible entre deux jeunes gens qui ont grandi ensemble. Se voir tous les jours ne peut conduire qu’à une douce et fraternelle amitié. Grâce à d’habiles précautions, mademoiselle Lorilleux et Pascal s’étaient à peine entrevus dans de rares occasions, ménagées avec un art infini. Ils ne s’étaient pas parlé en tout dix fois.
Il s’agissait maintenant pour le médecin de mettre les jeunes gens en présence. Grave affaire; pourtant il lui semblait que toutes les difficultés, sauf cette fortune maudite, étaient aplanies. Pascal allait avoir trente ans, il était doué de tous ces avantages extérieurs qui séduisent une femme. Mademoiselle Lorilleux avait, elle, dix-huit ans, elle était remarquablement jolie, brune, et ravissante de grâces et de distinction. Elle devait à son frère une éducation beaucoup plus sérieuse que ne l’est ordinairement celle des femmes. Enfin, ce frère prévoyant et rigide s’était appliqué à briser la volonté de la jeune fille, exagérant à plaisir sa tyrannie, lui préparant ainsi d’heureux jours pour le temps où elle trouverait un joug moins rude que le sien.
Lorsque le médecin les considérait tous deux, cet ami entouré de tant de soins, cette sœur si tendrement aimée, il ne pouvait s’empêcher de s’émerveiller et de s’applaudir de son œuvre, tant il les trouvait bien faits l’un pour l’autre. Il les unissait par la pensée, s’installait dans le ménage, et le bonheur dont il les voyait jouir était sa récompense.
Décidé à presser le dénouement, Lorilleux comprit qu’avant tout il devait peu à peu habituer Pascal à l’idée du mariage, le lui faire désirer. C’était affaire de temps. Encore, dans ce travail préparatoire, le médecin avait, sans s’en douter, deux auxiliaires puissants. Madame Divorne ne voulait pas avoir vainement cherché et trouvé une héritière, une belle-fille selon son cœur. Dans toutes ses lettres elle glissait, à côté d’un éloge de sa perle bretonne, quelque délicate allusion matrimoniale. Jean Lantier, en véritable orfèvre, répétait sans cesse qu’un homme était bien fou de se résigner à vivre seul, quand il y a de par le monde tant de charmantes demoiselles qui ont reçu la meilleure des éducations dans les pensionnats les plus renommés de Paris; établissements modèles, où la moins intelligente des élèves apprend bien vite à faire trois toilettes par jour.
Mais Lorilleux, par le fait de ses relations quotidiennes avec Pascal, pouvait agir bien plus directement. Il avait trouvé pour endoctriner son ami une petite combinaison assez ingénieuse. Il avait feint d’être lui-même atteint de matrimoniomanie. Grâce à ce détour, il pouvait tout dire, ses insinuations ne pouvant être regardées que comme les épanchements d’une confiante amitié.
Aussi, comme il disait bien les amertumes de la solitude, les tristesses du célibat! Comme il chantait les douceurs de l’hyménée, le chaste bonheur de deux âmes qui se comprennent et dont l’union a été sanctifiée par l’Église et reconnue par la loi.
Puis il détaillait à plaisir les «causes déterminantes» qui le décidaient. Un homme doit se marier jeune. N’est-ce pas folie que d’attendre pour choisir une compagne l’heure de la décadence? Ainsi font ces vieux éhontés qui semblent moins chercher une épouse qu’une garde-malade.
Qu’apportent-ils, ceux-là, à la chaste jeune fille qu’ils conduisent à l’autel, en échange de ses trésors de jeunesse et de candeur? Un cœur éteint, une imagination flétrie, un corps usé, des ruines, des débris de toutes sortes. Aussi, quel sort les attend! Il faut voir l’intérieur de ces ménages, un an après la signature du contrat. Ah! qu’on est plus sensé mille fois en Angleterre, en Amérique, en Allemagne! Là, chacun épouse la femme qu’il aime, et l’épouse pour elle-même. Pas de ces considérations honteuses qui font, en France, du mariage une spéculation, une affaire d’argent que discutent froidement des notaires, et dont la conclusion dépend d’un chiffre au total. En ces pays heureux, ce n’est pas la dot qui attire les épouseurs; aussi, toutes les jeunes filles se marient, riches ou pauvres, pourvu qu’elles soient belles et aimables; il n’y a que les laides à coiffer sainte Catherine, et encore lorsqu’elles ne savent pas sauver leur figure à force de bonnes qualités.
Ainsi parlait Lorilleux avec l’éloquence de la conviction. Chaque jour, pour reproduire ces quelques idées, il inventait une forme nouvelle. Pour décrire les enchantements de la lune de miel, il devenait presque poète. On aurait pu croire que tous les matins il étudiait, pour les paraphraser le soir, quelques pages de ce livre aimable et ingénieux qui, après avoir fait la réputation et la fortune de M. Legouvé le père, n’a pas été sans contribuer aux succès littéraires et à la renommée de M. Legouvé le fils.
A tous ces propos, Pascal prêtait une oreille distraite. Lorsque Lorilleux, après avoir décrit la femme de ses rêves, c’est-à-dire après avoir fait le portrait de sa sœur, s’écriait:
—Oui, c’est bien décidé, le jour où je trouve cette femme, je me marie.
—Marie-toi, lui répondait simplement Pascal.
Il fallait alors une grande force de caractère au médecin pour ne pas dire à son ami:
—Eh bien! et toi?
Mais déjà à deux ou trois reprises le jeune ingénieur était venu au-devant de cette question, toujours suspendue aux lèvres de Lorilleux.
—Je me marierai très probablement, disait-il, comme tout le monde, mais je suis assez jeune pour attendre encore. Je me trouve fort heureux tel que je suis; la solitude ne me pèse en aucune façon. D’ailleurs, à notre époque, une femme est un luxe encore au-dessus de mes moyens. Il faut vraiment de la fortune à celui qui ne se sent pas l’utile courage de considérer la dot avant tout; et je veux, moi, pouvoir choisir sans m’inquiéter de l’argent.
Si le peu d’empressement de Pascal désolait Lorilleux, au moins il était ravi de son désintéressement. Et Dieu sait s’il l’approuvait!
—Une femme doit tout tenir de son mari, disait-il.
Mais au fond du cœur il maudissait les femmes qui ont amené les hommes à penser ainsi: «Une femme est un luxe, il faut être riche pour se marier.» C’est pourtant cette maxime désolante qui peuple les couvents. Dix coquettes font cent vieilles filles. Pour une femme qui ruine son mari, cinquante hommes jurent de vivre et de mourir célibataires.
Au moins la persistance de Lorilleux n’avait pas tardé à produire d’excellents effets. Sa manie de mariage était devenue un des textes favoris de conversation des amis qui presque tous les soirs se réunissaient chez Pascal. Il avait semé une idée, elle germait, elle ne devait pas tarder à porter ses fruits.
Dans les groupes de jeunes gens, il est rare qu’il n’en soit pas ainsi: qu’un seul se décide, les autres arrivent bien vite à partager ses désirs. L’éternelle histoire des moutons de Panurge.
En attendant, on plaisantait le médecin; c’était à qui le taquinerait, en affectant de caresser sa marotte.
—Docteur, disait l’un, j’ai votre affaire: cent vingt mille francs et des espérances. J’ai vu le portrait de la fortune des parents chez un notaire.
—Lorilleux, affirmait un autre, j’ai vu à deux pas de chez Pascal, dans la montre de Badié, la photographie d’une jeune fille charmante; elle vous conviendra, allez donc demander son adresse...
Contre son ordinaire, le docteur prenait fort bien les plaisanteries.
—Parbleu, répondait-il, vous devez tous avoir mon affaire, on a toujours l’affaire d’un homme bien posé qui désire se marier; le malheur est qu’on ne lui offre que des jeunes filles auxquelles il conviendrait fort bien, mais qui ne lui conviennent pas du tout.
Et tout bas, Lorilleux se disait:—Allez, mes amis, allez, riez à votre aise! Le dresseur ramène mille fois, s’il le faut, son cheval devant l’obstacle qu’il veut lui faire franchir, et le cheval finit par sauter. Vous sauterez tous, ce dont je me soucie fort peu; mais Pascal aussi sautera, et c’est ce que je veux.
Voilà où en était de sa marche savante le machiavélique Lorilleux, lorsqu’un soir, un des amis arriva porteur des plus séduisantes propositions.
Cet ami, tout en riant, avait pris la chose au sérieux; il s’était enquis d’un bon parti près de cinq ou six vieilles dames de sa connaissance, et on n’avait pas tardé à lui trouver ce qu’il demandait. Il venait donc offrir à Lorilleux de le présenter. Voir n’engage à rien.
Le médecin écouta fort attentivement les détails qu’on lui donnait, fit quelques objections, et finit par refuser.
—Cet homme-là est par trop difficile à la fin, dit un des jeunes gens, nous ne le marierons jamais. S’il ne veut pas mourir garçon, il n’y a plus qu’une ressource, M. de Saint-Roch, la providence des célibataires.
Il n’est personne assurément qui n’ait au moins entendu parler de cet excentrique et mystérieux personnage. C’est lui qui s’intitule l’ambassadeur des familles. Il se glorifie d’avoir inventé la profession matrimoniale, et se flatte d’avoir rendu au mariage un lustre nouveau, alors qu’il était bien près de tomber dans la déconsidération.
Aussi, la proposition faite à Lorilleux de s’adresser à cet habile homme eut un succès de rires. Le médecin ne sourcilla pas.
—Pourquoi non? dit-il fort sérieusement. Mais je voudrais savoir avant si M. de Saint-Roch a jamais marié quelqu’un?
—Comment, malheureux, répondit l’auteur de la motion, vous avez l’audace de douter? Vous n’avez donc de votre vie lu un journal? Ouvrez le premier venu, vous serez édifié. Le célèbre ambassadeur ne dédaigne pas de louer, de temps à autre, la quatrième page des cinq grands journaux. C’est là qu’il brille dans sa gloire. Il annonce aux familles qu’il tient à leur disposition un riche assortiment de demoiselles et dames veuves, de seize à soixante ans, toutes ornées des avantages sociaux les plus recherchés, esprit, beauté, naissance, et embellies de quelque petit million de dot.
—Oh! reprit Lorilleux, je sais tout cela parfaitement. J’ai lu que M. de Saint-Roch est honoré de la confiance des premières familles de la noblesse, de la magistrature, de l’armée et de la finance. J’ai lu que toutes les maisons princières de l’Europe ont l’habitude de solliciter ses bons offices; je sais aussi qu’il faut écrire lisiblement son adresse, mais tout cela ne m’a pas convaincu. J’en reviens donc à ma question: A-t-il jamais marié quelqu’un?
—Mais, docteur, à Paris seulement il y a au moins une douzaine de négociants en mariages.
—Qu’est-ce que cela prouve?
—Qu’ils n’auraient pas un magasin s’ils n’avaient pas des pratiques.
—J’ai vu des magasins sans pratiques.
—Enfin, vous croyez, cher Esculape, que c’est uniquement pour son plaisir et sa gloire que l’inventeur de la profession matrimoniale dépense cent mille francs par an à louer des quatrièmes pages de journaux?
Cette dernière raison parut concluante à Lorilleux, il s’avoua convaincu. Mais la conversation continua sur le chapitre. Qui M. de Saint-Roch mariait-il, où, comment? Quels étaient ses procédés? Autant de questions que nul des amis ne pouvait résoudre.
—Eh bien! messieurs, dit enfin l’un d’eux, je dois vous avouer une faiblesse, dix fois j’ai été sur le point d’écrire à M. de Saint-Roch.
—Et pourquoi? grands dieux! demanda le docteur.
—Par curiosité.
—Ma foi, dit Pascal, j’ai eu la même idée; cet homme m’intrigue.
—Alors, objecta Lorilleux, il faut non écrire, mais y aller toi-même.
—Au fait, ce serait plus intéressant et plus instructif.
—Puisque c’est ainsi, reprit Pascal en riant, je satisferai d’un coup votre curiosité et la mienne, j’irai trouver l’homme mystérieux.
—C’est vraiment un beau projet, fit le médecin en haussant les épaules, je te reconnais bien là.
—Y verrais-tu quelque inconvénient?
—Oh! aucun en vérité, si cela peut vous amuser. Je trouve seulement qu’il est inconvenant d’aller chez un homme avec l’intention de se moquer de lui. Cet enfantillage n’est plus guère de notre âge.
On imposa silence à ce trouble-fête.
—C’est convenu, dirent les amis, Pascal va à la découverte; s’il est satisfait, nous donnons tous, d’emblée, notre clientèle à M. de Saint-Roch.
Le fondateur de la profession matrimoniale occupe tout le premier étage d’une magnifique maison située à l’angle de deux des plus belles rues du quartier de la Chaussée-d’Antin.
Son appartement n’a pas moins de seize fenêtres de façade, et les riches rideaux qu’on aperçoit du dehors donnent aux passants une haute idée de l’intérieur.
Le choix seul de cette maison est un coup de maître. Sa situation lui donne deux entrées sur des rues différentes. Deux escaliers conduisent chez le négociateur, et encore, en cherchant bien, on trouverait au moins un escalier de service et un couloir obscur qui aboutit à une troisième rue.
Dans ses annonces, M. de Saint-Roch fait sonner bien haut ces trois issues, gages d’incognito pour les pratiques. Il n’est pas fier, et ne tient pas à ce que ses visiteurs se fassent annoncer à son de trompe. Enfin, comme pour préparer des excuses, des prétextes, aux hommes aussi bien qu’aux femmes, une modiste en renom occupe le troisième étage, tandis qu’au deuxième demeure un banquier dont on entend tinter les écus dans l’escalier. Trois fois heureux présage!
Cette maison mystérieuse a sans doute un portier, deux portiers plutôt, puisqu’il y a deux portes, mais personne jamais ne les a vus. Il y a deux loges, mais jamais au carreau de l’une ni de l’autre ne se montre une tête maussade; jamais une voix insolente ne crie aux visiteurs: «Où allez-vous?» Cette question pourrait être embarrassante.
Des écriteaux à lettres dorées sur un fond de laque noire, remplacent avantageusement les portiers absents. Ils prennent pour ainsi dire l’étranger par la main, le suivent tout le long de l’escalier, et le conduisent où il désire aller: chez le banquier, chez la modiste, où chez l’homme aux mariages.
Dans cette bienheureuse maison, d’un côté ou de l’autre, on entre comme chez soi. C’est ainsi qu’y entra Pascal. Guidé par les mains à l’index tendu dessinées sur le mur, il gravit l’escalier. Sur le palier du premier étage donnent trois portes; sur toutes trois, en lettres brillantes, on lit le nom illustre de l’ambassadeur matrimonial.
Pascal sonna au hasard à l’une de ces entrées. Le timbre vibrait encore que la porte s’ouvrait, et il se trouvait face à face avec un superbe domestique, plus doré sur tranche qu’un suisse de cathédrale.
—M. de Saint-Roch? demanda Pascal.
—Si monsieur veut bien prendre la peine de me suivre, répondit respectueusement le magnifique valet, je vais conduire monsieur.
Et écartant une portière de damas, il précéda le jeune homme dans un couloir éclairé par des verres dépolis. Un épais tapis assourdissait le bruit des pas.
Tout en marchant, Pascal riait; il songeait aux réclames du négociateur qui dépeignent sa maison sous un aspect fantastique: portes mystérieuses, escaliers dérobés, corridors sombres, rien n’y manque; peut-être cependant les valets devraient-ils être sourds et muets.
Enfin, le domestique introduisit le visiteur dans un petit salon tendu de reps lilas tendre, d’une nuance audacieuse.
—Si monsieur veut prendre la peine de s’asseoir, dit-il, je vais prévenir monsieur.
Et en même temps il frappait trois coups sur un timbre placé au milieu de la table.
—Me faudra-t-il attendre longtemps?
—Monsieur est prévenu que monsieur l’attend dans le salon lilas, répondit en s’inclinant le domestique. Monsieur ne tardera pas à venir retrouver monsieur.
Il s’inclina de nouveau et se retira sans bruit, refermant discrètement la porte.
—Diable! pensa Pascal, il paraît qu’il y a des salons de toutes les couleurs, ici; examinons toujours celui-ci.
Ce salon lilas est, à vrai dire, une petite merveille de luxe malentendu et de richesse de mauvais goût. Une revendeuse à la toilette y aurait des éblouissements. Tout est doré, depuis le bras des fauteuils jusqu’à la rosace du plafond. La tapisserie des meubles est brodée à la main; il n’en est pas un qui ressemble à l’autre. Le tapis à personnages est le chef-d’œuvre du grotesque: il doit représenter la toilette de madame de Pompadour, ou autre chose, l’auteur du carton peut seul savoir quoi.
Le reste est à l’avenant. Mais ce qui donne au salon lilas une physionomie particulière, c’est le nombre des tableaux de tout genre accrochés aux lambris, et la profusion incroyable de menus objets disposés sur la cheminée, sur les tables, sur quatre ou cinq étagères.
Bronzes, plâtres, marbres, porcelaines, bois sculptés, il y a de tout. Un magasin de bric-à-brac peut seul donner une idée de cet encombrement d’objets d’art. Et quels objets d’art! Des choses inouïes, prodigieuses, des statuettes à faire frémir, des peintures à donner le frisson. Un bon tableau, trois médiocres, quelques bronzes de chez Barbedienne, trouveraient grâce; mais tout le reste!...
Pascal, horripilé, allait d’un objet à l’autre. Sous chaque bibelot il y avait une étiquette et une devise; on lisait: A notre bon ami.—A l’auteur de mon bonheur.—Souvenir d’une heureuse mère.—Gage de reconnaissance, etc., etc...
Évidemment tous ces objets d’art étaient des dons, mais de qui? Le sujet de la pendule était un Amour joufflu soufflant de tous ses poumons sur un brasier. Au-dessous du Cupidon, on avait gravé au burin: «Ainsi sera toujours notre flamme!...»
Le nouveau client de M. de Saint-Roch se perdait en conjectures.
Il était là, ébahi, devant cet Amour et cette flamme, lorsqu’une porte s’ouvrit doucement et l’ambassadeur matrimonial lui-même parut sur le seuil.
C’est un petit homme grassouillet, dodu et frais à faire plaisir. Les lis et les roses que les parfumeurs vendent en petits pots s’épanouissent sur sa joue scrupuleusement rasée. Sa bouche en cœur, qui sourit comme un bouquet à Chloris, découvre un écrin de perles fines et blanches, dernier mot de l’art du dentiste. Son œil a la tendre gaîté d’un madrigal.
Coquet, soigné, musqué, il exhale les plus pénétrantes senteurs. Fait-il un mouvement, un geste, on dirait un sachet qu’on agite. Il a les grâces juvéniles d’un berger de Watteau, et des précieusetés de poses à ravir le cœur. Vestris l’eût aimé pour sa façon de cambrer la jambe, c’est le dieu Menuet en personne.
Son gilet à transparents est un souvenir du premier empire. C’est lui qui usera le dernier des habits bleu-barbeau, à boutons d’or ciselé, à basques longues et effilées. Il a renoncé à la culotte courte, mais des boucles de brillants ornent les fins escarpins de castor qui emprisonnent ses gros pieds. Des manchettes de malines cachent à demi ses mains potelées et poilues.
Il a la passion des bijoux. Toute sa personne resplendit et scintille comme le ciel d’une nuit de décembre. Des bagues s’enfilent à tous ses doigts. Ouvre-t-il son habit, on croit voir s’ouvrir la boutique d’un orfèvre. Epingles, boutons, étincelles, constellent sa cravate, sa chemise et son jabot. Des chaînes d’or tombent en triples cascades le long des plis de son gilet. Il n’a jamais moins de trois montres sur lui; leurs breloques formeraient un musée. Il ne porte pas de boucles d’oreilles, mais sa perruque blonde et frisée est un poème.
Tel il apparut radieux sur le seuil du salon, et Pascal fut ébloui.
L’ambassadeur matrimonial ne sembla pas trop fier de l’effet qu’il produisait. Sa vanité sur ce point doit être blasée. Mais comme la surprise du nouveau client ressemblait fort à une timidité exagérée, il entreprit de le rassurer. Aussi, est-ce d’une voix enchanteresse qu’il modula ces simples paroles:
—Vous étiez, je le vois, monsieur, en contemplation devant mes pauvres ex-voto.
—Ex-voto! répéta Pascal comme un écho.
—Si je me sers de cette expression, continua l’illustre négociateur, c’est que je dois à la reconnaissance tous les objets que vous voyez ici. C’est en pensant à moi que des mains amies ont brodé ces fauteuils; ces bronzes, ces tableaux, sont pour moi les gages d’un impérissable souvenir.
Pascal s’inclina. Les paroles lui manquaient pour peindre sa stupéfaction.
—Aussi, continua l’ambassadeur matrimonial d’une voix attendrie, j’aime à m’entourer de ces dons pieux. Ils sont mon trésor le plus cher, la plus précieuse récompense de mes labeurs. Mais tout n’est pas ici, je vous prie de le croire. J’ai sept autres salons encore, aussi encombrés que celui-ci.
—Monsieur, dit Pascal, vous avez, je le vois, marié bien du monde.
—Le tiers de la France, à peu près, répondit M. de Saint-Roch d’un air modeste. Beaucoup ne s’en doutent guère, beaucoup m’ont oublié.
—Est-ce possible?
—Cela est ainsi, du moins. Ah! monsieur, et l’attendrissement semblait gagner l’ambassadeur, j’ai fait bien des ingrats! On a calomnié mes intentions si pures, on m’a intenté des procès. Mais j’ai des arrêts et jugements en ma faveur, par mes soins ils ont été imprimés, avec les plaidoiries des dix avocats. J’ai des consultations qui confirment la moralité et la légalité de mes actes! j’ai encore... Mais tous ces présents que vous voyez ici ne sont-ils pas la plus éloquente des plaidoiries, le panégyrique le plus glorieux...
—Monsieur, essaya Pascal, je n’ai jamais eu l’idée de contester...
—Heureusement, continua M. de Saint-Roch, il n’est pas que des ingrats en ce monde. Tenez, ce petit groupe que vous voyez là m’a été ce matin envoyé par un jeune ménage que j’ai marié l’an passé. Je dois ce tableau à deux jeunes époux dont j’ai négocié l’union il y a quatre ans. Ah! ceux-là me donnent bien de la satisfaction; ils en sont à leur cinquième enfant, c’est une fille, et ils m’ont choisi pour parrain. Que de couples ont gardé ma mémoire au fond de leur cœur! ils m’écrivent, ils m’informent de tout ce qui leur arrive d’heureux..... Survient-il une petite brouille dans le ménage, ils me prennent pour arbitre, et j’ai bientôt rétabli la paix.
—Voilà des faits qui honorent un homme.
—Et une profession, monsieur. Ah! si les heures n’étaient pas si courtes, je voudrais, après avoir allumé le flambeau de l’hyménée, entretenir sa flamme toujours pure et brillante. Que faudrait-il pour cela? Une maison d’assurance contre les querelles de ménage. Les époux soumettraient leurs petits griefs à un jury composé de personnes des deux sexes. Le jugement rendu, d’habiles négociateurs feraient entendre raison à celui des époux qui serait dans son tort. Mais, pardon, j’abuse de vos instants, monsieur; veuillez donc prendre la peine de passer dans mon cabinet.
Et l’homme surprenant s’effaça devant Pascal, pour lui livrer passage, avec la grâce flexible d’un professeur de maintien.
Le cabinet de M. de Saint-Roch ressemble à tous les laboratoires d’affaires possibles. A la malpropreté, à la poussière près, un avoué s’y croirait chez lui. Mais les valets du négociateur font la chasse aux araignées, et essuient soigneusement le cuir doré des nombreux cartons qui tapissent la pièce.
L’ambassadeur matrimonial daigna, de sa main, avancer un fauteuil à son jeune client, et lui-même prit place devant un vaste bureau chargé de papiers et de dossiers ornés de ficelles roses.
—Monsieur, dit alors Pascal, je suis venu vous trouver parce que je désire me marier.
—Bien, monsieur, bien, très bien! répondit M. de Saint-Roch, voilà une bonne pensée. Le mariage, monsieur, est la véritable fin de l’homme. Je puis vous en parler, moi qui seul ai le droit de me dire son rénovateur. Dieu et moi avons dit à l’homme: Prends une compagne. Et si moi-même je ne suis pas père de famille, c’est que j’exerce un sacerdoce trois fois saint. Je suis voué au célibat, comme le confesseur. Je porte en moi trop de secrets pour ne pas redouter et fuir la présence d’une femme aimée.
—Aussi ai-je toute confiance.
—Loyauté et discrétion, monsieur, voilà ma devise. Ah! vous avez mille fois raison de vous adresser à moi. Comment se font, s’il vous plaît, les mariages dans le monde? Je ne parle pas des exceptions. Ils se font par hasard, par un ami, un parent, une simple connaissance. Les vieilles femmes ordinairement ont la rage de marier les gens. Oh! les vieilles femmes! Mais quelles garanties avez-vous, quel contrôle? Vous épousez de confiance, les yeux fermés. Si vous êtes délicat, on exploite votre délicatesse; on vous promettait des monts d’or, on ne vous donne rien. Mais vous êtes engagé, une fausse honte vous retient, vous êtes furieux, mais vous n’osez dire: Non.
Pascal fit un geste de dénégation.
—Oh! reprit M. de Saint-Roch, je sais qu’il y a des exceptions. Mais enfin, chez moi, jamais de surprise, jamais de déception. Ce qui honore mes actes, monsieur, ce qui les distingue, c’est que vous pouvez toujours faire vérifier par votre notaire les pièces et documents que je fournis; et cela, sans être engagé. Voilà d’où découle ma réputation hors ligne...
—C’est fort bien, monsieur, interrompit Pascal, mais ne serait-il pas temps d’en revenir à mon affaire?
—Nous y voici; mais je tenais, mon cher client, à vous donner ces explications nécessaires.
Et sur ce, l’interrogatoire de Pascal commença. Nom, profession, famille, demeure, fortune, caractère, détails intimes, le négociateur en mariages n’oublia rien. Il prenait des notes, à mesure que le jeune homme répondait. Lorsqu’il fut à bout de questions:
—Maintenant, mon cher client, dit-il, vous pouvez dormir tranquille, nous trouverons chaussure à votre pied, et cela, avant longtemps.
—Comment, répondit Pascal surpris, avant longtemps; mais je croyais que ce serait de suite...
—Oh! fit l’ambassadeur qui parut extrêmement choqué, comme vous y allez! Ah! bouillante jeunesse, continua-t-il d’un ton badin, vous croyez qu’un mariage se fait ainsi...
—Que j’avais là, dans un carton, une épouse à vous présenter? Mais parlons sérieusement. Nous sommes aujourd’hui jeudi, revenez mercredi prochain, je me serai occupé de vous.
M. de Saint-Roch se leva sur ces mots, l’audience était finie. A ce moment, quatre coups frappés sur un timbre retentirent.
—Ah! fit l’ambassadeur, quelqu’un m’attend dans le salon rose.
—Alors, dit Pascal, à mercredi.
Et il se dirigea vers la porte. M. de Saint-Roch le retint.
—Pas par là, pas par là, dit-il. Peste! vous pourriez rencontrer quelqu’un. On ne doit rencontrer personne chez moi, la maison est disposée en conséquence. J’y recevrais vingt personnes à la fois, que chacun se croirait seul. Par ici, venez.
Et, ouvrant une porte dissimulée par des cartons, il remit Pascal aux mains d’un domestique, qui le conduisit, par un couloir assez obscur, jusqu’à la rue.
Le soir même, Pascal racontait, sans omettre le plus léger détail, sa visite au négociateur. Jamais récit n’eut plus grand succès. Mais ce n’était là qu’un premier acte, et chacun engagea le jeune ingénieur à pousser l’aventure. Lorilleux lui-même, que les exhortations matrimoniales de l’ambassadeur avaient beaucoup réjoui, fut de cet avis.
Pascal fut donc fidèle au rendez-vous. Cette fois on le fit attendre dans un salon vert-pomme, à la couleur près exactement semblable au premier. Il n’eut pas le temps de s’impatienter. M. de Saint-Roch parut presque aussitôt.
Mais combien cette seconde réception fut différente de la première! Pascal fut accueilli comme un fils attendu avec impatience, l’ambassadeur ne savait quelle fête lui faire.
—Eh bien! lui dit-il, j’ai pensé à vous. Ah! vous êtes un jeune homme bien honnête, et je vous dois des félicitations: pourquoi tous mes clients ne vous ressemblent-ils pas?
—Comment cela, en quoi?
—Eh! vous êtes trop modeste, mon cher enfant, vous m’avez caché une partie de votre fortune. Que me disiez-vous donc, que votre père possède dix mille livres de rentes et une étude qui vaut quarante mille francs? Son étude vaut trente mille écus, et il a bien près de vingt mille livres de rente. Sa seule ferme de Kerpris rapporte douze mille francs par an. Il a près de Guingamp des bois magnifiques, et de superbes prés le long du Trieux.
Jamais homme ne fut plus stupéfait que Pascal en écoutant ces détails. Comment! un étranger connaissait mieux ses affaires que lui-même? D’où diable M. de Saint-Roch tenait-il ces détails?
—Ce n’est pas tout, continua le fondateur de la profession matrimoniale, vous annonciez une fortune personnelle de trois cent mille francs; vous avez beaucoup mieux que cela. Le docteur Lorilleux dit partout que vous avez le double, mais votre associé, M. Lantier, calcule sur quatre cent cinquante mille francs.
—Morbleu! monsieur, dit Pascal, d’où savez-vous tout cela?
—Eh! eh! fit M. de Saint-Roch en riant, on est allé aux renseignements.
—Monsieur!
—N’allez-vous pas vous fâcher? Ah çà, croyez-vous donc que je marie les gens sans savoir ce que je fais? Ce serait de belle besogne, vraiment! Sachez que je n’ignore aucun détail de l’existence de mes clients. Je sais toutes les particularités de votre vie mieux que votre meilleur ami, le docteur Lorilleux. Ainsi, je pourrais vous dire ce que vous lui avez caché: par exemple, pourquoi vous avez donné votre démission il y a six ans.
—Oh! pour cela!...
—Eh! cher client, vous vous êtes retiré parce que vous deviez être nommé en province, et qu’à aucun prix, à ce moment, vous ne vouliez quitter Paris, à aucun prix! Certaine affaire de cœur...
Pascal devint cramoisi. Il eut presque peur.—«Ah çà, pensait-il, c’est un sorcier, cet homme, ou un employé de la préfecture de police.» Il regrettait fort sa démarche, et était bien près de se fâcher.
—Je sais que tout est fini depuis longtemps, ajouta M. de Saint-Roch. D’ailleurs, soyez sans inquiétude; ma maison, je vous l’ai dit, est un confessionnal. Effrayé de l’immense responsabilité qui pèse sur moi, jamais, par discrétion, je n’ai formé aucun élève. J’emporterai mes secrets au tombeau; cabinet, titres, notes, correspondances, tout mourra avec moi, et alors, la profession matrimoniale retombera dans l’enfance et la déconsidération.
Il prononça ces dernières paroles d’une voix émue, sa figure fardée exprimait une douleur profonde. Pascal ne savait s’il devait rire ou se mettre en colère. Était-ce un charlatan ou un homme convaincu? «—Quel comédien!» pensa le jeune homme. Peu à peu cependant le sourire habituel revint sur les lèvres de l’homme singulier.
—Maintenant, parlons de vous, dit-il. Vous êtes jeune, joli garçon, spirituel, riche, vous êtes très facile à marier, l’affaire sera vite faite. Répondez-moi comme à votre confesseur: Vous mariez-vous par spéculation, voulez-vous beaucoup d’argent?
—L’argent est une belle chose, je ne le méprise pas, mais je veux aimer la femme que j’épouserai.
—Eh bien! vous êtes dans le vrai. Parfois, je suis forcé de me prêter à des spéculations, mais cela me fâche toujours. Ainsi, nous disons une fortune qui réponde à la vôtre, une femme que vous puissiez aimer.
—Vous l’avez dit.
M. de Saint-Roch se leva, et, prenant un énorme registre, l’ouvrit sur son bureau.
—J’ai là, dit-il en frappant sur le registre, là, les plus riches fortunes de France et des divers pays, toujours avec titres à l’appui.
Pascal s’avança pour jeter un coup d’œil sur ce répertoire de toutes les héritières de l’Europe.
—Oh! vous pouvez regarder, dit l’ambassadeur, vous n’y comprendrez rien. Tous mes registres sont écrits en caractères hiéroglyphiques, et seul j’en ai la clef.
Tout en parlant, il feuilletait son registre:
—Quinze cent mille francs, c’est trop. Cent mille francs, pas assez. Là, il faut être noble, baron au moins; ici, on veut un militaire; il y a des parents singuliers! Ah! voici, peut-être: un million comptant, une veuve, cinquante-trois ans...
—Bien obligé.
—Cherchons encore. Ici, on désire que le mari continue à gérer une fabrique. Cette demoiselle exige que l’homme qu’elle prendra ne fume pas; des exigences et pas de dot! Cette autre n’épousera qu’un blond, et vous êtes brun; belle fortune pourtant. Ah! une de mes meilleures clientes, elle s’est remariée trois fois, toujours par mes soins: vingt-neuf ans, cinq enfants...
—Passons...
—Voici peut-être votre affaire: deux cent mille francs, dix-huit ans, excellente éducation, parents honorables...
—Cela pourrait aller.
—D’autant que je vous donne le chiffre du comptant. Il y a de belles espérances, très belles, superbes. La mère est âgée, sa santé est déplorable, vous comprenez.... et toute la fortune est de son côté. Quant à la jeune fille, elle est très jolie, ma foi! grande, bien faite, blonde. S’il faut tout dire, je lui crois un caractère inégal, les domestiques ne restent jamais plus de deux mois dans cette maison-là.
—Oui, quand on se marie, c’est pour plus longtemps. Les parents exigeront que leur gendre demeure avec eux...
—Alors, merci. Puis, je dois vous l’avouer, je n’aime pas les blondes.
—Fort bien! Et M. de Saint-Roch continua sa revue. Ah! pour le coup, s’écria-t-il, nous y voici. La demoiselle est charmante, oui, charmante, et brune. Elle a vingt ans, et n’est jamais allée en pension. Excellente éducation cependant, la mère est un peu rigoriste. La jeune personne a le meilleur caractère, elle est aimable, vive, enjouée, un peu enfant peut-être; mais elle n’est pas coquette et sait tenir une maison. Le père est un ancien fabricant de Roubaix, retiré depuis trois ans, un brave et excellent homme, nullement taquin. Grande fortune, ma foi! en immeubles, s’il vous plaît, bien près d’un million. Ils donneront cent mille écus.
—Arrêtons-nous, dit Pascal, il me semble difficile de trouver mieux.
—N’est-ce pas? Certainement la demoiselle vous plaira. Par exemple, je ne puis vous garantir, à cinquante mille francs près, le chiffre de la dot. Le père est un peu serré.
—Peu importe, je vous ai dit mes prétentions. Je ne suis pas exigeant. Et maintenant, quel est le nom de cette jeune fille, quand la verrai-je?
—Patience, vous saurez son nom quand il le faudra; on ne tardera pas à vous présenter. Il ne nous reste plus qu’une formalité à remplir, la plus simple au monde.
M. de Saint-Roch présenta alors un petit papier à son nouveau client, en le priant de vouloir bien le signer.
Pascal s’y engageait à compter à l’ambassadeur matrimonial cinq pour cent sur la dot, le lendemain de son mariage avec mademoiselle...
Le nom était en blanc.
—«Voilà le fond du sac, pensa Pascal. Dois-je signer? Bah! je ne crois pas que cette signature puisse jamais me coûter un centime.» Et, de sa plus belle écriture, il traça son nom au bas du papier.
M. de Saint-Roch prit la plume à son tour. Il mit sa signature à côté de celle de Pascal. Puis, dans le blanc laissé à la place du nom de la jeune fille, il écrivit: Antoinette Gerbeau.
—Antoinette, dit Pascal. Ce nom me plaît assez.
—C’est d’un heureux augure, répondit gracieusement M. de Saint-Roch; vous aurez bientôt de mes nouvelles.
Il mit ensuite son client à la porte avec les mêmes précautions que la première fois.
Les détails de cette seconde entrevue égayèrent encore beaucoup les amis du jeune ingénieur, sauf vers la fin. L’épisode du papier à signer leur parut inconvenant. L’homme d’affaires en cela perçait trop sous l’habit bleu-barbeau du commis-voyageur de l’hymen. Presque tous affirmèrent qu’ils n’auraient certes pas oublié leur signature dans ce mystérieux laboratoire, et ils déclarèrent que M. de Saint-Roch n’aurait pas leur pratique.
Lorilleux profita de ces dispositions pour en revenir à ses moutons et répéter, avec plus d’assurance, que jamais l’ambassadeur matrimonial n’avait marié personne. On partagea son avis, et on l’engagea, puisqu’il était toujours décidé à prendre femme, à s’adresser ailleurs.
Il y avait trois jours que, pour la dernière fois, à ce qu’il croyait, Pascal avait salué M. de Saint-Roch; il ne songeait plus guère à l’ambassadeur matrimonial, lorsqu’un soir, comme il rentrait, son domestique lui remit une lettre apportée dans la matinée.
Pascal brisa le cachet et lut:
«Monsieur et cher client,
«Je reçois à l’instant l’avis qu’une excellente occasion se présente pour vous de voir mademoiselle Gerbeau. Mon excellent ami le chevalier de Jeuflas ira ce soir vous prendre à neuf heures précises. Il se fera un plaisir de vous conduire à un bal où vous rencontrerez cette demoiselle.
«Je serais désolé que ma lettre ne vous parvînt pas à temps, peut-être ne trouverions-nous jamais de si tôt pareille occasion, la jeune personne sortant peu.
«Considérez-moi, je vous prie, monsieur et cher client, comme le plus dévoué de vos amis.
«J.-D. de Saint-Roch.»
—Diable! se dit Pascal, à neuf heures! Il est huit heures et demie passées, je n’ai que le temps de fuir si je veux éviter le personnage.
Mais, au même instant, le domestique annonça:
—Monsieur le chevalier de Jeuflas.
Le chevalier est un homme du meilleur monde, aimable, poli, distingué. Il serait difficile de lui assigner un âge, il doit avoir entre trente et soixante-cinq ans.
Ce qui se voit du premier coup d’œil, c’est qu’il a un excellent tailleur. Deux ou trois ordres, dont un marron clair, fleurissent à sa boutonnière. Il grasseye légèrement en parlant.
M. de Jeuflas n’eut aucunement l’air embarrassé de se présenter ainsi chez un étranger. Il salua gracieusement Pascal.
—Monsieur, dit-il, un de mes bons amis, qui a pour vous une estime singulière, m’a dit votre désir d’aller dans le monde. Je me tiendrai pour très honoré de présenter dans les quelques maisons où je suis reçu un homme aussi distingué que vous.
La pose, le geste, le ton, tout était parfait. Voilà ce que remarqua Pascal tout en se confondant en excuses. Il expliqua que, rentré depuis quelques minutes à peine, il n’avait été prévenu qu’à l’instant de la venue du chevalier. Dans le fait, bien que fort intrigué, il hésitait à suivre l’ami de M. de Saint-Roch.
—Je ne suis pas prêt, monsieur, ajouta-t-il, et je craindrais d’abuser de votre obligeance...
—Oh! qu’à cela ne tienne, répondit le chevalier, rien ne nous presse, et je puis fort bien vous attendre.
La curiosité triompha, et Pascal, après quelques façons, se décida à suivre M. de Jeuflas. Pour lui faire prendre patience pendant qu’il s’habillerait, il lui offrit des cigares; mais le chevalier refusa, bien qu’amateur, avoua-t-il, de bons cigares, parce qu’il ne fumait jamais lorsqu’il devait aller dans un salon où se trouveraient des femmes.
Tout en s’habillant, Pascal se disait:
—Où diable M. de Saint-Roch pêche-t-il de pareils compères? C’est qu’il est fort bien. Il n’y a plus que les gentilshommes et les coiffeurs, à craindre d’empester le tabac lorsqu’ils se présentent chez une femme; évidemment le chevalier est un gentilhomme. Allons, l’intrigue se complique.
Le chevalier avait sa voiture. Lorsqu’il y fut installé à côté de Pascal:
—Pour ce soir, dit-il, nous allons chez un ancien magistrat, fort de mes amis, qui donne deux ou trois soirées dansantes par hiver. C’est une bonne et agréable maison, où vous vous plairez, j’en suis sûr.
A la façon dont la maîtresse de la maison le reçut, lorsque M. de Jeuflas l’eut présenté comme un de ses meilleurs et de ses plus anciens amis, Pascal vit bien que le chevalier était effectivement très considéré, et plus aimé encore. A sa seule recommandation il dut cet accueil amical et gracieux qu’on réserve pour les hôtes aimés.
Quant à la maison, elle était vraiment ce qu’avait dit le compère de l’ambassadeur.
Pascal se sentit soulagé d’une assez grande inquiétude. Il n’avait pas craint une avanie, mais il redoutait fort d’être conduit dans un monde au moins équivoque.
La présentation terminée, M. de Jeuflas tira son très nouvel ami un peu à l’écart.
—Voyez donc là-bas, lui dit-il du ton le plus désintéressé, sur la banquette qui touche la fenêtre, cette jolie personne, au premier rang, la troisième après le rideau. Oui, là. N’est-ce pas, qu’elle est ravissante? C’est mademoiselle Antoinette Gerbeau. J’aime beaucoup son père; sa mère est le modèle achevé de toutes les vertus. Je suis un de leurs intimes.
Il s’éloigna sur ces mots, laissant son jeune ami, comme il disait, à ses réflexions.
Pascal aurait été bien difficile s’il n’avait été de l’avis du chevalier. Mademoiselle Gerbeau était une admirable jeune fille. D’épais cheveux bruns encadraient sa figure d’une expression charmante, et faisaient ressortir l’admirable blancheur de son teint; sa bouche était mutine et rieuse, ses grands yeux noirs pétillaient de malice et de gaîté. On valsait, à ce moment, et sans doute elle regrettait de rester à sa place. De temps à autre, elle se retournait vers sa mère, placée derrière elle, comme pour lui reprocher de l’avoir privée d’un grand plaisir.
—«M. de Saint-Roch ne m’avait pas trompé,» pensa Pascal. Mais à ce moment, en présence de cette jeune fille si belle, le souvenir de l’ambassadeur matrimonial le gênait; il eût voulu l’oublier et ne devoir qu’au hasard le plaisir d’admirer cette beauté si parfaite.—«Je vais toujours l’inviter à danser,» se dit-il; et tournant autour du salon, en longeant les banquettes pour éviter les valseurs, il arriva jusqu’à mademoiselle Gerbeau.
Elle était engagée pour tous les quadrilles, sauf pour le prochain. Personne n’avait eu l’idée de le lui demander, pensant qu’elle l’avait promis. Elle s’inquiétait même un peu de faire encore tapisserie pendant une contredanse, après n’avoir pas valsé. Aussi Pascal fut admirablement accueilli, non parce qu’il était homme d’esprit et beau cavalier, mais uniquement parce qu’il était le danseur désiré.
Pascal n’aimait pas la danse; il trouvait le quadrille moderne un divertissement fort ridicule, et pourtant celui qu’il dansa avec mademoiselle Gerbeau lui sembla trop court. Il aurait été, il est vrai, bien embarrassé de dire pourquoi. Sa conversation avec la jeune fille n’avait eu rien de bien attachant. Il avait, entre les figures, chuchoté quelques-uns de ces riens qui sont le hors-d’œuvre obligé de la contredanse, et que chaque danseur met dans la poche de son habit noir avec son foulard. Mademoiselle Gerbeau avait murmuré bien timidement quelques monosyllabes, et voilà tout.
Cependant, quand l’orchestre s’arrêta, essoufflé d’avoir couru après les ritournelles, découpées dans l’opéra en vogue ou dans quelque mélodie de Beaumann, il avait envie de crier: Encore!
Il lui fallait reconduire sa danseuse à sa place. Tout en prenant le plus long, pour avoir le plaisir de la sentir s’appuyer à son bras quelques minutes de plus, il la pria de lui accorder une mazurque, puisqu’elle avait promis tous les quadrilles.
—Je ne danse pas la mazurque, monsieur, dit-elle d’un petit air triste.
—Je vous en prie, mademoiselle, insista Pascal, permettez-moi de solliciter cette faveur en présence de madame votre mère; je suis sûr qu’elle ne me refusera pas.
Elle leva les yeux sur Pascal, et rougit de se voir devinée. Elle brûlait de la danser, cette mazurque séduisante, mais sa mère était inflexible. Bien bas, sans avoir grand espoir dans une démarche plusieurs fois renouvelée, elle répondit:
—Je le veux bien, monsieur.
Il est très-éloquent, au moins, cet intrigant de Pascal Divorne, mon ami; il le montra bien. Il emporta d’emblée le consentement de madame Gerbeau. Et ce n’était pas chose facile, car elle a des principes arrêtés, très arrêtés, et ne s’en départ pas volontiers. Jusqu’à ce jour elle avait juré, au su de tout le monde, que jamais, au grand jamais, sa fille ne se mêlerait à ces danses inconvenantes où un jeune homme a le droit d’enlacer de son bras la taille d’une jeune fille.
Oui, elle l’avait juré et crié sur les toits; c’était l’article premier de la charte maternelle octroyée le jour où, pour la première fois, elle avait conduit sa fille au bal. Tout le monde le savait bien. Aussi lorsqu’on vit mademoiselle Antoinette mazurker avec ce beau jeune homme que personne ne connaissait, on pensa qu’il y avait quelque chose, et que le danseur heureux était un futur mari.
Pascal, lui, fut héroïque; il dansa avec d’autres jeunes filles trois ou quatre quadrilles, espérant ainsi mériter une mazurque nouvelle. Mais lorsque, vers deux heures du matin, il chercha madame Gerbeau pour lui arracher un second consentement, elle avait disparu.
Son dépit fut vif. Il regretta de s’être donné tant de mouvement pour rien. Alors seulement il se souvint de son introducteur. Il eut quelque peine à le découvrir; enfin il l’aperçut dans le salon de jeu.
Le chevalier de Jeuflas était assis à une table d’écarté. Il gagnait. Ce n’était plus le même homme, sa froideur l’avait quitté, sa figure exprimait une joie passionnée, bien que contenue. Son regard s’était allumé et lançait des éclairs fauves comme l’or amassé devant lui.
—Voilà donc le secret! pensa Pascal, cet homme est un joueur. C’est par le jeu que M. de Saint-Roch le tient. Pauvre homme! quelle servitude!
En apercevant son protégé, le chevalier lui fit an signe amical. Attendez-moi, semblait-il lui dire. De ce moment, il ne fut plus à son jeu. Ses traits reprirent leur calme, son regard s’éteignit.
Dès qu’il put quitter la table d’écarté, il se leva et vint rejoindre Pascal.
—Eh bien! lui demanda-t-il, non sans une certaine anxiété, qui se lisait bien dans ses yeux.
—Vous me voyez ravi, répondit le jeune homme, enchanté, sous le charme. De ma vie je n’ai vu une aussi charmante jeune fille.
—N’est-ce pas? dit avec une satisfaction non moins visible que son anxiété le chevalier de Jeuflas. Eh bien, je l’aurais parié. Voulez-vous que je vous présente à son père, qui est, je vous l’ai dit, mon ami?
—Je le voudrais, mais je crois que ces dames sont parties.
Le chevalier tira sa montre.
—Trois heures bientôt. Il est trop tard en effet, ces dames se retirent toujours à deux heures. Madame Gerbeau est inflexible, excepté pour vous, cependant. Ah! il faut que vous lui plaisiez bien.
—Comment! cette mazurque...
—Si vous connaissiez cette mère, vous sauriez quelle immense faveur. Mais, dites-moi, êtes-vous libre, demain matin?
—Pourquoi cela?
—Je vous ferais déjeuner avec M. Gerbeau.
—Je suis libre comme l’air, répondit Pascal avec empressement.
—Eh bien! demain, ou plutôt aujourd’hui, à onze heures précises, promenez-vous dans le passage Jouffroy, je vous rencontrerai par hasard.
—J’y serai, comptez sur moi.
A onze heures trois minutes, Pascal en était à son second tour dans le passage Jouffroy, lorsqu’il vit venir de loin le chevalier de Jeuflas, donnant le bras à un homme d’une soixantaine d’années, à la figure prospère, à la physionomie bienveillante. C’était M. Gerbeau.
Le chevalier parut enchanté de rencontrer son jeune ami; il lui raconta qu’il était allé le matin même débaucher son vieil ami Gerbeau; bref, il finit par l’inviter à venir déjeuner avec eux. Ce que Pascal accepta avec un visible plaisir.
En route, bien qu’on n’eût pas loin à aller, M. de Jeuflas trouva le moyen de raconter, à l’oreille de M. Gerbeau, la biographie de Pascal. Si bien qu’en arrivant à la porte du restaurant, l’ancien fabricant savait qu’il allait déjeuner avec un jeune homme charmant, remarquable autant par sa conduite que par son talent, ancien élève de l’École polytechnique, appartenant à une famille honorable et riche, et orné d’une fortune personnelle de quatre cent mille francs.
Le chevalier dit tout cela entre deux bouffées de son cigare, car il fumait le matin.
Au moins son adresse ne fut pas perdue. Le dessert n’était pas servi, que déjà Pascal avait séduit le père d’Antoinette. Au café, la conquête était achevée.
M. Gerbeau, fabricant très habile, était un fort médiocre connaisseur en maisons. Or, depuis dix-huit mois, il se trouvait à la tête d’une assez mauvaise affaire. Saisi tout à coup de la passion de bâtir, passion qui a troublé la cervelle de tant de pauvres rentiers, il avait eu la fâcheuse idée de vendre des propriétés qu’il avait en Saintonge, pour acheter des terrains à Paris. Sur ces terrains, acquis de seconde main, et fort cher, il avait eu l’idée non moins malheureuse de faire bâtir.
Une maison en construction, pour qui n’est pas initié, est une véritable bouteille à l’encre: impossible de rien voir aux dépenses. Voilà où en était M. Gerbeau. Il comprenait instinctivement qu’on le pillait, mais qui? mais comment? Il était sérieusement inquiet, parce qu’il savait vaguement qu’il en est de la spéculation comme de l’engrenage d’une machine: qu’on laisse s’engager un doigt sous la roue, il faut bientôt couper le bras, si on ne veut pas que le corps suive le doigt. Dans la spéculation, un billet de banque attire l’autre, une fortune est vite à sa fin.
M. Gerbeau conta sa mésaventure à Pascal, et Pascal lui promit de le tirer de là, en faisant la part au feu, s’il le fallait absolument, mais en la faisant aussi petite que possible.
Il tint parole, et après huit jours de courses, de démarches, de calculs du jeune ingénieur, le fabricant put voir clair dans son affaire. Cette petite expérience lui coûtait soixante mille francs net. Il entrevit non sans frémir la profondeur du gouffre où il avait failli être précipité. Il comprit que sans Pascal il était peut-être ruiné: sa reconnaissance fut grande.
Toutes ces démarches, on le comprend, ces arrangements à prendre, amenèrent souvent Pascal chez M. Gerbeau pendant les jours qui suivirent leur première rencontre. Il y fut invité à dîner à plusieurs reprises. Ainsi, il eut de fréquentes occasions de voir mademoiselle Antoinette, et loin de revenir sur sa première impression, il ne fit que subir davantage le charme. Il trouvait dans cette famille un parfum d’honnêteté, de bonheur, d’aisance, qui lui rappelait le doux souvenir de sa famille. En madame Gerbeau, cette mère si digne sans raideur, si tendre sans faiblesse, il croyait revoir sa mère. Enfin, il le sentait, il le comprenait, il aimait Antoinette.
C’est alors que Pascal eût souhaité voir l’ambassadeur matrimonial descendre au tombeau avec tous ses secrets, titres, actes et registres écrits en caractères hiéroglyphiques. L’ombre de l’onctueux et paternel M. de Saint-Roch le poursuivait plus terrible et plus fardée que celle de Jézabel. Il n’osait le maudire, car enfin c’était à lui qu’il devait de connaître celle qu’il aimait, mais comme il l’aurait anéanti de bon cœur!
Puis il se rappelait sa signature au bas d’un traité, en caractères très lisibles. Il l’avait devant les yeux, ce traité, écrit en caractères de feu; il lui semblait avoir signé un pacte diabolique.
Et ce terrible chevalier de Jeuflas, autre démon, autre remords! Celui-là semblait peut-être plus effrayant à Pascal, car le négociateur sort peu de son laboratoire, et ce chevalier, il devait le rencontrer à chaque pas, c’était un ami de la famille dans laquelle il voulait entrer. N’assisterait-il pas au mariage? Alors sans doute un sourire satanique viendrait errer sur ses lèvres!
Oh! comme Pascal aurait volontiers donné la moitié de ce qu’il possédait pour connaître Antoinette sans avoir jamais connu les deux complices du pacte.
Et personne à qui conter ses peines, pas un ami à consulter! Pour rien au monde Pascal n’eût voulu que son meilleur ami, que Lorilleux sût ce qui se passait. Il tremblait à cette seule idée qu’un jour, peut-être, quelqu’un viendrait à savoir qu’il s’était marié par l’entremise de M. de Saint-Roch.
Cependant il fallait se décider à quelque chose. Pascal avoua à M. Gerbeau qu’il aimait sa fille. Le fabricant fut ravi de cet aveu; seulement il demanda quelques jours pour consulter sa femme et sa fille.
La réponse fut favorable: trois jours après sa demande, Pascal était admis à faire sa cour—officiellement.
Mais à qui devait-il cette décision si prompte, qui comblait ses vœux les plus chers?
Au chevalier de Jeuflas, qui avait évité du temps perdu à courir aux renseignements, et avait répondu sur sa tête de son jeune ami; au chevalier de Jeuflas qui, pendant tout un après-midi, enfermé avec madame Gerbeau, avait chanté les louanges de son protégé: il était descendu aux moindres de ces détails, si précieux pour une mère inquiète du bonheur de sa fille; il avait dit jour par jour la vie du jeune ingénieur; au chevalier de Jeuflas enfin, qui avait parlé de la famille de Pascal comme s’il la connaissait depuis vingt ans, et avait tracé de M. et de madame Divorne le portrait le plus flatteur et le plus ressemblant.
Le chevalier n’avait certes rien dit que de très vrai. Mais devoir son bonheur à un pareil homme! être son complice!—car enfin il mentait en réalité, puisqu’il avançait des choses dont il n’était pas sûr, des faits qu’il ignorait,—quel supplice et quelle honte!
Pascal ne savait pas au juste s’il était furieux ou au comble de la joie.
Depuis quinze jours, Pascal, autrefois si casanier, n’habitait plus chez lui. Ses amis venaient et ne le trouvaient pas.
Le domestique avait tous les jours la même réponse à la bouche:
—Monsieur est sorti, il a dit qu’il ne rentrerait pas de la soirée.
Jean Lantier cherchait en vain son associé pour une affaire qui ne souffrait, disait-il, aucun retard: pas d’associé.
Lorilleux se perdait en conjectures et se mourait d’inquiétude.
Cela ne pouvait durer, et un soir la même préoccupation réunit l’entrepreneur et le médecin. Tous deux, à dix heures du soir, attendaient Pascal dans son cabinet.
Jean Lantier, pressé par sa femme, voulait parler d’une de ses filles.
Lorilleux était décidé à inviter son ami à venir dîner en famille, le surlendemain, comptant lui présenter sa sœur.
A onze heures, Pascal rentra radieux. Il avait passé la soirée près de mademoiselle Antoinette, elle n’avait pas répondu: Non, à une question qu’il avait osé lui adresser tout bas.
Pascal rentrait avec la résolution bien arrêtée d’écrire à sa famille pour solliciter l’autorisation nécessaire, et d’annoncer hautement son mariage. C’était bien le meilleur moyen de détourner les soupçons, si quelqu’un pouvait en avoir. Ainsi il laissait M. de Saint-Roch et le chevalier de Jeuflas dans la coulisse dont ils ne devaient pas sortir. Les constructions de M. Gerbeau expliquaient parfaitement l’introduction de Pascal dans cette famille: les relations d’affaires sont souvent le prélude d’une bonne et sincère amitié.
—Ce n’est pas malheureux! s’écria Lorilleux, dès que le jeune ingénieur parut, voici deux heures que nous t’attendons. Te voir devient furieusement difficile. Mais tu es superbe! chez quel prince souverain as-tu dîné? Je ne te savais pas si beau.
Depuis sa première entrevue avec mademoiselle Gerbeau, Pascal en effet tournait au dandy.
—Il faut bien corriger un peu la feuille de figuier, répondit-il gaîment; quand on veut faire des conquêtes, on doit autant que possible revêtir l’armure du conquérant. Donc, tu es satisfait de mon armure?
—Conquêtes! conquérant, balbutia Lorilleux.
—Certainement. Ne vas-tu pas te fâcher de ce que j’ai adopté les idées dont tu me rebats les oreilles depuis un temps infini? Mais, à propos, depuis deux semaines que je t’ai à peine entrevu, as-tu découvert enfin ta jeune fille idéale?
Le médecin eut le pressentiment d’un horrible malheur.
—Non, pas encore, répondit-il; trouver une femme comme je la veux n’est pas facile.
—Je crois bien, dit Jean Lantier, mettre la main sur l’anguille dans le sac de vipères.
—Vous êtes aussi trop exigeants, reprit Pascal. Et, ma foi! comme je ne poursuis pas une chimère, j’ai trouvé. J’espère bien avoir pris l’anguille, comme dit Jean Lantier. Bref, mes amis, vous qui êtes mes meilleurs amis, vous saurez les premiers la grande nouvelle: Je me marie, c’est décidé.
Ce fut comme un coup de massue pour les deux amis du jeune ingénieur.
Lantier s’affaissa lourdement sur un fauteuil. Lorilleux demeura pétrifié, plus immobile que la femme de Loth après la métamorphose, plus pâle que sa cravate blanche de docteur. Pascal les regardait avec stupéfaction.
—Eh! mais, dit-il, la nouvelle de mon mariage ne paraît pas vous causer une joie folle. Je pensais que vous partageriez mon bonheur, je m’attendais à des félicitations...
—Ce n’est donc pas une plaisanterie? demanda Lantier.
—Une plaisanterie! J’espère bien qu’avant trois semaines nous célébrerons la noce, et je compte que vous en serez, Lantier, mon vieil ami. Et nous allons nous occuper de me bâtir une jolie petite maison, où nous pendrons la crémaillère avant l’hiver prochain.
—Je ferai tout ce qu’il vous plaira, dit l’entrepreneur avec un soupir. J’étais venu, ajouta-t-il, pour vous parler d’une affaire que j’ai, c’est-à-dire que j’avais en vue; mais comme rien ne presse, ce sera pour une autre fois. Il se fait tard aujourd’hui, et l’instant ne me paraît pas bien choisi.
En saluant Lorilleux qui ne le voyait pas, il serra la main de Pascal et sortit. On put entendre son pas lourd dans l’escalier que, deux heures auparavant, il avait monté leste et joyeux.
En même temps que Lantier sortait, Pascal passa dans une autre pièce, laissant Lorilleux seul dans son cabinet.
Alors seulement le médecin sortit de son immobilité. Mais ce fut pour se livrer à un de ces accès de rage froide que connaissent seuls les gens de cette trempe.
La bile, et non le sang, lui montait à la tête à flots pressés, lui serrait la gorge à l’étouffer, et l’aveuglait. D’un mot, Pascal venait de renverser le laborieux édifice de sa vie, il était enseveli sous les décombres.
Tout est perdu, plus d’espérance! Voilà les mots qui bourdonnaient à son oreille, et sa fureur redoublait. Il se sentait capable des plus grands crimes. Comme il haïssait cet homme qu’hier encore il nommait son ami! Et en quelques minutes sa haine avait pris d’effroyables proportions.
—L’infâme, disait-il d’une voix sourde, les dents serrées, le misérable, trahir ainsi notre amitié... Oh! il me paiera cher les horribles souffrances qu’il me donne. Le bonheur de sa vie ne suffira pas à me payer de tels moments.
Et il marchait çà et là, dans le cabinet, avec l’agitation fiévreuse d’un fou, l’œil hagard, plus effrayant que le tigre qui tourne autour de sa loge. Ses doigts crispés heurtaient les murailles. Avec quel bonheur il aurait poignardé Pascal! Mais il cherchait, il voulait une vengeance plus raffinée.
Mais c’était déjà plus que n’en pouvait supporter le médecin. Cet accès furieux ne dura qu’une minute; il fut obligé de s’asseoir. Sa colère n’avait pas diminué, il était homme à l’entretenir pendant des années, mais peu à peu il recouvrait son sang-froid.
Sa figure contractée reprenait son masque habituel. Il réfléchissait, tout en froissant machinalement quelques papiers placés devant lui sur une table.
Tout à coup un nom au bas d’une lettre lui sauta aux yeux, un nom qui lui révélait l’énigme de la conduite de Pascal.—«Une lettre de M. de Saint-Roch,» se dit-il; et il lut ce billet qu’avait écrit l’ambassadeur matrimonial pour annoncer à son client la venue d’un de ses amis.
La date de cette lettre, qui concordait si bien avec la disparition de Pascal, valait pour Lorilleux les plus longues et les plus complètes explications.
—Plus de doute, pensa-t-il, c’est cette demoiselle Gerbeau qu’il épouse! S’il me faut une assurance encore pour me prouver que je ne me trompe pas, Pascal lui-même va me la donner tout à l’heure. Se marier par l’intermédiaire d’un M. de Saint-Roch! c’est horrible. Mais tout n’est pas perdu encore, murmura-t-il après un moment de réflexion. Je puis parer ce coup terrible et imprévu.
Et obéissant à une inspiration soudaine, qui illumina d’un rayon de joie sa pâle figure, il prit une plume et se prépara à écrire.
A ce moment la voix de Pascal retentit dans la pièce à côté.
—Eh bien! docteur, tu ne viens pas te chauffer? Il fait un froid de loup dans mon cabinet, nous serons ici beaucoup mieux pour causer. Apporte donc la boîte aux cigares.
—Je suis à toi, cria le médecin; laisse-moi achever une lettre...
Lorilleux écrivit en effet, non pas une lettre, mais deux. Voici la première:
«Cher monsieur Divorne,
«Si vous voulez éviter un irréparable malheur, accourez sans perdre une minute. Votre fils est tombé entre les mains d’un brocanteur de mariages que vous connaissez peut-être de nom, M. de Saint-Roch. Cet homme va le faire entrer dans une de ces familles que fuient tous les honnêtes gens, il va lui faire épouser une de ces jeunes filles qui ne trouvent pas de maris. Pascal est amoureux et aveugle. Il s’est caché et se cache de ses meilleurs amis. Leurs représentations seraient d’ailleurs inutiles, vous savez l’entêtement de votre fils. Seul vous pouvez sauver de la honte et du désespoir ce malheureux jeune homme.
«Un de vos amis.»
«P.S. Peut-être sera-t-il convenable de ne pas montrer cette lettre à Pascal. Venez, venez vite.»
La seconde lettre, destinée à M. Gerbeau, était ainsi conçue:
«Cher ami,
«Reçois mes compliments sincères: tu es un bon père et un gaillard sans préjugés. Tu maries ta fille à un homme qui t’a été présenté par M. de Saint-Roch, l’habile agent matrimonial. Antoinette sera bien heureuse! Tu dois être fier d’avoir pour gendre un homme enrichi par des spéculations véreuses,—si toutefois il est riche, ce dont je doute. Tu seras plus glorieux encore quand tu sauras pourquoi M. Pascal Divorne a été honteusement chassé de l’École des ponts et chaussées. Adresse-toi à lui pour le savoir. Allons, bonhomme, prépare les écus de la dot.
«Comme tu pourrais ne pas me croire, je t’envoie des pièces justificatives, un autographe de l’illustre Saint-Roch.
«Ton meilleur camarade te félicite. A quand la noce?»
Dans cette seconde missive, Lorilleux renferma soigneusement le billet de M. de Saint-Roch. Puis il plia les deux lettres anonymes, mit l’adresse à la première, et rejoignit Pascal pour savoir de lui où il fallait adresser la seconde. Le médecin était tout heureux, comme un homme qui vient de voir se briser en éclats, à deux pas de lui, une tuile qui semblait devoir lui tomber inévitablement sur la tête.
—Eh bien! demanda-t-il à Pascal, maintenant que nous voici seuls, vas-tu au moins me raconter le roman de tes amours, affreux cachottier?
Le jeune ingénieur ne demandait pas mieux. Quelle excellente occasion pour parler d’Antoinette! Il ne s’en fit pas faute, et fut prolixe comme un amoureux. Mais il eut bien soin d’omettre les noms de l’ambassadeur et du chevalier son compère. Il dit qu’une personne de ses connaissances lui avait adressé l’ancien fabricant qui avait besoin d’un architecte; il avait eu le bonheur de sauver la fortune de ce brave homme, et leur intimité datait de ce service. Il avait vu la jeune fille, il l’avait demandée, on la lui avait accordée, c’était tout.
—Tu as oublié, dit le médecin, le nom de cet estimable fabricant?
—Il s’appelle Gerbeau.
—Je ne m’étais pas trompé, pensa Lorilleux. Et où demeure, ajouta-t-il tout haut, l’heureux père de cette fille charmante?
—Rue Pavée, au numéro 5, répondit Pascal sans défiance.
—Quoi! tu te maries au Marais! Oh! fi, le bourgeois!
—Mon cher, le Marais est, après le faubourg Saint-Germain, le quartier des héritières; ne t’y trompe pas. C’est aussi un des rares recoins de Paris où l’on trouve encore des maisons habitables, avec de vrais appartements, et des escaliers où l’on peut passer deux de front.
—Allons, tu es un heureux mortel, fit le médecin. Mais, étourdi que je suis, j’ai oublié quelque chose dans l’épître que je viens de griffonner.
Et passant dans le cabinet de Pascal, il écrivit, en déguisant son écriture, comme il l’avait déjà déguisée, sur l’adresse de la seconde lettre anonyme:
A monsieur
Monsieur GERBEAU, ancien négociant,
5, rue Pavée, au Marais.
PARIS.
—Adieu, dit-il à Pascal quand il eut fini, je te laisse en tête à tête avec le souvenir de la belle Antoinette. Je vais mettre ma lettre à la poste et rentrer chez moi. Je tâcherai de rêver que j’ai trouvé une Antoinette, moi aussi.
Certes, Lorilleux n’avait aucun remords de l’infâme trahison dont il se rendait coupable. A ses yeux, la conduite de Pascal, le dommage qu’il lui causait, auraient excusé bien d’autres perfidies. Mais le coup qui l’avait frappé était trop récent pour qu’il n’en eût pas gardé quelques traces. Il avait beau être maître de soi, sa figure, si pâle d’ordinaire, semblait livide. Ses efforts pour se contraindre faisaient perler le long de ses tempes des gouttelettes de sueur. Sa main tremblait encore en serrant la main loyale de son ami.
—Tu as quelque chose d’extraordinaire ce soir, dit Pascal en le regardant fixement. As-tu éprouvé quelque vive contrariété? serais-tu malade?
—Je n’ai rien, en vérité, répondit Lorilleux sans rougir, jamais je ne me suis mieux porté.
Puis il sortit rapidement. Il sentait le besoin d’être seul. Les deux lettres qu’il avait dans sa poche le brûlaient. Arrivé devant le bureau de poste, il réfléchit:
—Si je mets à la poste ce soir, se dit-il, la lettre de M. Gerbeau, il fermera sa porte à Pascal très probablement; mais très probablement aussi Pascal trouvera le moyen d’avoir une explication, et il est possible qu’il s’ensuive une réconciliation. Si, au contraire, je laisse à M. Divorne le temps d’arriver, la colère des deux pères brouillera si bien les cartes que le mariage sera rompu à tout jamais. Il faut à M. Divorne quatre jours pour recevoir la lettre et accourir, c’est donc dans quatre jours seulement que je lancerai mon brûlot chez M. Gerbeau.
Et Lorilleux alla se coucher, content comme Titus lorsqu’il n’avait pas perdu sa journée.
Il était huit heures du matin. Pascal, levé depuis l’aube, c’est-à-dire depuis un quart d’heure, parcourait son logis, un mètre à la main.
—Décidément, disait-il, tout en prenant des mesures, impossible de rester ici, c’est trop petit. Quand je rétablirais les cloisons qui divisaient mon appartement en sept pièces, je ne l’agrandirais pas d’un pouce, bien que mon propriétaire croie précisément le contraire. Il faudra chercher ailleurs. C’est fâcheux, je regretterai plus d’une fois la verdure du square; comme compensation, il est vrai, je n’aurai plus la vue du faîte de ce Théâtre-Lyrique, lequel ressemble, à s’y méprendre, à une grande malle qui a perdu sa poignée...
L’entrée de M. Divorne père interrompit brusquement le monologue de Pascal.
—Mon père! s’écria-t-il, laissant, de surprise, tomber le mètre qu’il tenait.
—Oui, moi, répondit l’avoué. Mais avant tout, un mot, un seul: te maries-tu? est-ce vrai?
—Je vous l’ai écrit.
—Et par l’intermédiaire d’un marchand d’héritières?
Pascal s’était bien gardé de souffler mot de M. de Saint-Roch dans sa lettre; aussi fut-il bien étonné, et plus contrarié encore, de voir l’avoué si bien au fait. Il n’eut pourtant pas l’idée de nier, sachant bien qu’en toute sûreté il pouvait se confier à son père.
—C’est vrai, dit-il.
—Malheureux!
—Au moins, écoutez comment les choses se sont passées. C’est une plaisanterie qui se trouve avoir un dénoûment sérieux, je lui devrai mon bonheur.
Le récit du jeune homme fut long, parce qu’il n’omit pas la circonstance la plus insignifiante: M. Divorne l’écouta avec cette attention patiente qu’il prête à ses clients lorsqu’ils le mettent au courant d’un procès. Quand enfin Pascal eut achevé:
—Pauvre jeune homme! s’écria M. Divorne, et tu ne vois pas le piége, et tu ne comprends pas que tu es la dupe d’une comédie préparée à ton intention!
—Cependant, mon père, il me semble que le hasard seul...
—Et tu donnes dans ces hasards, toi? Mais comprends donc bien que ces gens-là ne cousent pas leurs malices de fil blanc; s’ils n’étaient pas habiles, ils ne prendraient personne. J’avoue, cependant, que leur traquenard est assez ingénieux; un plus fin que toi y serait pris. Mais on ne refait pas au même un vieil avoué retors. Et je suis là, moi, morbleu!
L’avoué venait d’éveiller au fond du cœur de son fils la nichée vipérine des soupçons. Pourtant Pascal voulut défendre encore la famille Gerbeau. Son père l’interrompit.
—Voyons, continua-t-il, que sais-tu de ces gens-là? à qui en as-tu parlé? quelles personnes t’ont répondu d’eux? Tout ce que tu en connais, tu le tiens de deux intrigants, ligués pour te pousser dans le panneau, c’est-à-dire pour te faire entrer dans une famille tarée et ruinée.
—Oh! ruinée.
—Toi-même m’as dit que sans toi la fortune de ce M. Gerbeau était compromise ou allait l’être dans une affaire. Es-tu certain qu’il n’ait pas beaucoup d’affaires de ce genre?
—Si ce n’était que l’argent, je suis assez riche pour deux.
—Soit, j’admets qu’il soit riche, très riche, cela prouve-t-il qu’il soit honnête homme? Je connais, pardieu! nombre de coquins millionnaires. Mais rien qu’à leur manière d’agir, je crois pouvoir te prédire à coup sûr qu’il faut renoncer à ce mariage.
Pascal ne répondit rien. Aux discours de son père, il lui semblait que des écailles lui tombaient des yeux. N’avait-il pas agi bien légèrement?
—Écoute, garçon, reprit l’avoué, raisonnons un peu. Lorsqu’un père de famille honorable veut marier sa fille, s’adresse-t-il, pour lui trouver un mari, à un monsieur... comment l’appelles-tu, ton intrigant?
—De Saint-Roch.
—Va pour Saint-Roch. Si tu avais une fille, t’y prendrais-tu ainsi? Non. Cela seul devait t’éclairer. Et ensuite, comment as-tu été admis dans cette famille? tout à coup, sans informations, sans renseignements, sur la soi-disant parole d’un compère. Tu entres dans la maison comme un mendiant dans une église, et aussitôt on te permet de faire la cour à la demoiselle..... Tiens, vois-tu, ces gens-là...
—Cependant, mon père, ils sont reçus dans d’honorables familles. C’est à une soirée chez un ancien magistrat....
—Ainsi, tu crois encore à l’ancien magistrat.... un magistrat où ton chevalier d’industrie a ses grandes entrées! Pauvre garçon! mais on t’a fait danser dans un bal d’occasion, avec des figurants loués à la soirée...
—Oh! par exemple! mon père, je me connais en physionomies, et....
—Mon cher ami, en y mettant le prix, on trouve fort bien des intrigants à mine honnête! Mais veux-tu que je te donne raison sur tous ces points? Soit. La famille Gerbeau est riche et honorable, très honorable, je le veux bien; alors c’est la fille qui...
—Oh! mon père! s’écria Pascal atteint au cœur, de grâce! ne parlez pas ainsi. Elle, si pure, si belle! Oh! si vous la connaissiez, rien qu’à voir cette figure si suave, ces yeux si candides! vous reconnaîtriez votre injustice et votre erreur.
M. Divorne haussa les épaules.
—Comment, c’est toi, à trente ans, qui parles ainsi! Mais, mon garçon, à dix-huit ans, je savais déjà la foi qu’on doit ajouter à ces airs de candeur. Tu crois encore que de beaux yeux, tendres et timides, sont le reflet fidèle d’une belle âme! Mais qu’une femme veuille te tromper, ses yeux ne te révéleront rien de son cœur, pas plus que la surface calme et unie d’un lac ne te dira les vases et les scories amassées dans les profondeurs des eaux si limpides...
—Mais je l’aime! s’écria Pascal qui avait presque les larmes aux yeux, je l’aime!
—Hélas! mon pauvre ami, dit M. Divorne, je crains bien que ce soit sans espoir. Avant de rien décider, pourtant, il faut voir, s’informer, et c’est ce que je vais faire aujourd’hui même, après que tu m’auras donné à manger, toutefois, car je meurs de faim.
Tout en déjeunant, M. Divorne s’efforçait de consoler son fils.
—Voyons, disait-il, ne te désole donc pas, nous te trouverons une autre femme, si tu ne peux épouser celle-là. Ta mère en avait déjà une toute prête, et même je dois te dire que la nouvelle de ton mariage a fait beaucoup de peine à ta mère, beaucoup; elle a pleuré. Si tu l’avais consultée, tout ceci n’arriverait pas. Tu serais venu à Lannion, tu aurais vu la jeune fille qu’elle te destine, tu l’aurais aimée. Mais rien n’est perdu, si ce mariage-ci échoue, tu l’aimeras....
—Je ne puis aimer qu’Antoinette, soupira le triste Pascal.
—Vraiment! fit l’avoué en hochant la tête, c’est si sérieux que cela! Eh bien, il ne faut pas rester plus longtemps dans l’incertitude; ce soir même tu seras fixé. Fais-moi venir une voiture, et donne-moi l’adresse du père de la jeune personne et de tes deux intrigants. Ah! çà, tu ne connais aucun des amis, ou des ennemis, l’un vaut l’autre, de la famille Gerbeau?
—Je ne sais même pas quelles sont leurs relations.
—Prodigieux! je te trouve prodigieux! Ah! ce serait pourtant bien important. Voyons, réfléchis, cherche un peu.
—J’ai beau chercher, je ne vois personne absolument, sauf peut-être leur notaire...
—Leur notaire? Tu connais le notaire de la famille et tu ne le dis pas! et tu ne t’es pas adressé à lui! Mais, cher ami, lorsqu’il s’agit d’un mariage, les notaires sont la source même des renseignements, on ne consulte qu’eux, ils ont été institués exprès pour cela. Son nom, vite...
—Bertaud....... Je ne le connais pas, mais peu importe. Son titre me suffit. Il est mon ami ou doit l’être, tous les officiers ministériels sont mes amis; nous sommes confrères, ou peu s’en faut. Je commence ma tournée par lui. Allons, je pars, ne te tourmente pas.
Bien certainement, si M. Divorne avait pensé qu’il trouverait des renseignements, je ne dis pas excellents, mais seulement passables, il ne se serait pas mis en quête; il aurait purement et simplement refusé son consentement; il aurait profité du premier moment de surprise de Pascal pour lui arracher la promesse de ne pas passer outre.
Mais il s’attendait à recueillir de singulières histoires sur ces parents, qui mettaient leur fille en étalage dans la boutique d’un négociateur matrimonial; il s’apprêtait à entendre des révélations déplorables, des confidences étranges; il s’en réjouissait d’avance en montant en voiture; il s’en réjouissait, parce qu’en quittant Lannion il avait bien promis à sa femme de faire manquer ce mariage. Il allait ainsi se trouver rompu, sans manœuvres de sa part, sans acte d’autorité. Et non-seulement Pascal ne pourrait lui en vouloir, mais encore il lui saurait gré d’être entré dans ses idées et de n’avoir décidé la rupture définitive qu’après des démarches qui prouvaient combien était nécessaire cette extrémité. Voilà ce que pensait l’avoué en montant l’escalier de maître Bertaud.
Pascal, resté seul, se désolait. Avait-il ou non été pris pour dupe? Les apparences, il est vrai, étaient pour l’avoué, mais les apparences sont trompeuses. Comment, pourquoi le nom de mademoiselle Gerbeau se trouvait-il sur le répertoire aux héritières de M. de Saint-Roch? Il devait y avoir quelque motif caché. Ah! qu’il regrettait amèrement de s’être tant avancé, comme cela, à l’aveuglette. L’expérience, la raison, lui disaient, lui prouvaient que son père était dans le vrai. Mais il était amoureux, et son cœur plaidait chaudement la cause d’Antoinette.
Le bruit d’une vive discussion dans l’antichambre tira Pascal de ses réflexions. Presque aussitôt le chevalier de Jeuflas entra ou plutôt fit irruption, violant la consigne sévère, donnée au domestique, de ne laisser entrer personne.
Le premier mouvement de Pascal—ce n’était pas le bon—fut de sauter au cou du chevalier pour l’étrangler. Par bonheur, il se contint, et toute sa colère tomba lorsqu’il eut envisagé l’ami et courtier de M. de Saint-Roch.
Pauvre M. de Jeuflas! il semblait vieilli de dix ans. En une nuit, le chagrin avait creusé des rides le long de ses tempes. Lui si droit la veille, il marchait courbé, le chef branlant. Sa toilette n’avait pas sa correction habituelle, sa cravate était chiffonnée, ses souliers maculés de boue. La disposition si naturellement symétrique des quelques cheveux qui lui restaient était dérangée.
Il devait, lui aussi, avoir reçu un rude coup. Il ne paraissait guère moins affligé que son jeune ami. Il était visiblement très ému. Son visage exprimait l’abattement; sa voix tremblait; cependant il grasseyait encore.
—Eh bien! dit-il d’un ton piteux, tout est manqué. Mais vous savez le malheur; je le vois à votre tristesse...
Et le chevalier, accablé, s’assit ou plutôt se laissa tomber sur un fauteuil.
—Oui, répondit Pascal, l’arrivée de mon père...
—Il s’agit bien de votre père, ma foi!..... Vous n’avez donc pas reçu la lettre de M. Gerbeau?
—J’ai reçu des lettres, dit Pascal, mais je ne les ai pas ouvertes. Elles sont toutes là, sur ma cheminée.
Le chevalier se leva avec effort et, prenant la correspondance intacte de son jeune ami, chercha un instant parmi les lettres, les journaux, les imprimés arrivés dans la matinée.
—Voici la lettre de Gerbeau, dit-il enfin; je reconnais son écriture. Vous permettez, n’est-ce pas?
Et, sans attendre la réponse de Pascal, il brisa l’enveloppe et parcourut rapidement la lettre.
—Oh! tout est bien fini, dit-il lorsqu’il eut achevé. Je sais mon Gerbeau par cœur: il périrait plutôt que d’avouer qu’il s’est trompé. Tenez, ajouta-t-il en passant la lettre au jeune homme, lisez... et du calme surtout.
Le calme était fort nécessaire, en effet. M. Gerbeau avait écrit sous l’impression d’une violente colère, et il n’avait pas ménagé ses termes. Il disait à Pascal:
«Ne prenez plus la peine, monsieur, de vous présenter chez moi. Vous n’y trouverez personne, désormais. Je sais tout. J’ai appris vos perfides manœuvres pour surprendre ma confiance. Je connais les odieux complices qui vous ont ménagé l’accès de ma maison. Je n’ignore pas davantage votre expulsion de l’École. Mon regret le plus cuisant est d’être votre obligé. Fixez vous-même le prix de vos services, demandez-moi la moitié de ma fortune, mais ne songez plus à ma fille.»
Pascal lut avec une lenteur extrême cette lettre injurieuse. Il n’y comprenait pas grand’chose, il est vrai, mais le sens le tourmentait peu. Il était plus inquiet du motif qui avait fait agir M. Gerbeau.
—Serait-ce une comédie? se disait-il; mais pourquoi? Sans doute pour aller au-devant d’une rupture, pour prévenir l’enquête de mon père. Mais comment a-t-on pu savoir l’arrivée de mon père?
A toutes ces questions, il ne trouvait pas de solution satisfaisante. Enfin, il reposa tranquillement la lettre sur la table, et M. de Jeuflas, qui l’observait et s’attendait à une explosion de fureur, fut très surpris de ce calme.
—Eh bien! demanda le chevalier, que dites-vous de cela?
—Rien. M. Gerbeau est sans doute devenu fou. Il m’écrit des injures, et je veux être pendu si je sais pourquoi.
—Comment, vous ne comprenez pas?
—Pardon! Je vois très bien qu’il ne veut plus me donner sa fille, mais c’est tout ce que je vois. Ce n’était pas la peine de me la faire proposer par M. de Saint-Roch.
—Mais, malheureux! s’il vous repousse, c’est qu’il a su la part que Saint-Roch prenait à cette affaire.
—Pardieu! c’est trop fort, répondit Pascal; espérez-vous me faire entendre que c’est à l’insu de M. Gerbeau que le nom de sa fille se trouve sur les registres de votre ami,—avec titres à l’appui, pour parler comme lui!
—Je vous jure qu’il l’ignorait.
—Alors, je n’y suis plus du tout.
—C’est cependant bien simple. Dans les mariages que fait Saint Roch, il arrive presque toujours que l’une des deux parties ignore son entremise. Vous imaginez-vous donc qu’il connaît tous les gens qu’il marie? Pas le moins du monde. Il a des agents, des coopérateurs, qui travaillent pour lui, qui lui donnent les renseignements et qui...
—... Partagent les honoraires; à merveille! Ainsi vous, chevalier, vous êtes un de ces coopérateurs, je trouve le mot très-joli.
M. de Jeuflas, sous le regard sardonique de Pascal, ne put s’empêcher de rougir. Un instant il resta muet, embarrassé. Enfin, reprenant tout à coup courage:
—Eh bien! oui, répondit-il, je suis un des agents de Saint-Roch. Il faut vivre, n’est-ce pas, et je vois de pires métiers. La honte, si honte il y a, je la partage avec plus d’un homme bien posé et largement décoré, avec nombre de vieilles femmes très estimées, très honorées et très dévotes. Ah! je connais à Saint-Roch plus d’un agent qu’on ne soupçonne guère, et dont personne n’aurait l’idée de se défier... Mais après tout, où est le mal quand on agit loyalement?
—Oh! loyalement! fit Pascal...
—Oui, monsieur. Ainsi, je puis très bien vous expliquer le mécanisme de Saint-Roch. Il a des agents, moi, par exemple. Je dresse la liste de toutes les demoiselles à marier que je connais parmi mes relations, dont les parents sont mes amis. Je prends des renseignements sur la fortune, sur la moralité, etc. J’agis de même pour les jeunes gens, et je porte le tout à Saint-Roch. Ses autres coopérateurs agissent de même. Il recopie nos listes, et peut ensuite offrir les jeunes gens ou les demoiselles qu’on lui indique, et cela à leur insu. C’est ce qui est arrivé pour mademoiselle Gerbeau. Quelquefois même les mariages se concluent sans qu’on se soit adressé à Saint-Roch directement, et c’est en cela que consiste son habileté; tout se fait par ses agents, qu’il met en rapport.
Pascal gardait toujours son air triste; au fond, il était ravi. Volontiers il aurait embrassé le coopérateur matrimonial, car il ne doutait pas de sa véracité: on n’imite pas l’air et le ton qu’avait l’affligé chevalier. Le jeune homme renaissait à l’espérance.—«Ainsi donc, se disait-il, Antoinette n’est pas perdue pour moi.»
—Maintenant, demanda-t-il au chevalier, comment M. Gerbeau a-t-il été informé?...
—J’aurais dû vous le dire d’abord, c’est une lettre anonyme...
—Oh!
—Oui, une lettre anonyme, et qui, de plus, doit être d’un de vos amis.
—Sachez, monsieur, dit Pascal, que mes amis ne font pas de ces infamies.
—C’est au moins de quelqu’un qui a accès chez vous, car à la lettre était joint le billet par lequel Saint-Roch vous annonçait ma visite.
—C’est impossible! s’écria le jeune homme.
Et il courut à son bureau, pour retrouver le fameux billet. Mais c’est en vain qu’il chercha, fouilla tous les tiroirs, bouleversa ses cartons, secoua un à un tous les papiers; le billet ne se retrouva pas. Il vint se rasseoir fort découragé.
—C’est incroyable, disait-il, une lettre anonyme! Mais au fait, qui a prévenu mon père?
—Ah! répondit le chevalier, vous avez quelque ennemi bien perfide.
—Oh! je le trouverai. Si j’avais seulement cinq minutes entre les mains la lettre adressée à M. Gerbeau...
—Allez la lui demander si vous voulez, dit M. de Jeuflas avec découragement; quant à moi, je ne m’en sens pas le courage. Il m’a traité ce matin d’une façon indigne, il m’a presque jeté à la porte...
—Aussi, comment diable un homme comme vous se met-il à la solde d’un négociant en mariages?
—Eh! monsieur! la misère! J’ai été riche, je suis ruiné. Est-ce à mon âge qu’on se met à travailler? Et encore, à quoi serais-je bon...
—Pauvre chevalier! vrai, je vous plains...
—Vous auriez tort de me railler, en tout cas. Cette affaire avec Gerbeau me perd à tout jamais. Qu’adviendra-t-il si elle s’ébruite? C’en est fait de mon honneur, de mon crédit, de ma considération, toutes les maisons me seront fermées.
Pascal eut pitié de cet homme malheureux.
—Quoi qu’il advienne, lui dit-il, je vous promets le silence le plus absolu.
—Et Gerbeau, se taira-t-il? Ce matin, il m’a chassé de chez lui, ô honte! moi le chevalier de Jeuflas. A cette heure, il a sans doute raconté l’aventure à vingt personnes.
—Je me trompe peut-être, reprit Pascal, mais il me semble que, dans l’intérêt même de sa fille, M. Gerbeau doit se taire. Vous vous alarmez à tort.
Mais Pascal eut beau faire, il ne put ramener le sourire sur les lèvres de l’infortuné coopérateur. Il avait la mort dans l’âme, il n’était plus que l’ombre de lui-même.
Lorsqu’enfin il se retira, il serra affectueusement la main du jeune homme, et sa dernière parole fut un conseil.
—Vous avez un ennemi bien dangereux, dit-il, tenez-vous sur vos gardes.
Cet avis était au moins inutile.
Frappé au cœur dans son amour, Pascal était bien résolu à découvrir le misérable qui trahissait ainsi l’amitié. M. Gerbeau pouvait ne pas vouloir revenir sur sa décision, alors c’en était fait du bonheur de sa vie. Il voulait se venger.
Assis à son bureau, devant les fameux cartons verts qui renferment tant et de si terribles secrets, devant ses registres en caractères hiéroglyphiques, M. de Saint-Roch, l’œil illuminé par l’inspiration, travaillait au bonheur de l’humanité.
L’apôtre du mariage rédigeait une réclame, une de ces réclames superbes qui, placées à la quatrième page, font quelquefois de l’Ami de la Religion un journal amusant.
La tâche était pénible et le travail hérissé de difficultés. On le voyait au papier couvert de ratures et de surcharges. C’est que l’annonce est le côté sérieux de la mission de l’illustre ambassadeur: chaque ligne lui coûte gros, et les marchands de publicité ont un petit instrument pour mesurer l’espace; aussi faut-il dire beaucoup en peu de mots.
C’est ce que s’efforçait de faire le propagateur-initiateur. Sa réclame, destinée à faire battre la chamade à tous les cœurs célibataires, s’adressait plus spécialement qu’à l’ordinaire aux pères de famille:
«Pères prudents, disait-il, je suis la sauvegarde de l’honneur des familles. C’est moi, Saint-Roch,—pas de succursales,—qui ai inventé le mariage il y a quarante ans. Mon laboratoire est l’antichambre de la mairie, ma bienveillance vaut presque le sacrement. Vos demoiselles vous embarrassent-elles, adressez-les à moi, je leur trouverai un placement avantageux. Ecrivez-moi—lisiblement,—je viens de recevoir un assortiment complet de princes souverains à marier, de la plus belle qualité. Pères de famille, vous me bénirez, moi, Saint-Roch, car...»
Six coups frappés sur un timbre firent tressaillir l’ambassadeur.
—Oh! dit-il, un client dans le salon gris-perle.
Aussitôt il cacha son prospectus dans un tiroir, et ouvrant une armoire, il en tira un habit bleu barbeau, exactement semblable à celui qu’il avait sur lui, à cette seule différence près que le premier était fort râpé, et le second tout flamboyant de neuf.
Ce changement à vue, si important pour une négociation matrimoniale, terminé, il s’approcha de la glace pour donner un coup d’œil sur sa toilette.
Il tira ses manchettes de malines, rajusta son jabot, disposa gracieusement les cataractes de ses chaînes de montres, frotta les pierreries de ses bagues pour leur donner plus d’éclat, et enfin, d’un geste coquet de la tête, imprima à sa blonde chevelure bouclée un tour plus gracieux.
Alors, il s’adressa dans la glace un dernier et charmant sourire et se dirigea vers le salon gris-perle, où sans doute «la pratique» s’impatientait.
Il entra. Suivant sa noble et affable habitude, il salua gracieusement le nouveau client, en trois temps, ainsi que le prescrivent les professeurs de maintien de la bonne école, les talons sur la même ligne, la pointe du pied en dehors, le buste légèrement incliné, le coude arrondi, la main à la hauteur de la poitrine...
Il exécutait le deuxième temps de son salut, il préparait déjà le troisième, lorsque le client lui sauta à la gorge, sans pitié pour le jabot, en l’appelant: Misérable!
Ce pauvre M. de Saint-Roch eut une terrible frayeur. Il fit un bond de côté, cherchant à mettre la table entre lui et ce visiteur peu parlementaire.
Ce rapide mouvement de retraite lui réussit; mais, dans son évolution, il heurta la table et entraîna sept à huit ex-voto de porcelaine, qui tombèrent et se brisèrent avec éclat.
—Bon, pensait l’ambassadeur, ce doit être quelque nouveau marié qui n’est pas content. Je connais ça.
Ce n’était pas un nouveau marié, mais bien M. Gerbeau en personne. La lettre anonyme de Lorilleux produisait son petit effet. Ce n’était plus l’honnête et digne négociant qu’on connaît, c’était un tigre déchaîné. Savoir le nom de sa fille sur les registres de M. de Saint-Roch l’avait jeté hors de ses gonds. Il s’était promis de donner des coups de canne à l’ambassadeur, et il venait à la seule fin de tenir sa promesse.
Cependant, l’inventeur du mariage, retranché derrière sa table, avait repris un peu de courage.
—Je vous préviens, dit-il à son adversaire, que si vous usez encore de violence, j’appelle mes domestiques. Maintenant, si vous voulez causer, causons, mais doucement. Qui êtes-vous et que...
—Qui je suis, coquin, répondit l’ex-fabricant, un père dont tu as failli compromettre la fille, infâme tripoteur! Je suis monsieur Gerbeau, à qui tu voulais donner pour gendre un homme taré, vil brocanteur! un certain Pascal Divorne, renvoyé honteusement de l’École.
—Taisez-vous, cria M. de Saint-Roch, et n’insultez pas un jeune homme qui vaut mieux dans son petit doigt que vous dans toute votre personne.
—Ah! tu m’insultes, coquin! reprit M. Gerbeau. Attends, attends!
Et il tournait autour de la table pour tâcher de saisir le négociateur. Mais M. de Saint-Roch n’était pas moins leste que lui; la discussion cependant continuait.
—Qui t’a permis de te mêler du mariage de ma fille?
—Je n’ai pas de comptes à rendre.
—Je m’adresserai aux tribunaux.
—Je m’en soucie peu, j’ai des arrêts qui sanctionnent mon honorable profession.
De guerre lasse, essoufflés, n’en pouvant plus, les deux adversaires s’arrêtèrent. Mais quel désordre, justes dieux! dans la toilette si bien ordonnée de M. de Saint-Roch! Les chaînes d’or battaient au hasard sa poitrine, le jabot pendait comme une loque, une des manchettes était arrachée à demi; et la belle chevelure blonde qui s’était déplacée!
Il n’avait pas cependant, cet illustre ambassadeur, perdu sa faconde si brillante; il entreprit, à force d’éloquence, de dompter le farouche M. Gerbeau.
—Vous avez parlé de tribunaux, monsieur, s’écria-t-il, mais n’aurais-je pas le droit de me plaindre moi-même de vos transports? Vous avez insulté la plus noble des professions, vous calomniez mon sacerdoce.
—Gredin! répétait M. Gerbeau entre ses dents.
—D’autres aussi ont essayé de me ternir aux yeux de mes contemporains et de la postérité: j’en ai obtenu justice. Connaissez-vous les arrêts en ma faveur?
—Je m’en moque.
—Avez-vous lu la plaidoirie de mes avocats?
—Je m’en soucie!
—Enfin, une consultation imprimée à mes frais?
M. Gerbeau commençait à être un peu honteux de son emportement.
—Il ne s’agit pas de tout cela, dit-il avec humeur. Vous avez osé mêler le nom de ma fille à vos tripotages malpropres, c’est ce que je ne puis souffrir. Je ne sortirai pas d’ici avant d’avoir déchiré de ma main la page où vous avez écrit le nom de ma fille. Je vous défends, désormais, de vous occuper d’elle. Il me faut votre promesse et des garanties.
—Soit, répondit l’ambassadeur; veuillez, monsieur, me suivre dans mon cabinet, nous nous expliquerons.
Une explication, commencée si vivement, devait être longue. Elle fut interminable. Et pourtant, jamais le célèbre négociateur n’avait été si beau, si touchant, si pathétique. Oubliant le désordre de sa toilette, qui dans un autre moment l’eût rempli de confusion et eût paralysé ses moyens, il entassait raisons sur raisons, non pour se disculper, mais pour convaincre son adversaire.
En dépit des difficultés, il espérait encore renouer ce mariage rompu; un si beau mariage, si merveilleusement assorti! il le savait mieux que personne.
Il attaqua tout d’abord les préjugés de M. Gerbeau. Pour s’assurer les susceptibilités de ce négociant, l’ambassadeur ne craignit pas de déchirer à ses yeux le voile mystérieux qui pour le profane environne ses opérations. Il mit à nu les rouages ingénieux de sa maison. Il vanta ensuite la grandeur de sa mission, les bienfaits de son intermédiaire. N’est-elle pas, cette profession, un progrès heureux de notre civilisation, tout comme la vapeur, le gaz, les vêtements confectionnés, les omnibus et le télégraphe électrique?
Mais il atteignit réellement au sublime, lorsqu’il parla de Pascal, lorsqu’il énuméra les belles qualités de ce jeune ingénieur, si riche, si économe, véritable merle blanc des gendres. Même, emporté par son sujet, il lui arriva d’enfreindre son vœu de discrétion, et, pour disculper Pascal, lâchement calomnié et accusé d’avoir été renvoyé de l’École, il raconta l’histoire de ce qui l’avait fait renoncer à son brevet.
L’ambassadeur prêchait dans le désert. M. Gerbeau restait plus froid que marbre; il se bornait à élever la voix de temps à autre, pour rappeler le but de sa visite. Enfin, voyant que l’éloquence de M. de Saint-Roch ne tarissait pas:
—Brisons là-dessus, dit-il, je ne crois pas un mot de tout ce que vous me dites; je me trompe, je crois que vous avez un grand intérêt à marier M. Divorne.
—Eh! monsieur, les notaires aussi ont intérêt à marier leurs clients...
—Oui, mais ils sont officiers ministériels; on sait qu’on peut se fier à eux; leur probité et leur discrétion...
L’ambassadeur vit jour à porter, croyait-il, un coup décisif.
—Leur discrétion! s’écria-t-il, ah! je vois bien, monsieur, que vous ne connaissez pas la mienne; j’ai cependant dépensé plus de cent mille francs pour l’annoncer au monde entier. Un secret est chez moi plus en sûreté que votre argent à la Banque de France. Ma maison est le confessionnal de l’univers, le tombeau des secrets du monde entier. Rien ne transpirera jamais des mystères dont je suis le confident. La mort même ne me fera rien révéler. A ma mort, tout doit me suivre au cercueil, tout, cabinet, titres, mémoires. Je n’ai jamais formé d’élève. Quant à mes registres, vous pouvez les ouvrir. Jetez les yeux sur cette nomenclature de toutes les héritières des cinq parties du monde, vous ne comprendrez rien aux caractères hiéroglyphiques que seul je puis déchiffrer...
Le bruit d’un timbre, qui résonna dans le lointain des appartements, coupa brusquement la parole au négociateur. Il prêta l’oreille et compta cinq coups.
—Peste soit de l’importun! murmura-t-il, c’est une visite, au salon bleu-ciel.
Presque aussitôt un domestique entrebâilla une des portes du cabinet et fit un signe à M. de Saint-Roch.
—Mille pardons! dit l’ambassadeur à M. Gerbeau, je suis à vous à l’instant. Et il s’approcha du domestique.
—Monsieur, dit celui-ci à voix basse, il y a un monsieur dans le salon bleu.
—Je le sais, j’ai entendu, il était inutile de me déranger.
—C’est que monsieur ne sait pas que ce monsieur paraît furieux. Il ne voulait pas attendre et menaçait de tout casser.
—Diable! quelle espèce d’homme est-ce?
—Un grand qui a des lunettes d’or; assez vieux, bien mis, l’air de province, il m’a donné sa carte.
M. de Saint-Roch prit la carte, y jeta les yeux et poussa une exclamation de joie; il avait lu:
Pierre Divorne,
Avoué licencié.
—Le père! pensa-t-il, l’avoué! c’est le ciel qui me l’envoie.
Et saisi d’une de ces inspirations sublimes qui décident des batailles, il repoussa le domestique, et s’élança dans le corridor, laissant son visiteur seul et stupéfait.
M. Divorne, le père, sortait précisément de chez maître Bertaud. Le notaire lui avait donné sur la famille d’Antoinette des détails si inespérés, des renseignements si brillants, qu’il regretta amèrement la promesse faite à sa femme de rompre le mariage. Mais, esclave de sa parole, il s’affermit dans sa résolution de refuser malgré tout son consentement. S’il venait chez le négociateur, c’est qu’il voulait passer un peu sa colère, et lui laver convenablement la tête.
C’est dire qu’il accueillit fort mal M. de Saint-Roch qui accourait. Mais l’ambassadeur ne s’amusa pas à répondre, il prit le bras de l’avoué, et le poussant presque devant lui:
—Dans mon cabinet, dit-il, dans mon cabinet.
Une fois entrés:
—Monsieur, prononça-t-il, en s’adressant à son premier visiteur, j’ai l’honneur de vous présenter M. Pierre Divorne, avoué licencié près le tribunal de Lannion, père de M. Pascal.
Puis, se retournant vers l’avoué:
—Je vous présente, monsieur, dit-il, M. Gerbeau, ancien fabricant à Roubaix, père de mademoiselle Antoinette.
Les deux pères se saluèrent froidement, tandis que M. de Saint-Roch allait s’asseoir derrière son bureau, en homme désormais parfaitement désintéressé dans la question.
Il y eut un moment de silence assez long entre l’avoué et le fabricant. Puis, ils commencèrent à parler ensemble, très vivement, chacun espérant faire taire l’autre et le forcer à l’écouter.
M. Gerbeau, qui n’avait pas eu de renseignements et qui persistait à se croire pris pour dupe, était le plus irrité. Il parlait de beaucoup le plus haut; il reprenait sans discontinuer la même phrase:
—Je ne veux rien entendre, je refuse positivement votre fils...
Cette obstination injurieuse à refuser Pascal exaspéra M. Divorne, à la fin.
—Allons chez maître Bertaud nous expliquer, proposa-t-il.
—Soit, dit M. Gerbeau.
Et ils sortirent,—par le couloir d’introduction, au risque de rencontrer quelqu’un!—sans même saluer M. de Saint-Roch.
Mais cette impolitesse n’attrista pas le négociateur.
—Ils vont chez le notaire, se dit-il en se frottant joyeusement les mains, c’est bon signe. Ça m’a donné du mal, mais l’affaire est dans le sac: ici dix mille francs au moins, dont trois mille pour Jeuflas; bénéfice net, sept mille livres.
Et s’asseyant à son bureau, il se remit à la confection de sa réclame, qui se terminait ainsi:
«Ce qui distingue surtout M. de Saint-Roch, c’est que jamais l’intérêt ne le guide. Moraliser l’espèce humaine, voilà son but; faire fonctionner le mariage, tel est son moyen. Mystère et désintéressement sont sa devise.»
L’illustre négociateur avait deviné juste. Tout s’arrangea dans l’étude du notaire. Maître Bertaud savait mettre en pratique ces belles et nobles paroles d’un tabellion à son successeur: «Souvenez-vous, jeune homme, qu’un notaire est un tampon destiné à amortir le choc des intérêts.» Il s’interposa habilement entre ces deux pères, entre M. Gerbeau, qui ne voulait pas donner sa fille, et M. Divorne, qui s’obstinait à vouloir cette fille, depuis qu’on la refusait à son fils.
Grâce à l’inépuisable patience de maître Bertaud, le plus patient et le plus onctueux des notaires, on finit par s’entendre.
Après moins de cinq heures de pourparlers, le mariage fut arrêté, décidé, conclu, presque signé.
Il y était stipulé, entre autres conditions, que M. Gerbeau donnait à sa fille cent mille écus comptants. C’était au moins cinquante mille francs de plus que n’aurait voulu l’ancien fabricant, mais il avait eu la main forcée, tant par le notaire que par M. Divorne.
L’avoué, intraitable sur l’article dot, était bien loin de se douter qu’il travaillait bien moins pour son fils que pour l’ambassadeur matrimonial.
Enfin, la date du mariage fut fixée, et les deux pères, devenus les meilleurs amis du monde, sortirent ensemble de l’étude de maître Bertaud. M. Divorne avait hâte d’annoncer la bonne nouvelle à son fils.
La visite du chevalier de Jeuflas avait singulièrement rassuré Pascal, mais il était bien loin de s’attendre à une solution si prompte.
Il faillit tomber à la renverse, en voyant entrer son père et M. Gerbeau. Mais on n’est pas longtemps à revenir des commotions que donne un bonheur inespéré.
Pascal fut vite mis au courant de ce qui s’était passé, tant chez le propagateur-initiateur que chez le notaire, et bientôt il se trouva qu’il était le moins surpris des trois.
—Qui jamais se serait attendu à cela? répétait M. Divorne.
Et dans le fait, l’avoué eût été bien embarrassé d’expliquer comment, tout à coup, il avait oublié les serments faits à sa femme.
—Ce que je ne comprendrai jamais, disait M. Gerbeau, c’est que ce cher Pascal ait eu l’idée incroyable, impossible, de s’adresser à ce M. de Saint-Roch.
—Oh! pour cela, répondit Pascal, je jure bien que je croyais simplement faire une très innocente plaisanterie.
—Comme si on plaisantait avec le mariage, dit gravement M. Divorne: c’est jouer avec le feu.
—Et encore, continua Pascal, qui jamais se serait douté du rôle de mon ambassadeur, sans un de mes amis qui s’est empressé de vous écrire? Le malheureux croyait me nuire, il m’a rendu le plus grand des services. Mais je voudrais bien savoir qui je dois remercier.
—Il faudrait voir l’écriture, dit M. Gerbeau; voici ma lettre.
—Et la mienne, fit M. Divorne.
Mais l’écriture, habilement contrefaite, n’apprenait rien à Pascal. Il tournait et retournait les deux lettres anonymes, tout en se creusant la tête à chercher le mobile de leur auteur, lorsqu’il aperçut ses initiales à lui, un P et un D en relief, aux angles des deux feuilles de papier.
—Morbleu! dit-il, ces lettres ont été écrites chez moi.
—Mais par qui? demandèrent ensemble M. Gerbeau et l’avoué.
—Ah! voilà, répondit Pascal; il vient beaucoup d’amis chez moi.
Mais en même temps le jeune homme se disait que, seuls, Lorilleux ou Jean Lantier avaient pu s’emparer du billet de M. de Saint-Roch. Le doute à cet égard n’était pas possible.
C’est alors que Pascal se souvint de la pâleur de son ami, la dernière fois qu’il l’avait vu. Il se rappela encore que le médecin était resté seul, ce soir-là, dans son cabinet, pour y écrire, disait-il, une lettre.
Évidemment Lorilleux était le coupable.
Cette trahison si lâche d’un ami d’enfance accabla Pascal. Les déceptions en amitié sont plus cruelles qu’en amour, parce qu’elles sont plus inattendues. Cependant il se garda bien de dire tout haut ce nom qu’il venait de deviner. Indigné contre le médecin, il sentait qu’il l’aimait encore et qu’il répugnait à livrer au mépris le nom d’un ancien camarade de collége; il avait honte d’avouer qu’il avait été dupe d’apparences trompeuses.
Aussi, lorsque M. Gerbeau, après un assez long silence, lui demanda:
—Eh bien! devinez-vous? êtes-vous sur la trace?
—Non, répondit-il. Je n’ai pas même un soupçon.
—Il faut faire une enquête, proposa l’avoué. Si tu restes dans l’incertitude, te voilà condamné à te défier de tous tes amis.
—J’aime mieux ne plus penser à cette infamie, dit résolûment Pascal.
Et il froissa les lettres et les jeta dans un coin, se réservant bien de les reprendre plus tard, pour confondre et accabler le traître Lorilleux.
—Soit! s’écria M. Gerbeau, n’y pensons plus, non plus qu’au Saint-Roch et à son acolyte Jeuflas. Pardon universel. Et moi, je vais, de ce pas, consoler ma pauvre fille, que j’avais laissée dans les larmes, je puis le dire maintenant.
Pascal ne fut pas désolé d’apprendre que mademoiselle Antoinette avait beaucoup pleuré; et, sans doute pour remercier son futur beau-père de l’aveu, il l’embrassa de bon cœur.
A l’exemple des mineurs prudents, qui s’éloignent bien vite lorsque, la mine chargée, ils ont mis le feu à la mèche, Lorilleux s’était tenu à l’écart en attendant l’explosion de ses bombes anonymes.
Il ne reparut que le lendemain de ce jour si rempli où le mariage de Pascal avait été décidé. Le médecin dissimulait assez bien ses graves inquiétudes sous un air agréablement badin.
—Quoi de neuf? demanda-t-il en s’installant dans le fauteuil de son ami. Moi, je suis accablé de besogne: tous mes clients se sont donné le mot pour tomber malades le même jour. Et ton mariage, à propos?
—Je me marie toujours avec mademoiselle Gerbeau.
—Ah! fit le médecin, qui pâlit. Et ton père?
—Il est ici depuis hier matin.
—Il consent?
—Qui l’en empêcherait?
Lorilleux, fort décontenancé, se demandait anxieusement s’il ne s’était pas trompé en écrivant les adresses, lorsque Pascal, qui s’était levé fort tranquillement, lui tendit les lettres anonymes en lui disant d’un ton fort calme:
—Tiens, mon ami, voici deux lettres qui ont failli faire échouer mon mariage; reprends-les, et surtout aie soin de les brûler. Que personne ne se doute que tu es capable d’une semblable action.
En venant chez son ami, le médecin était préparé à tout, à tout, excepté à cela. Il balbutia quelques paroles d’excuse; il voulut essayer de nier, il n’en eut pas la force. La honte, l’émotion le suffoquaient.
Il se leva, cachant sa figure entre ses mains, et se dirigea vers la porte en chancelant comme un homme ivre.
Pascal l’arrêta.
—Je n’oublie pas ainsi, lui dit-il, vingt années d’une amitié dévouée; Lorilleux, je te pardonne.
—Ah! s’écria l’infortuné docteur, que les larmes gagnaient, c’est grand ce que tu fais là, car tu ne sais pas quelles pensées me guidaient.
—Je ne veux pas le savoir.
—Il serait généreux de m’entendre; de grâce, écoute-moi. Ton mariage, mon ami, est le coup le plus rude que puisse me porter la destinée. C’en est fait des rêves de ma vie.
—Quoi! parce que j’épouse mademoiselle Gerbeau?
—Oui! je voulais te donner une femme. Cette femme, c’est ma sœur. Seul, tu me semblais digne d’elle. Je croyais ainsi assurer ton bonheur et le sien. Voilà plus de quinze ans que je désire ce mariage...
—Eh! que ne l’as-tu dit plus tôt. J’aurais peut-être déjà quatre enfants à cette heure...
—J’ai voulu attendre.
—Mon cher ami, je te l’ai répété vingt fois, les gens qui attendent toujours que la poire soit mûre, finissent par n’en jamais manger.
—Accable-moi, soupira le médecin, je le mérite, mais, au nom du ciel, ne me raille pas.
—Je n’ai jamais été plus sérieux, reprit Pascal; mais vois la vanité des projets: tu voulais me marier avec ta sœur, ma mère élevait exprès pour moi une héritière, Lantier me destinait une de ses filles... Folies. Je me marie, et c’est par hasard. Vois-tu bien, mon cher, on n’épouse jamais avec préméditation.
Lorilleux était trop accablé pour répondre.
—Écoute, continua Pascal, veux-tu, veux-tu faire une fois en ta vie une action sensée? Accepte, mais là, tout à coup, les yeux fermés, une proposition que je vais te faire, et qui te prouvera que je t’avais déjà pardonné.
—Je suis prêt à faire tout ce qu’il te plaira.
—Lantier voulait me donner une de ses filles, l’aînée, avec deux cent mille francs de dot. Je déclare la jeune personne charmante; mais Lantier ne m’a prévenu que ce matin, il était trop tard, j’en aime une autre. Seulement, pour calmer le chagrin de ce père, je lui ai proposé un autre gendre; et cet autre, c’est toi. Tu lui conviens, acceptes-tu? est-ce dit?
—Au moins, laisse-moi quelques jours de réflexion.
—Pas une heure. Oui ou non, sur-le-champ.
Incertain, éperdu, presque fou d’avoir à prendre ainsi subitement une décision si grave, Lorilleux ferma les yeux, comme le voyageur ébloui qui tout à coup, sous ses pas, entrevoit un abîme béant. Lui qui mûrissait ses actions les plus indifférentes, se résoudre ainsi à l’acte le plus important de la vie, quelle épreuve! Mais enfin, triomphant des habitudes de toute son existence:
—Soit, dit-il, j’accepte.
Et tout bas, il ajouta: La fortune de ma femme rejaillira sur ma sœur.
—Ainsi, reprit Pascal, je puis prévenir Lantier.
—Oui, j’ai toujours été malheureux, peut-être la chance me viendra-t-elle par ton entremise.
—Eh! cher ami, pour que le bonheur entre dans une maison, il faut lui tenir la porte ouverte.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le soir même, pour prévenir toute occasion de chagrin à venir, Pascal, après bien des hésitations, osa,—contre l’avis de M. Divorne et même de M. Gerbeau,—instruire mademoiselle Antoinette de tout ce qui s’était passé; il lui dit le rôle joué par l’ambassadeur matrimonial et le chevalier de Jeuflas Pour toute réponse, la jeune fille lui tendit la main, comme je souhaite, ami lecteur, que te la tende la femme que tu aimes, lorsque tu auras quelque requête à lui présenter.
Cependant le chevalier de Jeuflas ne fut point invité à la noce, qui eut lieu quinze jours plus tard.
Depuis un mois, le jeune ménage était installé dans une ravissante maison des Champs-Elysées, arrangée, Dieu sait avec quels soins! par Jean Lantier, devenu le beau-père du docteur Lorilleux; M. et madame Divorne étaient repartis pour Lannion, enchantés de leur belle-fille, lorsqu’un matin, un monsieur se présenta qui tenait essentiellement, disait-il, à parler à Pascal.
Ce visiteur était coquettement vêtu, malgré l’heure matinale. Il portait, par-dessus son habit bleu-barbeau, une douillette de couleur claire, doublée de satin blanc, il avait des gants paille. Pour ne pas déranger l’ordre merveilleux de sa chevelure blonde, il tenait son chapeau à la main.
Le domestique pensa d’abord que cet étranger si bien frisé sortait de quelque bal et se trompait de porte; mais, comme il insistait sous prétexte d’affaires très urgentes, il se décida à l’introduire dans le cabinet de son maître.
—Bonjour, cher enfant, dit la voix de miel de M. de Saint-Roch; j’ai voulu vous surprendre dans votre bonheur; me pardonnez-vous cette indiscrétion qui est ma seule récompense?
Pascal ne jugea pas à propos d’offrir un siége à l’ambassadeur.
—Eh bien, cher client, continua le négociateur, bénissons-nous notre ami? Je ne vous avais pas trompé, hein? papa Gerbeau s’est gentiment exécuté; peste! trois cent mille francs....
—Je suis fort pressé ce matin, interrompit Pascal.
M. de Saint-Roch poussa un gros soupir.
—Ingrat! murmura-t-il, ingrat! il oublie que j’ai été son initiateur à la félicité du mariage.
—De quoi s’agit-il?
—C’est la moindre des choses, reprit l’ambassadeur; nous avons un petit traité, vous savez, cinq pour cent de la dot. Vous avez eu cent mille écus, il me revient quinze mille francs.
—Et si je refusais de payer? demanda Pascal en souriant.
—Oh! fit M. de Saint-Roch, pâlissant sous son vermillon, quelle plaisanterie, marchander votre bonheur...
—Mais si je ne plaisantais pas, si je marchandais?
—Nous plaiderions, alors, j’ai la douleur de vous le dire, et je gagnerais certainement. J’ai, vous le savez, des arrêts en ma...
—Assez, assez, dit Pascal... Tenez, ô le plus désintéressé des ambassadeurs, voici votre argent.
—Ah! cher enfant, s’écria l’homme illustre d’une voix doucement émue, je n’attendais pas moins de votre reconnaissance. C’est la dette du bonheur que vous acquittez... Puis, avisant sur le bureau un petit presse-papier:—J’emporte ceci, dit-il; ce souvenir me sera plus précieux que les billets de banque que vous venez de me donner. Ne suis-je pas votre second père, en voyant ce don pieux d’une...
—Au revoir, cher monsieur de Saint-Roch, dit Pascal, en poussant son second père vers la porte.
Mais le diou de l’hymen s’arrêta sur le seuil.
—Cher enfant, dit-il à demi-voix, si jamais,—Dieu vous préserve de ce malheur!—vous veniez à perdre votre épouse, souvenez-vous de mes bons offices, et conservez-moi votre clientèle.
Au dire de tous, même de ses amis, et on sait l’impartialité des amis, Hector Malestrat était et méritait d’être le lion de la jeunesse bordelaise.
C’était, en 1859, un fort joli garçon, un peu fat, légèrement prétentieux, et fier comme il convient de ses avantages. Il avait vingt-neuf ans, une agréable figure, beaucoup d’argent, et un bon tailleur. On citait comme une merveille son hôtel de Bordeaux, on admirait ses chevaux et ses voitures, on copiait servilement ses livrées; son chalet d’Arcachon avait rendu malade de jalousie un Anglais spleenique. Enfin, la capricieuse fortune s’était complue à vider sur la tête de cet heureux mortel le coffre-fort de ses faveurs.
Hector était le fils unique d’un armateur fabuleusement riche et néanmoins d’une honnêteté si rare, qu’à Bordeaux son nom était devenu le synonyme de probité commerciale. Sur la fin de sa carrière, et comme il songeait sérieusement à jouir enfin de ses millions, ce négociant fut atteint de malheurs que nul ne pouvait prévoir. La faillite de plusieurs maisons d’Angleterre et de Hollande, trois sinistres en mer, une baisse énorme sur les vins, le mirent à deux doigts de sa perte. Tout autre que lui eût succombé, son immense crédit lui permit de faire face à tout, l’orage passa sans le renverser.
Mais s’il ne fut pas ruiné complétement, ses capitaux subirent une telle diminution qu’il se trouva pauvre, en comparant le passé au présent. Il en prit un grand chagrin, comme tout homme habitué au bonheur, qui ne sait ce que c’est que la lutte et se laisse abattre au premier revers. La mort de sa femme, sa compagne de vingt-cinq ans, qu’il aimait de tout ce que le commerce lui avait laissé de cœur, compliqua des peines déjà au-dessus de son énergie. Il baissa la tête sous ce dernier coup, languit une année à peu près, et mourut avec le regret de n’avoir pu réparer ce qu’il appelait son désastre, en demandant pardon à son fils de l’avoir mis sur la paille par son imprudence.
A vingt-trois ans, Hector se trouva donc orphelin, libre et maître d’une fortune qui s’élevait encore à bien près de cent mille livres de rentes. Son père, en mourant, lui avait recommandé de continuer les affaires; mais, après quelques jours de réflexions, il pensa qu’il n’avait pas de goût dispendieux, que par conséquent il était assez riche. Il liquida à tout prix les opérations en train, ferma le comptoir et ne voulut plus entendre parler d’affaires. Il disait qu’il n’avait pas trop de tout son temps pour s’occuper sérieusement de ses plaisirs.
De ce moment, il donna le vol à toutes ses fantaisies, et commença d’éparpiller ses revenus le plus joyeusement du monde, en compagnie de quelques beaux de son cercle qui, dès les premiers jours, voulurent bien lui former une petite cour, et devinrent plus tard les satellites de cet astre.
Hector, cependant, en vrai fils de son siècle calculateur, prétendit mettre à son désordre un ordre infini. Il se le promit et se tint parole, fermant les oreilles lorsqu’il le fallait, et même le cœur, à tous les entraînements. Il eut pour ses prodigalités la prudence d’un avoué. Il s’accorda pour soixante mille francs de folies par an, et jamais il ne dépensa dix louis de plus.
C’en était assez pour lui assurer une belle position; il eut l’art de prendre la première place. Une aventure scandaleuse dans le grand monde fut la première marche de son piédestal. Il ne mentit pas à de si heureux débuts, et la chronique assure que rarement il trouva des cruelles. Sans doute il eut l’adresse de bien choisir, et il ne compromit pas sa réputation de conquérant, en livrant des batailles perdues d’avance, ou même douteuses.
Il avait d’ailleurs une vie fort occupée. Une danseuse arrivait-elle au Grand-Théâtre avec de niaises prétentions à la vertu? on était sûr de le trouver à la tête de la cabale qui chutait ce sylphe à préjugés et le forçait de partir ou de se rendre. D’ordinaire il tyrannisait la première forte chanteuse, heureuse de s’assurer, à ce prix, la protection d’un homme qui régnait despotiquement dans la loge infernale de l’Opéra, et dont le veto était sans appel au moment critique des débuts. Elle avait droit, en échange de sa confiance, à des succès orageux payés comptant, à des avalanches de bouquets et de couronnes, à une ovation lors de son bénéfice, et à un compte ouvert à la caisse de son tyran, à l’article amour.
Que fallait-il à Hector pour couronner l’édifice de sa réputation? Deux ou trois duels. Il les eut, heureux pour lui, pas trop malheureux pour ses adversaires. La gloire sans le remords, le triomphe sans l’odieux de la victoire. Sa bravoure devint un fait notoire, et il fut à l’abri des méchancetés directes. On redoutait d’ailleurs son esprit un peu brutal, comme celui de tous les hommes avantageux qui, après avoir tout osé, croient pouvoir tout dire.
Pour varier ces occupations si nobles et si graves, Hector, suivant la saison, chassait ou s’aventurait en mer, sur un yacht à lui. Puis il dressait ses attelages et montait à cheval. Quand il passait, bien des gens s’arrêtaient au bord du trottoir ou tout au moins se retournaient. Les petites grisettes, si agaçantes sous leurs bonnets à ruches de rubans, n’avaient pas pour le regarder d’assez grands yeux. Il pouvait recueillir sur sa route comme un murmure d’admiration. On disait:
—Voilà M. Malestrat qui passe.
Et c’est là une jouissance vive et délicate, la plus grande des villes de province. A Paris, on ignore ce plaisir, qui transporte la vanité: Rastignac et de Marsay passent inaperçus dans la foule qui roule sur les boulevards. La majorité ne connaît pas M. de Rothschild de vue.
Hector eût peut-être fait courir; la déconfiture d’un sien ami qui avait dépensé un million pour gagner un prix de huit cents francs, vint l’éclairer fort à propos sur le danger d’une écurie. Ce fut comme un poteau de salut placé près de l’abîme. Sa plus grosse dépense resta le jeu. On joue beaucoup à Bordeaux; quiconque s’est promené passé minuit aux alentours du Grand-Théâtre, a pu facilement s’en convaincre. A travers les volets des clubs, fermés par ordre de la police, filtrent de vives lueurs, et dans le silence de la nuit on entend le tintement de l’or sur les tapis. C’est comme une provocation de la fortune, comme une enseigne au-dessus de la porte: Ici l’on gagne. Par malheur, on y perd souvent aussi, mais Hector était heureux au jeu.
Aussi ce roi absolu était à la fois très envié, très adulé, très calomnié. Les uns le disaient avare, les autres prodigue. On ne peut contenter tout le monde. Quelques hommes, de ceux qui le gagnaient plus que de raison au baccarat, l’accusaient d’être joueur. Certains soupeurs émérites avaient bien été jusqu’à dire du mal de sa cave et à déconsidérer son cuisinier. Enfin deux ou trois belles dames, après s’être inutilement compromises pour lui, en étaient venues à déchiqueter sa réputation de leurs trente-deux fausses dents. Mais il avait pour lui l’escadron charmant des demoiselles à marier,—on le disait si dangereux!—et la phalange sacrée des mamans qui le guignaient pour leurs fillettes,—on assurait qu’il ne tiendrait pas à la dot;—et aussi ceux qui lui empruntaient de l’argent. En tout, une armée respectable. Amis et ennemis, flatteurs et calomniateurs, il avait tout ce qui consacre la supériorité.
Eh bien! cet homme heureux s’ennuyait.
Comme nombre de gens, Hector valait mieux que sa réputation. Qui l’eût jugé sur sa façon de vivre, se fût grossièrement trompé. Il avait fait nombre de folies, mais sans passion, le cœur y était resté étranger. Il agissait suivant certaines formules que le monde impose, et qui souvent rendent un homme d’esprit tributaire des imbéciles. Devenir un homme à la mode l’avait flatté en commençant; son but atteint, il avait cru son honneur intéressé à maintenir sa réputation. Sa vanité était devenue comme un boulet qu’il traînait, sans oser rompre la chaîne. Il avait bonne envie de donner un but a son existence, mais il ne savait lequel. Une fausse honte, une certaine défiance de soi, et aussi les mille fils de l’habitude le retenaient.
Il se demandait comment s’y prendre pour faire autrement qu’il n’avait fait jusqu’alors, cherchait et ne trouvait pas. Qu’entreprendre à son âge? Se remettre aux affaires? Mais l’argent fait tout l’intérêt du commerce, et il se trouvait plus riche que ses désirs. Il eût fallu se mettre résolûment à travailler, mais à quoi? et que dirait Bordeaux? Brave l’épée à la main, il se sentait sans courage contre l’opinion. N’était-il pas lui-même l’homme de l’opinion, et ne lui devait-il pas tout? Il ne savait que rougir de son peu de résolution. Il méprisait un peu ses bons amis, mais leurs railleries lui inspiraient une véritable terreur. Jusqu’alors il avait vécu non pour soi, mais pour les autres; il le comprenait fort bien, et cette idée l’exaspérait. En jugeant l’avenir d’après le passé, il se sentait le cœur affadi, mais il ne se décidait à rien.
Le fait est qu’il était excédé de cette existence, plus aride qu’un éloge académique, et, malgré son apparente variété, plus monotone que les évolutions d’un pendule.
Le soir, en rentrant chez lui, il se laissait aller sur son fauteuil, plus fatigué qu’un acteur après six heures de planches, bâillait et se répétait avec un énorme découragement:
—C’est toujours la même chose, toujours la même chose!
Ah! si les amis l’avaient vu! Mais il cachait soigneusement cet écrasant ennui, que nul ne soupçonnait, pas même son valet de chambre.
Enfin, un matin, il eut une inspiration qu’il jugea envoyée d’en haut.
—Si je faisais une fin, murmura-t-il, si je me mariais?
Il saisit l’inspiration au vol, et, séance tenante, sans trouble, sans hésitations, il décida qu’avant trois mois il serait marié; lui qui jusqu’alors n’avait pensé au mariage que comme un jeune sous-chef du ministère, ambitieux et remuant, pense à sa retraite.
Son esprit ne s’arrêta pas une minute à ces mille détails futiles ou graves, tristes ou charmants, qui font du mariage une si belle ou si terrible chose. Il ne songea pas davantage aux sept ravissements qui, dit le poète arabe, attendent le cœur de l’époux. Même il ne se posa pas ce terrible problème, fantôme de la dernière nuit de ceux qui vont se lier pour toujours:—Serai-je heureux? serai-je malheureux?
Non, il se disait simplement:—J’ai assez de la vie de garçon, cela me changera.
Et il bâtissait ainsi son château en Espagne:
—Ma femme sera jolie, spirituelle et très riche. Nous aurons la meilleure maison de Bordeaux. Elle fera admirablement les honneurs de son salon, nous recevrons beaucoup, je serai le plus envié et, partant, le plus heureux des hommes.
Après avoir vécu pour le monde, il allait se marier pour le monde. Toujours la même folie.
Le soir même, avant de quitter le cercle, il fit part à ses amis de sa grande résolution; il dit que c’était chose arrêtée irrévocablement.
Il était à peine sorti, qu’il y eut un tolle général.—Quelle mouche l’avait piqué? devenait-il fou? Se mettre la corde au cou, à son âge!
Si encore il avait demandé conseil à ses amis! A quoi servent les amis, si on ne les consulte pas? Les intimes se déclarèrent très blessés, disant qu’il avait conduit toute cette affaire avec peu de délicatesse.
Mais les commensaux habituels d’Hector, hôtes de tous les jours, étaient sérieusement affectés. Ils prévoyaient que la caisse d’un homme marié est de plus difficile composition que celle d’un célibataire. Au fond, ils se trouvaient lésés, et leur figure prit le deuil que bientôt, sans doute, allait prendre leur fourchette.
La conversation sur ce texte du mariage d’Hector fut infinie. La table de baccarat fut délaissée, tant était grand l’intérêt.
Comme il avait gagné toute la soirée, on vit bien que le dépit ne l’avait pas fait parler. Aussi ne songea-t-on qu’à découvrir la femme mystérieuse qui avait triomphé de l’irrésistible. Toutes les demoiselles et veuves à marier de la ville et des environs furent passées en revue, sans que le moindre indice pût mettre sur la trace.
Enfin, à deux heures du matin, on se sépara sur cette conclusion, qu’il devait y avoir un amour sous roche.
Il y avait bien une épouse sous roche, en effet, mais d’amour point. Hector était simplement promis à une jeune fille que, depuis dix-sept ans passés, on lui tenait en réserve. Elle s’appelait Aurélie Blandureau et habitait Paris. Les amis ignoraient ce détail.
Autrefois, lorsqu’il commençait timidement les affaires avec les capitaux d’autrui, M. Malestrat avait eu un associé, M. Blandureau.
Bientôt cet associé se lassa. Il ne comprenait pas grand’chose aux opérations qu’il faisait, puis il trouvait la fortune trop lente à venir à Bordeaux. Il partit pour Paris, fonda une maison de commission et se maria. Mariage et maison prospérèrent; il avait déjà mieux de cinq cent mille francs lorsque sa femme lui donna une fille. M. Malestrat, choisi pour parrain, fit, à cette occasion, le voyage de Paris avec son fils, âgé de dix ans.
Le soir même du baptême, après un magnifique dîner où l’on but prodigieusement à la santé de l’accouchée, les deux associés se jurèrent de marier ensemble leurs enfants. Il n’y eut pas de billets échangés ni de dédit stipulé; mais on sait ce que vaut une bonne parole.
Pour les deux familles, cette union devint une chose aussi certaine que si le maire y eût passé avec son écharpe. Lorsque M. Blandureau écrivait, toujours il demandait des nouvelles du mari de sa fille. M. Malestrat, de son côté, ne manquait jamais de s’informer de la femme de son fils.
Hector avait toujours entendu parler «de cette affaire» comme de chose arrêtée. On ne lui demanda pas son avis. D’ailleurs, que lui importait? Il avait seulement été prévenu que les dix-huit ans de mademoiselle Blandureau étaient l’échéance.
Lors des revers de M. Malestrat, il eût pu y avoir rupture. L’armateur écrivit à son ami, dès qu’il vit clair dans sa situation, pour lui avouer qu’il n’avait même plus cent mille livres de rentes, et lui rendre sa parole. Mais M. Blandureau n’entendit pas de cette oreille.
«Ce qui est fait est fait, écrivit-il noblement par le retour du courrier. Ma fille aura quinze cent mille francs de dot; je me soucie peu de l’argent. N’eussiez-vous plus une obole, nos paroles tiennent toujours.»
A la mort de son père, Hector ne voulut pas laisser protester sa parole. Il continua la correspondance avec M. Blandureau. Chaque année, au premier janvier et le jour de la Sainte-Aurélie, il faisait porter au chemin de fer une caisse de cadeaux. Ces attentions valaient un engagement formel et expliquent la brusque décision d’Hector: ce n’était plus qu’une question de «probité commerciale.»
Du reste, il ne savait rien de sa fiancée, sinon qu’elle s’appelait Aurélie, qu’elle était grande et brune, et qu’elle avait été élevée au Sacré-Cœur.
Un excellent système pour ne pas revenir sur une détermination, est de s’en ôter les moyens. Ainsi fit Hector: il brûla ses vaisseaux en écrivant à son futur beau-père pour lui annoncer «que, fin septembre, il irait lui rappeler un engagement cher à son cœur.»
Aussitôt il s’occupa sérieusement de son départ. Ce n’était pas une petite besogne: il avait à mettre ordre à ses affaires et à liquider un passé orageux.
Comptant ne revenir à Bordeaux qu’avec sa femme, il ne voulait rien laisser en arrière qui pût trahir le secret des années écoulées. Il redoutait le sort de certains maris que des spectres oubliés viennent tirer par les pieds lorsqu’ils s’endorment dans la quiétude. Il prit des précautions et voulut des garanties. Avant de jeter ses souvenirs à la mer, il eut soin de les lester d’une bonne grosse pierre qui les empêchât de revenir jamais flotter à la surface.
Le dernier acte de ce sacrifice fut l’inventaire de ses trophées de séducteur. Il s’était enfermé avec un grand feu dans la cheminée pour l’auto-da-fé. En fouillant à pleines mains dans le tiroir de son secrétaire, il lui semblait qu’il remuait les cendres de son cœur. C’était un retour sur lui-même, un examen de conscience qui plus d’une fois le fit rougir.
Tout y passa sans pitié, sinon sans regrets: rubans fanés, bouquets flétris, portraits microscopiques, bagues, boucles soyeuses brunes ou blondes, billets parfumés de violette ou de verveine, tout, tout. A chaque lettre cependant il s’arrêtait. Une nouvelle écriture, n’était-ce pas un nouveau chapitre?
Il regardait en soupirant s’envoler la fumée, roulant dans ses spirales des bluettes de papier où les lettres un instant apparaissaient en traits de feu.
Cette fumée, n’était-ce pas sa jeunesse?
Et tandis qu’avec les pincettes il attisait la flamme, il se demandait tout ce que représentaient au juste ces reliques de promesses oubliées, de serments menteurs, d’illusions, d’amour vrai, de larmes ou de remords.
Lorsqu’il n’y eut plus qu’un monceau de cendres au-dessus duquel voltigeaient quelques débris, comme des papillons noirs, il poussa un soupir de satisfaction.
—Allons! se dit-il, c’est fini, je suis libre, je suis un autre homme.
Le lendemain, il fit venir son tapissier. Il s’agissait, en son absence, de changer tous les ameublements. Puis il livra son hôtel aux peintres, qui, des caves aux greniers, devaient tout refaire, tout restaurer. Par ce dernier acte de sa volonté, il se mettait bénévolement à la porte de chez lui.
On était à la fin de juin, lorsque, ses dernières visites P. P. C. faites, Hector quitta Bordeaux. Trois mois encore le séparaient de sa première entrevue avec sa future. Il n’en était pas embarrassé. Il avait pensé qu’un voyage en Suisse est la préface indispensable d’un mariage, et il était parti.
C’était prendre le chemin des écoliers, mais tout chemin mène à Rome. Hector se réjouissait d’avoir un peu de temps devant lui pour réfléchir et se préparer convenablement. On n’entre pas dans une idée aussi facilement que dans une paire de pantoufles, et il devait se familiariser avec la sienne. Il s’exerçait au genre grave qui sied à l’homme sur le point de devenir père de famille, et il trouvait que cet air lui allait bien. Il avait commandé à son tailleur des vêtements d’une coupe sérieuse, parce qu’il avait reconnu la vérité du vieux proverbe: l’habit fait le moine.
Après moins d’un mois d’exercice, une véritable métamorphose s’était accomplie en lui. Plusieurs fois il se surprit à croire qu’il était réellement marié, et depuis plusieurs années; avait-il l’occasion de causer avec une jeune femme, il prenait involontairement un ton paternel.
Mais il eut beau se promener six semaines durant à travers la Suisse, il avait des yeux pour ne pas voir, il ne regarda rien. Les plus beaux paysages le trouvèrent indifférent, son esprit était ailleurs.
Peu à peu, sans s’en rendre compte, il était parvenu à se monter l’imagination. Peu pressé d’arriver, au départ, voilà que tout à coup il fut dévoré d’impatience. Il comptait les jours et même les heures. Le miroitement de l’inconnu l’attirait invinciblement. Il lui arriva de soupirer pour mademoiselle Aurélie, et, symptôme plus grave, il ne se trouvait pas ridicule.
Tant et si bien qu’un mois avant l’époque fixée, il s’éveilla à Tours, à six heures de Paris. Comment cela s’était-il fait? Il se le demanda quand la raison lui revint.
Il brûlait d’arriver. Dans le lointain du calendrier, la maison de M. Blandureau lui apparaissait comme la terre promise. Là régnait Aurélie. Il n’avait qu’à se rendre à la gare, à prendre un billet, le soir même il serait près d’elle. Quelle tentation!
Mais quoi! arriver ainsi à l’improviste, tomber dans une maison comme un avis de démolition! N’y verrait-on pas une preuve de mauvais goût, une défiance peu délicate, un sentiment d’infériorité? L’exactitude en matière d’échéance consiste moins à être prêt quinze jours à l’avance qu’à se trouver en mesure à l’heure juste. Il se fit violence et décida qu’il attendrait.
Mais que faire, à Tours, seul, pendent quatre éternelles semaines?
Il avait à choisir entre ces deux alternatives: revenir sur ses pas, ou mettre à profit ses dernières heures de liberté, en étudiant incognito la vie parisienne.
Justement Hector ne connaissait pas Paris. Il y était venu tout enfant; mais, depuis qu’il était en âge de raison, il n’avait jamais voulu y remettre les pieds. Il redoutait les désenchantements du retour. Après six mois du boulevard des Italiens, se contenterait-il des Fossés de l’Intendance? Peut-être Bordeaux lui paraîtrait-il alors mesquin et petit, il aurait des regrets. Il ne tenta pas l’aventure, ne voulant pas quitter sa ville, où il avait une supériorité que ne consacrerait pas Paris. Il aimait mieux être le premier dans la seconde ville de France, que le second dans la première: du César tout pur.
Mais, à la veille d’un mariage, il eut peur de Paris et aussi de lui-même. La conversion était trop fraîche. De fait, on aurait tort de choisir la grande ville, pour y faire retraite avant ses noces. Toutes les tentations de saint Antoine y paient leurs impositions et s’y promènent en robes de soie. Hector se dit qu’une fois marié il aurait tout le temps d’aller à la découverte. C’était un expédient à tenir en réserve, une poire pour la soif future.
Cependant, continuer le métier d’amoureux errant lui souriait peu.
Il était à bout de délibérations et d’expédients, lorsque fort à point il se souvint d’un de ses bons amis d’enfance, qui devait avoir planté sa tente sur les bords de la Loire, quelque part, entre Blois et Tours.
Cet ami l’était venu voir souvent à Bordeaux, et à chaque fois l’avait conjuré de lui rendre ses visites. Il avait promis, parce que les promesses ne coûtent rien; il avait songé, qui plus est, à tenir sa parole, mais toujours au dernier moment quelque empêchement était survenu. Cependant il aimait beaucoup cet ancien camarade de collége, il l’estimait, et il éprouvait à le revoir un extrême plaisir.
En ce moment, il s’accrocha à ce souvenir avec l’empressement que met l’homme qui se noie à saisir une branche. Il s’habilla en toute hâte et courut aux informations.
Tout le monde à Tours connaît M. Ferdinand Aubanel. Il habite, à cinq petites lieues, une belle propriété, la Fresnaie. A l’éloge pompeux qu’on lui fit de son ami, Hector conclut que la tente devait être un château.
Il n’avait plus rien à apprendre. Il eut vite trouvé une calèche, et, tout en roulant sur le chemin qui mène à la Fresnaie, il se répétait qu’il est bon d’avoir des amis un peu partout.
Le véhicule avançait lentement, les chevaux, comme on dit, trottaient sur place, le conducteur dormait à demi. Hector ne songeait pas à s’en plaindre. Enfoncé dans une rêverie sans but, il se laissait aller au balancement monotone de la voiture; son esprit se reposait à contempler ces paysages si tranquilles de la Touraine.
La route était belle. Tantôt accrochée au flanc d’une colline ombreuse, elle dominait le cours de la Loire; tantôt elle s’enfonçait dans quelque fraîche vallée, avec mille sinuosités qui adoucissaient les pentes.
Bientôt on prit un chemin de traverse.
—Voici que nous avançons, dit le conducteur.
Et d’un coup de fouet, il éveilla ses maigres chevaux, dont l’allure ne changea pourtant pas.
Déjà tout annonçait le voisinage de quelque riche habitation. L’œil du maître devait veiller par là. Les haies vives étaient bien entretenues, alignées et sans espaces vides, les fossés relevés soigneusement, les arbres taillés de façon à donner de l’ombre sans que le chemin fût endommagé par l’humidité.
On dépassa deux fermes, tapies dans des massifs d’ormeaux comme des nids; plus loin, c’était le toit pointu d’un pigeonnier qu’on apercevait dominant les cimes. On coupait, dans une prairie, le regain un peu en retard cette année, et l’odeur des foins embaumait l’air. Dans un enclos soigneusement entouré de barrières, des chevaux de race paissaient. Au bruit de la voiture, ils relevaient leurs têtes intelligentes; l’un d’eux, le favori sans doute, s’avança jusqu’aux poteaux de la petite porte, allongeant son col fin par-dessus les planches.
Puis l’habitation apparut, au loin, à l’extrémité d’une longue, longue avenue de marronniers. Ce n’était pas un château à proprement parler, mais une de ces bonnes grosses maisons bourgeoises sans prétention, flanquées de deux ailes un peu en retour, commodes, hospitalières, avec tout un étage consacré aux chambres d’amis.
Près de la grille un domestique était debout, comme en vedette, la main devant les yeux, à cause du soleil; il semblait interroger la voiture, probablement pour signaler plus vite le visiteur.
—On attend quelqu’un sans doute, se dit Hector; je n’ai pas de chance en vérité, je serai peut-être importun.
Mais en avançant il reconnut le domestique pour l’avoir vu à Bordeaux avec son ami. Lui semblait aussi reconnaître Hector, car il faisait des signes avec son chapeau.
Lorsque la voiture s’arrêta dans la cour:
—Ah! monsieur, dit cet homme à Hector, enfin vous voici! mon maître se mourait d’impatience en vous attendant.
—On m’attendait, moi?
Il ne put entendre la réponse, Ferdinand était accouru et le serrait dans ses bras à l’étouffer.
—Ah! merci! lui disait-il, merci, c’est très bien ce que tu fais là. Tu es un ami véritable, toi, et tu le prouves; je savais bien que tu viendrais. Tu as reçu ma lettre et tu as tout quitté.
—Mon cher ami, depuis trois mois je suis absent de Bordeaux, le désir de te voir m’a seul amené. Je n’ai pas reçu ta lettre, et le hasard...
—Soit! c’est le hasard, bénissons-le. Il a tout fait, mais je n’en suis pas surpris; le hasard est à mes ordres désormais. Je suis l’homme le plus heureux. Que désires-tu? Je vais le souhaiter pour toi, tu seras exaucé. Mon bonheur me fait trembler; ce n’est pas naturel. Mais je te tiens là, au milieu de la cour, je perds la tête, suis-moi. J’ai le plus pressant besoin de tes conseils, viens; peut-être désires-tu te rafraîchir?
Et Ferdinand, à pleine voix, appela ses domestiques pour leur donner des ordres: toute la maison fut en l’air. Alors il entraîna son ami, mais il ne lâchait toujours pas son bras, il le pressait sous le sien, autant dans la crainte de le voir s’enfuir que pour s’assurer de la réalité de sa présence.
Et le long des corridors, dans l’escalier, il continuait, s’essoufflant à parler:
—Si je t’ai écrit d’accourir, c’est que je veux ta signature à mon contrat, tu es mon témoin, je me marie, cher Hector, après-demain. Une jeune fille, non, un ange, et belle, belle... Mais tu la verras: je l’aime, ou plutôt je l’adore. Et dire qu’après-demain elle sera à moi, à moi tout seul, pour toujours; tiens, cette idée me rend fou. Je tremble que ce ne soit un rêve; si tu es mon ami, ne m’éveille pas. Après-demain... mais que c’est long! c’est une éternité, vivrai-je jusque-là? Les jours ont vingt-quatre heures et les heures soixante minutes: j’aurai des cheveux blancs d’ici là. Et elle m’aime, oui, mon ami, elle m’aime, elle me l’a dit, elle te le répétera si tu veux, elle s’appelle Herminie. Tout à l’heure nous monterons au grenier, je te montrerai sa maison; elle, tu la verras ce soir; mais viens, viens.
—C’est une rage, pensa Hector, tout le monde se marie; j’ai bien fait de me décider, je n’aurais plus trouvé de femme si j’avais attendu. Sois béni, ô mon père, de ta sage prévoyance!
On était au premier étage. Ferdinand ouvrit une porte, et s’effaçant devant son ami:
—Entre, lui dit-il, entre, c’est ma chambre, ma chambre de garçon; je ne l’habiterai pas longtemps, nous en aurons une autre, ici, à côté; les tapissiers y mettent la dernière main. C’est un chef-d’œuvre, un nid de satin... Mais pardon, cher Hector, attends, prends garde, je vais te trouver une chaise.
Il y parvint, non sans peine. Le chaos avait élu domicile dans la chambre de garçon, la confusion y tenait cour plénière. Les objets les plus disparates y avaient été entassés comme à plaisir, lit, table, commode, chaises; tout était encombré. Le parquet même n’était pas libre, ni sans danger; deux caisses à peine éventrées étaient placées en travers; à côté gisaient des débris, des planches avec leurs clous en l’air, des tenailles, un marteau, un ciseau de menuisier.
Près de la fenêtre, un monsieur bien mis se tenait debout. Il s’inclina respectueusement lorsqu’entrèrent les deux amis. Il tenait à la main une petite bande de toile cirée, avec des chiffres en or, son mètre enfin.
—C’est mon tailleur, dit Ferdinand à son ami, il arrive de Paris avec ces deux caisses qui sont pleines d’habits. Depuis un mois il ne travaille que pour moi.
—Et tu prétends essayer tout cela?
—Sans aucun doute, tu vas bien le voir. Au surplus, tu seras juge. Voilà où tes conseils me deviennent indispensables; n’es-tu pas le roi de la mode, ou plutôt la mode en personne? Rien qu’à regarder un gilet, tu dois lui donner bonne façon.
Il parlait ainsi, tout en se déshabillant. Le tailleur, d’un air grave, présentait les vêtements que Ferdinand endossait les uns après les autres. Il ne se lassait pas, il n’en trouvait aucun à son gré.
—Hélas! gémissait-il, ma tournure est piteuse, je m’en aperçois aujourd’hui; j’avais des illusions. Regarde, Hector, regarde, suis-je assez commun, assez balourd? tu me trouves grotesque, n’est-il pas vrai? Mon cher tailleur, vos habits vont abominablement; ce pantalon est trop court, ce gilet trop long: l’un me grossit outre mesure, l’autre m’écrase la poitrine.
Le tailleur se donnait beaucoup de mal. Tout allait au mieux et «avantageait monsieur.» Jamais il n’avait vu plus charmante tournure ni trouvé plus difficile client.
Et on essayait encore.
—Aussi, c’est vrai, dit Ferdinand, vit-on jamais modes plus ridicules que les nôtres! Le chapeau tuyau de poêle a tué l’héroïsme. Soyez donc beau, noble, poétique avec cette loque qu’on appelle un habit noir! L’humanité entière a l’air de sortir du même moule! Apollon du Belvédère aurait aujourd’hui l’air d’un coiffeur. La galanterie a disparu avec les bas à coins, l’esprit s’est enfui avec la poudre.
—Levez un peu le bras, monsieur, disait le tailleur; bien, ainsi. Maintenant, tournez la tête, c’est cela.
—Avec tes idées, reprenait Hector, il fallait te marier en carnaval, tu aurais pu choisir un costume à ton gré, prendre la cuirasse des croisades, les souliers à la poulaine, les bottes Louis XIII, le chapeau galonné d’or, le justaucorps à brevet, et la cravate des merveilleux. Tu avais pour faire ton choix le magasin aux costumes de la Porte-Saint-Martin.
—Tu crois rire, mon ami, et tu viens d’émettre une grande et fructueuse idée. Mais là, sérieusement, vois... suis-je digne d’elle, d’elle, si belle, si gracieuse, si poétique? Non, je suis affreux, je voudrais avoir une marraine pour fée; comme Peau-d’Ane, j’aurais un pantalon fait d’un pan de la nue, un gilet couleur soleil, et un habit taillé dans l’aile d’un papillon.
—Monsieur est très bien ainsi, affirma le tailleur; si monsieur veut marcher un peu.
Ferdinand fit quelques pas.
—Très bien! insista Hector.
Il était temps, les caisses étaient vides. Restait à régler la façon de porter l’habit noir.
Ferdinand le voulait boutonné jusqu’au col, à la manière de M. de Girardin.
Hector tenait pour l’habit ouvert; c’est plus cérémonie.
Le tailleur insistait pour qu’il fût maintenu par «un double bouton;» il en avait apporté exprès. Il cita sept ou huit de ses clients, tous plus nobles les uns que les autres, qui ont adopté cette mode.
On discuta, mais on ne décida rien. Ferdinand déclara qu’il s’en remettait à l’inspiration qui vient toujours au moment suprême.
Le tailleur fut libre, mais non Hector. Il avait à dire son avis sur la corbeille.
Elle avait été déposée dans le grand salon, sur la table à thé.
C’était un meuble d’un goût exquis, comme il en sort quelquefois de chez Tahan, le travail était d’une délicatesse infinie. C’était un grand coffre ovale, en bois de rose avec des incrustations. Les poignées et les serrures d’argent avaient dû être ciselées par des fées.
Hector pensa qu’il achèterait la pareille pour mademoiselle Blandureau.
—Eh bien! qu’en dis-tu? demanda Ferdinand.
—Admirable.
—C’était mon avis. Ce qui me désole, c’est qu’elle sera bien trop petite, et alors comment faire?
Ce joli meuble paraissait à Hector d’une taille fort respectable. Mais, en regardant autour du salon, il comprit les inquiétudes de son ami.
Sans doute il avait dévalisé les dix plus somptueux magasins de Paris pour réunir toutes la merveilles qu’il voulait offrir à sa femme.
Hector admira sérieusement les cachemires et les dentelles, les coffrets, les étoffes, les bijoux, les éventails. Il évalua le tout à une somme considérable.
—Ma tante et moi avons couru quinze jours pour acheter tout cela, dit Ferdinand.
—Eh bien, elle a prêté la main à de belles folies. As-tu par hasard hérité d’un royaume, ou comptes-tu te ruiner?
—Me ruiner, moi! impossible. Je l’ai essayé trois fois, pour me distraire, avant de connaître Herminie. Je n’ai pas réussi. Sitôt que j’écornais mon capital, vlan! il me tombait un héritage. A ce train j’aurais réduit ma famille à moi seul. Je me suis arrêté. Ceci ne me coûte rien, c’est la succession d’un de mes oncles. Tout y a passé, mais ce n’est pas trop payer un sourire d’Herminie. Pourvu que la corbeille ne soit pas trop étroite. Enfin, c’est l’affaire de ma tante, elle sera ici demain de bonne heure, car c’est demain que j’envoie la corbeille. Allons dîner.
—Décidément, pensa Hector, la tête n’y est plus.
Au moins, l’estomac était toujours solide. Ferdinand le prouva bien à table. Il mangea comme quatre, tout en parlant. Mais il avait à peine avalé la dernière bouchée, qu’il se leva, et, bon gré mal gré, entraîna Hector.
—Je vais faire ma visite à ma fiancée, lui dit-il, ce sera la troisième aujourd’hui. Je dois te présenter, tu le comprends; n’es-tu pas mon meilleur ami? J’ai souvent parlé de toi, on te connaît. C’est à une demi-lieue d’ici; nous irons à pied, si tu le veux, j’ai besoin d’air et de mouvement.
A mesure qu’ils avançaient sur la route qui mène de la Fresnaie à Cormes-Ecluse qu’habitait la future famille de Ferdinand, Hector put remarquer que la verve de son ami allait en s’éteignant. Lorsqu’il entra au salon, toutes les couleurs de l’arc-en-ciel parurent tour à tour sur sa figure, il balbutiait en présentant Hector.
—Diable, pensa celui-ci, il paraît que c’est très sérieux.
Et il observait du coin de l’œil la contenance de mademoiselle Herminie. Elle était devenue plus rouge qu’une pivoine. Elle s’était levée pour faire une petite révérence, bien timide, mais presque aussitôt elle s’était rassise. Une broderie qu’elle tenait paraissait absorber toute son attention. Mais Hector remarqua que ses mains tremblaient si fort, qu’à peine elle pouvait tenir son aiguille. Puis, bien qu’elle eût la tête penchée sur son ouvrage et les yeux baissés, il put voir le regard qu’elle adressa à Ferdinand.
Toute son âme avait passé dans ce regard humide et doux, plein d’aveux naïfs et de candides promesses.
—Elle l’aime, se dit-il, eh bien! tant mieux! c’est un brave garçon, il le mérite.
Et tandis que Ferdinand s’approchait de sa fiancée, il resta près des parents; il parlait de choses indifférentes, de la Suisse qu’il n’avait pas vue, de Bordeaux. Lorsqu’il s’arrêtait un instant, il entendait le chuchotement des amoureux assis près de la table à ouvrage, si près que leurs cheveux se confondaient.
Toute la maison était en mouvement. A côté, il y avait des couturières qui achevaient le trousseau. A la cuisine, à l’office, on préparait le grand dîner qui le lendemain devait précéder le contrat.
Il fallut aller voir les robes. Ferdinand sortit avec sa fiancée et sa mère. Hector resta seul avec le père, qui profita de cette occasion pour entamer l’éloge de son futur gendre. Il semblait ne pas devoir tarir.
Les deux amis revinrent le soir, par un sentier qui avait la réputation de couper au plus court, et beaucoup plus long que la route en réalité. Ferdinand allait le premier, éclairant la marche, il écartait les clôtures à claire-voie qui séparent les champs et avertissait son ami quand il y avait un fossé à sauter.
Sur le seuil de la chambre préparée pour le voyageur, ils se séparèrent avec une dernière poignée de main, se souhaitant mutuellement bonne nuit.
Hector reconnut une de ces bonnes grandes chambres, qui attendent le visiteur aimé dans les maisons riches de la campagne, et s’entendent avec les maîtres pour l’y retenir longtemps. Le confortable de la vie de famille éclatait de toutes parts. Là, du moins, ni l’air ni l’espace n’avaient été mesurés par un architecte complice de la sordide lésinerie du propriétaire. Le plafond s’élevait à quatre mètres, on eût pu entrer en voiture par les fenêtres. Dès votre entrée, un bon fauteuil vous tendait les bras et vous invitait aux douceurs de la vie contemplative.
Hector eut un cri de joie, il se retrouvait comme chez lui. Et il y avait deux mois qu’il essuyait la poussière des auberges, se brisant aux durs fauteuils, se courbaturant à l’humidité des lits, doutant de tout, même quelquefois de la scrupuleuse virginité du linge. Aussi, avec quelles délices il respira le parfum d’iris des serviettes de fine toile, comme il s’émerveillait de la blancheur des draps, éclatante comme la neige.
Et il se déshabillait à la hâte, il promettait à son pauvre corps dix heures de bon sommeil, ni plus ni moins, les poings fermés.
Il comptait sans son hôte.
Ses idées s’embrouillaient à peine, que Ferdinand entra en robe de chambre; il s’assit sans façon sur le pied du lit.
Il avait mille choses de la plus haute importance à confier à son ami. Et sous ce prétexte, il débita les extravagances les plus inouïes. Hector riait de ses folies, et de temps à autre essayait de le renvoyer. Mais Ferdinand bravait le sommeil, et toujours il avait quelque chose à ajouter.—«Tiens, écoute encore, je m’en vais après.»
Enfin sur le matin, comme cinq heures sonnaient, Hector réussit à le mettre à la porte, à force de raisonnements, et aussi en le poussant un peu par les épaules.
Mais c’est peine perdue de courir après le sommeil enfui. Hector le vit bien. Déjà la maison s’emplissait de rumeurs matinales.
Dans la cour, on venait d’amener la voiture neuve, le carrosse des noces; on ouvrait les portes de la remise, les garçons d’écurie s’appelaient. Dans les corridors retentissaient les sabots bruyants des servantes, le ban et l’arrière-ban des vassales avaient été convoqués pour «prêter la main» en cette solennité. Le glacier de Tours arrivait, avec ses ustensiles sonores, moules de cuivre ou de fer-blanc, seaux et sabotières; on eût dit le carillon d’une église de village voyageant en carriole. On déballait le tout à grand bruit. Les escaliers gémissaient, ébranlés sous les pas d’un bataillon d’ouvriers. Les tapissiers montaient des banquettes pour le bal; le long de la rampe ils hissaient leurs échelles doubles. Tout le bâtiment tremblait au choc des marteaux, tandis qu’à grand renfort de clous on montait les tentures.
Bientôt, dominant le tumulte, la voix de Ferdinand retentit, il appelait tout le monde à la fois, hommes et femmes, il criait tout le calendrier par la fenêtre. Sa tante, la vieille demoiselle Aubanel, venait d’arriver.
Hector prit un parti héroïque. Il se leva et descendit. Ferdinand battait décidément la campagne; il le remplaça et se fit l’aide de camp de la tante. Sous ses ordres il dirigea l’armée indisciplinée des domestiques et des ouvriers. Il veilla à tout avec le sang-froid et la présence d’esprit du capitaine de vaisseau un jour de tempête.
Ferdinand avait disparu.
—Tu ferais bien, mon neveu, lui avait dit sa tante, d’aller rendre visite à ta future.
Il ne se l’était pas fait répéter deux fois.
Enfin, tout fut terminé, ou à peu près. Il manque toujours quelque chose, mais on doit savoir s’arrêter: le mieux est ennemi du bien. A peine restait-il le temps de courir au dîner, éloigné d’une demi-lieue en ne prenant pas le plus court.
C’était un dîner en cinq points, long et plantureux, un repas comme on les ordonne en Touraine; Gamache, s’il revenait sur terre, choisirait ce pays pour ses noces. La table ployait sous le faix des bouteilles et des verres, la lumière étincelait sur la facette des cristaux. Il y avait trente-huit personnes autour de la table, et deux plats au moins par convive. Tous se connaissaient et même étaient un peu parents. Hector aurait semblé étranger, mais Ferdinand avait parlé, beaucoup parlé. On vit leur intimité, les regards reconnaissants de la tante à son aide de camp, et il fut traité comme de la famille. Un vieux cousin s’écria: «Il n’y a qu’un parent de plus.» On rit. Ce soir-là on riait de tout et de rien. Hector eut de l’esprit, et parut spirituel, ce qui est mieux, quoi qu’on dise. Le futur était fier de son ami, encore un peu et il en eût paré sa boutonnière. Par instants il cessait de regarder sa fiancée pour lui sourire des yeux et le remercier d’avoir apporté sa part d’entrain et de gaîté.
Mais voilà que, sur la fin, deux messieurs tout de noir habillés, le col tendu par l’empois d’une cravate blanche, se levèrent et silencieusement passèrent dans le salon.
—Ces messieurs sont les notaires, dit à Hector une de ses voisines.
On les suivit. Les chaises, dans le salon, avaient été préparées à l’avance, en cercle. On prit place. Au milieu, sur la table, des plumes de cygne, immaculées, attendaient pour la signature, près d’une grosse écritoire de vermeil.
Le plus vieux des deux notaires était debout, il avait mis ses lunettes, il tenait le contrat à la main. Le silence s’établit, profond. En prêtant l’oreille, on eût entendu battre le cœur du futur.
La lecture commença.
Le vieux notaire, d’un ton monotone, énumérait les clauses et conditions, les noms et prénoms «des conjoints;» il hésitait de temps à autre, lorsqu’il trouvait un mot difficile, et même il ânonnait. Il bredouillait toutes les fois qu’il arrivait à ces passages techniques, aussi obligatoires qu’inutiles, qui sont comme le cadre de tous les actes. A la fin de chaque phrase, il élevait la voix et reprenait haleine; il faisait des «tenues» en tournant les feuillets. Les phrases étaient si longues, si longues, qu’il lui fallait s’y reprendre à trois fois, et, entortillées qu’elles étaient, et hérissées de mots barbares, des nids de procès devaient se cacher dans leurs replis.
Le vieux cousin, de tempérament apoplectique, grommelait entre ses dents. Une pareille lecture, après un de ces dîners qui font un labeur de la digestion, lui paraissait comme un guet-apens. Hector se sentait pris d’un invincible sommeil. Ferdinand s’agitait sur sa chaise comme Guatimozin sur son gril, il n’était pas sur un lit de roses.
Enfin il s’acheva, ce contrat interminable; le notaire lut d’un ton joyeux les dernières phrases, chacun se leva pour signer.
Hector, à demi éveillé, avait fait comme tout le monde.
Debout, il attendait son tour, le notaire avait d’abord «passé la plume aux dames.» Son regard errait insoucieusement autour du salon, se complaisant aux figures satisfaites, lorsque par hasard ses yeux s’arrêtèrent sur la table.
Il vit alors, tenant la plume, une main si mignonne, si délicate, si parfaite, qu’il en eut comme un éblouissement.
Elle avait, cette petite main, une grâce indicible; les doigts étaient longs et fuselés, légèrement infléchis à la première phalange et coquettement retroussés; les ongles étaient roses et étroits, avec des reflets nacrés à la racine; ils se détachaient nettement sur la peau d’une blancheur ferme et vive; elle avait une carnation d’enfant, aux lumières elle semblait transparente, et sous le tissu souple de la peau on suivait les sinuosités bleues des veines, comme si le sang eût coulé à ciel ouvert. Un poignet d’une pureté divine, d’une délicatesse infinie, rattachait cette main au bras blanc, à demi perdu sous la dentelle des manches.
Hector s’émerveillait à ces détails charmants. Par un mouvement instinctif il se rapprocha, écartant les hommes debout devant lui, et qui lui cachaient celle à qui appartenait cette main d’une si magnifique perfection.
—Malheureusement, se disait-il, une femme d’au moins trente-cinq ans peut seule avoir une main pareille.
Il se trompait. C’était la main d’une toute jeune fille, de dix-huit ans à peine, belle comme un rêve, poétique à faire éclore des sonnets dans le cerveau d’un agent de change. Elle avait les cheveux d’un admirable blond, lumineux, avec ces teintes chaudes qui font l’orgueil des belles Vénitiennes. Tordus sans art par le poignet vigoureux d’une rustique camériste, ils étaient retenus par un peigne qui disparaissait entièrement sous les flots dorés; si souples, si abondants, qu’à tout instant on pouvait craindre ou espérer de les voir briser le lien qui les retenait, et s’épandre, comme un manteau d’or, sur des épaules dont on devinait les contours exquis sous une petite guimpe à la vierge, fermée au col par une ruche de dentelles.
—Où donc avais-je les yeux? se demandait Hector. Quoi! je n’avais pas remarqué encore cette rayonnante beauté.
Et il oubliait de prendre la plume, bien que son tour fût venu et que le notaire l’eût appelé trois fois.
Puis on partit pour la mairie du bourg, distante de quelques centaines de pas à peine. Hector avait offert son bras à la vieille demoiselle Aubanel, il l’entraînait, vite, trop vite; il avait hâte de retrouver la jeune fille blonde.
Il ne put la rejoindre que dans la salle de la mairie. Elle s’appuyait sur le bras du vieux cousin, insoucieuse, ignorante de son admirable beauté. Il parlait, et elle souriait en l’écoutant. Une innocente malice pétillait dans ses grands yeux bleus. A quelque plaisanterie plus amusante que les autres, elle éclatait de rire; alors ses lèvres roses découvraient ses dents, fines et brillantes comme des perles.
—On n’est pas plus belle, murmurait Hector en regagnant la maison de son ami.
Il s’enferma dans sa chambre, et lorsque Ferdinand, comme la veille, voulut entrer, il refusa énergiquement d’ouvrir, jurant qu’il dormait, et qu’il ne se lèverait pas même pour éteindre le feu s’il prenait à la maison.
Mais une douce vision le tint longtemps éveillé.
—Si mademoiselle Aurélie pouvait lui ressembler!
Le lendemain, c’était le grand jour. Longtemps encore le mariage à la mairie ne sera qu’une formalité ennuyeuse, un acte par devant un gros monsieur qu’on connaît souvent trop, et auquel l’écharpe tricolore ne prête aucune majesté.
A onze heures,—on se marie en plein soleil, en Touraine,—une douzaine de grandes voitures découvertes vinrent prendre les invités. Il faisait le plus beau temps du monde, le ciel se mettait de la fête. Jamais on ne vit noce plus gaie, plus souriante. C’était comme une de ces belles matinées qui promettent un jour radieux.
Il y avait des fleurs partout; les cochers avaient de gros bouquets à leur poitrine, avec des flots de rubans blancs; les chevaux étaient plus enguirlandés qu’un mouton de procession de la Saint-Jean. Le long des sentiers s’arrêtaient des groupes de paysans et de paysannes. Les hommes agitaient leurs chapeaux, les femmes poussaient de joyeux vivats.
Les voitures roulaient doucement sur le sable des allées, au milieu de ces beaux paysages de la Loire qui inspirent le désir de se faire laboureur, par des routes charmantes qui réduisent les promeneurs à envier le sort du facteur rural qui les parcourt tous les jours.
Après la cérémonie, sous le porche, Hector retrouva la jeune fille de la veille. Son ami passait, il l’appela.
—Quelle est, je t’en prie, lui demanda-t-il, cette délicieuse personne?
—Une de nos voisines, fit l’autre négligemment.
Et, allongeant le bras dans la direction de l’horizon:
—Tiens, sa mère habite ce petit château, que tu vois là-bas à mi-côte, comme un point blanc au milieu des arbres.
Elle était demoiselle d’honneur de la mariée, et l’usage faisait Hector son cavalier servant.
Tout le reste du jour, rieuse, babilleuse comme les libres oiseaux qui gazouillaient dans les ormes du parc, elle se suspendit à son bras. Ils allaient, tous deux, suivant les groupes amis dans les grandes allées du jardin et le long des charmilles.
Il fallut qu’il lui contât l’histoire de son amitié avec Ferdinand, et comment il s’était décidé à venir. Ses questions avaient cette superbe assurance d’une candeur qui ignore tout. Une ou deux fois, Hector fut si surpris, qu’il le laissa voir. Alors elle arrêtait sur lui ses grands yeux tremblants. Mais bientôt elle reprenait sa sérénité insouciante. Et lui bénissait le thème facile de causerie qu’elle lui donnait, car vraiment il n’eût su que lui dire. Près d’elle il était à court, même de ces frivoles niaiseries, de ces platitudes élégantes, qui sont la fausse monnaie d’une conversation spirituelle qu’échangent des inconnus.
Parfois, tout en écoutant, elle se baissait pour saisir au vol une fleur, qu’elle effeuillait machinalement. Elle s’appuyait alors plus fortement sur le bras d’Hector pour ne pas tomber, et il admirait l’élégante souplesse de sa taille; ou bien, c’était une branche qui s’embarrassait dans les plis de sa robe de crêpe blanc, et qu’elle arrachait en riant. Elle se piquait les doigts et vivement les portait à sa bouche, et les mordillait du bout de ses petites dents blanches.
Surpris, ravi, Hector s’abandonnait doucement à cette irrésistible séduction de l’innocence. Tant de grâces pudiques et naïves le tenaient si bien sous le charme, qu’il n’essayait même pas d’analyser les sensations nouvelles qui l’enivraient.
Placé près d’elle, à table, il maudissait ceux qui lui adressaient la parole et le forçaient à répondre, mais il l’observait curieusement et souriait lorsque, timidement, elle trempait sa lèvre au vin précieux qu’on versait dans les verres de mousseline.
A six heures précises,—il faisait encore grand jour,—des violons grincèrent. Le bal commençait sous la charmille, plus tard il devait continuer dans le salon.
Aux premiers accords elle s’était levée, Hector l’avait suivie.
Toute la nuit il dansa, comme un collégien en vacances, s’essuyant le front après chaque quadrille, tendant la main à tous les plateaux.
Valses, polkas, masurkes, il ne reculait devant rien. On eût pu le prendre pour un de ces pauvres surnuméraires qui ont leur nomination dans leurs escarpins. Mademoiselle Aubanel ne put s’empêcher de lui faire compliment. Il ne l’entendit pas. Un reste de prudence murmurait à son oreille:
—Tu peux au plus l’inviter une fois sur cinq.
Et il invitait toutes les femmes, jeunes, laides, vieilles, jolies, et pour toutes, il avait des attentions charmantes, des phrases spirituellement flatteuses.
De sa vie il n’avait été aussi satisfait. Il se souciait bien du monde vraiment, en ce moment; il jouissait pour lui; même il espérait probablement que le bal durerait toujours, jusqu’au jugement dernier, puisqu’il avait fait des invitations pour la trente-septième contredanse.
Mais voici que, tout à coup, sur les trois heures du matin, on n’aperçut plus la mariée. La mariée avait disparu.—Qu’est devenue la mariée?
Ce fut le signal de la retraite, qui bientôt se changea en déroute, malgré les efforts du vieux cousin, qui essayait d’organiser un cotillon et menaçait du garde champêtre les danseuses qui s’enfuyaient. Il invoquait à grands cris l’assistance d’Hector.
Hector venait d’offrir son bras à la charmante blonde et la reconduisait avec sa mère jusqu’à leur voiture. Le vestibule était encombré; on cherchait les châles et les manteaux.
Elle faisait une petite moue mutine.
—Comme nous partons de bonne heure, maman, disait-elle.
—Et vite, vite, ma fille, disait la mère, couvre bien ton cou, et tes épaules, et tes bras; l’air est froid au dehors, les fluxions de poitrine courent les chemins, guettant les imprudentes, et vite, vite, ce châle, et cette sortie de bal, et cette écharpe, et ce bon gros manteau, et encore ce foulard sur ta tête.
Et la jeune fille grelottait et riait. Embarrassée dans les étoffes, comme une momie dans ses bandelettes, elle pouvait à peine marcher. Hector la soutint ou plutôt la porta jusqu’à la voiture; il aida ensuite la mère à étendre sur elle une grande couverture de voyage; toutes deux le remerciaient.
Le cocher fouetta les chevaux.
Hector resta seul sur le perron, surpris, triste, comme le rêveur qui voit s’envoler un rêve heureux, comme l’enfant qui regarde à terre les débris de son jouet favori.
Il avait remarqué que la voiture avait des lanternes plus brillantes que les autres: tant qu’il le put, il suivit leurs lueurs à travers les sinuosités de la route; elles se montraient ou disparaissaient suivant les pentes, comme des feux follets dans la campagne.
Il les perdit de vue, mais il espéra les revoir encore des fenêtres du salon. Il remonta très vite, et, le front contre la vitre, il les chercha longtemps à travers les arbres, dans l’ombre.
Le salon était vide. Au loin, on entendait le roulement des dernières voitures qui se perdaient dans la nuit. Les domestiques, fatigués, allaient et venaient d’un pas traînant. Ils éteignaient les lampes et soufflaient les bougies.
Hector se résignait à regagner sa chambre, lorsque Ferdinand, l’air effaré, traversa le salon comme un ouragan.
Il l’arrêta par le bras, malgré lui, presque de force.
—Comment s’appelle-t-elle? demanda-t-il.
—Elle, qui? ma femme? Herminie.
—Eh! il s’agit bien de ta femme!
Mais Ferdinand avait réussi à se dégager, il était déjà loin.
Elle s’appelait Louise d’Ambleçay et venait d’avoir dix-sept ans.
Sa mère, madame la baronne d’Ambleçay, était restée veuve après peu d’années d’un mariage heureux. Jeune encore, riche, décidée à ne jamais se remarier, elle n’eut pas le courage de se séparer de sa fille unique, et voulut elle-même se charger de son éducation.
Elle eut pour aides, dans cette tâche si difficile, un vieil abbé fort savant, très spirituel, plus original encore, et une institutrice anglaise. Par miracle, cette Anglaise était excellente musicienne; par un miracle plus grand, elle n’était nullement romanesque. Le prêtre et l’institutrice font encore aujourd’hui partie de la famille; sans aucun doute, ils finiront leurs jours au château d’Ambleçay, à discuter, sans pouvoir se mettre d’accord, leur système d’éducation. Car ils ont chacun un système. Il est vrai qu’ils n’en ont pas fait l’essai sur leur élève.
Ainsi, Louise eut le rare bonheur d’éviter les pensions et les couvents, dont l’air est si souvent fatal aux jeunes filles. Une brebis malsaine a plus tôt fait qu’un loup de mettre à mal tout un troupeau, et la plus sévère vigilance souvent ne peut pas écarter de telles brebis. Enfin les demoiselles rapportent de la meilleure des maisons d’éducation nombre de préjugés et de sottes idées, dont plus tard, dans le monde, elles ont mille peines à se défaire.
A cette éducation, sous les yeux de sa mère, Louise devait cette ignorance adorable, cette grâce instinctive, cette naïveté sereine, ses plus grands charmes, bien avant sa rare beauté.
Madame d’Ambleçay vivait fort retirée. Abîmée dans sa douleur, à la mort de son mari, elle s’était réfugiée dans son château, se refusant à voir personne. Plus tard, lorsque le temps eut séché ses larmes et ramené un sourire sur ses lèvres, elle ne voulut plus changer son genre de vie. Elle pensait que les plaisirs du monde ne valent pas ceux d’une calme retraite.
Elle recevait cependant quelques-uns de ses parents de Tours, qui tous les ans, à tour de rôle, venaient passer une quinzaine au château. Elle avait aussi les visites de quatre ou cinq voisins de campagne, autrefois amis de son mari, bons gentilshommes qui, malgré leur noblesse, avaient le bon esprit de ne pas être ou de ne pas paraître mécontents, et qui, par extraordinaire, ne parlaient jamais politique, au moins devant des femmes.
Plusieurs fois déjà, dans le pays, on s’était étonné que madame d’Ambleçay ne parût pas songer à «l’établissement» de sa fille. Quelques indiscrètes même,—de ces mamans qui conduisent leurs demoiselles à tous les bals de la préfecture et de la recette générale, avec l’idée fixe d’y trouver un bon parti,—l’avaient, à cet égard, interrogée à brûle-pourpoint.
Madame d’Ambleçay répondait ordinairement que rien ne pressait.
Là-dessus, les bonnes âmes avaient charitablement répandu le bruit que la baronne sacrifiait Louise à son égoïsme maternel, qu’elle la séquestrait impitoyablement, bien décidée à lui faire, bon gré mal gré, coiffer sainte Catherine.
Hector sut très vite tous ces détails et beaucoup d’autres encore, par la femme de son ami. Madame Aubanel était précisément la meilleure, ou plutôt la seule amie de Louise. Aussi devint-elle la confidente du jeune homme, sans qu’il s’en doutât. Il recherchait les occasions de se trouver seul avec elle, et, toutes les fois qu’il le pouvait, il s’emparait de son bras. Il faisait assaut d’empressements avec Ferdinand, qu’il trouvait fort ridicule avec sa galanterie de jeune marié.
Il faut dire que, tout en parlant toujours et sans cesse de mademoiselle d’Ambleçay, Hector essayait et croyait prendre l’air le plus détaché et le plus désintéressé du monde. Mais il réussissait mal. Sans sa préoccupation, il eût surpris de malins sourires sur les lèvres de la jeune femme. Elle croyait voir clair dans le cœur de l’ami de Ferdinand.
Hélas! il n’y voyait rien lui-même, au moins dans les premiers jours. S’il dissimulait, c’était de très bonne foi. Il était le premier à prendre le change.
S’il restait à la Fresnaie, lui qui s’était si bien promis de partir dès le lendemain du mariage de son ami, c’est qu’il ne pouvait faire autrement. Il se le prouvait.
Les prétextes ne lui manquaient pas, ni les excellentes raisons. Il n’y a pas, en Touraine, de bonne fête sans lendemain, de noce sans «retour.» C’est à qui, des parents et des amis, recevra les nouveaux mariés. Les broches tournent quinze jours durant, les violons font rage toutes les nuits; les bals, les dîners, les parties de campagne se succèdent sans interruption. Pour que cette folie de plaisirs se calme, il faut que toute la parenté soit sur les dents.
Hector pouvait-il refuser les invitations qui pleuvaient dru comme grêle? Non certes. C’eût été faire injure à son ami.
Et partout il retrouvait mademoiselle d’Ambleçay, dont la mère, pour ce fait du mariage d’une amie de sa fille, avait renoncé à ses habitudes d’isolement.
Moins prévenu, Hector aurait à coup sûr remarqué le singulier changement qui s’opérait dans le caractère de la jeune fille. Elle, si rieuse, si expansive le premier jour, elle devenait de plus en plus réservée. A l’encontre de ce qui arrive d’ordinaire, il l’intimidait davantage à mesure qu’elle le connaissait mieux.
Il ne fit pas cette remarque, lui qui se flattait de connaître les femmes, parce que le séducteur le plus habile perd ses moyens dès l’instant où il aime sérieusement, de même que le meilleur acteur deviendrait exécrable s’il ressentait vraiment la passion qu’il s’efforce de rendre.
Cependant les jours se passaient, et chaque soir Hector faisait sa malle pour la défaire le lendemain. Il se maudissait d’être si faible; il se trouvait inconvenant et même un peu ridicule, de demeurer là, en tiers dans une lune de miel, de jouer le rôle de trouble-fête, d’épouvantail à amoureux. Parfois il était pris de remords.
—Le pauvre Ferdinand, pensait-il, doit être excédé de moi. Il y a longtemps qu’à sa place j’aurais très poliment jeté à la porte mon bon ami Hector.
Mais Ferdinand n’avait pas si mauvais caractère. La présence de son ami l’enchantait. Il disait les plus jolies choses sur l’amour et l’amitié, et ne se reprochait rien, sinon l’excès de son bonheur, qui commençait à l’inquiéter sérieusement. Il aurait vécu cent ans ainsi, sans se douter des perplexités de son ami. Il fut averti par sa femme.
C’était un matin, les jeunes mariés déjeunaient en tête-à-tête. Dès l’aube, Hector avait gagné les champs sous le prétexte très plausible de tirer quelques perdrix, en réalité pour aller rôder un peu du côté du château de madame d’Ambleçay. Ferdinand bénissait ce phénix des amis, qui, en dépit de ses affaires,—car il devait avoir des affaires,—leur consacrait ainsi plusieurs semaines.
—Es-tu bien sûr, mon ami, demanda madame Aubanel, que sa seule amitié pour toi, pour nous, retienne M. Malestrat à la Fresnaie?
—Parbleu! répondit Ferdinand, la bouche pleine, quelle autre raison.....
—Qui sait? quelque gentille raison, toute jeune, bien blonde.....
—Bah!...
—Mademoiselle d’Ambleçay, par exemple?
—Comment, ton amie, tu crois? quelle idée! Mais au fait, pourquoi non? on la dit fort bien, cette demoiselle.
—On la dit... comme si tu ne la connaissais pas.
—Je la connais; mais vous savez bien, madame, que depuis deux ans je n’ai pas regardé d’autre femme que vous.
—Et j’espère bien que ce sera toujours ainsi.
—Je le jure, dit gravement Ferdinand. Mais revenons à ta découverte. Hector amoureux, c’est invraisemblable! Comment ne m’a-t-il rien dit? ce serait le comble de la dissimulation, un crime de lèse-amitié; j’en aurai raison, et certainement je le confesserai.
La confession était toute faite.
Les indécisions d’Hector avaient cessé, après trois semaines des plus cruelles et des plus comiques perplexités qui aient jamais troublé le cœur et l’esprit d’un amoureux.
La première fois, la nuit du bal, après une journée délicieuse, Hector n’avait pas eu le loisir de la réflexion. Il n’était pas une de ses pensées qui ne fût à cette adorable jeune fille, à mademoiselle d’Ambleçay. Il subissait le charme.
Le lendemain seulement, le souvenir de mademoiselle Blandureau, de cette inconnue qu’il devait épouser, vint méchamment troubler son bonheur. Il chassa vite cette idée importune, se disant qu’il aurait bien assez de toute sa vie pour penser à celle qui allait être sa femme, et il ne songea plus qu’à Louise.
Mais il revint à la charge, ce souvenir, plus vif, plus pressant. Au milieu des rêves d’Hector, mademoiselle Aurélie Blandureau se dressait devant lui, froide et sévère comme le remords. Elle disait:
—Que fais-tu, fiancé coupable, que fais-tu, tandis que je t’attends? Tu oublies, je le vois, cette lettre qu’il y a deux mois à peine tu écrivais à mon père. C’est une horrible trahison.
—Daignez m’excuser, ombre irritée, murmurait Hector. Vous devez bien comprendre qu’il n’y a rien de sérieux dans tout ceci; je vais partir et j’oublierai celle que vous croyez, bien à tort, votre rivale.
—Je suis ta femme, ou c’est tout comme, reprenait l’ombre de mademoiselle Aurélie; désormais toutes tes pensées m’appartiennent. Tu n’as plus le droit d’ouvrir ton cœur à une autre femme. Ton père a-t-il, oui ou non, donné sa parole? Tu as, toi, reconnu la dette. Est-ce ainsi que tu prétends remplir des engagements deux fois sacrés? Que dira M. Blandureau, mon trop crédule père?
—Hélas, oui! murmura Hector, que dira M. Blandureau?
Et il baissait la tête comme un coupable. Il ne pouvait s’empêcher d’avouer que l’ombre de la fiancée inconnue avait raison, et il cherchait à la désarmer par de belles promesses.
Enfin, le jour arriva où, après un examen de conscience, il dut s’avouer qu’il était sérieusement épris de mademoiselle d’Ambleçay, mais là, sérieusement, pour tout de bon. Il était amoureux comme jamais il ne l’avait été, comme il ne croyait pas qu’on pût l’être.
Ce fut le comble. L’ombre d’Aurélie devint inexorable. Elle le pressait, le tourmentait, le harcelait, le torturait nuit et jour. Il n’avait plus un instant de répit.
Pris comme dans un inextricable labyrinthe, entre le passé et le présent, il ne voyait pas d’issue à l’avenir. Il se creusait l’esprit à chercher un expédient pour concilier ce qu’il appelait son devoir et ses désirs les plus chers. Mais comme tous les hommes d’imagination, il n’arrivait qu’à des combinaisons romanesques et impossibles.
Il était bien disposé à ne pas épouser mademoiselle Blandureau, mais il ne voulait pas reprendre sa parole. L’idée d’une banqueroute au jour de l’échéance lui faisait horreur. C’était le seul moyen pourtant. Il le repoussa, ce moyen, le reprit, l’écarta, le discuta longtemps, et finalement dut se résoudre à l’admettre.
—Mon père, se disait-il, a pris des engagements; il n’en avait pas le droit. J’ai eu le tort de ratifier moi-même ces engagements. Mais qu’ai-je promis en définitive? d’aimer mademoiselle Blandureau. Or, l’amour n’est si beau que parce qu’il est involontaire, et j’en aime une autre. Si je tenais ma parole, je serais un malhonnête homme, car j’assurerais mon malheur et celui d’Aurélie. Donc, je dois m’abstenir. Il y a force majeure; ce n’est plus une banqueroute, c’est une faillite simple.
J’ai droit à un concordat.
Résolu à ne pas laisser échapper le bonheur qui passait à portée de sa main, il poursuivit son idée de rupture dans tous ses développements.
Quel tort faisait-il à mademoiselle Aurélie? Aucun certainement. Elle ne l’avait jamais vu, et ainsi elle ne pouvait l’aimer; donc, aucune souffrance. Étant très riche, elle n’aurait qu’à choisir entre tous les partis qui se présenteraient; donc, aucun préjudice.
Tout le difficile pour Hector n’était plus que de redemander sa parole à M. Blandureau. Cette terrible perspective le tint en suspens deux jours encore. Mais il usa ce remords comme les autres. Il décida qu’il écrirait lorsque tout serait terminé, c’est-à-dire lorsqu’il aurait demandé la main de mademoiselle d’Ambleçay.
Dès lors il bannit tout souci, donna congé au souvenir fâcheux de mademoiselle Aurélie, et, tout entier à son amour, il attendit une occasion favorable pour se déclarer bravement.
Bravement est peut-être de trop. L’audacieux Hector était devenu fort timide. Il aurait sans doute attendu longtemps encore, lorsque madame Aubanel précipita les événements. Pour la centième, la millième fois, il venait d’amener—maladroitement—la conversation sur mademoiselle d’Ambleçay.
—Ma présence ici la contrarie donc? demanda-t-il; c’était votre meilleure amie, madame, et depuis votre mariage elle n’est pas venue vous rendre visite une seule fois.
—Ah! vous avez remarqué cela? C’est grave, dit madame Aubanel.
Ferdinand se mit à rire. Hector rougit, balbutia, s’embrouilla, mais n’en continua pas moins. Deux minutes plus tard, il en était à cette question qui lui brûlait les lèvres:
—Elle ne songe donc pas à se marier?
—Eh! le sais-je? répondit la jeune femme en souriant. Il fallait le lui demander, vous qui avez dansé si souvent avec elle.
—J’y ai bien pensé, dit naïvement Hector, mais je n’ai pas osé.
—Il fallait oser.
—Quoi! vous croyez... je pourrais espérer... elle vous aurait parlé...
—Comme vous y allez! Je ne crois rien, je ne sais rien, on ne m’a rien dit.
—Ah! madame, vous êtes cruelle, reprit Hector avec découragement; moi qui déjà songeais...
—A la demander en mariage? Essayez... Seulement vous rencontrerez, je le crains, certaines difficultés...
—Je ne suis pas noble, c’est vrai.
—Oh! ce ne serait pas une raison.
—Qu’est-ce, alors? Oh! madame, dites-le moi, je vous en prie...
—C’est un secret.
C’en était trop pour Ferdinand, qui depuis cinq minutes faisait, pour s’empêcher de rire, des efforts surhumains. En voyant la figure piteuse de son ami, sur ces mots: «C’est un secret,» il éclata. Il ne riait pas, il se tenait les côtes, il se tordait. A peine le fou rire lui laissait-il le moyen d’articuler quelques lambeaux de phrases.
—Parle, mon ami, disait-il, continue, cher Hector, tu me ravis... Ah! si tu pouvais te voir! tu es trop drôle... Non, de ta vie tu n’as été si amusant...
Le rire de son mari avait gagné madame Aubanel. Hector se leva furieux.
—Eh bien, oui! s’écria-t-il, j’aime mademoiselle Louise; qu’y a-t-il de si risible à cela?
Et comme on ne lui répondait pas:
—Oui, je l’aime, continua-t-il, et mon plus ardent désir est de l’épouser. Et au fait, j’en aurai le cœur net. Je vais aller demander sa main, aujourd’hui même, sur-le-champ. Je me rends de ce pas chez madame d’Ambleçay...
—Et tu lui diras? demanda Ferdinand.
—Je lui dirai: «Madame, j’aime votre fille, je crois que je ne lui suis pas indifférent...»
—Tu n’es qu’un fat.
—Je répète ce que ta femme m’a dit...
—Oh! par exemple, quelle horreur! fi! monsieur, interrompit madame Aubanel...
Hector lança à la jeune femme un regard furibond.
—Je puis, reprit-il, m’être cruellement trompé sur le sens de certaines de vos paroles; alors je ne dirai pas cela. Non, je dirai.... je dirai... je... Eh! par ma foi! je ne sais pas ce que je dirai; mais je parlerai, je m’expliquerai. Dans tous les cas je sortirai de cette affreuse incertitude qui me tue. Je ne puis supporter l’incertitude, c’est pour moi comme une rage de dents. Et quand une dent m’empêche de dormir, je n’hésite pas... je la fais arracher.
Et il sortit, laissant ses amis dans un nouvel accès de gaîté.
—Parbleu! s’écria Ferdinand, d’un ton suffisant, le pauvre garçon a perdu la cervelle; je n’étais certes pas plus fou la veille de mes noces.
—Eh bien! monsieur? dit gaîment madame Aubanel en menaçant son mari du doigt...
—Je serai fou très longtemps encore, rassure-toi. Mais sérieusement, je voudrais bien que ce mariage d’Hector réussît, nous fonderions ici une colonie d’amis. A-t-il des chances, au moins?...
—J’ai de bonnes raisons pour croire que Louise ne dira pas non.
—C’est déjà quelque chose.
—Malheureusement, je suis au moins aussi sûre d’une vive résistance de la part de madame d’Ambleçay.
—Bast! quand on se sent aimé on est bien fort; je jure pour ma part que si tes parents s’étaient opposés à notre mariage...
—Chut!... le voici.
Hector reparut, plus grave qu’un député le jour du vote de l’Adresse, tout de noir vêtu comme un notaire où un maître d’hôtel. Il achevait de mettre ses gants paille.
—Je pars pour le château d’Ambleçay, dit-il d’un ton résolu.
Ses amis essayèrent quelques représentations des plus justes, mais tous leurs efforts échouèrent contre son obstination.
—Je veux être fixé, répondit-il; je me sens en veine de courage, j’en profite, le sort en est jeté. La voiture doit être attelée, adieu; souhaitez-moi bonne chance.
Lorsque Hector fut parti, madame Aubanel conjura son mari de courir après cet imprudent, qui par une démarche inconsidérée allait certainement tout compromettre.
—Je ne me dérangerai certes pas, répondit Ferdinand; crois-tu donc, chère amie, qu’il ira chez la baronne? que nenni. Le château est à près d’une heure d’ici, il aura le temps de la réflexion, et nous allons le voir revenir tout penaud.
Une fois seul, en voiture, sur la route du château de la baronne, Hector réfléchit en effet.
Quelle aventure courait-il? n’était-ce pas une folie? Aller ainsi, seul, de but en blanc, demander à madame d’Ambleçay la main de sa fille, c’était marcher au-devant d’un refus. Qui le forçait à risquer ainsi, sur une seule carte, le bonheur de toute sa vie? Il pouvait attendre, se faire mieux apprécier de la mère de Louise, intéresser ses amis à son succès...
Il se dit tout cela. Mais il n’en poursuivit pas moins sa route. Ce n’est pas qu’il redoutât les railleries de Ferdinand, mais il obéissait à une voix secrète, inexplicable pressentiment qui lui conseillait de poursuivre.
En chemin il rencontra un pauvre, et vida sa bourse entre les mains du mendiant, surpris d’une semblable générosité. S’il était passé devant une église, il y serait entré pour faire brûler un cierge. Le bruit de la voiture ayant effrayé des pies en train de picoter au milieu de la route, il remarqua avec satisfaction qu’elles étaient trois et qu’elles avaient pris leur vol à droite. Cet augure est infaillible.
Dans la cour du château, un gros dogue assez laid et passablement malpropre vint à lui, le flaira, et se mit à lui lécher les mains. Il le flatta doucement. Les caresses de ce chien lui semblaient encore un heureux présage. L’inquiétude et l’attente doivent avoir donné naissance à la superstition.
Comme il traversait le jardin, il crut apercevoir derrière les massifs une robe blanche qui fuyait. Il reconnut ou plutôt devina Louise.
Enfin, on l’introduisit dans le salon, en le priant d’attendre. On était allé prévenir madame d’Ambleçay. Il eut ainsi le temps de se remettre un peu. Il en avait besoin. Sa démarche en ce moment lui apparaissait comme un acte de démence insigne. Pour un peu il se serait enfui comme un voleur, lorsque la baronne entra.
C’est une femme d’une quarantaine d’années, mais jamais on ne lui donnerait cet âge. Le calme et la quiétude de sa vie lui ont laissé cette fleur de jeunesse que dès la vingtième année perdent les femmes de la ville. On ne se douterait jamais de ses souffrances passées, sans ses cheveux blancs, qui forment avec sa figure juvénile le contraste le plus étrange, et attestent la profondeur de ses chagrins. Sa voix est douce, un peu traînante, son geste affable et digne. Toute sa personne est empreinte de cette distinction suprême que la fortune ne donnera jamais.
Ses yeux, fort beaux, trahirent, en apercevant Hector, une légère surprise. Mais ce ne fut qu’un éclair. Elle pensa que sans doute il quittait la Fresnaie et venait lui faire une visite d’adieu. D’un geste gracieux, elle indiqua un fauteuil à son visiteur, et prit place elle-même sur une causeuse.
Hector était fort pâle à ce moment, comme un homme qui s’est jeté à l’étourdie dans un grand péril et s’aperçoit qu’il ne peut plus reculer. Son mariage à cette heure pouvait n’être plus qu’une question d’habileté. Il le comprit, et parvint à dominer un peu son angoisse. «Pas de phrases entortillées, pensa-t-il, droit au but; je m’expliquerai après.» Sa voix était fort tremblante, mais très distincte pourtant.
—Madame, dit-il, je n’ai pu voir sans l’aimer mademoiselle votre fille. Si j’avais le bonheur d’être par vous jugé digne d’elle, je n’aurais pas assez de toute ma vie pour payer la dette de ma reconnaissance.
Madame d’Ambleçay se leva brusquement, en portant la main à son front. Une foule de circonstances qui lui avaient échappé ou lui avaient paru insignifiantes, se présentaient tout à coup à son esprit comme un faisceau lumineux. Elle s’accusa d’imprévoyance et d’aveuglement.
—Imprudente! murmura-t-elle en reprenant sa place, imprudente...
—Pardonnez-moi, madame, continua Hector avec un geste suppliant, pardonnez-moi la singularité, l’inconvenance même de ma démarche. J’ai obéi à un sentiment dont je ne suis plus le maître. D’ordinaire, dans le monde, un ami, un parent, se chargent de la demande que j’ai osé vous faire moi-même. Mais, hélas! je n’ai plus de parents, je suis seul, isolé. Vous me connaissez à peine, je le sais, mais toute une ville, le jour où vous le voudrez, se lèvera pour témoigner de l’honneur de ma famille. Pour moi, madame, demandez-moi, si vous le voulez, des années d’épreuves...
Le regard froid et sévère de la baronne glaça les paroles sur les lèvres d’Hector; il y eut un moment de silence aussi embarrassant pour l’un que pour l’autre.
—Croyez, monsieur, dit enfin madame d’Ambleçay, mal remise encore de son émotion et de sa surprise, croyez que je me tiens pour très honorée de votre démarche. Mieux eût valu, pourtant, me la faire pressentir; prévenue, je vous aurais épargné la douleur d’un refus, car il m’est impossible d’accueillir votre demande...
—Oh! madame! s’écria douloureusement Hector...
—Impossible! monsieur.
Un cri étouffé, qui semblait venir de la pièce voisine, répondit à ce mot, prononcé d’un ton ferme qui annonçait une inébranlable résolution.
—Écoutez... dit la baronne avec inquiétude, imposant silence à Hector.
Presque aussitôt on entendit comme le bruit sourd d’un corps qui s’affaisse sur lui-même, et madame d’Ambleçay s’élança vers une des portes du salon.
Elle écarta la tapisserie, ouvrit vivement la porte, embrassa d’un coup d’œil l’appartement, et se retournant vers Hector qui l’avait suivie:
—Je vous prie de m’attendre, dit-elle.
La porte se referma sur la baronne, et le jeune homme demeura seul.
Qui avait poussé ce cri? mademoiselle d’Ambleçay, évidemment. Elle écoutait donc aux portes!...
En toute autre circonstance, Hector se serait beaucoup amusé de cette situation à la fois triste et comique, et d’une vulgarité désolante. Mais il n’avait pas le cœur à la raillerie. A peine osa-t-il se réjouir de cet aveu si formel arraché à la jeune fille. Quelle serait l’influence de cet aveu involontaire sur la décision de madame d’Ambleçay? Là était pour lui toute la question.
Dévoré d’inquiétudes et d’angoisses, ne sachant s’il devait craindre ou espérer encore, il se laissa tomber sur un fauteuil, prêtant l’oreille à tous les bruits de la maison. Son sort se décidait en ce moment. Un mot allait consommer son désespoir ou le faire renaître au bonheur.
Il était si profondément plongé dans ses sombres réflexions, qu’il n’entendit pas la porte s’ouvrir et ne s’aperçut pas de la présence de l’ancien précepteur de Louise. Il fallut que celui-ci lui touchât légèrement le bras.
Hector tressaillit comme un dormeur éveillé par un seau d’eau froide. Sa figure exprima un si naïf ébahissement, il roulait des yeux si effarés, que l’abbé ne put s’empêcher de sourire.
—Monsieur, dit le prêtre, madame la baronne ne tardera pas sans doute à revenir, mais elle a craint pour vous l’ennui, et m’envoie vous tenir compagnie.
Le jeune homme s’inclina.
—Ce cher abbé, pensa-t-il, va, sans s’en douter, me raconter tout ce qui se passe.
Folle présomption! En vain Hector se mit en frais de ruses et de diplomatie. A toutes ses questions insidieuses ou directes, le spirituel prêtre trouva moyen, tout en parlant beaucoup, de ne répondre absolument rien. Si bien, qu’après une heure et plus de conversation, le triste amoureux n’était pas plus avancé qu’auparavant. Il était fort déconcerté, lorsqu’à sa grande satisfaction la baronne vint rompre le tête-à-tête. L’abbé, presque aussitôt, s’esquiva discrètement.
La physionomie de madame d’Ambleçay accusait une douleur profonde. Il était aisé de voir qu’elle avait pleuré; elle avait encore quelque peine à retenir ses larmes. Hector aurait eu pitié de l’altération des traits de la pauvre mère, si lui-même n’avait beaucoup souffert. La douleur est égoïste.
—Avant tout, monsieur, dit la baronne avec des prières dans la voix, jurez-moi, quoi qu’il puisse arriver, de ne jamais ouvrir la bouche sur ce qui vient de se passer.
—Je vous le jure, madame.
L’accent inimitable de sincérité d’Hector dut rassurer madame d’Ambleçay. Elle le remercia d’un seul regard, mais ce regard valait toutes les actions de grâces de la terre.
—Tout à l’heure, monsieur, reprit-elle, à votre demande si imprévue, j’ai répondu: impossible. Alors,—elle rougit en prononçant ces mots,—alors, je n’avais pas consulté ma fille. Maintenant, c’est avec son assentiment que je viens vous dire: Je ne crois pas qu’il me soit possible de vous accorder jamais sa main.
Hector saisit parfaitement la nuance de cette seconde réponse. Pourtant ce fut comme une seconde blessure. Ce n’était pas là ce qu’il attendait. Il retombait rudement à terre, de toute la hauteur de ses espérances. La baronne continua:
—Voici bien longtemps déjà que le mariage de ma fille est inexorablement arrêté. Le baron d’Ambleçay, à son lit de mort, a désigné lui-même l’époux qu’il destinait à sa fille. J’ai juré d’obéir à ses volontés; on ne trahit pas un serment fait au chevet d’un mourant. Dût mon cœur se briser, dût le cœur de Louise être brisé de même, nous tiendrons une promesse sacrée. On n’est jamais complètement malheureux lorsqu’on a la conscience d’avoir rempli son devoir.
—N’est-il donc plus d’espoir? murmura Hector accablé.
—Je vous en fais juge, monsieur, écoutez-moi: A la Révolution, le grand-père de mon mari émigra avec toute sa famille, sa femme et ses cinq enfants. Tous ses biens furent mis en séquestre, et il ne tarda pas à tomber dans une détresse profonde. C’est à Londres qu’il s’était réfugié. Lui et les siens faillirent périr de misère, de froid et de faim, dans cette ville où ils ne connaissaient personne. Pour donner un peu de pain à ses enfants, il se plaça comme homme de peine chez un riche fabricant, et sa femme, une Cinq-Cygne, fit des ménages dans le voisinage. Mais que pouvaient leurs efforts!... La femme tomba dangereusement malade. Un propriétaire inexorable allait, faute de paiement, jeter toute la malheureuse famille dans la rue, c’en était fait d’eux, lorsque la Providence, dont il ne faut jamais désespérer, leur envoya un sauveur. Un riche baronnet recueillit le grand-père de mon mari et lui offrit, ainsi qu’à tous les siens, la plus noble des hospitalités. Et cela, non pour quelques jours, pour quelques mois, mais pour des années. Les d’Ambleçay doivent leur salut à cet homme si généreux, à cet ami des jours malheureux. Et plus tard, lorsque la tempête révolutionnaire fut calmée, c’est grâce à lui qu’ils purent regagner la France et recouvrer une partie de leurs biens. Le souvenir de ce bienfait s’est transmis comme héritage dans notre famille, monsieur.
—Je le comprends, répondit faiblement Hector.
—Eh bien, monsieur, nous pouvons aujourd’hui acquitter cette dette. A son tour, la famille de ce noble Anglais a connu le malheur; son fils a été ruiné. Plusieurs fois mon mari est allé mettre à ses pieds toute notre fortune; jamais il n’a voulu accepter une obole de ceux qui devaient plus que la vie à son père. Il aurait pu travailler, entreprendre quelque chose, tenter de relever sa fortune; mais vous savez l’horreur profonde, insurmontable, de la noblesse anglaise pour tout ce qui touche au commerce. Le baronnet, enfermé dans le château de ses pères, refusa toutes les propositions, préférant sa médiocrité, héroïquement supportée, à toutes les jouissances de richesses acquises au prix de ce qu’il appelait son honneur. Enfin, il est mort, ne léguant à son fils que sa pauvreté et un nom sans tache.
C’est ce fils, monsieur, qui doit être le mari de Louise.
—Ah! s’écria Hector, emporté par son désespoir, l’Anglais n’avait fait que partager sa fortune, et vous, madame, vous sacrifiez votre fille.
—Cette union, monsieur, dit sévèrement la baronne, a été arrêtée entre le père de ce jeune homme et mon mari. Nous n’avions aucun autre moyen de venir en aide à une famille cruellement éprouvée, trop fière pour accepter la restitution d’une aumône.—Car ils ont fait l’aumône aux d’Ambleçay. Depuis longtemps le jeune baronnet est prévenu, il connaît nos conventions, il sait que ma fille lui est destinée, l’époque fixée pour ce mariage approche, et enfin, pour tout vous dire...
La pâleur livide d’Hector effraya la baronne; aussi hésita-t-elle une minute après ces dernières paroles.
Elle s’arma cependant de courage, et détournant la tête:
—Nous l’attendons, dit-elle d’une voix faible.
—Vous êtes cruelle! madame, répondit Hector avec amertume, il ne fallait pas revenir sur votre refus...
—Je suis revenue sur mes premières paroles, parce que j’étais contre vous avant d’avoir parlé à Louise; maintenant je suis pour vous. J’aurais tout fait pour hâter la conclusion de ce mariage, désormais je ne ferai rien...
—Qu’espérez-vous alors?...
—J’espère en Dieu, monsieur. Le fiancé de ma fille peut oublier sa promesse, Louise peut lui déplaire... que sais-je?...
Hector secoua tristement la tête.
—Si encore on pouvait aider à cet oubli. Ah! si je le connaissais, j’irais lui dire...
—Vous ne lui diriez rien, monsieur. Si seulement vous prononciez le nom de ma fille devant lui, vous auriez alors moins de chances qu’aujourd’hui.
—Mais je suis riche. Si la moitié de ma fortune...
—Si c’était une question d’argent, elle serait déjà résolue.
—Oh! murmura Hector, arrêter ainsi par avance des mariages! fatale imprudence. Mon père aussi, madame, reprit-il plus haut, avait décidé que j’épouserais la fille d’un de ses amis. Il m’attend, cet ami...
—C’est encore un obstacle dont vous ne parliez pas.
—S’il n’y avait que celui-là! ajouta-t-il étourdiment.
—Je vous excuse, monsieur, reprit madame d’Ambleçay avec dignité, ce n’est pas votre raison qui parle. Sachez même que si le baronnet venait à oublier la parole de son père, je ne vous accorderais pas la main de Louise avant le mariage de votre fiancée..... Mais permettez-moi d’aller rejoindre ma fille, et reposez-vous sur la Providence. J’aurai cependant encore un service à réclamer de vous...
Hector arrêta du geste madame d’Ambleçay.
—Je vous comprends, madame, dit-il; ce soir même j’aurai quitté la Fresnaie.
Et, prenant congé de la baronne, il se retira désespéré, la tête vide, le cœur gonflé de sanglots. Il sentait qu’il laissait son âme dans ce petit château de Touraine.
Comme il traversait lentement la cour pour regagner sa voiture, cherchant à deviner laquelle de toutes ces fenêtres était celle de Louise, il fut rejoint par l’abbé. Il salua tristement ce prêtre dont il enviait le bonheur.
Ne vivait-il pas presque de la même vie que mademoiselle d’Ambleçay? il la voyait tous les jours, il pouvait lui parler à toute heure.
—Cher monsieur, lui dit le vieux précepteur, excusez-moi de courir ainsi après vous, mais ne m’avez-vous pas dit tantôt que vous comptiez partir prochainement pour Paris?
—J’y serai demain, répondit Hector avec un soupir.
—Ma foi! cela tombe bien. Je vous serais fort obligé s’il vous convenait de vous charger pour moi d’une petite commission...
—Je suis tout à votre service, monsieur...
—Oh! c’est simplement une lettre à remettre de ma part au fiancé de mademoiselle Louise, sir James Wellesley, qui habite pour le moment la capitale, rue de Rivoli, hôtel des Etrangers.
Hector prit la lettre en tremblant de plaisir, et l’abbé qui se confondait en remercîments le reconduisit jusqu’à sa voiture.
—Que veut dire ceci? pensait Hector, lorsqu’il se trouva seul; madame d’Ambleçay ne m’avait pas dit le nom de cet Anglais de malheur; prendrait-elle ce moyen détourné? M’autorise-t-elle tacitement ainsi à faire tous mes efforts pour amener une rupture? Non, ce n’est pas probable. Est-ce Louise qui... Oh! non, non, impossible, l’idée doit venir de l’abbé, je le soupçonne très fin, avec son air bonhomme. Le chagrin de son élève m’aura valu sa protection. Il sait le proverbe: «Aide-toi, le ciel t’aidera,» et il me conseille, c’est évident, de donner un coup de main à la Providence. Il m’en fournit les moyens. A bon entendeur, salut! Je ne parlerai jamais de madame d’Ambleçay à M. Wellesley; mais que je perde l’amour de Louise s’il vient jamais en Touraine!
Hector trouva ses amis de la Fresnaie fort inquiets de sa longue absence, et sa figure bouleversée ne les rassura pas.
—Vous avez échoué? lui demanda madame Aubanel.
—Hélas, oui!... il me reste bien peu d’espoir.
Strict observateur de sa parole, Hector ne parla pas de la scène du salon, mais en peu de mots il résuma sa conversation avec la mère de Louise. Lorsqu’il en arriva à la lettre dont il était chargé par l’abbé, madame Aubanel partagea son avis.
—C’est une branche de salut qu’il vous tend, dit-elle, mais soyez circonspect. Je connais la baronne depuis mon enfance, jamais je ne l’ai vue revenir sur une décision. Pas un mot de Louise à sir James. Si je suis surprise d’une chose, c’est qu’elle ne vous ait pas repoussé absolument. Il y a pour moi là-dessous un mystère que je pénétrerai. Je dois vous avouer que je connaissais l’histoire de la famille d’Ambleçay, et l’échange des paroles...
—Et je n’en savais rien, moi! s’écria Ferdinand; ma femme a des secrets, c’est une trahison. Mais toi, pauvre ami, que vas-tu faire?
—D’abord, partir ce soir même; puis, j’agirai selon les circonstances. Toi-même, à ma place, que ferais-tu?
—Vrai, je n’en sais absolument rien. Tout ce que je puis dire, c’est que si entre Herminie et moi j’avais aperçu un rival, un homme, un Anglais surtout...
—Eh bien?
—Je l’aurais étranglé, net, sans remords. Moi, d’abord, je ne puis souffrir les Anglais.
—Hélas! j’avais la faiblesse d’aimer ce peuple.
—Quel aveuglement!
—J’en reviens. C’est égal, ton moyen est violent.
—Surtout, conclut madame Aubanel, de la prudence, monsieur Hector, de la prudence.
Quelques heures plus tard, Ferdinand conduisait son ami à la station de chemin de fer la plus voisine, distante encore de trois lieues.
Hector expliquait à Ferdinand une combinaison ingénieuse et infaillible qu’il venait d’imaginer.
—Vois-tu bien, cher ami, je vais trouver cet Anglais maudit, je l’accable de prévenances, je lui ouvre mon cœur, ma maison, ma bourse...
—C’est aimable de ta part.
—N’est-ce pas? Le voilà donc séduit. Il est mon ami, mon inséparable, nous ne faisons plus qu’un, il ne voit que par mes yeux.
—Jusqu’ici, tout va bien; et après?
—Après, ami Ferdinand, j’inocule à ce fils de la perfide Albion le virus de tous les vices de notre civilisation gangrenée. J’éveille en lui toutes les passions qui ruinent le cœur, l’esprit, la santé et la bourse. Je le fais joueur, ivrogne, libertin. Je le plonge au plus profond du cloaque infect de la débauche. Je le veux, d’ici un an, perdu d’honneur et de dettes, chauve, et sans un sou...
—Tais-toi, Hector, la passion te fait perdre le sens moral.
—Ce n’est rien encore. Il est ruiné, je viens à son secours; je lui prête de l’argent, tant qu’il en veut, plus qu’il n’en veut. Je nourris royalement ses vices. Je lui jette en pâture cent, deux cent, cinq cent mille francs, s’il le faut... C’est bien le diable si madame d’Ambleçay accepte un pareil gendre. J’admets pourtant qu’elle se résigne à immoler sa fille à ce sacripant, alors j’use de mes droits. J’ai pris mes précautions, l’Anglais m’a signé des lettres de change, je l’exécute, et je l’envoie pourrir à Clichy...
—Diable! dit Ferdinand, tu es un ingénieux scélérat. Mon procédé était brutal, le tien est plus doux, mais bien autrement abominable.
—Rassure-toi! cher ami; dès le lendemain de mon mariage avec mademoiselle d’Ambleçay, je lui assure une rente perpétuelle de vingt mille livres. Quant au reste, tant pis pour lui. De quoi s’avise-t-il, cet intrigant, de vouloir épouser la femme que j’aime?
Les deux amis venaient d’entrer à la gare.
Hector avait pris son billet et faisait enregistrer ses bagages. Ferdinand l’attira dans un coin.
—Écoute, dit-il mystérieusement, il est venu cet été à la Fresnaie un photographe...
—Ah ça! que me chantes-tu là?
—Patience donc. Il n’était pas fort habile, cet artiste, cependant je l’ai autorisé à faire le portrait de ma femme. Mademoiselle d’Ambleçay a profité de l’occasion pour avoir le sien. Il en était resté une épreuve à ma femme, je l’ai volée pour toi, la voici...
—Oh! donne, cher Ferdinand, donne vite, tu es le meilleur des amis..... Te faut-il tout mon sang?
—Merci pour aujourd’hui. Il est assez laid, ce portrait; mais tu sais, les blondes viennent mal. Allons, adieu! le train va partir, envoie-moi ton adresse, nous te tiendrons au courant...
Hector monta en wagon, bénissant au fond du cœur l’abbé, madame Aubanel, Ferdinand, la photographie et les photographes.
Il n’était pas seul dans son compartiment, ce qui le chagrina beaucoup. Mais il profita du sommeil des autres voyageurs pour sortir plus de cent fois de sa poche le portrait de mademoiselle Louise et lui dire les plus jolies choses.
A Paris, on attendait Hector.
Sa lettre à la famille Blandureau donnait trois mois de répit, ils furent bien employés. Tout était prêt à temps pour la venue de l’époux. La maison se tenait sous les armes, comme un régiment à la veille de l’inspection. Les domestiques faisaient envie à voir, sous leurs livrées neuves. Le mobilier du salon avait été renouvelé, depuis les bourrelets des fenêtres et des portes, jusqu’aux tableaux de «grands maîtres» que l’ancien négociant se plaît à acheter,—à des prix raisonnables, pour encourager les arts.
M. Blandureau avait des agitations fébriles, en pensant à l’arrivée de son gendre futur. Les préparatifs étaient terminés, pourquoi tardait-il? Et il comptait les jours. Madame Blandureau, aussi, paraissait tourmentée, plutôt par la curiosité, il est vrai, que par l’inquiétude.
Seule, mademoiselle Aurélie ne semblait en aucune façon troublée par l’approche du grand événement. Ses anxiétés, si elle en avait, ne se trahissaient guère. Elle attendait, avec l’impatience la plus paisible et la plus calme, comme il convient à une ancienne élève du Sacré-Cœur.
Tout le monde a connu, connaît ou connaîtra la famille Blandureau.
C’est l’épreuve très nette et très distincte, bien qu’après la lettre, d’un tableau réaliste: intérieur d’un négociant retiré avec une énorme fortune. Ce tableau sera vrai, à quelques détails près, tant que le commerce enrichira des commerçants, c’est-à-dire longtemps encore.
Les gens qui ont pratiqué M. Blandureau, commissionnaire pour les États-Unis,—une industrie qui a beaucoup perdu,—affirment qu’en affaires c’était un homme tout rond. Il l’est encore au physique. Son ventre majestueux semble appeler une écharpe; il a les jambes trop courtes, et ses bras ne sont pas assez longs. Sa tête petite, un peu dénudée, ne manque pas de finesse. Il a les yeux remuants qui disent bien son caractère, il ne saurait rester une heure en place.
M. Blandureau serait le meilleur des hommes, s’il pouvait oublier sa grande fortune. Il l’oublie quelquefois, alors il est charmant. Vous parlez, il vous écoute d’un air affable, ses réponses sont simples et bienveillantes.
Mais si tout à coup ses millions lui reviennent à l’esprit, bonsoir! l’homme poli disparaît; vous n’avez plus qu’un interlocuteur maussade, brusque, impertinent. Il tranche du gros traitant, coupe la conversation, et, d’un ton qui n’admet pas de discussion, affirme les plus grosses absurdités. C’est alors le plus détestable et le plus assommant des parvenus.
M. Blandureau s’ennuie, voilà son malheur. Il voulait une grande fortune, il l’a. Ses vœux sont comblés, son but est atteint, sa vie n’a plus de raison d’être. Il maudit, j’en suis convaincu, la vanité qui l’a fait se retirer du commerce. Tous les trente-un du mois, il a des crispations en songeant qu’il n’a pas d’échéance «à faire.» Pour lui les journées sont interminables, bien qu’il use pour tuer le temps de tous les expédients possibles: les journaux sont sa plus grande distraction, et il ferait peut-être de l’opposition, s’il était bien convaincu que ces affreux libéraux n’en veulent pas à ses propriétés.
Tous ceux qui l’entourent ont souvent à souffrir de ses brusques changements d’humeur. On lui pardonne, parce qu’on le sait très bon en réalité. On n’ignore pas que ce petit tyran est aussi, lui, lourdement opprimé. Il est en effet le plus esclave des despotes. Sa fille, l’impérieuse Aurélie, le domine et l’écrase de sa supériorité. De sa vie, il n’a su résister à cette enfant, objet d’un culte qui n’est pas exempt de crainte. Au souffle de ses inspirations, il obéit plus vite que la girouette aux quatre vents du ciel. Il a honte parfois de sa faiblesse, et il s’en venge sur sa femme.
Aussi madame Blandureau est-elle comme une ilote entre son mari qu’elle craint et vénère,—il a fait fortune,—et sa fille qu’elle admire et redoute pour son esprit et ses manières hautaines.
Un employé aux passeports tracerait bien le portrait de madame Blandureau: front moyen, yeux moyens, taille moyenne, tout en elle est moyen, sauf l’esprit. Sa plus grande jouissance intellectuelle est l’absorption d’un drame de M. d’Ennery, et elle a contribué, par sa présence, au succès si mérité du Pied de mouton.
Cette pauvre femme se réjouit d’être riche, et pourtant sa fortune est son plus grand malheur.
Elle a trente-six robes, toutes plus magnifiques les unes que les autres, mais elle est mal à l’aise dedans. Elle souhaiterait une mise simple, son mari exige d’elle des toilettes millionnaires. Elle aimerait à se promener à pied, son mari ne veut la laisser sortir qu’en voiture, avec un valet sur le siége, à côté du cocher. Enfin, dernier supplice, elle est obligée de commander à des domestiques dont la mine impertinente et la belle tenue l’intimident et lui imposent énormément.
Mademoiselle Blandureau ne tient en rien de sa mère. Souveraine absolue de la maison, elle règne sans contrôle; devant sa volonté, toutes les volontés plient. Les bourgeois vaniteux aiment à se donner des maîtres dans leurs enfants.
A voir mademoiselle Aurélie, on devine son caractère. Hautaine, capricieuse, elle n’est et ne peut être sensible qu’aux jouissances idiotes de la vanité. Elle traverse la vie en jouant les emplois de reine.
C’est une grande jeune fille à la démarche superbe, très brune, au regard dur. Ses yeux noirs ont le froid et l’éclair de l’acier. Jamais on n’y surprit une lueur de sensibilité, ni d’autres larmes que des larmes de colère. Sa voix sèche et brève est plus impérieuse encore que son regard.
Elle aime peut-être ses parents. Si elle traite sa mère assez mal, à peu près comme une première femme de chambre, elle sait bon gré à son père d’avoir amassé une grande fortune. Il est vrai qu’elle ne lui pardonne pas de s’appeler Blandureau.
Ce nom ridicule, trivial, commun,—pour parler comme elle,—a empoisonné sa jeunesse et fait encore son désespoir.
Son horreur pour ce nom date du couvent.
Placée dans une maison peuplée des filles de la vieille aristocratie, elle eut le tort immense de vouloir humilier des compagnes moins riches.
On se vengea. Ses jeunes amies lui prouvèrent qu’une demoiselle dont le père s’appelle Blandureau ne peut prétendre à rien, sinon à redorer le blason de quelque gentilhomme ruiné, et qu’il n’est en ce bas monde qu’un avantage social vraiment digne d’envie: avoir eu un aïeul aux croisades.
Les railleries de ses compagnes exaspérèrent Aurélie. Elle y répondit par un étalage tout à fait ridicule; les épigrammes redoublèrent, on lui avait donné un surnom, on ne l’appelait plus que Blandurette. Dire ce qu’elle souffrit est impossible.
Enfin comme, un jour de sortie, son père, sur ses ordres exprès, l’avait envoyée chercher dans un véritable carrosse de gala, ses ennemies, pendant la récréation, improvisèrent une longue complainte sur l’air de Cadet-Roussel.
Cette complainte commençait ainsi:
Les cinquante autres couplets n’étaient ni plus méchants ni plus spirituels, mais ils faillirent faire mourir de dépit mademoiselle Aurélie: elle eut une attaque de nerfs, et le lendemain sortit de son couvent pour n’y plus remettre les pieds.
Elle eut des maîtres à domicile.
Mais ce surnom de Blandurette est resté dans sa vie comme un souvenir amer. Elle n’a revu aucune de ses compagnes du couvent, et, si elle en rencontre quelqu’une, elle lui lance des regards furibonds.
Si mademoiselle Aurélie a songé parfois au mariage, c’est avec l’espérance de quitter ce nom fatal. Ce sera le plus beau jour de sa vie.
Hector n’était pas noble, il est vrai, mais portait un nom sonore, Malestrat. Elle espérait bien décider son mari à mettre devant une particule, à prendre un titre même, ce qui n’est pas très difficile, dit-on, avec de l’argent.
Toute la famille Blandureau habitait alors sa maison de campagne de Ville-d’Avray, bien qu’on fût au commencement de l’hiver. Il est de bon ton de rester se morfondre à la campagne jusque dans les premiers jours de janvier; les nobles familles du faubourg Saint-Germain ne dédaignent pas cette économie.
La maison de Ville-d’Avray est l’œuvre des ennuis de M. Blandureau.
Il y a consacré trois ans et près de cinq cent mille francs; il appelle cette habitation sa bonbonnière.
C’est en effet quelque chose dans le goût des pièces montées que les restaurateurs servent aux repas de noces et de corps. Tous les ordres d’architecture s’y mêlent et s’y confondent dans le plus abominable tohu-bohu. Il y a des tours et des ogives, des poivrières avec un péristyle italien; des pignons moyen âge avec des colonnes grecques et des tourelles flamboyantes, enfin une vérandah comme en ont les planteurs du Sud à leurs habitations.
Il y a à Paris trois ou quatre architectes qui ont gagné cent mille francs de rente à agrémenter de ces horribles choses la campagne parisienne, jadis si belle.
La Folie-Blandureau, c’est ainsi que les voisins l’appellent pour flatter l’ex-négociant, est bâtie moitié pierres et moitié briques de toutes les couleurs. Il y a des peintures à l’extérieur et des incrustations de marbre et de porcelaine. On dirait quelque chose de chinois, une pagode si vous le voulez, et le voyageur s’arrête involontairement pour voir sortir le magot.
Tout autour de l’habitation, il y a un grand parc bien boisé. M. Blandureau voulait jeter bas les arbres, et les remplacer par des vernis du Japon; mademoiselle Aurélie l’en a empêché. Son activité alors s’est rabattue sur le jardin, dont il a voulu faire un petit bois de Boulogne en miniature: il y a des rochers, une grotte et deux ponts, un étang et une rivière; il y a aussi une cascade. Un vieux cheval tire à la journée la rivière d’un puits: la cascade tarit quand le cheval prend ses repas.
C’est à Ville-d’Avray que tomba Hector, le lendemain de son départ de la Fresnaie, à quatre heures du soir. M. Blandureau, qui se rappelait l’avoir vu quand il n’avait que dix ans, le reconnut lorsqu’il se fut nommé.
Il le pressa sur son cœur, en l’appelant son fils, et poussa de grands cris pour attirer toute la maison, même il cassa une sonnette.
Madame Blandureau accourut au bruit et son mari lui présenta leur gendre.
—Mais où est donc Aurélie? demanda-t-il; au jardin sans doute?
On chercha mademoiselle Aurélie; on ne la trouva pas.
L’arrivée de son mari futur lui ayant été signalée, elle avait couru précipitamment à sa chambre.
Comme elle ne fit qu’un brin de toilette, au bout de moins de deux heures elle reparut. Elle s’avança majestueusement, annoncée de loin par les froufrous de sa robe de soie qui balayait les tapis à un demi-mètre derrière elle.
On eût dit la statue de la Dignité descendue de son socle.
—Arrive donc! lui cria M. Blandureau.
Et le bonhomme, prenant la main de sa fille, la mit dans celle d’Hector.
—Allons, embrassez-vous, mes enfants, dit le père.
Les deux enfants ne s’embrassèrent pas.
Mademoiselle Aurélie se recula en dessinant une révérence aussi froide que correcte.
Hector s’inclina profondément.
La jeune fille venait de décider que son mari ne serait jamais rien pour elle.
Hector se disait, tout en souriant gracieusement:
—Grand Dieu! que cette grande fille me déplaît! Je n’aurais pas d’avance décidé de rompre mon mariage, que certainement j’en prendrais la résolution aujourd’hui.
De ce moment Hector étudia le caractère de mademoiselle Aurélie, il espérait arriver très rapidement à lui déplaire et à se faire donner congé.
Le malheur est que M. Blandureau était enchanté de lui; il lui trouvait l’air bon enfant, et le négociant retiré adore les bons enfants.
Mais c’est précisément cet air que ne peut souffrir mademoiselle Aurélie. Hector a les façons d’un homme comme il faut, c’est-à-dire qu’il est simple. Mademoiselle Aurélie, dont le goût n’est pas fort exercé, confond cette simplicité avec les manières communes. La suprême distinction pour elle est le vêtement qui attire l’œil, la démarche emphatique, la figure solennelle, enfin cette confiance en soi qui donne aux niais les allures insupportables qu’ils traînent dans le monde.
Hector, au bout d’une heure, savait à fond le caractère de sa fiancée. Aussi à table eut-il l’humeur enjouée et l’entrain facile d’un commis-voyageur. Sans se soucier du pincement de lèvres de mademoiselle Aurélie, il appela M. Blandureau «papa beau-père,» et madame Blandureau «belle-maman.»
Tout le long du dîner, il parla de commerce, hérissant sa conversation de chiffres. Il est vrai qu’il ne sait rien du commerce: peu importe; il parla de spéculations, de hausse, de baisse, de frets, de navires en charge.
Il avait, dirait-il, une idée des plus heureuses, une entreprise considérable qu’il voulait commencer immédiatement après son mariage. Il s’agissait d’opérer une râfle des cuirs bruts sur les marchés du Mexique; il comptait alors amener une disette, faire la loi à la tannerie française, maintenir les prix, et réaliser ainsi des bénéfices considérables.
Mademoiselle Aurélie pâlissait à ces discours.
Ce fut bien autre chose, vraiment, au dessert. Hector s’attendrit, parla de l’avenir, et dit tout haut ses rêves. Il espérait, une fois marié, trouver enfin le bonheur et la tranquillité; sa femme serait son caissier; elle tiendrait les livres et s’occuperait de la correspondance.
—Songez, mademoiselle, dit-il, s’adressant alors directement à Aurélie, aux magnifiques affaires que nous pouvons entreprendre et aux bénéfices immenses que nous réaliserons, car enfin notre maison n’aura presque plus de frais.
La jeune fille ne répondit pas. En elle-même elle se promettait de déconcerter fort les plans de son futur mari.
Hector outra un peu son rôle, ce ne fut pas un malheur. A la fin, il avait réussi presque à déplaire à M. Blandureau.
Cependant, comme il se faisait tard, le négociant ne voulait pas laisser Hector regagner Paris. Il lui offrit une chambre, mais, sur un signe de sa fille, il cessa vite d’insister.
—Vous avez peut-être raison de refuser, dit-il au jeune homme, notre maison dans cette saison est presque inhabitable.
M. Blandureau est bien honnête, sa maison est inhabitable en toute saison.
Le dernier mot d’Hector en se retirant fut dit à l’oreille de M. Blandureau.
—Eh bien! lui demanda-t-il, à quand la noce?
—Oh! répondit celui-ci, nous en recauserons, nous avons le temps, rien ne presse.
Hector s’en alla tout joyeux.—De ce côté-ci, se disait-il, mon affaire est faite. A l’Anglais, maintenant, sus à l’Anglais!
Le lendemain, à neuf heures du matin, Hector en habit noir, malgré l’heure, entrait à l’hôtel des Etrangers.
—Sir James Wellesley? demanda-t-il à un valet.
—Je vais avoir l’honneur de conduire monsieur, répondit le domestique.
Hector fut introduit dans un petit salon où on le pria d’attendre.
C’était au quatrième, une toute petite pièce, garnie de ces meubles particuliers aux hôtels, qu’on fabrique sans doute exprès pour eux, car on n’en trouve nulle part ailleurs de semblables.
Au milieu, sur une grande table, était déployé un plan de Paris hérissé d’épingles.
Sur la cheminée, on apercevait tous les livres publiés sur Paris à l’intention de nos voisins d’outre-Manche: le Promeneur à Paris, le Guide des Musées, l’Art de connaître Paris en trois jours, the Traveller’s illustrated Guide in Paris et the Murray’s Guide. Il y avait aussi toutes sortes de manuels de conversation et deux ou trois dictionnaires pocket.
Hector n’attendit guère plus de cinq minutes. La porte s’ouvrit et sir James parut.
C’est un homme d’une trentaine d’années environ, le type le plus frappant de l’Anglais classique. Il n’a pas les cheveux très blonds, mais sa barbe est du plus beau rouge. Il a le teint clair et frais comme celui d’un lycéen. Ses yeux d’un beau bleu de faïence n’ont pas la moindre expression; il est grand et raide, paraît gêné aux articulations et est mis à la dernière mode de Regent’s street, qui tire expressément ses modes de la rue Vivienne. Sir James est le cant fait homme; jamais baronnet plus digne, plus froid, plus poli, plus réservé, plus pudibond n’a promené en France la fierté britannique. Une seule fois dans sa vie il n’a pas été parfaitement convenable et même a été tout à fait improper, c’est en venant de Douvres à Calais sur le steam-boat: il ne fut pas le maître des impressions de son estomac et, for shame! une vieille lady, placée près de lui, s’écria: Shocking!
Sir James parle à peine français; aussi remuait-il la langue dans sa bouche, cherchant un mot, lorsque Hector prit la parole:
—C’est à M. Wellesley que j’ai l’honneur de parler? demanda-t-il.
—Oui, répondit le baronnet.
Hector sortit alors de sa poche la missive de l’abbé, et la remettant à son rival:
—Voici, monsieur, une lettre, que je suis chargé de vous remettre.
—Vous permettez, monsieur? demanda sir James en brisant le cachet.
L’abbé avait eu soin d’écrire en anglais. Aussi M. Wellesley parcourut la lettre en quelques secondes.
Le vieux prêtre y parlait sans doute avantageusement d’Hector, car les manières de sir James changèrent subitement du tout au tout. Autant il avait été froid, autant il devint poli et même affectueux. Il invita son visiteur à s’asseoir, ce qu’il n’avait pas fait pour un homme qui ne lui avait pas été présenté.
Après une heure de conversation assez laborieuse vu la difficulté de la mimique, les deux jeunes gens étaient au mieux ensemble.
Sir James raconta à son nouvel ami qu’il était en route pour aller se marier en Touraine. S’il s’était arrêté à Paris, c’est qu’il désirait se perfectionner dans la langue française et parler intelligiblement avant de se présenter devant celle qu’il devait épouser.
Hector pensa que son séjour dans la capitale durerait longtemps.
L’Anglais alors confessa l’ennui profond qu’il éprouvait à Paris; il n’y connaissait personne et vivait seul. Il lui semblait toujours que les gens auxquels il adressait la parole se moquaient de lui. S’il entrait dans un magasin, les marchands le volaient; au théâtre il ne comprenait absolument rien; même au ballet de l’Opéra il trouvait les pirouettes de mademoiselle Emma Livry trop écrites en français. Bref, il était tout à fait désolé, very disappointed, comme il le dit avec un soupir.
Mais la figure du baronnet s’éclaira quand Hector lui eut dit qu’il comptait rester quelques semaines à Paris et qu’il se mettait à sa disposition, soit pour le promener, soit pour le présenter dans quelques familles où il était admis.
Sir James, d’un ton attendri, jura une éternelle amitié à celui qu’il appelait son sauveur.
—Oui, nous serons amis, se disait Hector; ta naïveté rend mon plan plus facile, et je ne te quitterai que lorsque tu seras devenu le plus impossible des époux.
Alors, pour resserrer cette amitié d’une heure, le fiancé d’Aurélie proposa à l’Anglais de le présenter le soir même à M. Blandureau.
Hector, qui connaissait la susceptibilité aristocratique d’un baronnet tory, se garda bien de lui dire que ce Blandureau était un négociant retiré.
Le commerce, à ce qu’on assure, n’est pas fait précisément pour développer les qualités du cœur et de l’esprit. C’est au commerce cependant que M. Blandureau doit une vertu rare et précieuse, qui domine son caractère et lui donne une certaine originalité, par le temps qui court.
Cet homme vaniteux est fanatique de ce qu’il appelle «la probité commerciale.»
Ce fanatisme date de ses débuts dans les affaires, lorsqu’il signait beaucoup de billets qu’il payait avec exactitude à l’échéance.
Il pouvait, sans être agité de vains scrupules, s’en tenir là. Le code particulier de l’industrie a des marges assez larges pour que chacun y soit à l’aise.
On achète, on règle, on paie, et on est considéré. Le surplus ne regarde personne.
Mais M. Blandureau ne voulut pas rester un négociant vulgaire. Sa signature avait cours comme un billet de banque, il résolut de donner à sa parole la valeur de sa signature. Dès lors, il s’astreignit à tenir ses promesses verbales non moins scrupuleusement que ses promesses signées. Il traitait hautement de coquins ceux qui ne se croient pas engagés tant qu’il n’y a rien d’écrit.
Lorsqu’on traitait une affaire avec lui, s’il disait: «C’est convenu,» on pouvait dormir tranquille, aussi tranquille qu’après un contrat rédigé par deux notaires.
A plusieurs reprises il s’engagea ainsi dans des opérations désavantageuses, sans être autrement lié que par une promesse verbale; il pouvait se retirer, il ne le voulut pas, et subit les pertes sans se plaindre. S’il avait été pauvre, gêné, peut-être l’aurait-on trouvé un peu simple; il était riche, on l’admira.
En ces sortes d’occasions, il mettait à s’exécuter un certain héroïsme, jamais il n’eût accepté la remise d’un centime. Aussi, sur les places de New-York, de Londres et de Paris, on disait:
—Parole de Blandureau vaut de l’or.
Ce proverbe commercial caressa délicieusement l’amour-propre du négociant et exalta son orgueil. C’était son bonheur, sa gloire. On voit sur les panneaux de superbes carrosses, autour de vieilles armoiries, des devises qui ne valent pas celle-là.
—La Banque, disait souvent M. Blandureau en se rengorgeant, la Banque de France, qui exige trois signatures sur les effets qu’elle escompte, n’hésiterait pas à faire des avances sur ma simple parole.
C’était peut-être aller un peu loin. Mais il faut respecter des défauts qui produisent de telles qualités. Tant de gens n’auront jamais les qualités de leurs défauts!
Vanité oblige. M. Blandureau le comprit, et, sur la fin de sa carrière commerciale, il aurait sans balancé sacrifié sa fortune et suspendu ses paiements un jour d’échéance, plutôt que de «laisser sa parole en souffrance,» suivant sa pittoresque expression.
Aujourd’hui qu’il est retiré des affaires, il applique ses principes à la vie privée; ils sont la règle de sa conduite, le guide de ses actions les plus indifférentes, enfin sa probité commerciale a dégénéré en monomanie.
Ne vous avisez pas de manquer à un rendez-vous que vous lui aurez donné, vous baisseriez singulièrement dans son estime, il vous accuserait de n’avoir ni honneur ni délicatesse.
En revanche, vous pouvez compter absolument sur lui lorsque, pour la moindre chose, à propos de quoi que ce soit, il vous aura donné cette fameuse parole qui a cours à la Banque.
Vous l’avez invité à dîner, il vous a promis de venir, soyez certain qu’il viendra. Il viendra, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il tonne; il viendra malade, il serait venu mourant. Et il fera honneur à votre dîner, et il mangera, il boira, il sera bon convive, dût-il dans la nuit périr d’indigestion.
Aussi est-il extrêmement difficile de lui arracher une promesse formelle. Il hésite toujours, ne dit ni oui, ni non. Il redoute de s’engager, ne sachant jamais où cela peut le conduire.
Avec un tel caractère, M. Blandureau ne devait point songer à rompre un mariage arrêté jadis entre lui et M. Malestrat le père; il n’en eut pas même l’idée. Hector avait eu le bonheur de lui déplaire, mais il lui aurait déplu mille fois davantage que rien n’eût été changé à des conventions qu’il considérait comme sacrées.
Hector s’était cruellement trompé lorsqu’il avait cru ses affaires en bon chemin de ce côté. Si le premier soir M. Blandureau avait répondu évasivement lorsque son gendre futur lui avait demandé:—«A quand la noce?» c’est qu’il n’avait pas eu le loisir de la réflexion. Il avait éprouvé une déception cruelle et n’avait pas été maître de son dépit et de sa mauvaise humeur. Il avait obéi à ce premier mouvement dont il faut toujours se défier.
Hector n’était pas loin, que déjà l’ancien négociant se reprochait avec amertume une réponse qui pouvait éveiller certains doutes dans l’esprit du jeune homme, et lui donner à penser qu’on voulait temporiser pour l’éconduire ensuite poliment sous n’importe quel prétexte.
Bien certainement, s’il n’avait pas été si tard, M. Blandureau aurait couru après son gendre; mais il ne connaissait même pas son adresse à Paris. Il regagna son appartement, en se promettant bien de lui faire des excuses le lendemain.
—Ce mariage ne me plaît pas beaucoup, se disait-il, donc je dois me hâter de le conclure, mon honneur y est intéressé.
C’est à peu près ce qu’il répondit à sa fille, lorsque mademoiselle Aurélie lui avoua très catégoriquement que jamais elle n’aimerait le mari qu’on lui avait choisi.
—Je n’y puis rien, ma pauvre enfant, lui dit-il; nous nous sommes engagés dans une spéculation malheureuse, il faut en subir les conséquences. C’est surtout quand les suites doivent en être désastreuses qu’on a du mérite à ne pas faillir à ses promesses; nous ne faillirons pas à la nôtre; parole de Blandureau vaut de l’or.
Et comme la jeune fille faisait une moue assez significative:
—Écoute, continua l’ancien négociant, il ne faut pas trop s’affliger. Qu’ai-je promis à M. Malestrat? de lui accorder ta main. Donc tu l’épouseras. Mais je ne lui ai pas garanti que tu l’aimerais, fort heureusement. Ainsi, lorsque tu seras mariée, si tu ne reviens pas sur son compte, eh bien! tu plaideras en séparation, ou même vous vous quitterez à l’amiable, s’il veut y consentir.
Cette façon assez neuve d’envisager un mariage fit sourire mademoiselle Aurélie, et elle n’insista pas davantage. Elle savait que tout ce qu’elle pourrait dire à son père serait parfaitement inutile, elle était à l’avance résignée à épouser Hector. Au fond, elle en éprouvait un assez médiocre chagrin, personne, jusqu’ici, n’ayant réussi à toucher son cœur.—«Autant celui-là qu’un autre,» pensait-elle. Et déjà elle arrêtait dans son esprit un plan fort habile, qui, dès le lendemain du mariage, devait lui assurer à tout jamais une incontestable suprématie dans le ménage.
On ne demanda pas l’opinion de madame Blandureau, parce qu’ordinairement cette excellente dame n’a jamais d’opinion. Elle en avait une, pourtant, en cette circonstance: elle avait trouvé son gendre le plus aimable et le plus séduisant des fiancés.—«Excellent jeune homme, pensait-elle, tu n’auras pas, Dieu merci! le temps d’étudier le caractère de ma fille; tu l’épouseras dans la quinzaine, et ainsi tu auras assuré la tranquillité de mes vieux jours. Sois béni mille fois!»
Telle était la situation morale de la famille Blandureau, lorsque, le lendemain de son arrivée, Hector s’avisa de présenter à Ville-d’Avray son nouvel ami M. James Wellesley.
C’étaient les débuts du jeune baronnet dans cette société française qui, aujourd’hui encore, passe, à Londres comme dans presque toutes les capitales de l’Europe, pour la plus spirituelle, la plus moqueuse, la plus impitoyable qu’il soit au monde. Ce qui prouve bien que renommée vaut mieux que ceinture dorée, et qu’on peut vivre très longtemps sur une réputation bien établie.
Sir James avait passé une partie de la journée à se préparer à cette présentation solennelle et décisive. Comme avant tout et surtout il redoute le ridicule, il avait exagéré tous ses ridicules. Il était plus froid, plus grave, plus empesé que jamais; si raide, qu’il pouvait à peine faire un mouvement. Il marchait tout d’une pièce, et, s’il s’inclinait, son corps formait un angle droit et aigu comme un couteau qu’on referme.
Sa physionomie exprimait bien ce dédain profond du monde entier, qui est une des prérogatives du citoyen de la Grande-Bretagne. Enfin, quoique fort troublé au fond de comparaître au tribunal des dames françaises, il avait cette imperturbable assurance, cette confiance en soi, d’un homme sachant sa valeur, et sûr que si on s’avisait d’arracher un cheveu de sa tête, lord Palmerston n’hésiterait pas à armer une centaine de vaisseaux et à dépenser un million de livres pour obtenir réparation et faire restituer le cheveu.
Lorsqu’il avait offert ses services au jeune Anglais, pour l’introduire dans le monde parisien, Hector n’avait eu qu’un but: poser les premiers jalons d’une amitié qui, dans sa pensée, devait être funeste à un rival détesté. Certes, il ne le croyait pas appelé au moindre succès.
Combien il se trompait!
M. Wellesley apparut à la famille Blandureau fascinée, comme l’incarnation vivante et admirable des grandes traditions de la noblesse. Madame Blandureau avouait, plus tard, que, ce jour-là, elle avait cru voir un empereur, pour le moins, entrer dans son salon.
Hector se trouva du coup relégué au second plan; mieux encore, il fut éclipsé, si bien qu’on ne sembla plus s’apercevoir de sa présence. Le gendre était oublié pour le nouveau venu.
De sa vie, le vaniteux négociant n’avait fait si gracieusement, avec tant d’affabilité, les honneurs de sa maison.
Pour son nouvel hôte, il eut des attentions délicates, presque respectueuses. Mais en apprenant que sir James doit hériter de la pairie, d’un de ses oncles qui siége à la Chambre des Lords, il devint tout à fait obséquieux.
De ce moment, il n’appela plus M. Wellesley que mylord. Il mettait à prononcer ce titre si magnifique une naïve et orgueilleuse emphase: il en avait, comme on dit, plein la bouche.
C’était à ne plus reconnaître le monsieur Blandureau qui fait si volontiers profession d’opinions aussi libérales qu’égalitaires. Lui qui, chaque fois que l’occasion s’en présente, dit nettement son opinion sur les prêtres et les nobles, il ne se sentait pas d’aise d’avoir à sa table un représentant authentique de cette aristocratie anglaise, la plus fière et la plus susceptible de la terre.
S’il se souvint d’Hector, ce fut pour le féliciter de ses belles relations, et le remercier d’avoir songé à lui présenter ce noble étranger.
Mademoiselle Aurélie était, s’il est possible, plus ravie que son père, et elle ne sut pas mieux que lui dissimuler ses impressions.
Sous le regard de M. Wellesley, ce regard qui n’exprimait absolument rien, que la satisfaction de soi, elle rougit comme une pensionnaire. Pour la première fois de sa vie elle fut embarrassée et douta d’elle-même. Enfin, chose étrange, elle crut sentir quelque chose comme un léger battement de cœur.
Mais aussi, pouvait-on rêver un gentilhomme plus convenablement guindé, plus parfaitement froid, plus noblement digne? N’était-il pas vraiment l’idéal de l’étiquette et de la solennité officielles?
Toute jeune fille, qu’elle se l’avoue ou non, caresse au fond de son cœur un héros invraisemblable qu’elle ne rencontre jamais dans la vie réelle; plus heureuse, mademoiselle Blandureau venait de trouver son héros.
Une subite métamorphose s’opéra en elle.
La hardiesse de son regard s’éteignit, sa voix devint moins impérieuse, son geste, son maintien se firent modestes.
Elle parut oublier son rôle superbe de reine, et redevint une jeune fille.
Enfin, elle eut pour sa mère des attentions et des prévenances qui stupéfièrent celle-ci. Madame Blandureau ne comprenait rien à ce changement, et son regard étonné semblait interroger toutes les personnes présentes, et leur demander la cause de tant d’affabilité.
La superbe Aurélie venait de trouver son maître.
Sir James, de son côté, ne fut pas long à comprendre qu’il était sympathique à tous. Il est de ces nuances imperceptibles que ne peut imiter la politesse la plus raffinée, et qui donnent bien vite à l’homme du monde la mesure de l’accueil qu’on lui fait.
Le baronnet se sentit plus à l’aise; sa timidité se rassura. Venu chez des étrangers, il se trouvait après moins d’une heure dans une maison amie. Il oublia donc un peu sa morgue, dénoua le masque de sa froideur et cessa de se tenir sur le qui-vive d’une prudence soupçonneuse.
En accompagnant Hector, M. Wellesley s’était bien juré de ne pas ouvrir la bouche. Il ne s’abusait pas sur sa facilité à parler notre langue, et ne voulait pas prêter à rire.
Certain qu’on ne se moquerait pas de lui, il osa parler et parla beaucoup. On ne le comprenait guère, à dire vrai, mais l’attention qu’on lui prêtait n’en était que plus grande.
Cette première soirée acheva de perdre Hector dans l’esprit de mademoiselle Aurélie.
Tout en prêtant une oreille distraite aux discours de M. Wellesley qui expliquait à M. Blandureau la différence qui existe entre un whig et un tory, différence que le négociant n’a jamais bien comprise, elle comparait involontairement les deux jeunes gens, et certes la comparaison n’était pas à l’avantage d’Hector.
Comme il lui semblait commun et trivial!
Il était gai, spirituel et railleur, il avait en parlant le geste animé des hommes du Midi; il riait, et, chose plus grave, les autres riaient en l’écoutant.
Quelle différence entre ces deux hommes, entre l’air plein de bonhomie de l’un et la physionomie glacée de l’autre, entre le regard clair et un peu moqueur d’Hector et le regard terne de sir James!
Comme on reconnaissait bien, à première vue, le neveu du pair d’Angleterre et le fils du marchand de Bordeaux! Car enfin, M. Malestrat était un marchand.
Mademoiselle Aurélie était devenue profondément triste, en faisant toutes ces réflexions.
—Et cependant, se disait-elle, cet homme que je hais, il me faudra l’épouser!...
A cette idée, elle était bien près de pleurer, et, pour la première fois encore, elle accusa d’imprudence son père, qui lui avait choisi un mari sans la consulter. Jamais elle n’avait été si véritablement malheureuse.
Sir James ne paraissait pas s’apercevoir que les heures s’écoulaient, et c’est à minuit seulement qu’il parla de se retirer.
Tout en reconduisant ses hôtes jusque dans la cour, M. Blandureau faisait jurer à «mylord» Wellesley de revenir souvent, le plus souvent possible.
—Je vous le promets, répondit le baronnet.
Et lorsqu’il se trouva seul avec Hector:
—Je ne saurais exprimer, lui dit-il, l’impression profonde que je garde de cette jeune fille; je la trouve, en vérité, tout à fait charmante et adorable.
Hector ouvrait la bouche pour répondre:
—Mademoiselle Aurélie est ma fiancée.
Un secret pressentiment l’arrêta.
Le jour où Hector avait imaginé l’abominable plan qui devait conduire à l’abîme l’homme heureux désigné par le baron d’Ambleçay, il n’avait pas compté avec sa conscience. Il n’avait écouté que le désespoir, conseiller des résolutions insensées.
Avec le sang-froid et la réflexion, le sentiment de l’honneur lui revint, et il comprit tout l’odieux de son projet. Il eut horreur d’avoir pu s’y arrêter seulement une minute, et il y renonça. Pourtant, à moins d’un miracle, il n’entrevoyait pas de salut possible. Que pouvait-il faire? Attendre. Il attendit avec les mortelles angoisses du malheureux qui sait une inévitable condamnation suspendue sur sa tête.
S’il retournait encore chez M. Blandureau, c’est qu’il hésitait à rompre le premier; il avait d’ailleurs la conviction qu’un jour ou l’autre on lui signifierait très poliment congé. Il n’avait certes pas l’empressement d’un jeune homme admis officiellement à faire sa cour, à peine paraissait-il une fois ou deux par semaine.
Mais il pouvait rester à Paris. La maison de Ville-d’Avray avait conquis un hôte assidu, un hôte qui remplissait avec une merveilleuse exactitude les devoirs négligés par Hector.
Sir James est un homme qui, lui aussi, sait tenir une parole donnée. Il avait promis à M. Blandureau de revenir quelquefois, il revint tous les jours.
Oui, tous les jours, ce baronnet, aussi audacieux qu’exemplaire, affrontait trois et quatre heures de conversation avec l’ancien négociant, ravi de se voir écouté si attentivement par un homme dont l’oncle siége à la Chambre haute. C’était l’auditeur le plus bienveillant et le plus résigné qu’il eût jamais rencontré.
Il est vrai que le plus souvent le lord futur répondait de façon à prouver péremptoirement qu’il n’avait rien entendu ou rien compris, mais M. Blandureau ne s’arrêtait pas pour si peu. Il attribuait l’incohérence de son interlocuteur à la difficulté qu’il devait éprouver à s’exprimer en français, et n’en continuait que de plus belle.
Le fait est que, tout en paraissant prêter une oreille patiente aux discours du père, le baronnet n’avait d’yeux et d’attention que pour la fille.
Frappé au cœur, le premier soir, sir James, le lendemain, adorait mademoiselle Aurélie. Au bout de huit jours il était amoureux fou, amoureux au point de perdre le boire et le manger, mais non pas assez fou, malheureusement, pour perdre la mémoire.
L’infortuné souffrait tous les tourments qu’avait endurés Hector, lorsque, près de mademoiselle d’Ambleçay, il oubliait la fille de M. Blandureau.
Il était cependant bien plus excusable. Frappé comme par la foudre, il n’avait pas eu une minute pour la réflexion. Il ne s’appartenait plus, déjà, lorsque le souvenir de Louise lui revint. Et cependant, la voix impitoyable de sa conscience lui criait:
—Gentilhomme indigne, tu forfais à l’honneur!
Mais qu’est le devoir, lorsque la passion commande! et déjà sir James en était arrivé à s’avouer que, pour lui, s’éloigner d’Aurélie, ce serait mourir.
Il avait bien d’autres tortures encore.
Il était pauvre, et il savait le père de mademoiselle Blandureau prodigieusement riche. Cette fortune était un insurmontable obstacle aux yeux du gentilhomme anglais. Lui qui avait à peine de quoi vivre, il professait pour l’argent un souverain mépris. Mais qui voudrait croire à son désintéressement?
Une héritière, en notre siècle, peut-elle croire au désintéressement d’un homme pauvre?
S’il demandait a M. Blandureau la main de sa fille, celui-ci n’y verrait-il pas la démarche d’un gentleman ruiné qui spécule sur son nom pour faire des réparations au manoir paternel?
Mais ces tristes réflexions s’envolaient à un seul regard de mademoiselle Aurélie, et plus d’une fois les yeux de la jeune fille rencontrèrent ceux du baronnet.
Sir James est un homme timide en dépit de ses manières hautaines. Il est modeste aussi; bien longtemps il refusa de croire à des apparences trop flatteuses. Il avait bien remarqué que la jeune fille ne fuyait pas sa présence. Arrivait-il, si elle n’était pas au salon, elle ne tardait pas à y descendre. Plus d’une fois, en s’éloignant, il avait cru l’apercevoir soulevant un coin d’un des rideaux de mousseline de la fenêtre, et l’accompagnant du regard jusqu’à sa voiture.
Il attribuait tout cela au hasard; il n’y voulait voir que des actions indifférentes, jusqu’à ce qu’un jour enfin ce hasard qu’il gratifiait si bénévolement de ses succès lui fournit l’occasion de se trouver seul avec mademoiselle Aurélie.
Oh! ce ne fut qu’un instant, cinq minutes à peine, mais on dit bien des choses en cinq minutes, surtout quand on ne parle pas, car ils ne se parlèrent pas. Ils restèrent debout, l’un devant l’autre, émus, tremblants, les yeux dans les yeux.
Ma foi! sir James ne se posséda plus, le magnétisme de l’amour bouleversa toutes ses idées innées du respect des convenances; il se rendit coupable d’une hardiesse qu’il ne s’explique pas encore aujourd’hui, il osa prendre la main de mademoiselle Aurélie et la porter respectueusement à ses lèvres.
Mademoiselle Aurélie ne retira pas sa main; même il crut sentir une légère pression de ses doigts, muette réponse à sa muette déclaration.
Sans doute sir James allait enfin bégayer quelques phrases, lorsque M. Blandureau entra. Le négociant ne remarqua ni la rougeur de sa fille, ni l’air embarrassé du baronnet. Il tenait un journal à la main et venait demander à «mylord» des explications sur la conduite du cabinet anglais dans l’affaire du San Jacinto.
Sir James réussit, après des efforts incroyables, à maîtriser son émotion. Que n’eût-il pas donné pour éloigner Blandureau? Il était aimé, c’était désormais une certitude pour lui; il eût voulu pouvoir savourer son bonheur; mais non, il lui fallait répondre aux questions de l’ancien négociant, qui lui répétait toujours:
—Que pensez-vous de l’enlèvement des commissaires du Sud?
L’infortuné baronnet ne pensait rien du tout, sinon que mademoiselle Aurélie est la plus belle des femmes. Il se rejeta dans les généralités et ne mit pas moins d’un bon quart d’heure à amplifier cet axiome de la politique britannique: «Les principes de morale sont éternels, mais le coton est indispensable.»
Cette journée, si heureusement commencée pour sir James, devait finir bien tristement, hélas!
Le matin, il avait reçu l’aveu tacite de l’amour de mademoiselle Blandureau; le soir même il apprit qu’elle était la fiancée d’Hector et qu’avant un mois elle serait sa femme.
C’est l’ancien négociant lui-même qui lui révéla cette funeste nouvelle. M. Wellesley pâlit et chancela sous le coup.
—Est-ce possible? balbutia-t-il, est-ce possible?
Son trouble était trop visible cette fois. M. Blandureau fut obligé de s’en apercevoir.
—Qu’avez-vous, mylord? demanda-t-il.
—Oh! fit le baronnet, je souffre, je souffre beaucoup!
Et, prenant congé, il se retira sans s’apercevoir que mademoiselle Aurélie partageait visiblement son émotion.
Sir James rentra chez lui dans un état impossible à décrire. L’homme froid n’existait plus. Il parlait haut dans sa chambre, il gesticulait.
—Je suis maudit décidément, disait-il, et tout à fait perdu désormais. J’ai violé ma parole de gentleman, j’ai oublié mademoiselle d’Ambleçay, j’ai trompé ma fiancée, et voici que maintenant j’enlève le cœur de la fiancée du seul ami que j’aie en France. Je serai un traître à ses yeux, un homme tout à fait vil et méprisable.
Il eut d’abord l’idée d’écrire à Hector; il voulait confesser sa faute involontaire; mais il réfléchit et déchira la lettre.
Puis, une inspiration soudaine illuminant son visage:
—Oui, dit-il, je n’ai que cela à faire; ma résolution est prise.
Et le lendemain il retourna chez M. Blandureau, comme si rien ne s’était passé.
Son existence était affreuse. En présence de mademoiselle Aurélie, il était au septième ciel; se retrouvait-il seul, il tombait sans transition au plus profond de l’enfer.
Cependant M. Blandureau commençait à s’apercevoir de ce qui se passait. Il n’en était pas positivement sûr, mais il avait ce que la justice appelle de sérieuses présomptions.
Il était aussi mécontent que possible. Il s’était fait jusqu’à présent honneur à lui-même des visites quotidiennes de sir James. En découvrant qu’il pouvait bien venir aussi pour sa fille, son amour-propre fut blessé au vif.
Ce n’est pas qu’un mariage avec le neveu d’un pair d’Angleterre ne l’eût flatté infiniment; il eût donné pour réaliser ce beau rêve la moitié de sa fortune. Mais il s’était engagé avec Hector; il ne songea donc qu’à presser l’union décidée et à prévenir son futur gendre de ses soupçons.
Hector, lui aussi, avait des soupçons.
Un jour qu’il était venu chez M. Blandureau où il se faisait de plus en plus rare, il avait aperçu sur une table une grammaire anglaise et un pocket-dictionary.
Ce fut comme un trait de lumière, et c’est le cœur gonflé de joie et d’espérance qu’il ouvrit ces deux volumes. Les pages en étaient coupées, et quelques signes au crayon le long des marges attestaient qu’on s’en était servi.
—Oh! pensa Hector, mademoiselle Aurélie est trop sensée pour vouloir apprendre l’anglais sans maître. Mon ami James, j’imagine, sera le professeur. Puisse-t-elle bientôt parler comme une demoiselle du Lancashire!
Et il s’éloigna plus joyeux qu’il ne l’avait été depuis longtemps.
—Ne troublons pas ces jeunes gens, se disait-il; si M. Blandureau veut me voir, il viendra me chercher.
M. Blandureau, en effet, après avoir inutilement attendu son gendre, alla le surprendre un matin.
L’ancien négociant paraissait fort ému.
—Vous aimez ma fille? lui demanda-t-il tout d’abord.
—Certes, répondit Hector, comme une sœur.
—Eh bien, continua M. Blandureau, je dois vous révéler un fait très grave. Votre ami mylord Wellesley aime Aurélie.
Hector eut toutes les peines du monde à comprimer sa joie.
—Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites? demanda-t-il.
—A peu près. Je crois donc qu’il serait bon de presser l’affaire, et de vous marier le plus tôt possible.
—C’est bien, dit Hector, je vous remercie; j’aviserai.
Et comme M. Blandureau en revenait sans cesse à son idée, il lui joua la scène de M. Dimanche. M. Blandureau quitta son gendre, assez surpris de son peu d’empressement.
Une surprise plus grande l’attendait chez lui. Sa fille l’avait fait demander.
Mademoiselle Aurélie aimait véritablement sir James, et elle était bien résolue à rompre à tout prix avec Hector.
Elle trouvait à cette rupture des avantages sans nombre. D’abord elle devenait la femme d’un homme titré; on l’appelait mylady. Comme elle avait assez de fortune pour deux, elle s’inquiétait peu de la fortune. Elle irait habiter l’Angleterre, où nul ne songerait à lui reprocher son origine plébéienne. Enfin la meilleure raison, elle aimait sir James.
Aussi est-ce du ton le plus résolu qu’elle déclara à son père que jamais elle n’épouserait Hector.
On se ferait difficilement idée de la colère et de l’étonnement de l’ancien négociant à l’annonce de cette résolution d’Aurélie.
—Songes-tu bien à ce que tu dis? balbutia-t-il, toi, ma fille, lorsque tu sais que j’ai donné ma parole!
—Vous la reprendrez, mon père.
—Jamais, s’écria le négociant, jamais! Parole de Blandureau vaut de l’or.
—Soit, répondit mademoiselle Aurélie; mais, moi, je n’ai rien promis et je n’ai rien à tenir.
—Mais, malheureuse enfant, la présence seule de ce jeune homme ici impliquait une acceptation de ta part. Je suis le créateur du billet, mais tu es l’endosseur. D’ailleurs, songe au désespoir d’Hector; veux-tu briser sa vie?
—Croyez-vous qu’il m’aime, mon père?
—S’il t’aime! ah! si tu savais de quel ton il me disait, il n’y a pas plus d’une heure: «Mademoiselle Aurélie, je l’aime comme une sœur.»
La jeune fille ne put retenir un éclat de rire.
—Vous trouvez que cela suffit? demanda-t-elle.
—Je t’affirme, répondit M. Blandureau, je t’affirme que moi je n’aimais pas du tout ta mère lorsque nous nous sommes mariés. Dieu sait cependant si nous avons été heureux!
—Eh bien, moi, reprit mademoiselle Aurélie, à aucun prix, mon père, je ne veux de ce bonheur. Je ne suis pas des jeunes filles que l’on contraint, ajouta-t-elle d’un ton de défi.
—Et moi, s’écria M. Blandureau furieux, je jure que la terre cessera de tourner et le soleil d’éclairer la terre avant qu’on me voie reprendre ma parole.
Et il sortit en tirant violemment la porte.
Mademoiselle Aurélie n’était pas d’un caractère à s’effrayer pour si peu. Elle ne renonça nullement à ses espérances.
Une heure plus tard, Hector recevait d’elle un petit billet où, invoquant sa délicatesse de galant homme, elle le conjurait de se retirer. D’ailleurs, elle ne lui donnait aucun détail.
Mais Hector ne pouvait ainsi se rendre à la légère aux désirs de mademoiselle Aurélie. Il voulut la voir auparavant, lui parler.
Et comme le temps pressait, il sauta dans une voiture et se fit conduire à Ville-d’Avray.
Il y avait quinze jours à peu près qu’Hector n’avait vu mademoiselle Blandureau; il la reconnut à peine, tant l’avait transfigurée l’amour vrai qu’elle éprouvait. C’était encore la statue, mais la statue animée par l’étincelle.
C’est avec une rougeur modeste qu’elle lui conta fort simplement son roman.
Si elle avait écrit à Hector, c’est qu’elle était sûre de l’amour de M. Wellesley.
Hector fut vraiment touché de l’expression d’angoisse qui se peignit sur les traits de la jeune fille, lorsqu’en terminant elle lui renouvela sa prière.
—Je vais vous obéir, mademoiselle, lui dit-il, avec l’espoir qu’à défaut de l’amour que je n’ai su mériter, cette déférence me vaudra votre amitié.
En toute autre circonstance, Hector aurait été singulièrement troublé d’avoir à affronter la colère de M. Blandureau; mais il était si joyeux que c’est à peine s’il y songea.
L’ancien négociant, pour tout dire, le reçut assez mal.
Ravi de cette rupture, il tenait à honneur d’en paraître indigné. Il fit des représentations à Hector, lui offrit de fermer la porte à M. Wellesley, lui proposa d’augmenter le chiffre de la dot, et lorsqu’il vit le jeune homme inébranlable, il l’accabla des paroles les plus dures et lui reprocha son manque de foi.
—Votre père n’aurait pas agi ainsi, lui dit-il; mais enfin, puisque vous refusez absolument d’accepter ma fille, car c’est vous qui refusez, je l’espère, et sans motifs, vous allez m’en signer une déclaration.
Hector signa de grand cœur, et prenant congé de M. Blandureau, il courut au café le plus voisin et écrivit à Ferdinand:
«Tout est arrangé. Accours, je t’attends.»
Le soir même, M. Blandureau agréait la demande de M. James Wellesley. Même il profita du changement de gendre pour diminuer la dot de cinq cent mille francs.
Alors seulement le baronnet apprit que son beau-père avait été dans le commerce. Ses préjugés voulurent élever la voix. Il leur imposa silence. Il se consola d’ailleurs par cette réflexion:
—Qui le saura en Angleterre?
Deux jours plus tard, Hector achevait sa toilette lorsque le domestique de l’hôtel lui annonça qu’un monsieur insistait pour lui parler.
—Qu’il entre, dit Hector, sûr que ce devait être Ferdinand, et il s’avança à la rencontre de son ami.
Ce n’était pas Ferdinand, mais bien sir James, plus pâle et plus grave qu’à l’ordinaire. Il tenait à la main une boîte d’acajou qu’il posa sur la table.
—J’ai à vous parler sérieusement, dit-il à Hector, êtes-vous certain que personne ne peut nous entendre?
—Personne, répondit Hector, surpris de ce début.
L’Anglais alla s’assurer que la porte était bien fermée, et revenant vers son ami:
—Monsieur, lui dit-il, je suis un homme tout à fait coupable et tout à fait indigne de votre amitié. Je me méprise moi-même et vous ne sauriez m’accabler de plus de reproches que ne m’en a fait ma conscience. J’avais une fiancée, je l’ai trahie; hier, j’ai dû lui écrire que j’étais un homme sans foi; aujourd’hui je viens vous dire: Ami, je vous ai trahi de la façon la plus misérable, je vous ai enlevé le cœur de celle que vous deviez épouser, j’aime Aurélie, j’en suis aimé. Son père vient de m’accorder sa main.
—Tu es le meilleur et le plus excellent des hommes, s’écria Hector en serrant le gentleman sur son cœur. S’il te faut jamais un ami sûr, viens à moi. Te faut-il toute ma fortune, parle?
M. Wellesley pensa que la raison d’Hector s’égarait, et ses remords en redoublèrent.
—Revenez à vous, lui dit-il, je ne vous ai pas tout dit encore. Je veux vous offrir toutes les satisfactions qu’un homme peut désirer. J’ai là une boîte de pistolets; une seule de ces armes est chargée. Vous allez choisir et...
—Me battre avec vous! s’écria Hector, et pourquoi, grand Dieu! Rassurez-vous; je n’aimais pas mademoiselle Aurélie.
—Que vous l’aimiez ou non, reprit sir James, mon action n’en est ni moins perfide, ni moins odieuse. Mais, je vous le répète, j’ai là des pistolets...
—Vous êtes fou, fit Hector en haussant les épaules. Comment, vous me prenez mademoiselle Aurélie, et vous voulez me tuer par-dessus le marché!
M. Wellesley se fâcha tout rouge sur ces dernières paroles.
—Il est trop tard pour reculer, dit-il; je vous ai fait des excuses telles que désormais je ne pourrais supporter votre vue. Vous refusez la réparation que je venais vous offrir; c’est moi maintenant qui vous demande satisfaction.
Un duel aurait certainement terminé cette singulière querelle, si l’arrivée de Ferdinand n’était venue y mettre un terme.
Il avait reçu la lettre d’Hector et il accourait.
Dès qu’on l’eut mis au courant de l’affaire:
—Laisse-moi, dit-il à Hector, moi qui parle anglais comme un Londonien, je vais arranger l’affaire avec M. Wellesley.
Il s’entendait à arranger les affaires, Ferdinand.
Une fois Hector passé dans une autre pièce, il raconta à sir James l’histoire de son ami et de mademoiselle d’Ambleçay.
La fureur de l’Anglais ne connut plus de bornes.
—Je suis joué! s’écria-t-il; et alors il exigea des réparations d’une voix si impérieuse et si haute, qu’Hector accourut au bruit.
On s’expliqua, et le lendemain Hector gratifiait sir James d’un joli coup d’épée dans le bras, qui retarda son mariage de six semaines.
Ces quelques gouttes de sang retrempèrent l’amitié de ces ennemis d’un jour.
Ferdinand était plus fier cent fois qu’un triomphateur romain, le soir où, après trois semaines d’absence, il fit son entrée à la Fresnaie, suivi de son ami Hector.
On attendait les voyageurs. La maison avait cet air de fête qui trahit au dehors la joie de ceux qui l’habitent. Tenue au courant, par son mari, de tout ce qui se passait à Paris, madame Aubanel avait ménagé à Hector la plus douce des surprises. A force d’éloquence, elle avait décidé madame d’Ambleçay à venir dîner à la Fresnaie avec sa fille. La baronne avait essayé de résister, mais quelles bonnes raisons pouvait-elle donner? Sir James lui avait officiellement notifié la rupture, et elle lui avait répondu pour lui rendre sa parole.
C’est donc Louise que la première Hector aperçut lorsqu’il entra dans le salon, et le regard qu’échangèrent les deux amants fut comme un long poème, qui disait leurs angoisses passées et leur félicité présente.
Hector était bien loin de s’attendre à un tel bonheur; il avait redouté de nouveaux obstacles; aussi fut-il obligé, pour ne pas tomber, de chercher un point d’appui sur le bras de son ami, tandis qu’il s’inclinait respectueusement devant la baronne.
—Si j’ose reparaître devant vous, madame, lui dit-il d’une voix tremblante d’émotion, c’est que j’ai rempli les conditions que vous aviez cru devoir m’imposer.
Et il lui présenta une lettre.
Cette lettre était celle où M. et madame Blandureau avaient l’honneur d’informer leurs amis et connaissances du mariage de mademoiselle Aurélie Blandureau, leur fille, avec sir James Wellesley.
S’il y avait «sir» et non pas «mylord,» ce n’était pas la faute de l’ancien négociant; il avait eu à ce sujet une discussion de plus de deux heures avec le baronnet.
Madame d’Ambleçay parcourut rapidement cette lettre qui ne lui apprenait rien de nouveau, et s’adressant à sa fille:
—Eh bien! ma pauvre enfant, dit-elle d’un ton de fausse tristesse, voici que M. Wellesley t’abandonne pour une autre.
Depuis plus de quinze jours déjà mademoiselle Louise se réjouissait de cette bienheureuse trahison, elle fit cependant tous ses efforts pour paraître surprise: elle essaya même,—voyez la perfidie,—une petite moue chagrine. Mais elle était mal exercée à la dissimulation, et ses yeux brillants de joie donnaient à son air dépité un éclatant démenti.
—Et quand se marie M. Wellesley? demanda la baronne à Hector.
—Le trois du mois de mai prochain, répondit Ferdinand, grâce à ma diplomatie qui a fait hâter le mariage.
—Eh bien! reprit madame d’Ambleçay, je crois que nous pouvons faire nos préparatifs pour cette époque.
Et, prenant la main de sa fille, elle la mit dans la main d’Hector.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. et madame Hector Malestrat sont aujourd’hui fixés en Touraine. Ils habitent le château d’Ambleçay en attendant que soit achevée la jolie maison qu’ils font construire à une lieue de la Fresnaie.
Hector ne retourna jamais à Bordeaux, et si vous ouvrez les Petites Affiches, vous y lirez probablement:
A VENDRE, dans un des plus jolis quartiers de Bordeaux, l’hôtel Malestrat, entièrement remis à neuf et magnifiquement décoré.
Mademoiselle Aurélie, devenue madame Wellesley, règne à Follingham-Castle, le manoir de son mari, dans le Lincolnshire.
Son nom de demoiselle ayant été par hasard prononcé devant quelques-unes des châtelaines du voisinage, elle n’a pas hésité à leur faire entendre que les Blandureau sont alliés aux premières familles de France.
Madame Wellesley, adorée d’un mari qu’elle aime, est d’ailleurs si heureuse, qu’elle ne songe même pas à souhaiter la mort de cet oncle qui doit lui léguer le titre de lady.
Ni Hector, ni sir James, s’ils ont des enfants, ne s’aviseront d’arrêter vingt ans à l’avance leur établissement, ils savent trop ce qu’il en coûte.
—Les promesses de mariage faites par les parents, dit M. Blandureau, sont des lettres de change tirées sur l’avenir, le plus inexact de tous les débiteurs.
Et le hasard est et restera toujours le premier des négociateurs en mariages.
FIN
| I M. J. D. de Saint-Roch, ambassadeur matrimonial I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI |
1 |
| II Promesses de Mariage I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI |
175 |
Paris.—Imprimerie de E. Donnaud, rue Cassette, 9.
End of the Project Gutenberg EBook of Mariages d'aventure, by Émile Gaboriau
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MARIAGES D'AVENTURE ***
***** This file should be named 46253-h.htm or 46253-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/6/2/5/46253/
Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images available at The Internet Archive)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.